17.01.2026 à 13:12
Les États-Unis ont passé des décennies à faire pression pour mettre la main sur le pétrole vénézuélien
Texte intégral (2315 mots)

Hugo Chavez et Nicolas Maduro ont longtemps résisté aux tentatives des États-Unis d’exercer le contrôle des réserves pétrolières du Venezuela. Car ce pays d’Amérique du Sud, ayant joué un rôle clé dans la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), possède plus de 300 milliards de barils de pétrole.
Après que les forces spéciales des États-Unis ont fait irruption à Caracas pour exfiltrer le président vénézuélien Nicolas Maduro et renverser son gouvernement, Donald Trump déclare que les États-Unis vont désormais « diriger le Venezuela » , y compris ses abondantes ressources pétrolières.
Les entreprises états-uniennes sont prêtes à investir des milliards pour moderniser les infrastructures pétrolières vénézuéliennes en ruine, a-t-il dit, et « commencer à faire de l’argent pour le pays ». Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole mondiales – devançant l’Arabie saoudite – avec 303 milliards de barils, soit environ 20 % des réserves mondiales.
Si cela se réalise – et c’est un très grand « si » –, cela marquerait la fin d’une relation conflictuelle qui a commencé il y a près de trente ans.
Oui, l’action militaire de l’administration Trump au Venezuela a été à bien des égards sans précédent. Mais cela n’est pas surprenant, compte tenu de l’immense richesse pétrolière du pays et des relations historiques entre les États-Unis et le Venezuela, sous les mandats de l’ancien président Hugo Chavez et ceux de Nicolas Maduro.
Une longue histoire d’investissement états-unien
Le Venezuela est une république d’environ 30 millions d’habitants située sur la côte nord de l’Amérique du Sud, soit environ deux fois la taille de la Californie. Pendant une grande partie du début du XXᵉ siècle, il était considéré comme le pays le plus riche d’Amérique du Sud en raison de ses réserves pétrolières.
Les entreprises étrangères, y compris les états-uniennes, ont beaucoup investi dans la croissance du pétrole vénézuélien et joué un rôle important dans sa politique. Face à l’opposition de l’Oncle Sam, les dirigeants vénézuéliens ont commencé à exercer un contrôle accru sur leur principale ressource d’exportation. Le Venezuela a joué un rôle clé dans la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) en 1960, et a nationalisé une grande partie de son industrie pétrolière en 1976 (sous la présidence de Carlos Andrés Pérez, ndlr).
Cela a eu un impact négatif sur des entreprises comme ExxonMobil et a alimenté les récentes affirmations de l’administration Trump selon lesquelles le Venezuela aurait « volé » le pétrole américain.
Mais la plupart des Vénézuéliens ne profitent pas de cette prospérité économique. La mauvaise gestion de l’industrie pétrolière conduit à une crise de la dette et à l’intervention du Fonds monétaire international (FMI) en 1988. Des manifestations éclatent à Caracas en février 1989 et le gouvernement (du président Pérez qui vient d’être réélu, ndlr) envoie l’armée pour écraser le soulèvement. On estime que 300 personnes sont tuées, mais le nombre de morts pourrait être dix fois plus élevé.
Par la suite, la société vénézuélienne se divise davantage entre les riches, qui veulent travailler avec les États-Unis, et la classe ouvrière, qui cherche à obtenir l’autonomie vis-à-vis des États-Unis. Cette division définit la politique vénézuélienne depuis lors.
L’ascension de Chavez au pouvoir
Hugo Chavez débute sa carrière comme officier militaire. Au début des années 1980, il fonde le Mouvement révolutionnaire bolivarien-200 au sein de l’armée et donne des conférences passionnées contre le gouvernement.
Puis, après les émeutes de 1989, Chavez planifie le renversement du gouvernement vénézuélien. En février 1992, il organise un coup d’État, raté, contre le président pro-américain Carlos Andrés Pérez. Pendant son emprisonnement, son parti organise une autre tentative de coup d’État qui échoue également. Chavez est condamné à deux ans de prison, mais devient le principal candidat à la présidence en 1998, réunissant les courants socialistes révolutionnaires.
Hugo Chavez devient un géant de la politique vénézuélienne et latino-américaine. Sa révolution évoque la mémoire de Simon Bolívar (1783-1830), le grand libérateur de l’Amérique du Sud face au colonialisme espagnol. Non seulement Chavez est populaire au Venezuela pour son utilisation des revenus pétroliers, subventionnant les programmes gouvernementaux en matière d’alimentation, de santé et d’éducation, mais il est respecté, grâce à sa générosité, par des régimes partageant les mêmes idées dans la région.
Plus particulièrement, Hugo Chavez fournit à Cuba des milliards de dollars de pétrole en échange de dizaines de milliers de médecins cubains travaillant dans des cliniques de santé vénézuéliennes. Il établit un précédent en s’opposant aux États-Unis et au FMI lors des forums mondiaux, appelant le président états-unien de l’époque George W. Bush « le diable » à l’Assemblée générale de l’ONU en 2006.
Les États-Unis accusés d’avoir fomenté un coup d’État
Sans surprise, les États-Unis n’étaient pas fans d’Hugo Chavez.
Après que des centaines de milliers de manifestants de l’opposition descendent dans la rue en avril 2002, Chavez est brièvement renversé lors d’un coup d’État par des officiers militaires dissidents et des figures de l’opposition. Ces derniers installent un nouveau président, l’homme d’affaires Pedro Carmona. Chavez est arrêté, l’administration Bush reconnaît Carmona comme président, et le New York Times célébre la chute d’un « dictateur en devenir ».
Chavez revient au pouvoir seulement deux jours plus tard, grâce à des légions de partisans qui remplissent les rues. L’administration Bush doit se justifier pour son possible rôle dans le coup d’État avorté.
Bien que les États-Unis nient toute implication, les allégations persistent pendant des années sur le fait que Washington ait eu connaissance au préalable du coup d’État et ait tacitement soutenu sa destitution. En 2004, des documents nouvellement classifiés montrent que la CIA était au courant du complot, et il n’est pas clair dans quelle mesure les responsables des États-Unis ont prévenu Chavez.
La pression américaine continue sur Maduro
Nicolas Maduro, syndicaliste, est élu à l’Assemblée nationale en 2000 et rejoint le cercle rapproché de Hugo Chavez. Il accède au poste de vice-président en 2012 et, après la mort de Chavez l’année suivante, remporte sa première élection avec une courte avance.
Maduro n’est pas Chavez. Il ne bénéficie pas du même niveau de soutien parmi la classe ouvrière, l’armée ou dans son pays. La situation économique du Venezuela se détériore et l’inflation explose.

Les administrations états-uniennes successives continuent d’exercer des pressions sur Nicolas Maduro. Le Venezuela subit des sanctions à la fois sous la présidence de Barack Obama et lors de la première présidence Trump. Les États-Unis et leurs alliés refusent de reconnaître la victoire de Maduro lors des élections de 2018 et de nouveau en 2024.
Isolé d’une grande partie du monde, le gouvernement de Nicolas Maduro devient dépendant de la vente de pétrole à la Chine.
Maduro affirme avoir déjoué plusieurs tentatives de coups d’État et d’assassinats impliquant les États-Unis et l’opposition intérieure, notamment en avril 2019 et en mai 2020 durant le premier mandat de Trump.
Les responsables états-uniens nient toute implication dans tous les complots potentiels ; les rapports n’ont également trouvé aucune preuve de l’implication américaine dans le coup d’État raté de 2020.
Aujourd’hui, Donald Trump a réussi à évincer Nicolas Maduro dans une opération bien plus audacieuse, sans aucune tentative de déni. Il reste à voir comment les Vénézuéliens et les autres nations latino-américaines réagiront aux actions états-uniennes, mais une chose est certaine : l’implication américaine dans la politique vénézuélienne continuera tant qu’elle aura des intérêts financiers dans le pays.
James Trapani ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
16.01.2026 à 14:58
Avant le pétrole vénézuelien, il y a eu les bananes du Guatemala…
Texte intégral (2645 mots)
Dans les années 1950 déjà, les États-Unis intervenaient contre un gouvernement démocratiquement élu au nom d’une menace idéologique, tout en protégeant des intérêts économiques majeurs. Mais si les ressorts se ressemblent, les méthodes et le degré de transparence ont profondément changé.
Dans la foulée de la frappe militaire américaine qui a conduit à l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro le 3 janvier 2026, l’administration Trump a surtout affiché son ambition d’obtenir un accès sans entrave au pétrole du Venezuela, reléguant au second plan des objectifs plus classiques de politique étrangère comme la lutte contre le trafic de drogue ou le soutien à la démocratie et à la stabilité régionale.
Lors de sa première conférence de presse après l’opération, le président Donald Trump a ainsi affirmé que les compagnies pétrolières avaint un rôle important à jouer et que les revenus du pétrole contribueraient à financer toute nouvelle intervention au Venezuela.
Peu après, les animateurs de « Fox & Friends » ont interpelé Trump sur ces prévisions :
« Nous avons les plus grandes compagnies pétrolières du monde », a répondu Trump, « les plus importantes, les meilleures, et nous allons y être très fortement impliqués ».
En tant qu’historien des relations entre les États-Unis et l’Amérique latine, je ne suis pas surpris de voir le pétrole, ou toute autre ressource, jouer un rôle dans la politique américaine à l’égard de la région. Ce qui m’a en revanche frappé, c’est la franchise avec laquelle l’administration Trump reconnaît le rôle déterminant du pétrole dans sa politique envers le Venezuela.
Comme je l’ai détaillé dans mon livre paru en 2026, Caribbean Blood Pacts: Guatemala and the Cold War Struggle for Freedom (NDT : livre non traduit en français), les interventions militaires américaines en Amérique latine ont, pour l’essentiel, été menées de manière clandestine. Et lorsque les États-Unis ont orchestré le coup d’État qui a renversé le président démocratiquement élu du Guatemala en 1954, ils ont dissimulé le rôle qu’avaient joué les considérations économiques dans cette opération.
Un « poulpe » puissant
Au début des années 1950, le Guatemala était devenu l’une des principaux fournisseurs de bananes pour les Américains, comme c’est d'ailleurs toujours le cas aujourd’hui.
La United Fruit Company possédait alors plus de 220 000 hectares de terres guatémaltèques, en grande partie grâce aux accords conclus avec les dictatures précédentes. Ces propriétés reposaient sur le travail intensif d’ouvriers agricoles pauvres, souvent chassés de leurs terres traditionnelles. Leur rémunération était rarement stable, et ils subissaient régulièrement des licenciements et des baisses de salaire.
Basée à Boston, cette multinationale a tissé des liens avec des dictateurs et des responsables locaux en Amérique centrale, dans de nombreuses îles des Caraïbes et dans certaines régions d’Amérique du Sud afin d’acquérir d’immenses domaines destinés aux chemins de fer et aux plantations de bananes.
Les populations locales la surnommaient le « pulpo » – « poulpe » en espagnol – car l’entreprise semblait intervenir dans la structuration de la vie politique, de l'économie et de la vie quotidienne de la région. En Colombie, le gouvernement a par exemple brutalement réprimé une grève des travailleurs de la United Fruit en 1928, faisant des centaines de morts. Cet épisode sanglant de l’histoire colombienne a d'ailleurs servi de base factuelle à une intrigue secondaire de « Cent ans de solitude », le roman épique de Gabriel García Márquez, lauréat du prix Nobel de littérature en 1982.
L’influence apparemment sans limites de l’entreprise dans les pays où elle opérait a nourri le stéréotype des nations d’Amérique centrale comme des « républiques bananières ».
La révolution démocratique guatémaltèque
Au Guatemala, pays historiquement marqué par des inégalités extrêmes, une vaste coalition s’est formée en 1944 pour renverser la dictature répressive lors d’un soulèvement populaire. Inspirée par les idéaux antifascistes de la Seconde Guerre mondiale, cette coalition ambitionnait de démocratiser le pays et de rendre son économie plus équitable.
Après des décennies de répression, les nouveaux dirigeants ont offert à de nombreux Guatémaltèques leur premier contact avec la démocratie. Sous la présidence de Juan José Arévalo, élu démocratiquement et en fonction de 1945 à 1951, le gouvernement a mis en place de nouvelles protections sociales ainsi qu’un code du travail légalisant la création et l’adhésion à des syndicats, et instaurant la journée de travail de huit heures.
En 1951, lui a succédé Jacobo Árbenz, lui aussi président démocratiquement élu.
Sous Árbenz, le Guatemala a mis en œuvre en 1952 un vaste programme de réforme agraire, attribuant des parcelles non exploitées aux ouvriers agricoles sans terre. Le gouvernement guatémaltèque affirmait que ces politiques permettraient de bâtir une société plus équitable pour la majorité indigène et pauvre du pays.
United Fruit a dénoncé ces réformes comme le produit d’une conspiration mondiale. L’entreprise affirmait que la majorité des syndicats du pays étaient contrôlés par des communistes mexicains et soviétiques, et présentait la réforme agraire comme une manœuvre visant à détruire le capitalisme.
Pression sur le Congrès pour une intervention
Au Guatemala, United Fruit a cherché à rallier le gouvernement américain à son combat contre les politiques menées par Árbenz. Si ses dirigeants se plaignaient bien du fait que les réformes guatémaltèques nuisaient à ses investissements financiers et alourdissaient ses coûts de main-d’œuvre, ils présentaient aussi toute entrave à leurs activités comme faisant partie d’un vaste complot communiste.
L’entreprise a mené l'offensive à travers une campagne publicitaire aux États-Unis et en exploitant la paranoïa anticommuniste dominante de l’époque.
Dès 1945, les dirigeants de la United Fruit Company ont commencé à rencontrer des responsables de l’administration Truman. Malgré le soutien d’ambassadeurs favorables à leur cause, le gouvernement américain ne semblait pas disposé à intervenir directement dans les affaires guatémaltèques. L’entreprise s’est alors tournée vers le Congrès, recrutant les lobbyistes Thomas Corcoran et Robert La Follette Jr., ancien sénateur, pour leurs réseaux politiques.
Dès le départ, Corcoran et La Follette ont fait pression auprès des républicains comme des démocrates, dans les deux chambres du Congrès, contre les politiques guatémaltèques – non pas en les présentant comme une menace pour les intérêts commerciaux de United Fruit, mais comme les éléments d’un complot communiste visant à détruire le capitalisme et les États-Unis.
Les efforts de la compagnie bananière ont porté leurs fruits en février 1949, lorsque plusieurs membres du Congrès ont dénoncé les réformes du droit du travail au Guatemala comme étant d’inspiration communiste. Le sénateur Claude Pepper a qualifié le code du travail de texte « manifestement et intentionnellement discriminatoire à l’égard de cette entreprise américaine » et d’« une mitrailleuse pointée sur la tête » de la United Fruit Company.
Deux jours plus tard, le membre de la Chambre des représentants John McCormack a repris mot pour mot cette déclaration, utilisant exactement les mêmes termes pour dénoncer les réformes. Les sénateurs Henry Cabot Lodge Jr., Lister Hill et le représentant Mike Mansfield ont eux aussi pris position publiquement, en reprenant les éléments de langage figurant dans les notes internes de la United Fruit.
Aucun élu n’a prononcé un mot sur les bananes.
Lobbying et campagnes de propagande
Ce travail de lobbying, nourri par la rhétorique anticommuniste, a culminé cinq ans plus tard, lorsque le gouvernement américain a orchestré un coup d’État qui a renversé Árbenz lors d’une opération clandestine.
L’opération a débuté en 1953, lorsque l’administration Eisenhower a autorisé la CIA à lancer une campagne de guerre psychologique destinée à manipuler l’armée guatémaltèque afin de renverser le gouvernement démocratiquement élu. Des agents de la CIA ont alors soudoyé des membres de l’armée guatémaltèque tandis que des émissions de radio anticommunistes étaient diffusées et un discours, porté par les religieux et dénonçant un prétendu projet communiste visant à détruire l’Église catholique du pays, se propageait dans tout le Guatemala.
Parallèlement, les États-Unis ont armé des organisations antigouvernementales à l’intérieur du Guatemala et dans les pays voisins afin de saper davantage encore le moral du gouvernement Árbenz. La United Fruit a également fait appel au pionnier des relations publiques Edward Bernays pour diffuser sa propagande, non pas au Guatemala mais aux États-Unis. Bernays fournissait aux journalistes américains des rapports et des textes présentant le pays d’Amérique centrale comme une marionnette de l’Union soviétique.
Ces documents, dont un film intitulé « Why the Kremlin Hates Bananas », ont circulé grâce à des médias complaisants et à des membres du Congrès complices.
Détruire la révolution
En définitive – et les archives le démontrent –, l’action de la CIA a conduit des officiers de l’armée à renverser les dirigeants élus et à installer un régime plus favorable aux États-Unis, dirigé par Carlos Castillo Armas. Des Guatémaltèques opposés aux réformes ont massacré des responsables syndicaux, des responsables politiques et d’autres soutiens d’Árbenz et Arévalo. Selon des rapports officiels, au moins quarante-huit personnes sont mortes dans l’immédiat après-coup, tandis que des récits locaux font état de centaines de morts supplémentaires.
Pendant des décennies, le Guatemala s'est retrouvé aux mains de régimes militaires. De dictateur en dictateur, le pouvoir a réprimé brutalement toute opposition et instauré un climat de peur. Ces conditions ont contribué à des vagues d’émigration, comprenant d’innombrables réfugiés, mais aussi certains membres de gangs transnationaux.
Le retour de bâton
Afin d’étayer l’idée selon laquelle ce qui s’était produit au Guatemala n’avait rien à voir avec les bananes — conformément au discours de propagande de l’entreprise — l’administration Eisenhower a autorisé une procédure antitrust contre United Fruit, procédure qui avait été temporairement suspendue pendant l’opération afin de ne pas attirer davantage l’attention sur la société.
Ce fut le premier revers d’une longue série qui allait conduire au démantèlement de la United Fruit Company au milieu des années 1980. Après une succession de fusions, d’acquisitions et de scissions, ne demeure finalement que l’omniprésent logo de Miss Chiquita, apposé sur les bananes vendues par l’entreprise.
Et, selon de nombreux spécialistes des relations internationales, le Guatemala ne s’est jamais remis de la destruction de son expérience démocratique, brisée sous la pression des intérêts privés.
Les recherches d’Aaron Coy Moulton ont bénéficié de financements du Truman Library Institute, de Phi Alpha Theta, de la Society for Historians of American Foreign Relations, du Roosevelt Institute, de l’Eisenhower Foundation, de la Massachusetts Historical Society, de la Bentley Historical Library, de l’American Philosophical Society, du Dirksen Congressional Center, de la Hoover Presidential Foundation et du Frances S. Summersell Center for the Study of the South.
15.01.2026 à 15:58
Comment les États-Unis pourraient-ils contribuer à achever le régime des mollahs ?
Texte intégral (2136 mots)
Des frappes états-uniennes sur des cibles en Iran semblent possibles à ce stade, mais, en tout état de cause, une simple série de bombardements ne suffira pas à faire chuter le régime. L’option la plus efficace consisterait, pour Washington, à approvisionner en armes des groupes locaux, à commencer par ceux des Kurdes, et à les appuyer par une campagne aérienne. C’est ainsi que, il y a près de vingt-cinq ans, en Afghanistan, les Américains avaient soutenu leurs alliés locaux, qui avaient chassé les talibans et pris Kaboul. Il reste que plusieurs puissances régionales ne verraient pas d’un très bon œil une issue qui aboutirait à un net renforcement des Kurdes…
Alors que le régime des mollahs s’engage dans un massacre à huis clos de son propre peuple afin d’étouffer la révolution commencée dans le bazar de Téhéran le 28 décembre 2025, tous les observateurs guettent l’annonce d’une campagne de bombardements américains. La réussite spectaculaire de l’enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela le 3 janvier et les déclarations récentes de Donald Trump – le régime iranien sera « frappé très durement, là où ça fait mal » – semblent en effet plaider en ce sens. Trump pourrait profiter de l’extrême fragilité de la République islamique d’Iran pour lui porter le coup de grâce à en frappant les lieux de pouvoir, décapitant ainsi le régime.
Toutefois, cette perspective abondamment relayée dans la presse présente plusieurs écueils évidents : même si une campagne de bombardement pourrait « décapiter » le régime, on voit mal comment des frappes aériennes pourraient permettre au peuple désarmé de tenir tête aux milliers de pasdaran, la milice des Gardiens de la révolution, bras armé du régime, et des bassidji, forces paramilitaires estimées à 600 000 ou 700 000 combattants, qui massacrent aujourd’hui les manifestants pour écraser la révolution.
Seule une campagne de frappes très longue et massive, mobilisant sur la durée plusieurs centaines d’appareils, pourrait vraiment fragiliser ces milices au point de permettre aux civils, désarmés pour la majorité, de renverser un régime qui s’apparente de plus en plus à une dictature militaire. Or, les déclarations de Trump suggèrent pour l’instant une opération courte et spectaculaire et rien n’indique que les États-Unis veuillent s’impliquer dans une campagne de longue durée comme celles menées contre la Serbie lors de la guerre du Kosovo en 1999 ou contre les armées de Saddam Hussein au Koweït lors de la phase initiale de l’opération Tempête du désert en 1991. Un autre indice semble aller en ce sens : pour l’heure, la Maison Blanche n’a déployé aucun porte-avions au large du Golfe persique, ce qui réduit la masse d’appareils disponibles et semble confirmer l’hypothèse d’une offensive aérienne éclair sur le modèle de la guerre des douze jours de l’été dernier.
Dans ce contexte, on pourrait se demander si le type d’opération apparemment choisi par la Maison-Blanche est réellement de nature à renverser le régime. Quelles sont les autres options dont dispose Washington pour parvenir à cette fin ?
Armer les minorités en lutte contre le régime
Les rares vidéos qui nous parviennent de la répression menée par les pasdaran et leurs auxiliaires bassidji montrent à quel point le peuple iranien manque d’armes pour se défendre et pour renverser le régime aux abois.
Équiper matériellement la résistance iranienne semble donc davantage répondre aux demandes immédiates des manifestants qu’une campagne de bombardements qui détruirait certes les centres du pouvoir mais pas l’appareil sécuritaire et répressif qui maille tout le territoire iranien. Dans cette optique, les Américains pourraient décider d’équiper des groupes armés déjà existants et opérationnels en Iran parmi les minorités iraniennes : les Baloutches, les Azéris et les Kurdes sont en lutte pour l’autonomie contre Téhéran depuis des décennies et disposent de milices comme le PJAK kurde ou Jaish al-Adl baloutche qui, si elles étaient correctement équipées, pourraient tenir tête aux pasdaran.
Les Kurdes seraient, dans l’optique américaine, la minorité la plus intéressante, puisque les Kurdes iraniens pourraient s’appuyer sur les bases arrière que leur fournit le Kurdistan irakien – et ce, d’autant plus facilement que les Américains sont très présents dans cette région frontalière.
La base américaine d’Erbil pourrait servir de hub logistique pour équiper la résistance kurde iranienne depuis les provinces kurdes de l’Irak.

Washington a récemment renforcé cette base pour lutter contre l’État islamique et y a déployé des unités d’élite, particulièrement la Delta Force et la 101e division aéroportée. Cette dernière unité possède une importante flotte d’hélicoptères CH-47 Chinook et UH-60 Blackhawk qui pourraient acheminer les armes depuis le carrefour d’Erbil jusqu’au Kurdistan iranien.
Sachant que les Kurdes ont joué un rôle très actif dans tous les mouvements de révolte contre le pouvoir des mollahs et notamment dans le mouvement « Femme, Vie, Liberté » en 2022, et que les Kurdes irakiens ont, ces derniers jours, largement fait part de leur soutien à leurs compatriotes iraniens, ce pari d’armer la minorité kurde pourrait s’avérer gagnant pour Washington.
Une guerre sur le modèle afghan ?
Dès lors, les Américains pourraient mener une guerre par proxy sur le sol de la République islamique, sans envoyer d’importants contingents au sol, conformément aux promesses électorales faites par Trump à sa base MAGA.
Les États-Unis pourraient effectuer une campagne de bombardements en soutien à leurs alliés locaux comme ils l’avaient fait contre le régime des talibans en Afghanistan après les attentats du 11 Septembre. Pendant les mois d’octobre et de novembre 2001, les Américains avaient soutenu la minorité tadjique, organisée autour de la milice rebelle l’Alliance du Nord, formée en 1992 par le commandant Massoud, par une campagne de bombardements ciblés et par l’envoi de forces spéciales capables de coordonner les bombardements et de coordonner les rebelles sur le terrain.
Il semble probable que les succès américains obtenus lors de cette première phase de la guerre d’Afghanistan constituent un modèle pour Trump : rappelons que Kaboul a été prise le 13 novembre 2001 par l’Alliance du Nord sans que les Américains ne déploient des contingents massifs au sol.
C’est bien l’occupation de l’Afghanistan dans un deuxième temps qui mobilisera beaucoup de troupes américaines, entraînera d’importantes pertes parmi ces militaires et se soldera par un échec cuisant. Fort de ce double enseignement, Trump pourrait soutenir les rebelles via des bombardements et l’envoi de forces spéciales, sans chercher à occuper l’Iran.
Une politique risquée… mais inévitable ?
Il reste que la mise en œuvre d’une telle stratégie expose à plusieurs risques de déstabilisation régionale, ce qui pourrait dissuader Washington d’armer massivement les minorités iraniennes.
Trump pourrait se montrer réceptif aux craintes des puissances régionales comme la Turquie ou la Syrie, qui ne veulent surtout pas voir une contagion sécessionniste se diffuser au Moyen-Orient. Il est probable d’Ankara ou Damas considéreraient le développement d’une guérilla kurde iranienne comme un danger nourrissant les velléités de leurs propres communautés kurdes.
De plus, les régimes autoritaires du Golfe comme l’Arabie saoudite ou le Qatar pourraient percevoir le succès de la révolution iranienne comme une menace pour le maintien de leurs propres systèmes, sachant notamment que l’Arabie est confrontée au mécontentement de la minorité chiite à l’est du pays, spécialement depuis le Printemps arabe et la révolte de Qatif en 2011.
Ces facteurs expliquent sans doute les hésitations de Trump ces jours derniers et le temps que prend Washington pour lancer ses frappes contre l’Iran. Cela dit, l’ampleur de la répression perpétrée par le régime de Téhéran est telle qu’un point de non-retour a sans doute été franchi et que la perspective d’une guerre civile entre les milices du régime et les franges les plus déterminées et les mieux équipés des révolutionnaires iraniens soit devenue presque inévitable. Fort ce constat, Washington pourrait accepter les risques qu’implique l’envoi d’armes en Iran et consentir à une opération armée plus longue que prévu, mais dont la perspective de gain reste énorme pour le président américain, lequel pourrait ainsi se prévaloir d’avoir apporté un appui décisif à une révolte populaire contre un ennemi déterminé des États-Unis et, aussi, de leur allié le plus proche dans la région, à savoir Israël.
Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.01.2026 à 17:12
Iran : l’adhésion prudente des minorités ethniques au mouvement de protestation
Texte intégral (3326 mots)

Près de la moitié des Iraniens ne sont pas des Perses. Si les habitants des régions périphériques — Kurdistan, Baloutchistan, Azerbaïdjan… — soutiennent le mouvement de contestation, ils redoutent également un éventuel retour de la monarchie Pahlavi, qui ne leur a pas laissé que de bons souvenirs…
Lorsque les manifestations actuelles en Iran ont commencé au Grand Bazar de Téhéran le 28 décembre 2025, le gouvernement les a d’abord considérées comme gérables et temporaires.
Les marchands des bazars ont toujours fait partie des groupes sociaux les plus conservateurs du pays, profondément ancrés dans la structure économique de l’État et étroitement liés au pouvoir politique. Le gouvernement estimait donc que leurs protestations n’étaient pas de nature révolutionnaire et qu’il ne s’agissait que d’une campagne de pression de courte durée visant à stabiliser une monnaie, le rial, en chute libre et à freiner l’inflation — deux phénomènes menaçant directement les moyens de subsistance des commerçants.
Lors de sa première réaction publique au mouvement du bazar, le guide suprême iranien Ali Khamenei a ouvertement admis que les commerçants avaient des raisons d’être mécontents. C’était la première fois qu’il reconnaissait la légitimité d’une manifestation contestataire. Rappelant l’alliance historique entre l’État et le bazar, il a indiqué que le gouvernement considérait que les troubles étaient maîtrisables.
Les autorités n’avaient pas prévu ce qui allait se passer ensuite : les manifestations se sont étendues à plus de 25 provinces et constituent désormais un risque direct pour la survie du régime, lequel a réagi par une répression violente au cours de laquelle plus de 6 000 personnes auraient déjà été tuées.
Spécialiste des groupes ethniques iraniens, j’ai observé la façon dont ces groupes minoritaires, malgré leurs doutes quant à l’issue du mouvement et quant aux projets de certaines figures centrales de l’opposition, se sont joints à la contestation.
Les minorités ethniques se joignent à la manifestation
L’Iran est un pays d’environ 93 millions d’habitants dont l’État moderne s’est construit autour d’une identité nationale centralisée, ce qui masque une importante diversité ethnique. La majorité perse représente 51 % de la population ; 24 % des habitants du pays s’identifient comme Azéris ; le nombre de Kurdes est estimé à entre 7 et 15 millions de personnes, soit environ 8 à 17 % de la population totale. Enfin, les minorités arabe et baloutche constituent respectivement 3 % et 2 % des Iraniens.

Depuis le lancement du projet de construction nationale par la monarchie Pahlavi en 1925, les gouvernements successifs, qu’ils aient relevé de la monarchie ou de la République islamique qui l’a renversée en 1979, ont toujours considéré la diversité ethnique comme un défi sécuritaire et ont réprimé à plusieurs reprises des revendications en faveur de l’inclusion politique, des droits linguistiques et de la gouvernance locale.
Dans les manifestations actuelles, les régions où les minorités sont présentes en nombre se sont au départ moins mobilisées que lors de la dernière vague importante de manifestations : celle de 2022-2023, conduite sous le slogan « Femme, vie, liberté », déclenchée par la mort d’une Kurde iranienne nommée Jina Mahsa Amini.
Les Kurdes ont commencé à se joindre aux manifestations actuelles le 3 janvier, dans la petite ville de Malekshahi (province d’Ilam). S’est ensuivie une violente descente des forces de sécurité contre des manifestants blessés à l’intérieur de l’hôpital d’Ilam, qui a provoqué l’indignation au-delà de la communauté locale et attiré l’attention internationale.
Depuis, les manifestations se sont poursuivies à Ilam. Dans la province voisine de Kermanshah, en particulier dans la région pauvre de Daradrezh, elles ont éclaté en raison de la précarité économique et de la discrimination politique dont les Kurdes sont victimes.
Une approche stratégique de la protestation
Les communautés d’Ilam et de Kermanshah continuent de subir une exclusion fondée sur leur identité kurde. Et ce, malgré le fait qu’elles partagent leur foi chiite avec le pouvoir en place à Téhéran — un facteur qui leur a historiquement permis d’avoir un meilleur accès au gouvernement que la population kurde sunnite.
À la suite du meurtre de plusieurs manifestants à Ilam et Kermanshah, les partis politiques kurdes ont publié une déclaration commune appelant à une grève dans toute la région.
Il convient de souligner que les dirigeants kurdes n’ont pas appelé à manifester, mais uniquement à faire grève. Lors du soulèvement « Femme, vie, liberté », le gouvernement avait traité les villes kurdes comme des zones rebelles, qualifiant les manifestations de « menace pour l’intégrité territoriale de l’Iran » et utilisant cette justification pour procéder à des massacres et à des exécutions massives.
En optant cette fois-ci pour des grèves, les dirigeants kurdes ont cherché à manifester leur solidarité avec le mouvement qui touche l’ensemble du pays tout en réduisant le risque de subir un nouveau massacre.

L’appel a été suivi : presque toutes les villes kurdes se sont retrouvées à l’arrêt.
Le Baloutchistan, dans le sud-est de l’Iran, a rapidement suivi le Kurdistan. Après les prières du vendredi 9 janvier, des manifestations ont éclaté, également motivées par la marginalisation ethnique et religieuse que la région subit depuis longtemps.
L’Azerbaïdjan iranien, une région située dans le nord-ouest du pays, s’est joint à la contestation plus tard et plus prudemment. Cette manifestation tardive et modeste reflète la position favorable dont jouissent actuellement les Azéris au sein des institutions politiques, militaires et économiques iraniennes. Historiquement, du XVIe siècle à 1925, les Turcs azéris chiites ont dominé l’État iranien, l’azéri étant la langue de la cour.
La période de la monarchie Pahlavi a marqué une rupture : la langue azérie a été interdite et l’autonomie locale réduite. Mais depuis 1979, la République islamique a partiellement restauré l’influence azérie, autorisant les religieux à s’adresser à leurs fidèles dans leur langue maternelle et intégrant des personnes d’origine azerbaïdjanaise dans le gouvernement central à Téhéran. L’actuel guide suprême, Ali Khamenei, est d’ailleurs d’origine azérie.
Une longue histoire de répressions
Des mouvements politiques de nature ethnique ont vu le jour dans tout l’Iran immédiatement après la révolution de 1979, que de nombreux groupes minoritaires avaient soutenue dans l’espoir d’obtenir une plus grande inclusion et des droits plus étendus.
Mais ces mouvements ont été rapidement réprimés : la République islamique a écrasé les soulèvements dans l’Azerbaïdjan iranien, le Baloutchistan, le Khouzestan et d’autres régions périphériques.
Le Kurdistan a été l’exception : la résistance, les affrontements militaires et les violences étatiques, y compris les massacres, s’y sont poursuivis pendant plusieurs années.
Cette répression et l’impact de la guerre Iran-Irak, durant laquelle la mobilisation nationale a éclipsé les griefs internes, ont étouffé les revendications des minorités ethniques tout au long des années 1980. Celles-ci ont refait surface dans les années 1990, notamment sous l’impulsion d’un renouveau culturel et de la formation d’identités transfrontalières après l’effondrement de l’Union soviétique. Au Kurdistan iranien, la lutte armée a largement évolué en une lutte civile, tandis que de l’autre côté de la frontière, au Kurdistan irakien, les forces peshmergas ont conservé leurs armes et leur entraînement militaire. Le gouvernement iranien a considéré ce réveil comme une menace stratégique et a réagi en décentralisant les autorités sécuritaires et militaires afin de pouvoir réprimer rapidement les manifestations sans attendre l’approbation de Téhéran.
Les revendications divergentes des manifestants
Ces précédents expliquent pourquoi les manifestations actuelles en Iran ont été, du moins au début, plus centralisées que les soulèvements précédents. Les régions où vivent des minorités ethniques ne sont pas indifférentes au changement, mais leurs habitants sont sceptiques quant à l’issue du mouvement.
De nombreux manifestants des villes à majorité persane réclament des libertés sociales, une reprise économique et une normalisation des relations avec l’Occident, en particulier avec les États-Unis. Mais les communautés ethniques expriment des revendications supplémentaires : décentralisation du pouvoir, reconnaissance des droits linguistiques et culturels, et véritable partage du pouvoir au sein de l’État.
Depuis plus de quatre décennies, les revendications des minorités ethniques sont qualifiées par la République islamique de séparatistes ou de « terroristes » et ont donné lieu à de nombreuses arrestations et exécutions. Cette rhétorique a également influencé les principaux groupes d’opposition dominés par les Perses — couvrant tout le spectre idéologique, de la gauche à la droite, et opérant principalement en exil — qui perçoivent les exigences des minorités ethniques comme une menace pour l’intégrité territoriale de l’Iran.
La crainte d’un retour du chah
Reza Pahlavi, le fils exilé du dernier chah d’Iran, se positionne comme le leader de l’opposition et une figure de transition. Ce qui ne va pas sans inquiéter les communautés ethniques.
Le bureau de Pahlavi a publié une feuille de route pour un gouvernement de transition qui contraste fortement avec ses déclarations publiques selon lesquelles il ne cherche pas à monopoliser le pouvoir. Ce document présente Pahlavi comme un leader doté d’une autorité extraordinaire. Dans la pratique, la concentration du pouvoir qu’il propose sous sa direction ressemble fortement à l’autorité actuellement exercée par le guide suprême iranien.

Pour les groupes ethniques minoritaires, cette perspective est particulièrement préoccupante. La feuille de route qualifie leurs revendications de menaces pour la sécurité nationale, reprenant ainsi les discours étatiques traditionnels plutôt que de s’en éloigner. Cette position explicite a renforcé le scepticisme dans les régions périphériques à l’égard du système qui pourrait venir remplacer la République islamique si celle-ci venait à chuter.
Contrairement à l’ayatollah Khomeini en 1979, dont la vision révolutionnaire était délibérément vague quant au statut futur des groupes ethniques, le projet actuel des dirigeants de l’opposition dépeint un ordre politique centralisé qui exclut l’inclusion ethnique et le partage du pouvoir.
Pour les communautés dont les langues ont été interdites et dont les régions ont été systématiquement sous-développées pendant la monarchie, la résurgence des slogans monarchistes dans les villes centrales renforce la crainte qu’un changement de pouvoir aboutisse à une nouvelle marginalisation des régions périphériques du pays.
Le mouvement de contestation peut-il ignorer les sentiments des régions provinciales ?
Les manifestations actuelles révèlent donc plus qu’une simple résistance à un régime autoritaire. Elles mettent en évidence une division fondamentale sur la signification du changement politique et sur ceux à qui il profitera.
Dans un pays aussi divers sur le plan ethnique que l’Iran, où des millions de personnes appartiennent à des communautés ethniques non persanes, un ordre politique durable ne peut être fondé sur un pouvoir centralisé dominé par une seule identité ethnique.
Toute transition future, qu’elle passe par une réforme du système actuel ou par un changement de régime, aura plus de chances de réussir si elle s’inscrit dans un cadre politique qui reconnaît et intègre les revendications de toutes les régions et communautés. Sans cette inclusion, la confiance dans le processus de changement restera difficile à gagner et les espoirs d’un avenir meilleur s’amenuiseront.
Shukriya Bradost est affiliée au Middle East Institute.
14.01.2026 à 12:25
De l’histoire à la mémoire : 160 ans de commémoration de la fin de l’esclavage aux États-Unis
Texte intégral (2437 mots)

De la guerre de Sécession au « 1619 Project », la fin légale de l’esclavage aux États-Unis s’inscrit dans une histoire longue de luttes, de résistances et de controverses. Commémorer l’abolition, c’est interroger les fondements mêmes de la démocratie américaine et ses promesses inachevées.
L’abolition officielle de l’esclavage aux États-Unis est consacrée le 18 décembre 1865, date de la ratification du treizième amendement de la Constitution américaine. Cet amendement interdit formellement l’esclavage et la servitude involontaire, et marque une rupture juridique majeure dans l’histoire politique et sociale des États-Unis. Cette date constitue aujourd’hui la référence historique et symbolique de la fin légale de l’esclavage sur l’ensemble du territoire national.
Le contexte de cette abolition est indissociable de la guerre de Sécession (1861–1865), conflit né des profondes divergences économiques, politiques et morales entre les États du Nord et ceux du Sud. Tandis que le Nord se dirigeait progressivement vers l’abolition, le Sud fondait sa prospérité sur un système esclavagiste profondément enraciné. En 1863, le président Abraham Lincoln promulgua l’Emancipation Proclamation, qui déclara libres les esclaves des États confédérés en rébellion. Toutefois, cette proclamation avait une portée limitée et ne constituait pas une abolition universelle. Seule une réforme constitutionnelle pouvait garantir une suppression définitive et juridiquement incontestable de l’esclavage.
Le treizième amendement fut adopté par le Congrès en janvier 1865, puis ratifié par le nombre requis d’États en décembre de la même année. Abraham Lincoln, bien qu’assassiné en avril 1865, demeure la figure centrale de ce processus abolitionniste, en raison de son engagement politique et moral en faveur de l’amendement. La ratification marque l’aboutissement institutionnel d’un long combat mené par les abolitionnistes, les anciens esclaves et les défenseurs des droits humains.
Les contradictions originelles du projet américain
La commémoration de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis ne peut être comprise sans un retour approfondi sur les luttes politiques, sociales et intellectuelles qui ont conduit à la disparition formelle de cette institution, ni sans une analyse des contradictions qui traversent dès l’origine le projet national américain.
L’esclavage constitue en effet l’un des paradoxes majeurs de la construction des États-Unis : alors même que la jeune nation se fonde sur un discours universaliste de liberté, d’égalité et de souveraineté populaire, elle maintient et institutionnalise un système reposant sur la négation radicale de ces principes pour une partie de la population.
Dès la période coloniale, des résistances à l’esclavage émergent, portées à la fois par les personnes réduites en esclavage elles-mêmes – à travers des révoltes, des fuites ou des formes quotidiennes de résistance – et par des mouvements abolitionnistes structurés à partir de la fin du XVIIIᵉ siècle.
La révolte de Stono, survenue en Caroline du Sud en 1739, est l’une des plus importantes insurrections d’esclaves de l’Amérique coloniale. Les insurgés se soulèvent contre leurs maîtres et tentent de rejoindre la Floride espagnole, où la liberté est promise aux esclaves fugitifs. La répression est extrêmement violente, mais l’événement révèle l’ampleur de la résistance organisée des personnes réduites en esclavage.
Parallèlement, les Quakers jouent un rôle pionnier dans la lutte contre l’esclavage en Amérique du Nord dès le XVIIIᵉ siècle. Ils sont parmi les premiers à condamner l’esclavage pour des raisons morales et religieuses, affirmant l’égalité spirituelle de tous les êtres humains. Leur engagement conduit à la création des premières sociétés abolitionnistes et influence durablement le mouvement antiesclavagiste américain.
Au XIXᵉ siècle, ces luttes se renforcent avec la diffusion d’écrits abolitionnistes, de récits d’anciens esclaves et par l’action de réseaux militants, tels que l’Underground Railroad. Toutefois, ces combats se heurtent à des intérêts économiques considérables, en particulier dans les États du Sud, où l’esclavage constitue le pilier du système de production agricole.
La rédaction de la Constitution de 1787 illustre de manière exemplaire cette tension. Bien que le texte ne mentionne jamais explicitement le mot « esclavage », plusieurs dispositions en assurent la protection et la pérennité. Le compromis des trois cinquièmes, la clause relative aux esclaves fugitifs (établissant que les personnes qui échappaient à l’esclavage dans le Sud n’étaient pas réellement libres) ou encore la garantie du maintien de la traite jusqu’en 1808 traduisent un choix politique clair : préserver l’unité des États au prix d’un renoncement moral.
La clause des trois cinquièmes, inscrite dans la Constitution de 1787, est directement liée à la question de l’esclavage aux États-Unis et révèle les profondes contradictions sur lesquelles la nation s’est construite. Lors de la convention de Philadelphie (1787), les États du Sud, fortement esclavagistes, souhaitaient que les esclaves soient comptés comme des citoyens à part entière pour augmenter leur représentation politique au Congrès, tandis que les États du Nord s’y opposaient puisqu’ils refusaient d’accorder des droits politiques à des personnes privées de liberté. Le compromis trouvé fut la clause des trois cinquièmes, selon laquelle chaque esclave serait compté comme trois cinquièmes d’une personne pour le calcul de la population. Cette décision renforça le pouvoir politique des États du Sud tout en maintenant les esclaves dans une situation de déshumanisation totale, puisqu’ils n’avaient ni droits civiques ni libertés fondamentales. L’esclavage, déjà central dans l’économie des plantations de coton et de tabac, fut ainsi institutionnalisé et protégé par le cadre constitutionnel.
Cette clause illustre le paradoxe fondateur des États-Unis, une nation proclamant l’égalité et la liberté tout en acceptant l’exploitation et l’oppression de millions d’Africains réduits en esclavage. À long terme, ce compromis contribua à creuser les tensions entre le Nord et le Sud, tensions qui mèneront finalement à la guerre de Sécession et à l’abolition de l’esclavage en 1865.
Les Pères fondateurs, souvent présentés dans la mémoire nationale comme des figures héroïques de la liberté, apparaissent ainsi comme des acteurs ambivalents, pris entre idéaux philosophiques hérités des Lumières et réalités économiques et sociales profondément inégalitaires. Cette contradiction structurelle nourrit progressivement les divisions politiques et idéologiques qui mèneront à la guerre de Sécession (1861-1865), conflit au terme duquel l’abolition est proclamée par le 13ᵉ amendement. La commémoration de cette abolition renvoie donc moins à une victoire consensuelle qu’à l’issue d’un affrontement violent révélant les failles du projet démocratique américain.
Le « 1619 Project », une relecture de l’esclavage
Dans les débats contemporains sur la mémoire de l’esclavage, le « 1619 Project » occupe une place centrale. Lancé en 2019 par le New York Times, ce projet historiographique et médiatique propose une relecture profonde de l’histoire des États-Unis en plaçant l’esclavage et ses héritages au cœur du récit national. En faisant de l’année 1619 – date symbolique de l’arrivée des premiers Africains réduits en esclavage en Virginie – un point de départ alternatif à 1776, le projet remet en question la centralité de l’indépendance comme moment fondateur unique.
L’impact du « 1619 Project », qui a valu à sa créatrice, Nikole Hannah-Jones, le prix Pulitzer en 2020, est multiple. Sur le plan académique, il s’inscrit dans une historiographie critique qui insiste sur le rôle structurant de l’esclavage dans le développement économique, institutionnel et culturel des États-Unis. Sur le plan politique et mémoriel, il alimente de vives controverses, notamment autour de l’enseignement de l’histoire, de la légitimité des récits nationaux et de la place accordée aux populations afro-américaines dans la mémoire collective.
Ses promoteurs défendent l’idée que l’abolition de l’esclavage ne peut être comprise comme une rupture nette, mais comme un moment dans une longue continuité de domination raciale et de luttes pour les droits civiques. À l’inverse, ses détracteurs dénoncent une approche jugée téléologique ou idéologisée. Quelles que soient ces critiques, le « 1619 Project » a contribué à transformer durablement les cadres de la commémoration de l’esclavage, en mettant l’accent sur les héritages contemporains de cette institution.
L’analyse comparée permet aujourd’hui d’éclairer les spécificités du processus abolitionniste américain. Contrairement à d’autres puissances esclavagistes, l’abolition aux États-Unis résulte d’un conflit armé interne d’une ampleur exceptionnelle. Là où le Royaume-Uni adopte une abolition progressive par voie législative, accompagnée d’indemnisations pour les propriétaires, et où la France proclame l’abolition par décret en 1848 dans un contexte révolutionnaire, les États-Unis connaissent une abolition imposée par la victoire militaire du Nord sur le Sud.
Cette violence structure la mémoire de l’abolition et contribue à expliquer les résistances persistantes à son acceptation pleine et entière. À titre d’exemple, les Copperheads illustrent ce courant. Il ne s’agit pas d’un mouvement officiellement fondé par un leader unique, mais d’une nébuleuse d’élus, de journalistes et de militants – tels que Clement L. Vallandigham, figure emblématique du groupe – unis par leur opposition à la politique de guerre d’Abraham Lincoln. Les Copperheads aspirent avant tout à une paix négociée avec les États confédérés, au nom de la préservation de l’Union telle qu’elle existait avant la guerre, sans transformation sociale profonde. Leur rejet de l’abolition de l’esclavage repose sur plusieurs arguments : ils la considèrent comme inconstitutionnelle, dangereuse pour l’équilibre fédéral, et susceptible de provoquer une concurrence économique entre anciens esclaves et travailleurs blancs du Nord.
Par ailleurs, l’après-abolition américain se caractérise par l’échec partiel de la Reconstruction, période pourtant cruciale pour la redéfinition de la citoyenneté et des droits civiques. Là où certains pays tentent – avec des succès variables – d’intégrer les anciens esclaves dans le corps politique, les États-Unis voient se mettre en place, dès la fin du XIXᵉ siècle, des systèmes de ségrégation et de discrimination légalisée. Cette comparaison met en évidence le caractère inachevé de l’abolition américaine, tant sur le plan social que politique.
Enfin, la commémoration de l’abolition de l’esclavage aux États-Unis s’inscrit pleinement dans les débats contemporains sur la question raciale. L’abolition juridique de 1865 n’a pas mis fin aux inégalités structurelles, comme en témoignent la ségrégation, les violences raciales, les discriminations systémiques et les inégalités socio-économiques persistantes. Les commémorations actuelles, telles que Juneteenth, le 19 juin, reconnu comme jour férié fédéral en 2021 pour célébrer l’émancipation des esclaves, prennent ainsi une dimension éminemment politique. Elles visent non seulement à rappeler un événement historique, mais aussi à souligner la continuité des luttes pour l’égalité et la reconnaissance.
Dans cette perspective, commémorer l’abolition revient à interroger la capacité des États-Unis à se confronter à leur propre passé et à reconnaître les limites de leur projet démocratique. Loin d’être un simple rituel mémoriel, la commémoration devient un espace de débat critique sur la nation, ses valeurs et leurs traductions concrètes. Elle révèle que l’abolition de l’esclavage, plutôt qu’un aboutissement, constitue un moment fondateur d’un combat toujours en cours pour une démocratie réellement inclusive.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
13.01.2026 à 15:45
Enquête sur la diaspora malgache en France
Texte intégral (2570 mots)

Forte de près de 170 000 personnes, cette communauté est pourtant peu connue en France. Une enquête permet de mieux comprendre la perception de l’appartenance à la diaspora malgache ainsi que la diversité des relations entre les membres.
La diaspora malgache est l’une des principales diasporas d’Afrique subsaharienne en France. Les dernières estimations, datant de 2015, font état de 170 000 personnes, ce qui la place au même niveau que les diasporas malienne et sénégalaise. Malgré son importance numérique et son rôle important lors des récentes manifestations de la Gen Z à Madagascar, notamment à travers une mobilisation soutenue sur le réseau social Facebook, cette communauté est peu visible. Elle fait notamment l’objet de peu d’études si on la compare aux autres diasporas préalablement citées.
Une communauté peu connue
On peut faire remonter la première présence malgache en France hexagonale à la moitié du XIXᵉ siècle avec la venue de deux étudiants malgaches inscrits en faculté de médecine. Par la suite, d’autres étudiants, principalement issus des classes bourgeoises proches du pouvoir colonial, suivront le même chemin (études de médecine et de théologie). Cependant, comme le précise Chantal Crenn dans son livre Entre Tananarive et Bordeaux. Les migrations malgaches en France, il est difficile de parler de première vague tant le nombre est faible.
Il faut attendre la Première Guerre mondiale pour observer la première vague importante avec l’arrivée de 40 000 hommes, puis une deuxième vague avec la Seconde Guerre mondiale. Après 1947, la venue de Malgaches en métropole est principalement le fait d’étudiants issus de la bourgeoisie des Hautes Terres. Dans les années 1975-1980, les difficultés économiques et politiques de la Grande île vont pousser une partie des étudiants à venir étudier en France métropolitaine et certains à y rester.
Cet article se propose de combler en partie ces lacunes en analysant les résultats de l’enquête qualitative « Perception et réseaux de la diaspora malgache en France », réalisée dans le cadre du projet de recherche TADY entre janvier 2025 et décembre 2025, regroupant 25 entretiens réalisés avec des membres de la diaspora malgache en France (France hexagonale et La Réunion) et à Madagascar.
Dans le cadre de ces entretiens, deux thématiques principales ont été abordées : d’une part, la perception de l’appartenance à la diaspora malgache ; d’autre part, la diversité des relations entre les membres de la diaspora en France, ainsi que les relations entre cette communauté et Madagascar.
Les résultats développés dans cet article n’engagent pas l’ensemble de l’équipe de recherche du projet TADY mais les seuls auteurs de l’enquête « Perception et réseaux de la diaspora malgache en France ». Cependant, les travaux ont bénéficié d’interactions porteuses au sein du projet TADY et les auteurs remercient à ce titre l’ensemble des membres du projet. Nous renvoyons également les lecteurs au rapport « La diaspora malagasy en France et dans le monde : une communauté invisible ? ».
Définitions endogènes de la diaspora malgache
L’analyse des entretiens de notre enquête ne permet pas d’identifier une définition commune et uniforme à l’ensemble des membres de la diaspora.
Cela rejoint la littérature scientifique sur les diasporas et souligne la nécessité de ne pas adopter une définition trop restrictive des groupes diasporiques. Dans les faits, nous identifions plusieurs visions avancées par les personnes enquêtées, qui peuvent être cumulatives ou non.
Premièrement, une vision identitaire et culturelle met en lumière une série d’arguments en lien avec le fait d’être natif de Madagascar ; d’avoir un attachement identitaire et culturel ; ou encore d’avoir la nationalité malgache (sans forcément avoir un attachement particulier à la culture malgache ou au pays). Ainsi, plusieurs entretiens soulignent que l’appartenance à la diaspora malgache renvoie au fait d’être né à Madagascar puis d’avoir migré, ou encore d’avoir la nationalité et de vivre dans un autre pays que Madagascar.
« La diaspora pour moi, c’est être natif du pays tout en étant parti du pays. »
Cette définition est pour certaines personnes une condition essentielle de l’appartenance au groupe diasporique. D’autres ont une vision plus large et considèrent que l’appartenance à la diaspora malgache est davantage liée aux pratiques culturelles, surtout au fait de parler le malgache.
« Quelqu’un de deuxième génération peut être considéré comme de la diaspora, mais cela dépend de l’éducation. Si les deux parents sont nés à Madagascar, et si les parents entretiennent la langue avec leurs enfants. Dans ce cas, oui. Sinon, les enfants peuvent avoir un rejet. Cette adoption passe par la langue mais aussi la culture, l’adoption du pays. »
Deuxièmement, une vision réticulaire et communautaire, avec deux représentations.
La première (représentation plus individuelle) renvoie au fait d’être en relation avec les membres de la diaspora et/ou d’être en relation avec Madagascar.
« Pour moi, la diaspora c’est toute personne qui a une relation avec Madagascar – que la personne soit malgache ou mariée à un Malgache ou née en France mais enfant de Malgache. Voilà, donc dès qu’il y a une relation avec quelqu’un qui vient de Madagascar ou qui est malgache, qu’il soit né ou pas à Madagascar, pour moi, ça constitue totalement la diaspora. »
La deuxième représentation organisationnelle et communautaire (moins fréquente) qualifie la diaspora comme étant toute forme d’action collective et d’organisation (formelle ou non) qui œuvre pour l’intérêt des Malgaches en France ou à Madagascar.
« Selon moi, la diaspora malgache, c’est la communauté de Malgaches à l’étranger qui se retrouvent par leur origine […] et qui se réunissent selon leurs centres d’intérêt (sportif, religion commune, ou un aspect culturel, etc.). »
Comme nous le verrons dans la suite de l’article, cette dimension réticulaire prend une place importante.
La structuration de la diaspora malgache en France
L’analyse des récits nous permet également d’identifier une dimension centrale de la diaspora : celle de la complexité et de la diversité des relations entre diaspora et Madagascar, d’une part, et entre les membres de la diaspora, d’autre part.
Premièrement, l’ensemble des témoignages soulignent l’importance des relations d’entraide entre les membres de la diaspora et Madagascar.
D’abord, les soutiens sont pour la plupart intrafamiliaux et peuvent être plus ou moins réguliers. Ils peuvent intervenir pendant un événement ponctuel (mariage, enterrement, baptême, maladie) ou bien plus régulièrement (transfert mensuel, paiement de frais de scolarité, etc.).
« Chaque fois que mes parents avaient besoin, ou avaient un pépin à Madagascar, il fallait dépanner. Ils n’avaient personne sur qui compter à part moi. Donc on part, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a une responsabilité derrière. »
Ces logiques d’entraide s’apparentent souvent à de véritables mécanismes de protection sociale s’inscrivant dans une stratégie familiale construite autour de la migration.
D’autres témoignages relatent des processus d’entraide qui dépassent le simple cercle intrafamilial. À l’échelle de la famille élargie, de nombreuses initiatives sont développées dans le village d’origine des parents ou, plus largement, dans le lieu d’origine de la famille à Madagascar. Les mécanismes d’entraide sous-tendent de nombreux processus de négociation et des échanges complexes. Les écarts économiques et les perceptions de ces écarts renforcent la complexité de ces relations.
De nombreux témoignages soulignent la complexité des réseaux d’entraide entre la diaspora et Madagascar :
« Quand on envoie de l’argent là-bas, comme c’est un pays pauvre, ma famille a des voisins, les voisins savent que la famille de France envoie de l’argent, alors des fois quand on envoie de l’argent, on nourrit tout un voisinage. Donc des fois ma famille en demande un peu plus. C’est en allant là-bas que je l’ai vu et je l’ai vécu. »
Ainsi, les mécanismes d’entraide intrafamiliaux réguliers (entre enfants en France et parents à Madagascar par exemple) sont souvent le pilier de tout un système de redistribution impliquant de nombreuses personnes à Madagascar et en France.
Ensuite, au-delà de la logique de l’aide privée, plusieurs répondants soulignent la nécessité ressentie d’œuvrer directement pour Madagascar. Ils expriment leur sentiment de devoir moral impérieux, souvent cultivé au sein de la famille, à réinvestir leurs compétences acquises en France pour le développement de Madagascar.
Cette position, ancrée dans leur vision propre des enjeux du développement à l’île, se décline entre s’investir via l’aide au développement ou via le secteur privé, dans une perspective critique de l’aide. Dans les deux cas, toutefois, cette volonté de mobiliser ses compétences pour Madagascar entre en tension avec les opportunités limitées sur le marché du travail local, que ce soit en termes d’accès à l’emploi ou en termes de traitement salarial, en lien avec les écarts rapportés par plusieurs répondants entre conditions salariales des expatriés et conditions salariales des personnels nationaux. Les personnes malgaches venues étudier en France craignent de recevoir un salaire local alors que leur niveau de compétence est validé par un diplôme international.
Toutefois, malgré le manque d’opportunités de retour à Madagascar, la participation de la diaspora au développement du pays est bien réelle et prend notamment la forme de ressources immatérielles à travers le transfert d’opinions et d’idées qui peuvent influencer voire façonner celles des membres de la famille et plus largement l’opinion publique et dont le principal support et espace d’expression est Facebook, le réseau social le plus utilisé par les Malgaches.
Plusieurs enquêtés affirment s’informer régulièrement sur la situation du pays et certains prennent le temps de discuter les actualités avec leurs proches à Madagascar.
Par ailleurs, les influenceurs et lanceurs d’alerte sur Facebook basés en Europe, qui bénéficient d’une grande popularité en France comme à Madagascar, ont joué un rôle important dans le mouvement de la Gen Z.
Deuxièmement, l’analyse des récits permet également de caractériser la diversité des réseaux diasporiques en France selon les personnes.
Certaines se trouvent dans des réseaux exclusivement structurés autour de la famille proche et n’ont que peu de relations avec le reste de la diaspora malgache en France.
« En tant que personne faisant partie de la diaspora, je n’ai pas beaucoup échangé avec d’autres personnes de la diaspora, à part la famille. J’ai une définition très personnelle et très restreinte, je ne connais pas d’associations ou autre, je n’en ai jamais fait partie. »
Ces personnes peuvent par ailleurs maintenir des relations avec les membres de la famille présents à Madagascar. Tandis que d’autres, et ce à des niveaux variables, sont insérées dans des associations sportives, culturelles ou religieuses. Les organisations cultuelles malgaches occupent une place centrale dans la structuration des réseaux diasporiques. Au-delà de la fonction cultuelle, les Églises chrétiennes malgaches, dont les deux plus importantes et présentes dans les grandes villes françaises sont l’Église protestante malgache en France et le réseau des communautés catholiques malgaches de France, assurent souvent un rôle déterminant d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants (recherche d’emploi et de logement, conseil administratif), et favorisent également le maintien d’un lien fréquent et fort avec la communauté malgache.
« Sans la communauté malgache, je ne sais pas trop comment j’aurais pu m’en sortir à mon arrivée en France. C’est complètement grâce à la communauté malgache que j’ai pu m’en sortir, parce que ne serait-ce qu’avoir des amis, avoir des gens qui aident, par rapport à tout ce qui est administratif… parce qu’arriver en France sans rien connaître du tout, c’est très compliqué. […] Tout a été facilité par cette communauté malgache. La communauté de l’Église m’a permis de ne pas trop perdre mes repères et de ne pas être perdu totalement après mon arrivée en France. »
En conclusion, les principaux résultats de l’enquête soulignent la complexité des structures des réseaux diasporiques. Cette dernière s’explique non seulement par la diversité des représentations que la diaspora a d’elle-même mais aussi par la multitude des formes d’interaction qu’elle entretient avec Madagascar.
Cet article a été co-écrit avec Sarah M’Roivili.
Léo Delpy a reçu des financements du projet Tady.
Claire Gondard-Delcroix a reçu des financements du projet Tady.
Tantely Andrianantoandro et Tsiry Andrianampiarivo ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
13.01.2026 à 10:11
Le grand bond en arrière de Donald Trump sur la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis
Texte intégral (1756 mots)

Une enquête pénale vise Jerome Powell, l’actuel gouverneur de la puissante Réserve fédérale des États-Unis (Fed), dont le mandat arrive à terme en mai 2026. Donald Trump, dont la prérogative est de lui nommer un successeur, souhaite mettre à la tête de la Fed un de ses supporters, Kevin Hassett. Mais alors qui pour être le contre-pouvoir ? Contre-intuitivement, ce pourrait bel et bien être les marchés financiers.
Mervyn King, gouverneur de la Banque d’Angleterre de 2003 à 2013, aimait dire que « l’ambition de la Banque d’Angleterre est d’être ennuyeuse ». Le président de la Banque nationale suisse Thomas Jordan rappelait encore récemment que « la clé du succès est peut-être d’être ennuyeux ». Leur message est clair : la stabilité monétaire repose sur la prévisibilité, pas sur le spectacle.
Avec Donald Trump, cette règle pourrait changer. Le président des États-Unis, lui, n’aime pas être ennuyeux. S’il n’est pas clair que cela lui réussisse en politique intérieure ou extérieure, pour ce qui est de l’économie, c’est différent. La prévisibilité est un moteur de la stabilité des marchés et de la croissance des investissements. Dans ce contexte, les marchés pourraient être l’institution qui lui tient tête.
C’est ce rôle de contre-pouvoir que j’analyse dans cet article. Le conflit à venir se porte sur la nomination du successeur du président de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), la banque centrale des États-Unis, Jerome Powell dont le mandat expire en mai 2026. Dans la loi, le président de la première puissance mondiale a la prérogative de nommer un successeur.
Jerome Powell est actuellement visé par une enquête pénale du département de la justice américain, liée officiellement à la rénovation du siège de la Fed. Le président de la FED, lui, y voit une tentative de pression sur son indépendance, après son refus de baisser les taux d’intérêt. Donald Trump nie toute implication, même s’il dit de Powell qu’il « n’est pas très doué pour construire des bâtiments ». Pour de nombreux observateurs, le timing de l’attaque plaide pour une attaque politique. Les marchés ont réagi avec une montée du prix de l’or.
Car les présidents des banques centrales sont des personnages clés. Avec de simples mots, ils peuvent participer à créer des crises financières. Le président de la Bundesbank eut un rôle dans la crise du système monétaire européen de 1992. Si ce dernier s’était abstenu de faire un commentaire sur l’instabilité de la livre sterling, le Royaume-Uni aurait peut-être rejoint l’euro.
Gouverneurs technocrates
Traditionnellement, le choix du successeur n’est pas uniquement politique. Il se porte sur une figure reconnue, souvent issue du Conseil des gouverneurs. Les sept membres du Conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale sont nommés par le président et confirmés par le Sénat. Il s’agit ordinairement de technocrates.
Les chercheurs Michael Bordo et Klodiana Istrefi montrent que la banque centrale recrute prioritairement des économistes formés dans le monde académique, soulignant la sélection d’experts de la conduite de la politique monétaire. Ils montrent que les clivages entre écoles « saltwater » (Harvard et Berkeley) et « freshwater » (Chicago, Minnesota). Les économistes freshwater étant plus restrictifs (ou hawkish) en termes de baisse de taux, alors que les « saltwater » préfèrent soutenir la croissance.
Ben Bernanke incarne cette tendance. Du 1er février 2006 au 3 février 2014, il est gouverneur de la FED. Après un premier mandat sous la présidente de George W. Bush, Barack Obama le nomme pour un second mandat. Ce professeur d’économie, défenseur de la nouvelle économie keynésienne, gagne le prix Nobel en 2022 pour ses travaux sur les banques et les crises financières. La gouverneure de 2014 à 2018, Janet Yellen, est auparavant professeure d’économie à Berkeley, à Harvard et à la London School of Economics.
Ce processus relativement apolitique est essentiellement technocratique. Ces conventions seront potentiellement bousculées pour la nomination du prochain gouverneur de la banque centrale des États-Unis. Évidemment, certains gouverneurs avaient des préférences politiques ou des liens avec le président.
Kevin Hassett, économiste controversé
Le candidat de Donald Trump pressenti par les médias est Kevin Hassett. Ce dernier s’inscrit dans le sillage de la vision du nouveau président des États-Unis en appelant à des baisses de taux brutales. Il a qualifié Jerome Powell de « mule têtue », ce qui alimente les craintes d’une Fed docile envers la Maison Blanche.
« Kevin Hassett a largement les capacités pour diriger la Fed, la seule question est de savoir lequel se présentera » entre « Kevin Hassett, acteur engagé de l’administration Trump, ou Kevin Hassett, économiste indépendant », explique Claudia Sahm, ancienne économiste de la Fed dans le Financial Times. C’est cette question qui inquiète les marchés. Cela même si l’économiste a presque 10 000 citations pour ses articles scientifiques et a soutenu sa thèse avec Alan Auerbach, un économiste reconnu qui travaille sur les effets des taxes sur l’investissement des entreprises. De façade, Hassett a tout d’un économiste sérieux. Uniquement de façade ?
Les investisseurs s’inquiètent de la politisation de la Fed. Depuis la nomination de Stephen Miran en septembre 2025 au Conseil des gouverneurs, les choses se sont pimentées. Le président du comité des conseillers économiques des États-Unis est un des piliers de la doctrine économique Trump. Il a longtemps travaillé dans le secteur privé, notamment au fonds d’investissement Hudson Bay Capital Management.
Si les votes de la Fed sont anonymes, le Federal Open Market Committee, chargé du contrôle de toutes les opérations d’open market aux États-Unis, publie un graphique soulignant les anticipations de taux d’intérêt des membres. Depuis l’élection de Stephen Miran, un membre vote en permanence pour des baisses drastiques des taux d’intérêt, pour soutenir Donald Trump. Sûrement Miran ?
Si le nouveau président de la Fed faisait la même chose, on pourrait assister à une panique à bord… qui pourrait éroder la confiance dans le dollar. Les investisseurs internationaux ne veulent pas d’une monnaie qui gagne ou perde de la valeur en fonction du cycle électoral américain. Pour que les investisseurs aient confiance dans le dollar, il faut qu’il soit inflexible à la politique.
Les marchés financiers en garde-fou
Le marché, à l’inverse de la Cour suprême des États-Unis ou du Sénat, n’a pas d’incarnation institutionnelle, mais il a tout de même une voix. Il réagit par les prix, mais pas seulement. Si on ne l’écoute pas, le marché pourrait-il hausser le ton, en changeant les prix et les taux d’intérêt ?
Quelles seraient les conséquences de la nomination d’un président de la Fed pro-Trump et favorable à des coupes de taux pour soutenir le mandat de Trump ? Il se peut que les investisseurs institutionnels puissent fuir la dette américaine, du moins à court terme. Cette réaction augmenterait potentiellement les taux d’emprunt du gouvernement, notamment à long terme.
« Personne ne veut revivre un épisode à la Truss », a résumé un investisseur cité par le Financial Times, à la suite de la consultation du Trésor auprès des grands investisseurs. Liz Truss, la première ministre du Royaume-Uni, avait démissionné sous la pression des marchés en septembre 2022. Elle avait essayé dans un « mini-budget » à la fois d’augmenter les dépenses et de réduire les impôts. Quarante-quatre jours plus tard, elle avait dû démissionner à cause de la fuite des investisseurs qui ne voulaient plus de dette anglaise, jugée insoutenable.
Donald Trump ne démissionnera probablement pas quarante-quatre jours après la nomination de Kevin Hassett. Mais, en cas de panique des marchés, Kevin Hassett lui-même pourrait sauter. Et le dollar perdre encore un peu plus de sa splendide.
Alain Naef a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).
12.01.2026 à 15:57
Répression en Iran : pourquoi les forces de sécurité visent les yeux des manifestants
Texte intégral (1676 mots)
En Iran, les manifestants, et spécialement les manifestantes, font l’objet d’une répression extrêmement violente, avec cette spécificité que les tirs prennent souvent pour cible leurs yeux. En aveuglant l’« ennemi » qui ose les contester, les autorités inscrivent leur action dans la longue histoire du pays.
Au cours des mobilisations iraniennes de ces dernières années, et plus encore depuis celles du mouvement Femme, Vie, Liberté déclenché en 2022, la fréquence élevée de blessures oculaires infligées aux manifestants interpelle les observateurs. Femmes, jeunes, étudiants, parfois simples passants, perdent un œil – voire la vue – à la suite de tirs de chevrotine ou de projectiles à courte distance. Une pratique des forces de sécurité que l’on observe de nouveau actuellement : l’avocate Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix en 2003, a ainsi estimé ce 9 janvier que depuis le début des protestations en ce début d’année, « au moins 400 personnes auraient été hospitalisées à Téhéran pour des blessures aux yeux causées par des tirs ».
Ces violences ne relèvent pas de simples bavures. Elles s’inscrivent dans une logique politique qui trouve un écho dans l’histoire longue du pouvoir en Iran, où viser les yeux signifie symboliquement retirer à la victime toute capacité d’existence politique.
Le regard comme attribut du pouvoir
Dans la culture politique iranienne prémoderne, le regard est indissociable de l’autorité. Voir, c’est savoir ; voir, c’est juger ; voir, c’est gouverner. Cette conception traverse la littérature et l’imaginaire politiques iraniens. À titre d’exemple, dans le Shahnameh (Livre des rois), de Ferdowsi (Xe siècle), la cécité constitue un marqueur narratif de déchéance politique et cosmique : elle signale la perte du farr (gloire divine), principe de légitimation du pouvoir, et opère comme une disqualification symbolique durable de l’exercice de la souveraineté. Être aveuglé, c’est être déchu.
Dans le Shahnameh, l’aveuglement d’Esfandiyar par Rostam constitue une scène fondatrice de l’imaginaire politique iranien : en visant les yeux, le récit associe explicitement la perte de la vue à la disqualification du pouvoir et à la fin de toute prétention souveraine.

Historiquement, l’aveuglement a été utilisé comme instrument de neutralisation politique. Il a permis d’écarter un rival – prince ou dignitaire – sans verser le sang, acte considéré comme sacrilège lorsqu’il touchait les élites. Un aveugle n’était pas exécuté : il était rayé de l’ordre politique.
Le chah Abbas Iᵉʳ (au pouvoir de 1587 à sa mort en 1629) fait aveugler plusieurs de ses fils et petits-fils soupçonnés de complot ou susceptibles de contester la succession.
En 1742, Nader Shah ordonne l’aveuglement de son fils et héritier Reza Qoli Mirza, acte emblématique des pratiques de neutralisation politique dans l’Iran prémoderne.
De l’aveuglement rituel à l’aveuglement sécuritaire : pourquoi les forces de sécurité iraniennes visent-elles si souvent les yeux des manifestants ?
La République islamique ne revendique pas l’aveuglement comme châtiment. Mais la répétition massive de blessures oculaires lors des répressions contemporaines révèle une continuité symbolique.
Autrefois rare, ciblé et assumé, l’aveuglement est aujourd’hui diffus, nié par les autorités, produit par des armes dites « non létales » et rarement sanctionné.
La fonction politique demeure pourtant comparable : neutraliser sans tuer, marquer les corps pour dissuader, empêcher toute réémergence de la contestation.
Dans l’Iran contemporain, le regard est devenu une arme politique. Les manifestants filment, documentent, diffusent. Les images circulent, franchissent les frontières et fragilisent le récit officiel. Toucher les yeux, c’est donc empêcher de voir et de faire voir : empêcher de filmer, d’identifier, de témoigner.
La cible n’est pas seulement l’individu, mais la chaîne du regard reliant la rue iranienne à l’opinion publique internationale.
Contrairement à l’aveuglement ancien, réservé aux élites masculines, la violence oculaire actuelle frappe majoritairement des femmes et des jeunes. Le regard féminin, visible, autonome, affranchi du contrôle idéologique, devient politiquement insupportable pour un régime fondé sur la maîtrise du corps et du visible.
Un continuum de violences visibles
La répression actuelle, qui fait suite aux protestations massives déclenchées fin décembre 2025, s’est intensifiée avec une coupure d’Internet à l’échelle nationale, une tentative manifeste d’entraver la visibilité des violences infligées aux manifestants.
Des témoignages médicaux et des reportages indépendants décrivent des hôpitaux débordés par des cas de traumatismes graves – notamment aux yeux – alors que l’usage croissant d’armes à balles réelles contre la foule est documenté dans plusieurs provinces. Ces blessures confirment que le corps, et particulièrement la capacité de voir et de documenter, reste une cible centrale du pouvoir répressif.
Au-delà des chiffres, les récits des victimes féminines racontent une autre dimension de ces pratiques contemporaines. Alors que la société iranienne a vu des femmes à la pointe des mobilisations depuis la mort de Mahsa Jina Amini en 2022 – dont certaines ont été aveuglées intentionnellement lors des manifestations –, ces blessures symbolisent à la fois l’effort du pouvoir pour effacer le regard féminin autonome, source de menace politique, et la résistance incarnée par des femmes blessées mais persistantes, dont les visages mutilés circulent comme des preuves vivantes de répression.
L’histoire ne se limite donc pas à un passé lointain de neutralisation politique : elle imprègne l’expérience corporelle des femmes aujourd’hui, où l’atteinte à l’œil se lit à la fois comme une violence instrumentale et un signe que la lutte politique se joue aussi sur le champ visuel.
Le corps comme dernier champ de souveraineté
La République islamique a rompu avec le sacré monarchique, mais elle a conservé un principe ancien : le corps comme lieu d’inscription du pouvoir. Là où le souverain aveuglait pour protéger une dynastie, l’État sécuritaire mutile pour préserver sa survie.
Cette stratégie produit toutefois un effet paradoxal. Dans l’Iran ancien, l’aveuglement faisait disparaître politiquement. Aujourd’hui, il rend visible la violence du régime. Les visages mutilés circulent, les victimes deviennent des symboles et les yeux perdus témoignent d’une crise profonde de légitimité.
L’histoire ne se répète pas, mais elle survit dans les gestes. En visant les yeux, le pouvoir iranien réactive une grammaire ancienne de domination : empêcher de voir pour empêcher d’exister politiquement.
Firouzeh Nahavandi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.01.2026 à 16:49
Le raid de Donald Trump sur le Venezuela laisse présager un nouveau partage du monde entre les grandes puissances
Texte intégral (2166 mots)

Donald Trump a célébré la nouvelle année en marquant son territoire et en ouvrant la porte à un nouveau partage du monde entre Washington, Moscou et Pékin. L’Europe, tétanisée, prend acte par son silence approbateur de la mort du droit international.
Donald Trump et les hauts responsables de son administration ont salué l’opération « Détermination absolue » – le raid sur Caracas et la capture et l’enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, le 3 janvier 2026 – comme un succès militaire exceptionnel. On peut tout aussi aisément affirmer qu’il s’agit d’une violation flagrante et éhontée du droit international, qui marque une nouvelle érosion de ce qui reste de l’ordre international.
Mais la tentation pour la Maison Blanche est désormais de crier victoire et de passer rapidement à d’autres cibles, alors que le monde est encore sous le choc de l’audace dont a fait preuve le président américain en kidnappant un dirigeant étranger en exercice. Les populations et les dirigeants de Cuba (depuis longtemps une obsession pour le secrétaire d’État de Trump Marco Rubio), de Colombie (le plus grand fournisseur de cocaïne des États-Unis) et du Mexique (la principale voie d’entrée du fentanyl aux États-Unis) ont des raisons de s’inquiéter sérieusement pour leur avenir dans un monde trumpien.
Il en va de même pour les Groenlandais, en particulier à la lumière des commentaires de Trump ce week-end selon lesquels les États-Unis « ont besoin du Groenland du point de vue de leur sécurité nationale ». Sans parler du tweet alarmant de Katie Miller, influente membre du mouvement MAGA et épouse de Stephen Miller, l’influent chef de cabinet adjoint de Trump, montrant une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain.
Et ce n’est pas la réaction timide de la plupart des responsables européens qui freinera le président américain dans son élan. Celle-ci est extrêmement déconcertante, car elle révèle que les plus ardents défenseurs du droit international semblent avoir renoncé à prétendre qu’il a encore de l’importance.
La cheffe de la politique étrangère de l’Union européenne (UE), Kaja Kallas a été la première à réagir, avec un message qui commençait par souligner le manque de légitimité de Maduro en tant que président et se terminait par l’expression de sa préoccupation pour les citoyens européens au Venezuela. Elle a du bout des lèvres réussi à ajouter que « les principes du droit international et de la charte des Nations unies doivent être respectés ». Cette dernière partie apparaissait comme une réflexion après coup, ce qui était probablement le cas.
La déclaration commune ultérieure de 26 États membres de l’UE (soit tous les États membres sauf la Hongrie) était tout aussi équivoque et ne condamnait pas explicitement la violation du droit international par Washington.
Le premier ministre britannique Keir Starmer a pour sa part axé sa déclaration sur le fait que « le Royaume-Uni soutient depuis longtemps une transition au Venezuela », qu’il « considère Maduro comme un président illégitime » et qu’il « ne versera pas de larmes sur la fin de son régime ». Avant de conclure en exprimant son souhait d’une « transition sûre et pacifique vers un gouvernement légitime qui reflète la volonté du peuple vénézuélien », l’ancien avocat spécialisé dans les droits humains a brièvement réitéré son « soutien au droit international ».
Le chancelier allemand Friedrich Merz remporte toutefois la palme. Tout en faisant des commentaires similaires sur le défaut de légitimité de Maduro et l’importance d’une transition au Venezuela, il a finalement souligné que l’évaluation juridique de l’opération américaine était complexe et que l’Allemagne « prendrait son temps » pour le faire.
Le point de vue de Moscou et Pékin
Alors que l’Amérique latine était partagée entre enthousiasme et inquiétude, les condamnations les plus virulentes sont venues de Moscou et de Pékin.
Le président russe Vladimir Poutine avait manifesté son soutien à Maduro dès le début du mois de décembre. Dans une déclaration publiée le 3 janvier, le ministère russe des affaires étrangères se contentait initialement d’apporter son soutien aux efforts visant à résoudre la crise « par le dialogue ». Dans des communiqués de presse ultérieurs, la Russie a adopté une position plus ferme, exigeant que Washington « libère le président légitimement élu d’un pays souverain ainsi que son épouse ».
La Chine a également exprimé son inquiétude quant à l’opération américaine, la qualifiant de « violation flagrante du droit international ». Un porte-parole du ministère des affaires étrangères a exhorté Washington à « garantir la sécurité personnelle du président Nicolas Maduro et de son épouse, à les libérer immédiatement, à cesser de renverser le gouvernement du Venezuela et à résoudre les problèmes par le dialogue et la négociation ».
La position de Moscou, en particulier, est bien sûr profondément hypocrite. Certes condamner l’opération américaine comme étant une « violation inacceptable de la souveraineté d’un État indépendant » est peut-être justifié. Mais cela n’est guère crédible au vu de la guerre que Moscou mène depuis dix ans contre l’Ukraine, qui s’est traduite par l’occupation illégale et l’annexion de près de 20 % du territoire ukrainien.
La Chine, quant à elle, peut désormais avoir le beurre et l’argent du beurre à Taïwan, qui, contrairement au Venezuela, n’est pas largement reconnu comme un État souverain et indépendant. Le changement de régime apparaissant de nouveau à l’ordre du jour international comme une entreprise politique légitime, il ne reste plus grand-chose, du point de vue de Pékin, qui pourrait s’opposer à la réunification, si nécessaire par la force.
Les actions de Trump contre le Venezuela n’ont peut-être pas accéléré les plans chinois de réunification par la force, mais elles n’ont guère contribué à les dissuader. Cet épisode va probablement encourager la Chine à montrer plus d’assurance en mer de Chine méridionale.
Le partage du monde
Tout cela laisse présager un nouveau glissement progressif des intérêts des grandes puissances américaine, chinoise et russe, qui souhaitent disposer de sphères d’influence dans lesquelles elles peuvent agir à leur guise. Car si la Chine et la Russie ne peuvent pas faire grand-chose pour leur allié Maduro, désormais destitué, c’est aussi parce qu’il n’existe aucun moyen simple de délimiter où commence une sphère d’influence et où finit une autre.
La perspective d’un partage du monde entre Washington, Moscou et Pékin explique aussi l’absence d’indignation européenne face à l’opération menée par Trump contre le Venezuela. Elle témoigne de sa prise de conscience que l’ère de l’ordre international libre et démocratique est bel et bien révolue. L’Europe n’est pas en position d’adopter une posture qui lui ferait risquer d’être abandonnée par Trump et assignée à la sphère d’influence de Poutine.
Au contraire, les dirigeants européens feront tout leur possible pour passer sous silence leurs divergences avec les États-Unis et tenteront de tirer parti d’une remarque presque anodine faite par Trump à la fin de sa conférence de presse samedi 3 janvier, selon laquelle il n’est « pas fan » de Poutine.
Ce qui importe désormais pour l’Europe, ce ne sont plus les subtilités des règles internationales. Il s’agit dorénavant de garder les États-Unis et leur président imprévisible de son côté, dans l’espoir de pouvoir défendre l’Ukraine et de dissuader la Russie de commettre de nouvelles agressions.
Ces efforts pour accommoder le président américain ne fonctionneront que dans une certaine mesure. La décision de Trump de réaffirmer son ambition d’annexer le Groenland, dont il convoite les vastes ressources minérales essentielles, s’inscrit dans sa vision d’une domination absolue dans l’hémisphère occidental.
Cette renaissance de la doctrine Monroe vieille de deux siècles (rebaptisée par Trump « doctrine Donroe ») a été exposée dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine en décembre 2025. Elle ne s’arrête clairement pas au changement de régime au Venezuela.
La stratégie vise à « rétablir les conditions d’une stabilité stratégique sur le continent eurasien » ou à « atténuer le risque de conflit entre la Russie et les États européens ». Mais déstabiliser davantage l’alliance transatlantique en menaçant l’intégrité territoriale du Danemark au sujet du Groenland et en abandonnant peut-être l’Europe et l’Ukraine aux desseins impériaux du Kremlin risque d’avoir l’effet inverse.
De même, si l’incursion au Venezuela encourage les revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale et éventuellement une action contre Taïwan, elle ne permettra guère d’atteindre l’objectif américain, énoncé dans la stratégie de sécurité nationale, qui consiste à prévenir une confrontation militaire avec son rival géopolitique le plus important.
À l’instar des autres tentatives de changement de régime menées par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide, l’action américaine au Venezuela risque d’être une initiative qui isolera le pays et se retournera contre lui. Elle marque le retour de la loi de la jungle, pour laquelle les États-Unis, et une grande partie du reste du monde, finiront par payer un lourd tribut.
La traduction en français de cet article a été assurée par le site Justice Info.
Stefan Wolff a bénéficié par le passé de subventions du Conseil britannique de recherche sur l'environnement naturel, de l'Institut américain pour la paix, du Conseil britannique de recherche économique et sociale, de la British Academy, du programme « Science pour la paix » de l'OTAN, des programmes-cadres 6 et 7 et Horizon 2020 de l'UE, ainsi que du programme Jean Monnet de l'UE. Il est administrateur et trésorier honoraire de la Political Studies Association du Royaume-Uni et chercheur principal au Foreign Policy Centre de Londres.
08.01.2026 à 17:19
L’intervention des États-Unis au Venezuela au prisme du droit international
Texte intégral (1897 mots)
Bombarder un pays étranger sans mandat de l’ONU, capturer son dirigeant et proclamer qu’on va dorénavant diriger le pays en question : tout cela contrevient à de nombreuses normes du droit international détaillées dans la Charte de l’ONU et dans les Conventions de Genève.
L’Opération « Absolute Resolve » qui a impliqué le déploiement d’une force aéronavale sans précédent dans les Caraïbes depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 illustre la détermination du président Trump à capturer le président Nicolas Maduro et son épouse, en exécution d’un mandat d’arrêt de la justice américaine pour « narco-terrorisme ». Au-delà de la méthode et des raisons invoquées pour la justifier, il s’agit d’une intervention armée sur le territoire d’un État étranger sans fondement juridique, autrement dit une agression. C’est une nouvelle manifestation d’un interventionnisme décomplexé depuis l’adoption de la Doctrine Monroe il y a deux siècles.
Celle-ci, énoncée par le président James Monroe en 1823, visait à dissuader les puissances européennes d’intervenir dans l’hémisphère occidental, considéré comme chasse gardée des États-Unis. Elle s’est traduite notamment par le soutien aux républicains mexicains pour mettre fin à l’éphémère royaume de Maximilien voulu par Napoléon III (1861-1867), ainsi que l’appui aux indépendantistes cubains au prix d’une guerre hispano-américaine (1898) à l’issue de laquelle l’île de Porto Rico a été annexée par les États-Unis et Cuba est devenue formellement indépendante.
La Doctrine Monroe version Trump (« Trump Corollary » dans la Stratégie de sécurité nationale 2025) est désormais définie comme visant à restaurer la prééminence de Washington dans son arrière-cour en s’assurant qu’aucun rival extérieur ne soit en mesure d’y déployer des forces ou de contrôler des ressources vitales dans la région. Une allusion à peine voilée à la Chine dont l’activisme économique dans la région et singulièrement au Venezuela (qui intéresse avant tout Pékin pour son pétrole) est perçu comme une menace pour cette prééminence.
Un précédent : Panama, 1989
« Absolute Resolve » ressemble par son modus operandi à l’opération « Just Cause » décidée par le président George W. Bush en 1989 pour capturer et traduire devant un tribunal américain le dirigeant du Panama, Manuel Noriega, sous la même inculpation de trafic de drogue.
L’Assemblée générale des Nations unies avait qualifié cette intervention à Panama de « violation flagrante du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de Panama » (Résolution 44/240 du 29 décembre 1989).
Une différence réside dans le fait que le général Manuel Noriega – un dictateur responsable d’exécutions extrajudiciaires et de tortures – fut un allié de Washington, mais qui avait fini par s’avérer encombrant. A contrario, Nicolas Maduro — qui est également considéré par de nombreux États et ONG comme un dirigeant autoritaire — incarne une gauche révolutionnaire que Washington n’a cessé de combattre depuis la guerre froide.
Une violation manifeste de la Charte des Nations unies
L’intervention armée sur le territoire vénézuélien constitue sans discussion une violation de la Charte des Nations unies. Celle-ci dispose que « les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toutes autres manières incompatibles avec les buts des Nations unies » (article 2, § 4).
Les exceptions compatibles avec un recours à la force se limitent à la légitime défense ou à une action conforme à une décision du Conseil de sécurité. Dans cette circonstance, les États-Unis ne peuvent se prévaloir ni d’une action en légitime défense ni d’un mandat du Conseil de sécurité.
La Cour internationale de Justice avait relevé que le non-recours à la force relevait d’un principe essentiel et fondamental du droit international (arrêt du 27 juin 1986, qui concernait déjà une confrontation entre les États-Unis et un pays des Amériques, en l’occurrence le Nicaragua).
L’interdiction de l’emploi de la force peut être déduite d’une autre disposition de la Charte (Article 2, § 7) invitant les États à recourir au règlement pacifique des différends (chapitre 6), ce qui manifestement n’a pas été mis en œuvre ici.
Ces principes ont pour finalité de préserver la stabilité de l’ordre international et de prévenir le règne de la loi de la jungle dans les relations internationales. Or, faut-il le rappeler, dans la mesure où ils ont adhéré à la Charte des Nations unies, dont ils furent les rédacteurs en 1945, les États-Unis sont tenus d’en respecter et appliquer les dispositions.
Le « regime change » n’a pas de fondement en droit international
Le président Trump a justifié son intervention armée contre un président qu’il considère comme « illégitime » par l’accusation selon lequel Nicolas Maduro se serait livré, des années durant, au « narco-terrorisme ». La méthode utilisée, l’enlèvement d’un chef d’État en exercice, est doublement contraire au droit international : d’une part, en raison de l’immunité attachée à la fonction présidentielle (ce que semble ignorer l’application extra-territoriale de la justice américaine) ; d’autre part parce que la Charte, dans son art. 2, § 7, stipule clairement la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.
Le principe de souveraineté n’autorise pas un État à intervenir militairement sur le territoire d’un autre État en vue d’en changer le système politique, quand bien même le régime de Nicolas Maduro s’est rendu coupable de fraude électorale et de graves violations des droits humains à l’égard de l’opposition, qui font l’objet d’une enquête conduite par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.
Il reste que l’emploi de la force armée n’est pas la méthode la plus appropriée pour promouvoir les droits de l’homme dans un autre pays. Il existe des mécanismes internationaux compétents dans ce domaine (ONU, CPI) qui devraient pouvoir poursuivre leurs missions d’enquête sur les crimes présumés commis par au Venezuela.
Les Conventions de Genève applicables
Le droit applicable à l’intervention armée à Caracas est le droit des conflits armés encadrant la conduite des opérations militaires et la protection des biens et des personnes, même si les États-Unis nient être en guerre contre le Venezuela.
Les Conventions de Genève s’appliquent s’agissant d’un conflit armé international même si l’une des parties ne reconnaît pas l’état de guerre (art. 2 commun des Conventions).
Dès son arrestation, Nicolas Maduro peut se prévaloir de la protection de la 3ᵉ Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. En outre, la brièveté de l’opération militaire américaine n’exclut pas l’application de la 4ᵉ Convention de Genève si des victimes civiles sont à déplorer ou des biens civils ciblés.
D’autre part, Donald Trump a déclaré vouloir « diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse ». Cela peut être un motif d’inquiétude si un projet d’occupation est envisagé (la Charte des Nations unies le proscrit si l’occupation découle d’un recours à la force illicite). Cela dit, un tel scénario semble improbable compte tenu de l’expérience des fiascos en Afghanistan et en Irak, des réactions internationales majoritairement hostiles à l’intervention militaire, ainsi que de la montée des critiques au sein même de sa base MAGA, à qui Trump avait promis avant son élection de mettre fin aux guerres extérieures.
L’intervention armée et l’arrestation d’un chef d’État étranger en vue de le juger par un tribunal états-unien sont un message sans ambiguïté adressé par le président Trump à la communauté internationale : son pays n’hésitera pas à faire prévaloir le droit de la force sur la force du droit. Le droit international doit impérativement prévaloir comme contrat social liant les nations pour prévenir le chaos ou « l’homme est un loup pour l’homme » pour reprendre la formule de Thomas Hobbes.
Abdelwahab Biad ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 17:03
Syrie : comment les petites entreprises ont survécu à la guerre en bâtissant une économie parallèle
Texte intégral (1811 mots)

Même lorsqu’un pays est en guerre, que les institutions s’effondrent, que les groupes armés sèment la terreur, les entreprises de moins de 250 salariés jouent un rôle essentiel pour maintenir une activité économique minimale. Explication avec l’exemple syrien.
Pendant la guerre en Syrie, certaines petites entreprises ont dû payer des taxes au régime, négocier leur passage avec des groupes armés d’opposition, respecter les règles économiques de l’Organisation de l’État islamique, et s’appuyer sur des réseaux au Liban, en Irak ou en Jordanie.
Cette expérience met en lumière une réalité souvent négligée : lorsque l’État s’effondre, les acteurs économiques les plus modestes empêchent la société de s’arrêter complètement.
Contrairement à l’idée d’un pays économiquement à l’arrêt, la Syrie a vu émerger une économie parallèle, portée principalement par des petites et moyennes entreprises (PME) – de moins de 250 personnes et avec un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions de livres syriennes (SYP). Si cette économie n’était pas reconnue par les institutions officielles, elle était suffisamment organisée pour assurer la survie quotidienne de millions de Syriens et Syriennes.
Quand l’État disparaît, le marché se fragmente
À partir de 2012, la Syrie cesse de fonctionner comme un espace économique unifié. Le territoire se fragmente entre plusieurs autorités concurrentes : le régime syrien, différents groupes d’opposition armée, l’État islamique, les autorités kurdes et, en arrière-plan, les pays voisins. Dans ce contexte, le marché national se désagrège avec des routes coupées, des banques à l’arrêt et des contrats sans valeur juridique.
Selon la Banque mondiale, plus de la moitié des infrastructures économiques ont été détruites ou gravement endommagées.
Pourtant, les petites entreprises, comme les ateliers, les commerces, les transports ou les productions alimentaires, ont continué de fonctionner. Leur taille réduite et leur fort ancrage local leur ont permis de s’adapter à un environnement instable. Dans les contextes de conflit, ces entreprises jouent un rôle essentiel pour maintenir une activité économique minimale et aider les ménages à continuer de vivre.
Régime syrien, groupes d’opposition armés et État islamique
Pour survivre, ces petites et moyennes entreprises syriennes ont dû accepter une règle simple : travailler avec toutes les autorités en place, quelles qu’elles soient.
Avec le régime syrien
Dans les zones contrôlées alors par le régime de Bachar Al-Assad, les entreprises devaient obtenir des autorisations informelles, payer des taxes non officielles ou passer par des intermédiaires proches du pouvoir pour poursuivre leurs activités.
Ces pratiques, y compris des versements de pots-de-vin, symbolisent les défis auxquels font face ces petites et moyennes entreprises.
À lire aussi : La Syrie en transition... mais quelle transition ?
Avec les groupes d’opposition
Dans d’autres régions, les entreprises devaient payer des rétributions pour sécuriser leurs convois, négocier l’accès aux routes ou accepter des contrôles locaux afin d’éviter pillages et blocages. Dans les zones tenues par des groupes rebelles, cela passait parfois par des interactions économiques directes avec ces forces armées.
Dans les zones non contrôlées par l’État central, ces arrangements deviennent des conditions de fait pour maintenir une activité commerciale. Les acteurs économiques doivent payer des frais de passage imposés par des groupes armés.
Avec l’État islamique
Dans les zones contrôlées par l’État islamique, les règles économiques étaient strictes. L’organisation imposait des taxes obligatoires aux commerces et aux activités de production, contrôlait la circulation des marchandises et appliquait des sanctions sévères en cas de non-respect. Refuser de coopérer signifiait le plus souvent la perte de l’activité, voire des représailles.
Des analyses montrent que ce système de taxation et de contrôle économique constituait l’un des piliers du mode de gouvernance mis en place par l’État islamique dans les territoires syriens qu’il contrôlait.
Les pays voisins, prolongement de l’économie syrienne
Privées d’un système bancaire fonctionnel, de nombreuses petites entreprises syriennes se sont tournées vers les pays voisins.
Le Liban est devenu un point central pour les transferts financiers informels, la Jordanie, un espace d’approvisionnement relativement stable, et l’Irak un corridor essentiel pour le transport de marchandises. Dans ce contexte, les frontières ont cessé d’être de simples lignes de séparation pour devenir des espaces clés de l’économie syrienne.
La diaspora syrienne a joué un rôle central dans ces échanges, en finançant des activités locales et en sécurisant les transactions lorsque les institutions officielles faisaient défaut.
Une économie parallèle fondée sur la confiance
Cette économie n’était pas légale au sens strict, mais elle reposait sur des règles claires.
Lorsque les institutions disparaissent, la confiance ne s’évanouit pas, elle se déplace. Elle s’ancre dans la famille, les réseaux locaux, la réputation et la parole donnée. Les accords se concluent alors sans contrat écrit et, paradoxalement, ils sont respectés, car la survie collective en dépend.
De nombreux travaux sur les économies de guerre et les contextes de fragilité montrent que ces systèmes informels peuvent, dans certaines situations, s’avérer plus fiables que des institutions affaiblies ou absentes.
S’adapter en permanence pour ne pas disparaître
Faute de pouvoir investir ou planifier à long terme, les petites entreprises syriennes ont privilégié la réparation plutôt que le remplacement, l’utilisation d’un même atelier pour produire différents biens, le changement de fournisseurs ou d’itinéraires du jour au lendemain et la limitation de leurs stocks pour réduire les pertes en cas de rupture.
Privées d’accès au crédit, aux marchés extérieurs et à des infrastructures fiables, les entreprises syriennes ont ajusté leurs activités pour continuer à fonctionner.
Chaque décision devenait un calcul permanent du risque : quel trajet est le moins dangereux ? Qui faut-il payer pour passer ? Quelle perte peut être absorbée sans mettre l’entreprise en faillite ?
Réduire la dépendance à l’aide humanitaire
Cette économie parallèle a permis l’accès à des biens essentiels, contribué à la survie de millions de familles et maintenu un minimum d’activité économique dans un pays en guerre. En limitant l’effondrement total des circuits d’échange, elle a réduit, dans certains territoires, la dépendance exclusive à l’aide humanitaire.
Les organisations humanitaires elles-mêmes ont dû composer avec ces réseaux informels pour atteindre les populations et acheminer biens et services de première nécessité.
Un héritage difficile à intégrer
Aujourd’hui, une question centrale se pose : comment reconstruire une économie officielle sans fragiliser les mécanismes qui ont permis à la société de tenir pendant la guerre ?
Car les petites et moyennes entreprises syriennes abordent les institutions avec prudence, tout en restant dépendantes de relations régionales construites pendant le conflit. Réintégrer ces entreprises dans un cadre légal sans rompre ces équilibres constitue l’un des défis majeurs de la reconstruction économique de la Syrie.
Ancrées dans les communautés locales, ces entreprises jouent un rôle social majeur. Elles maintiennent des formes de solidarité économique, offrent des opportunités d’emploi aux femmes et aux jeunes et contribuent, dans certains secteurs, à la préservation d’activités artisanales et agricoles.
Au-delà du cas syrien, cette trajectoire rappelle que, dans les crises extrêmes, la résilience des sociétés repose souvent sur des acteurs invisibles : les petites entreprises, capables de faire tenir l’économie quand tout le reste vacille.
Mohamad Fadl Harake ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 08:47
Les États-Unis arraisonnent un navire battant pavillon russe : que dit le droit de la mer ?
Texte intégral (1620 mots)
Les États-Unis affirment avoir agi dans le respect du droit international. La Russie dénonce une violation manifeste du droit de la mer. Entre accusations et contre-accusations, l’arraisonnement d’un navire battant pavillon russe soulève un point de droit de la mer inédit.
Les relations entre les États-Unis et la Russie ont connu un nouvel accroc après que les garde-côtes américains ont abordé un navire naviguant dans les eaux islandaises, affirmant qu’il violait les sanctions visant le Venezuela. L’incident a immédiatement donné lieu à des accusations et des contre-accusations entre les États-Unis et la Russie.
Washington a affirmé avoir agi correctement, exécutant un mandat délivré par un tribunal fédéral américain. De leur côté, des responsables russes ont déclaré, selon l’agence de presse russe Tass, que cet arraisonnement constituait une violation manifeste du droit de la mer, affirmant qu’« aucun État n’a le droit d’employer la force contre des navires dûment enregistrés dans les juridictions d’autres États ». Le communiqué précisait que le Bella-1 – récemment rebaptisé Marinera – avait reçu une autorisation temporaire de naviguer sous pavillon russe, le 24 décembre.

Contrairement à l’enlèvement spectaculaire du président vénézuélien Nicolas Maduro de son palais de Caracas, le 3 janvier, une opération que les États-Unis ne semblent même pas tenter de justifier en droit international, l’interception du Marinera/Bella-1 paraît soulever un point inédit du droit de la mer, susceptible d’offrir au moins une certaine marge à Washington pour se présenter comme étant du côté du droit.
Avant l’enlèvement de Maduro, les États-Unis semblaient choisir avec un certain soin les navires transportant du pétrole vénézuélien qu’ils prenaient pour cibles. Il s’agissait soit de navires sans nationalité, soit de navires soupçonnés d’arborer un faux pavillon, ce qui ne leur confère aucune protection au titre de l’article 92 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), laquelle constitue également la règle de droit international coutumier, applicable aux États non parties comme les États-Unis.
Les navires sans nationalité sont vulnérables
Se trouver sans nationalité, ou adopter une conduite qui offre aux navires de guerre en haute mer un fondement valable pour traiter un bâtiment comme tel, est une position à haut risque que tout navire a tout intérêt à éviter. En effet, un navire sans nationalité n’a, par définition, aucun État sous le pavillon duquel il est enregistré pour faire valoir à son profit la juridiction exclusive et protectrice qui s’exerce en haute mer.
La CNUDM prévoit par ailleurs qu’un navire qui navigue sous les pavillons de deux États ou plus et qui les change en fonction des circonstances, « ne peut se prévaloir d’aucune des nationalités en question à l’égard de tout autre État ». Cela signifie qu’il peut être juridiquement considéré comme sans nationalité.
Ainsi, jusqu’au changement de pavillon signalé le 31 décembre, non seulement les États-Unis mais n’importe quel État étaient en droit de considérer le Marinera/Bella-1 comme un navire sans nationalité. Cela le rendait vulnérable à une interception en haute mer et à l’exercice, à son encontre, de la compétence répressive interne de l’État dont relevait le navire de guerre ou le bâtiment des garde-côtes procédant à l’interception.
La situation juridique demeure toutefois incertaine. La question pourrait être de savoir si les États-Unis poursuivaient déjà le Marinera/Bella-1 au moment où celui-ci a changé de pavillon. Si tel était le cas, Washington pourrait être fondé à ne pas tenir compte de la réimmatriculation.
La CNUDM prévoit ce qu’elle appelle le « droit de poursuite » (hot pursuit). Elle précise que « le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de son propre État ou d’un État tiers ». Aucun autre cas de cessation de ce droit n’étant mentionné – y compris l’hypothèse où le navire cesserait d’être sans nationalité –, cela laisse aux États-Unis la possibilité de soutenir qu’ils poursuivaient déjà le Marinera/Bella-1 et qu’ils n’étaient donc pas tenus de mettre fin à cette poursuite.
VOUS POUVEZ COURIR, MAIS VOUS NE POUVEZ PAS VOUS CACHER 🔥
Lors d’opérations menées avant l’aube ce matin, les garde-côtes américains ont arraisonné deux pétroliers de la « flotte fantôme » dans l’océan Atlantique Nord et dans les eaux internationales près des Caraïbes. Les deux navires avaient soit fait escale récemment au Venezuela, soit s’y rendaient.
Mais cet argument reste fragile, car rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait d’une véritable « hot pursuit ». En droit de la mer, cette notion s’applique à des poursuites engagées depuis l’une des zones maritimes de l’État concerné – et non en haute mer.
Accusations et contre-accusations
Jusqu’à présent, le ministère russe des transports a affirmé que l’action des États-Unis contrevenait à la règle énoncée à l’article 92. La Russie soutient que le changement d’immatriculation est intervenu dès le 24 décembre. Face à cet argument, les États-Unis pourraient faire valoir que ce n’est qu’au moment où le pavillon russe a été peint sur la coque du navire – ce qui aurait eu lieu le 31 décembre – que l’article 92 pouvait être invoqué à leur encontre.
Article qui précise également qu’« un navire ne peut changer de pavillon au cours d’un voyage ou lors d’une escale, sauf en cas de transfert réel de propriété ou de changement d’immatriculation ». Cette disposition est souvent mal comprise et interprétée comme interdisant purement et simplement tout changement de pavillon en cours de route — comme cela semble avoir été le cas ici. Une lecture plus attentive montre toutefois que ce n’est pas exact : ce que la règle interdit, c’est un changement de pavillon sans changement d’immatriculation correspondant.
Mais ce n’est pas la situation ici. À supposer qu’il y ait bien eu une immatriculation effective en Russie, c’est cet élément qui fait foi. Le fait de peindre un pavillon sur la coque faute d’en disposer physiquement n’en est qu’un indice matériel.
Le changement de pavillon en cours de poursuite constitue un point inédit du droit international de la mer, dans la mesure où aucun précédent connu n’existe. En l’absence de réponse juridique claire, la manière dont cet incident se réglera est susceptible de faire jurisprudence. Il faudra donc entendre les argumentaires juridiques concurrents des États-Unis et de la Russie pour déterminer lequel se révèle le plus convaincant.
Andrew Serdy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 18:03
La « défense avancée » d’Israël au Proche-Orient
Texte intégral (2875 mots)
En dépit des accords de cessez-le-feu conclus avec le Liban et à Gaza, et des discussions en cours avec la Syrie sur les contours d’un accord de sécurité, Israël poursuit une politique dite de « défense avancée » qui fait peu de cas de la souveraineté de ses voisins. Au nom de l’impératif de la sanctuarisation de son territoire, Tel-Aviv continue de redéfinir les frontières, d’étendre sa profondeur stratégique et d’asseoir son contrôle sur son voisinage. Cette politique se heurte toutefois de plus en plus aux intérêts de puissances régionales, comme la Turquie ou l’Arabie saoudite.
Depuis deux ans, l’accumulation de succès tactiques conduit Tel-Aviv à opter pour une politique impériale qui se poursuit en dépit des différents processus de négociations en cours. Au Liban, à Gaza, en Syrie, cette politique ne va pas sans susciter de tensions avec les grands acteurs de la région.
Détruire le Hezbollah… ou détruire le Liban ?
Au Liban, la guerre d’attrition visant à détruire les capacités militaires du Hezbollah – organisation libanaise alliée de l’Iran – et à décapiter sa chaîne de commandement a abouti à l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024.
Le dossier libanais est perçu par Israël comme le point de départ de la stratégie de restructuration du Moyen-Orient. Bien que le texte de l’accord ne prévoie que la cessation des hostilités et le retrait des forces militaires du Hezbollah et de ses armes du sud de la rivière Litani en échange d’un retrait israélien des cinq positions stratégiques qu’il occupe au Sud-Liban, la lettre complémentaire (side letter) adressée par Washington à Tel-Aviv donne un blanc-seing à la partie israélienne pour « répondre aux menaces » et « agir à tout moment contre les violations commises dans le sud du Liban ». En d’autres termes, les garanties offertes par les États-Unis permettent à Israël de mener des actions militaires préemptives sans être inquiété pour cela.
Entre novembre 2024 et novembre 2025, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a recensé plus de dix mille violations du cessez-le-feu par Israël. La partie israélienne considère que l’engagement diplomatique avec l’État libanais demeure distinct de ses attaques militaires contre le Hezbollah, qu’elle qualifie de groupe terroriste. De surcroît, l’État libanais, qui n’a cessé d’appeler, sans succès, à l’action de la communauté internationale pour faire cesser les attaques quasi quotidiennes contre sa souveraineté et son intégrité territoriale, s’est vu imposer, sous la pression de Washington, un calendrier pour désarmer le Hezbollah, au risque de mettre en péril la stabilité interne, dans un contexte marqué par une grande fragilité de ses institutions.
Ainsi, l’armée libanaise est censée avoir achevé le démantèlement de toutes les infrastructures du Hezbollah et le désarmement total du groupe dans de zone située au sud du Litani, à environ 30 km de la frontière avec Israël ; mais la partie israélienne réclame désormais la mise en application de la phase deux, à savoir la restauration du monopole exclusif de l’État sur les armes. Toutefois, comme le rappellent les universitaires Joseph Daher, Sami Zoughaib et Sami Atallah dans une publication du 20 novembre dernier :
« […] La véritable souveraineté se transmet rarement par une simple signature. Elle repose sur trois fondements interdépendants : un monopole crédible de la force par l’État, des institutions fonctionnelles et solvables, et une légitimité suffisamment large pour lier les communautés à l’État. Le Liban manque de ces trois éléments. Au contraire, la coercition extérieure dicte la politique, transformant l’État d’acteur souverain en instrument. »
La Syrie dans le viseur
En Syrie, tout en poursuivant les négociations autour d’un accord de sécurité, Israël mène des actions qui fragilisent l’État syrien et favorisent la fragmentation du territoire.
Au lendemain de la chute du régime d’Assad – événement dans lequel Israël se félicite d’avoir joué un rôle majeur grâce à sa guerre d’attrition visant à affaiblir les groupes pro-iraniens –, l’aviation israélienne a conduit des frappes préemptives massives, estimant avoir détruit de 70 % à 80 % des capacités militaires syriennes. Entre décembre 2024 et juillet 2025, plus de 800 attaques aériennes israéliennes contre la Syrie auraient été dénombrées.
À ce jour, l’intransigeance israélienne en matière d’exigences sécuritaires continue de faire obstacle à la conclusion d’un accord avec la Syrie. Tel-Aviv, qui a élargi son occupation au Golan en s’emparant de 600 kilomètres carrés sur le territoire syrien, en violation de l’accord de désengagement de 1974, réclame le droit d’intervenir militairement dans le sud syrien et de conduire des frappes sous le prétexte de préserver sa sécurité et sa stabilité.
Le projet d’accord de sécurité, qui reporte la question de la restitution du Golan (occupé par Israël depuis 1967), comporte d’autres exigences drastiques comme l’élargissement de la zone tampon de deux kilomètres côté Syrie et la mise en place d’une zone démilitarisée dans le Sud, qui constitueraient un précédent dangereux. En dépit de sa volonté plusieurs fois réitérée de conclure un accord de sécurité pour apaiser les tensions avec Israël, le président syrien Ahmed al-Charaa se montre réticent à l’idée d’une zone tampon qui transformerait la région en un espace de danger « aux conséquences inconnues ».
Israël dispose déjà d’une totale liberté d’action en Syrie comme l’illustre parfaitement sa gestion de la province de Quneitra, où les habitants font face à des incursions quotidiennes, à des contrôles et arrestations arbitraires, à la confiscation de leurs logements et de leurs biens, sans que l’armée syrienne ne les protège.
Tout en adoptant une posture maximaliste dans les négociations, Israël cherche à exploiter les minorités druze et kurde comme vecteur de déstabilisation, renouant ainsi avec la stratégie de l’expert du ministère israélien des affaires étrangères Oded Yinon développée dans les années 1980. Yinon considérait le monde arabe comme un maillon faible de l’ordre international. Les États étaient « un château de cartes temporaire » construit par la France et le Royaume-Uni dans les années 1920, qui ont divisé arbitrairement la région en dix-neuf États, « tous composés de combinaisons de minorités et de groupes ethniques hostiles les uns aux autres ». Dès lors, selon lui, ces États étant artificiels, il convient de les démembrer et de recomposer des entités sur des bases confessionnelles.
Cette approche est prégnante chez certains membres du gouvernement Nétanyahou. L’actuel ministre des affaires étrangères Gideon Saar a co-écrit en octobre 2015 avec un colonel de l’armée israélienne un article intitulé « Farewell to Syria » dans lequel il affirmait :
« Toute stratégie élaborée dans le but de mettre fin à la guerre civile en Syrie et de façonner son avenir doit partir d’un postulat clair : la Syrie, effondrée et divisée, ne peut être reconstituée. Il est donc nécessaire de se concentrer sur l’identification d’alternatives pratiques à l’État syrien. […] Un règlement coordonné et ordonné visant à séparer les forces entre la majorité sunnite et les minorités vivant sur le sol syrien […] offre le meilleur potentiel de stabilité. […] Tout accord de paix en Syrie doit reposer sur la garantie de l’existence de ces communautés au sein d’entités étatiques qui leur sont propres. »
Aussitôt après sa nomination à la tête de la diplomatie israélienne, Gideon Saar a annoncé qu’Israël devait se tourner vers les Kurdes, les Druzes et les autres minorités en Syrie et au Liban. Israël a, d’un côté, cherché à instrumentaliser la question druze, comme on l’a vu lors des affrontements intercommunautaires de mai dernier quand les Israéliens, en invoquant la défense des minorités, ont lancé une vague de bombardements massifs en Syrie et continuent de se présenter comme les protecteurs de cette communauté.
À lire aussi : Les violences inter-communautaires en Syrie et l’avenir de la transition
D’un autre côté, la partie israélienne a tenté de renforcer ses liens avec les Forces démocratiques syriennes (dominées par les Kurdes de la branche syrienne du PKK), engagées dans un processus d’unification pour placer les institutions civiles et militaires du nord-est de la Syrie (Rojava), sous le contrôle de l’État.
Après une interview accordée début décembre 2025 au Jerusalem Post par le commandant en chef des FDS, Mazloum Abdi, des révélations du Washington Post ont fait état des liens qu’entretiendraient les FDS avec Israël. Selon le quotidien américain, « des personnalités druzes liées aux services de sécurité israéliens ont acheminé des fonds vers des militants druzes à Soueïda via les FDS quelques mois avant la chute du régime d’Assad ».
Bien que les FDS démentent ces accusations – également nourries par différentes déclarations de Mazloum Abdi (« Si Israël peut empêcher les attaques contre nous et mettre fin au massacre de notre peuple, nous nous en réjouissons et nous lui en sommes reconnaissants ») –, les révélations du Washington Post renforcent l’argument de la Turquie selon lequel les FDS seraient inféodées à Israël, ce qui implique que leur intégration dans l’État syrien doit nécessairement entraîner leur désarmement et la dissolution de leur commandement.
Le mécontentement de la Turquie…
Depuis plusieurs mois, les actions israéliennes en Syrie heurtent les intérêts de la Turquie et suscitent des tensions croissantes avec Ankara. En effet, la Turquie, qui est l’un des principaux parrains d’Ahmed al-Charaa et qui a largement œuvré à sa normalisation, souhaite stabiliser un pays sur lequel elle entend exercer une forte influence.
L’accumulation des tensions a conduit Ankara à déployer des radars turcs à l’intérieur du territoire syrien, ce qui entraverait la liberté d’action d’Israël. La Turquie envisagerait également d’installer une base militaire.
De son côté, Israël a renforcé son partenariat sécuritaire et énergétique avec la Grèce et avec Chypre, opposées à la Turquie sur la question du zonage maritime en Méditerranée orientale. Dans un contexte où Athènes et Nicosie voient en Tel-Aviv un contrepoids aux ambitions de la Turquie, une hypothétique convergence entre Ankara et Téhéran pourrait se dessiner dans les semaines à venir.
Enfin, un autre signe supplémentaire de l’exacerbation des contradictions entre Israël et la Turquie est perceptible dans le refus israélien d’une participation turque à une « force de stabilisation internationale » à Gaza prévue dans le cadre du plan Trump pour la paix publié le 29 septembre 2025.
Ce plan ne constituerait, pour reprendre les termes d’une analyse récente publiée par le média Orient XXI, qu’une étape supplémentaire dans la réalisation du projet hégémonique israélien au Moyen-Orient « en rendant notamment obsolètes les frontières traditionnelles et en garantissant à Israël une liberté de mouvement pour frapper qui il veut, quand il veut et où il veut […] ». Il comporte plusieurs objectifs comme « exploiter davantage les fonds du Golfe pour financer le Conseil de la paix qui serait présidé par Donald Trump et préparer le plan de développement économique de Trump pour Gaza ; […] l’élimination de toute forme de résistance dans les territoires occupés ; la liquidation de la cause palestinienne et le déplacement forcé de la population ; […] normaliser la présence d’Israël dans la région et ses relations avec tous les pays arabes, en particulier l’Arabie saoudite ».
En offrant les mêmes garanties à Israël que dans le cadre libanais, les Américains consacreraient sa liberté d’action sur le territoire gazaoui aux côtés de la force de stabilisation internationale et lui permettraient donc de continuer à contrôler Gaza en évitant le coût d’une occupation permanente.
Par ailleurs, les États-Unis – qui superviseraient le Conseil de la paix et seraient donc en charge de la surveillance du comité de gouvernance temporaire de Gaza et du développement de la bande en coopération avec les pays du Golfe pour financer les projets et maintenir l’illusion d’une légitimité politique – pourraient également tenter, par ce biais, de renforcer les relations entre Israël et l’Arabie saoudite tout en enterrant la question palestinienne.
… et de l’Arabie saoudite
Toutefois, ce dernier pari ne tient pas compte de la déconnexion croissante des intérêts entre Tel-Aviv et Riyad. L’Arabie saoudite ne souscrit pas à l’approche israélienne de la « défense avancée » sous-tendue par une stratégie de restructuration du Moyen-Orient. Elle voit dans l’usage de sa supériorité militaire une menace pour ses propres intérêts et sa politique souveraine. Durant la guerre des douze jours contre l’Iran, Riyad s’est distanciée des actions israéliennes et s’est vigoureusement opposée à l’utilisation de son territoire et de son espace aérien par l’aviation américaine et israélienne pour frapper l’Iran.
Par ailleurs, en Syrie, elle converge avec la Turquie dans sa volonté de stabiliser le pays et veut exorciser le risque d’un effondrement qui sèmerait le chaos dans la région. Sur ce point, l’administration Trump est sur la même ligne que la Turquie et l’Arabie saoudite, tout en cherchant à offrir les meilleures garanties de sécurité possible à Israël, qui demeure étroitement tributaire de l’assistance financière, militaire des États-Unis, ainsi que de leur soutien diplomatique.
Terminons par ce constat du journaliste et écrivain américain Roger Cohen dans un article du New York Times le 30 novembre dernier après un séjour en Israël et au Liban : « Je n’ai trouvé que peu de signes indiquant que la puissance israélienne, telle qu’elle est actuellement déployée, permettra d’assurer un avenir plus pacifique à long terme pour Israël et la région. »
Lina Kennouche ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 15:01
Le Groenland, le Danemark et l’UE au défi de l’ordre trumpien : la doctrine Monroe en marche
Texte intégral (2673 mots)
Alors que l’attaque sur le Venezuela vient de confirmer la détermination des États-Unis à user de la force pour contrôler l’ensemble du continent américain, au détriment du droit international, l’avenir du Groenland, également dans la ligne de mire de Washington, requiert une attention accrue de la part de l’Europe.
« L’attaque contre le Venezuela est l’exemple effrayant d’un scénario où la politique de puissance prend le dessus. Nous ne savons pas encore ce qui se passe et où nous allons. Mais nous devrons tous réfléchir à notre vision du monde et prendre position. » Ce message posté sur LinkedIn (en danois) par la ministre groenlandaise de l’économie, du commerce, des minéraux et de la justice Najaa Nathanielsen traduit bien l’inquiétude qui règne à Nuuk, et qui s’est encore amplifiée depuis les événements du 3 janvier 2026 à Caracas. De son côté, la première ministre danoise Mette Frederiksen s’est alarmée :
« Si les États-Unis choisissent d’attaquer militairement un autre pays de l’Otan, alors c’est la fin de tout. »
Les menaces états-uniennes sur le Groenland, exprimées dès le retour au pouvoir de Donald Trump il y a un an, se sont nettement intensifiées au cours de ces dernières semaines, notamment avec la nomination, le 22 décembre 2025, d’un « envoyé spécial pour le Groenland » en la personne du gouverneur de Louisiane Jeff Landry. Celui-ci décrit ouvertement sa mission comme étant l’annexion du Groenland aux États-Unis (« make Greenland a part of the U.S. »).
La nomination témoigne, sans surprise, de la ténacité du président états-unien en ce qui concerne son projet d’annexion du territoire danois. L’accent mis par Donald Trump et par Jeff Landry sur l’histoire de la Louisiane, vendue par la France en 1803 aux États-Unis, dont elle représentait alors plus de 22 % de la surface, reflète – là aussi sans surprise – la logique transactionnelle de la politique promue par l’administration Trump, une logique de marché qui s’immisce sans complexe dans le domaine de la sécurité internationale.
Mais le Groenland est-il réellement, pour les États-Unis, une affaire de « sécurité nationale et internationale » qui justifierait son annexion ? Et si non, quelles sont les ambitions réelles de Washington ?
Créer la division entre le Groenland et le Danemark
Coutumier des fausses allégations, Donald Trump conteste de nouveau la souveraineté danoise sur le Groenland : « [Il y a trois cents ans], nous aussi étions là, avec des bateaux, j’en suis sûr. » Or la souveraineté danoise sur le Groenland ne fait aucun doute. Elle a été statuée par la Cour permanente de justice internationale en 1931 et officiellement reconnue par les États-Unis en 1951. Aucun changement sur le statut de l’île ne peut se faire sans l’accord du Danemark, conformément à l’accord de 2009 entre le Danemark et le Groenland sur l’autonomie du territoire groenlandais.
Lorsque, le 7 janvier 2025, Mette Frederiksen répond à la proposition américaine d’achat du Groenland que l’avenir de l’île appartient aux Groenlandais, la réponse ménage le Groenland mais elle est incomplète. Le Groenland est toujours danois, et un vote du Parlement danois, le Folketing, est notamment requis pour une éventuelle accession à l’indépendance. Donald Trump joue à dessein de l’histoire coloniale entre le Danemark et le Groenland pour écarter un acteur clé de la situation – qui plus est, État membre de l’Union européenne.
De même, il est faux de prétendre que le gouvernement danois n’a engagé aucune dépense pour la défense du Groenland, comme le Trump l’affirme. Certes, jusqu’à récemment, la participation danoise était modeste (présence du Joint Arctic Command à Nuuk, de patrouilleurs et frégates et de la patrouille en traîneau à chiens Sirius couvrant la côte nord du Groenland). « Nous pouvons faire plus dans le cadre qui existe aujourd’hui », assurait en 2025 le ministre danois des affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen. Deux programmes de défense ont été approuvés en 2025 par le Danemark pour un montant total avoisinant 6 milliards d’euros, et Copenhague a également approuvé une commande de 16 avions de combat américains F35 : la bonne volonté danoise ne suffit pas visiblement à calmer les ardeurs conquérantes de Washington.
La guerre de récits engagée par les États-Unis en soutien du projet d’annexion du Groenland n’est pas anodine. Elle cherche à ancrer dans les esprits le doute sur la légitimité de la souveraineté du Danemark et, en jouant sur son passé colonial, à créer la division entre le Groenland et le Danemark. Un autre aspect du discours de Washington est la surestimation de la menace militaire russe et chinoise au Groenland.
Des risques surdimensionnés pour justifier l’annexion du Groenland
Sur le plan de la sécurité, Donald Trump a, à plusieurs reprises, mentionné la présence de navires militaires russes et chinois autour du Groenland. Il s’agit d’une contre-vérité : les navires en question ont été repérés au large des côtes de l’Alaska.
La projection de puissance de la marine russe dans la zone d’étranglement GIUK (zone maritime entre le Groenland, l’Islande et le Royaume-Uni) est problématique et motive notamment les opérations Northern Viking de l’Otan. Elle est également redoutée au Groenland en ce qui concerne les infrastructures critiques (notamment les câbles sous-marins de télécommunications). Les risques en matière de sécurité ne sont donc pas nuls, d’autant que la Chine renforce sa puissance militaire dans le monde et, notamment, sa capacité en porte-avions.
Pour autant, s’il est important d’exercer un contrôle du territoire groenlandais, il n’y a pas de risque militaire significatif immédiat pour le Groenland qui justifierait son annexion par les États-Unis. Le risque est volontairement exagéré par Donald Trump afin de légitimer l’appropriation du Groenland, à laquelle le Groenland et le Danemark s’opposent.
Au-delà de la rhétorique et des fausses allégations, répétées à l’envi, les menaces de Washington sont à prendre au sérieux, car elles s’accompagnent de mesures concrètes et plus discrètes.
Dans leur rapport annuel de 2025, les services de renseignement danois ont, pour la première fois, fait état d’inquiétudes concernant les États-Unis. Le Danemark, historiquement l’un des plus atlantistes des pays européens, prend ses distances avec Washington.
Un expansionnisme au service d’intérêts bien pensés
En réalité, l’administration Trump est moins concernée par les questions de sécurité (même s’il s’agit de son argument officiel) que par un expansionnisme réactivant la doctrine Monroe, qui revendique un contrôle américain exclusif de l’« hémisphère occidental ». La nouvelle stratégie nationale de sécurité des États-Unis remet clairement au goût du jour cette doctrine (« Nous appliquerons un “corollaire Trump” à la doctrine Monroe », y est-il indiqué).
Cet expansionnisme de circonstance à l’approche des élections de mi-mandat promet de frapper fort. Annexer le Groenland est sans doute plus flatteur pour les ambitions du locataire de la Maison Blanche que renforcer des partenariats de défense pour des besoins non avérés, d’autant qu’il a clairement affirmé que les Européens devraient, dans le futur, assurer leur sécurité eux-mêmes.
Or, si la stratégie nationale de sécurité de 2025 peut très bien être « la plus longue note de suicide de l’histoire des États-Unis », pour reprendre les termes de l’historienne Anne Applebaum, elle n’en représente pas moins un danger immédiat pour l’Europe où, dans un renversement surréel, la démocratie et le supranationalisme sont non seulement décrits par l’administration Trump comme des menaces, mais plus encore comme des périls plus dangereux que les régimes autoritaires de la Russie ou de la Chine.
Contrairement aux affirmations de Trump, qui prétend que les États-Unis ne sont pas intéressés par les richesses minérales de l’île (« Nous avons tellement de sites pour les minéraux, le pétrole et tout le reste »), les investissements américains se développent au Groenland. Ronald Lauder, l’héritier milliardaire d’Estée Lauder qui aurait été le premier à avoir suggéré à Donald Trump l’idée d’« acheter » le Groenland, a pris des participations dans des entreprises groenlandaises et a manifesté son intérêt pour la construction d’une centrale hydroélectrique sur le plus grand lac du Groenland, Tasersiaq, afin d’alimenter en énergie une fonderie d’aluminium.
Des responsables de l’administration Trump seraient en pourparlers pour que le gouvernement états-unien prenne une participation dans l’entreprise américaine privée Critical Metals Corp, qui détient l’un des plus grands projets d’exploitation de terres rares au Groenland, Tanbreez. Cette opération donnerait aux États-Unis un accès direct à l’extraction de terres rares au Groenland, alors que la Chine détient le quasi-monopole mondial de leur extraction et raffinement.
Enfin, des rétorsions économiques visant des industries danoises ont déjà été mises en place : des contrats pour cinq projets éoliens offshore sur la côte est des États-Unis ont été suspendus, dont deux sont développés par la société danoise Ørsted.
Une réponse groenlandaise, danoise et européenne
Il est donc urgent d’adopter des mesures groenlandaises, danoises mais aussi européennes. Le premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen a clairement exprimé à Strasbourg, le 8 octobre 2025 devant le Parlement européen, son ouverture à une coopération plus approfondie avec l’UE :
« Nous avons besoin de coopération et de partenariats avec des pays et des institutions qui partagent nos valeurs. »
Le 6 janvier 2026, dans un message posté sur son compte Facebook, il remercie plusieurs États européens de leur soutien face aux menaces de Washington : les dirigeants de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Pologne, de l’Espagne, mais aussi du Royaume-Uni, ont déclaré qu’« il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland », et que « la sécurité dans l’Arctique doit donc être assurée collectivement, en coopération avec les alliés de l’Otan, y compris les États-Unis. »
Trois points sont donc saillants. Premièrement, sur le plan narratif, l’affirmation de la souveraineté du Danemark sur le Groenland ne se fait pas au détriment de l’autodétermination du peuple groenlandais, mais elle protège pour l’instant le Groenland d’une OPA américaine sur un territoire qui a bien, selon le droit danois, et en conformité avec le droit international, la capacité de décider de son futur selon les termes de l’accord d’autonomie de 2009.
Deuxièmement, sur le plan économique, une interdépendance trop forte avec les États-Unis peut déboucher sur une vulnérabilité politique et mettre en péril la démocratie au Groenland. Les Groenlandais ont déjà adopté des mesures claires de protection : le Parlement (Inatsisartut) a notamment voté en urgence en février 2025 une loi sur le financement des partis politiques, qui interdit les dons étrangers ou anonymes aux partis et aux candidats, et qui plafonne les contributions privées à l’échelle locale. Le Parlement examine en ce moment un projet de loi sur le filtrage des investissements directs étrangers visant à permettre aux autorités d’examiner, d’approuver, de conditionner ou de bloquer les investissements étrangers susceptibles de constituer une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public. L’UE s’est dotée d’un instrument similaire en 2019.
Troisièmement, en matière de sécurité, il est essentiel de penser une coopération européenne au bénéfice du Groenland et en accord avec le Danemark, une coopération qui peut dans un premier temps prendre la forme d’un dialogue stratégique régulier sur la sécurité et la résilience dans l’Arctique entre l’UE, le Groenland et le Danemark – et ce, sans attendre les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.
Ce dialogue stratégique aurait pu commencer dès le début de l’année 2025. Mais les menaces de Washington n’ont pas été prises au sérieux, et un retard considérable a été pris. Il n’est pas sûr que la proposition des pays européens d’une réponse dans le cadre de l’Otan soit suffisante pour convaincre les États-Unis de renoncer à la force pour annexer le Groenland. Il est donc urgent de comprendre que l’UE doit avoir le courage de repenser sa relation avec les États-Unis, et de se penser et de s’affirmer sans détour comme puissance.
Cécile Pelaudeix ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
06.01.2026 à 16:54
Que retenir de la présidence malaisienne de l’Asean ?
Texte intégral (2256 mots)
Avec désormais 11 membres, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a toujours l’ambition de jouer un rôle central en Asie du Sud-Est. La Malaisie, qui a exercé la présidence tournante de l’organisation en 2025, a profité de l’occasion pour se repositionner comme un acteur important dans la région et au-delà.
Cet article a été co-rédigé avec Colin Doridant, analyste des relations entre la France et l’Asie.
Ancienne colonie britannique, la Malaisie est l’un des rares États d’Asie du Sud-Est à être passé d’une stratégie d’alliance à une posture de non-alignement sur la scène internationale. Indépendante depuis 1957, sa politique étrangère est restée, dans un premier temps, étroitement liée aux garanties de sécurité britanniques à travers l’Anglo-Malayan Defence Agreement (1957-1971), puis les Five Power Defence Arrangements, un pacte défensif non contraignant réunissant le Royaume-Uni, la Malaisie et Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le progressif retrait britannique, la reconnaissance de la République populaire de Chine (RPC) en 1974 ainsi que l’arrivée au pouvoir de Mahathir Mohamad – une figure politique majeure en Asie – ont posé les bases d’une politique étrangère plus autonome et tournée vers le continent asiatique.
En 2025, la Malaisie a cherché à exploiter sa présidence de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) pour affirmer son rôle sur la scène régionale et internationale. Une stratégie qui s’est révélée payante pour Kuala Lumpur, mais en demi-teinte pour l’Asean.
Une politique étrangère neutre mais proactive
Après avoir adhéré au mouvement des non-alignés en 1970 et réaffirmé son non-alignement dans son Livre Blanc de la défense de 2020, la Malaisie semble aujourd’hui poursuivre une politique étrangère d’équilibre stratégique dynamique entre Pékin et Washington, centrée autour de l’Asean dont elle a été l’un des cinq membres fondateurs en 1967 (l’organisation compte désormais 11 membres).
Si la Malaisie, publiquement, n’hésite pas à aller dans le sens de la RPC – comme l’a encore montré la visite d’État de Xi Jinping en avril –, elle a également fait du respect de sa souveraineté en mer de Chine méridionale une de ses priorités stratégiques face à Pékin.
Avec les États-Unis, la relation bilatérale est de plus en plus tendue – que ce soit à propos du conflit israélo-palestinien ou de la nomination du très controversé prochain ambassadeur des États-Unis en Malaisie. La coopération reste néanmoins résiliente, comme en témoigne la signature d’accords de défense et d’accès aux terres rares lors de la visite de Donald Trump en octobre 2025.
Dans les relations avec ses voisins, la Malaisie privilégie un pragmatisme discret en matière de gestion des litiges frontaliers, comme avec les Philippines sur l’État de Sabah ou avec l’Indonésie autour d’Ambalat en mer de Célèbes.
Vis-à-vis de Singapour, ancien membre de la fédération qui s’est détaché en 1965, les relations sont largement normalisées avec des initiatives comme l’ouverture prochaine du Johor Bahru–Singapore Rapid Transit System ou la formalisation en janvier 2025 de la Johor-Singapore Special Economic Zone qui illustrent une approche axée sur l’interdépendance économique, évitant les confrontations publiques.
La présidence de l’Asean 2025 : un succès politique pour Anwar Ibrahim et diplomatique pour la Malaisie
Dix ans après sa dernière présidence de l’Asean, la Malaisie reprenait en 2025 les rênes de l’organisation dans un climat interne et international bien différent de celui qui prévalait une décennie auparavant.
Premier ministre depuis novembre 2022, Anwar Ibrahim, ancien dauphin puis rival de Mahathir, assurait cette présidence de l’Asean, plateforme unique pour rétablir une position d’acteur régional clé. La présidence malaisienne de l’Asean s’est inscrite dans la continuité de sa politique étrangère, qui vise à promouvoir le multilatéralisme et faire de Kuala Lumpur une capitale diplomatique en Asie du Sud-Est. Une mission réussie, avec les visites de plus de 25 chefs d’État différents en Malaisie au cours de l’année 2025, dont celles de Recep Tayyip Erdoğan, de Xi Jinping, de Donald Trump ou encore l’organisation de la rencontre Rubio-Lavrov en juillet.
Autre facette de la diplomatie malaisienne en 2025 : une forte solidarité avec les peuples « opprimés », en particulier les Palestiniens, et une critique des « doubles standards » occidentaux. Les efforts d’Anwar pour concrétiser l’organisation du premier sommet « Asean-GCC-China » entre l’Asean, les six pays du Conseil de coopération du Golfe et la RPC, sont également à souligner. La Malaisie tente de se positionner comme un pont (bridging linchpin vision) entre les différentes régions et cultures, particulièrement entre le monde islamique, l’Occident, mais aussi le « Sud Global », le pays ayant obtenu le statut de partenaire des BRICS en 2024.
Une année 2025 où la Malaisie aura donc pu rayonner à l’international, à l’instar de son premier ministre qui prépare déjà les prochaines élections générales de février 2028.
Asean : des horizons incertains
Point d’orgue d’une année intense, le 47e sommet de l’Asean, organisé concomitamment avec d’autres réunions (Partenariat économique régional global, Sommet de l’Asie orientale) et en présence de Donald Trump, fut historique par l’adhésion d’un onzième membre : le Timor-Leste.
Néanmoins, sur les plans économique et diplomatique, les résultats ont été mitigés. En effet, si le renforcement de l’Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA) et de l’Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) ont marqué des avancées vers plus d’intégration régionale, des critiques ont surtout été formulées à l’encontre des accords bilatéraux de réduction des tarifs douaniers signés par la Malaisie et le Cambodge avec les États-Unis. Ces derniers contiendraient des « clauses empoisonnées » visant à renforcer le commerce avec les États-Unis et à limiter celui avec la RPC. Des accords-cadres similaires ont été signés avec le Vietnam et la Thaïlande. Ces dispositions symbolisent les difficultés de l’Asean à s’adapter à la diplomatie économique trumpienne, qualifiée par certains de « diplomatie du cowboy ».
Sur le plan régional, c’est principalement le réveil du conflit larvé entre la Thaïlande et le Cambodge en mai 2025 qui a pesé sur la présidence malaisienne de l’Asean. Malgré des efforts – plus sino-malaisiens qu’états-uniens – qui ont mené à la conclusion lors du sommet de l’Asean de « l’accord de paix de Kuala Lumpur » entre les deux belligérants en octobre, les hostilités ont repris dès le mois de novembre.
En s’ajoutant à l’échec d’avancées concrètes sur le dossier birman et de la mer de Chine méridionale, la confrontation entre Bangkok et Phnom Penh n’a fait que souligner l’incapacité de l’Asean à régler les conflits régionaux. Un rappel supplémentaire de la complexité de ces défis persistants et des limites des mécanismes dont dispose l’Asean pour y faire face.
Les prochaines présidences de l’Asean – les Philippines en 2026, qui ont annoncé qu’elles feraient du Code de conduite en mer de Chine méridionale leur priorité, et Singapour en 2027, année des 60 ans de l’organisation et du prochain Congrès national du Parti communiste chinois – sont d’ores et déjà toutes deux sous pression face à l’accumulation des crises en Asie du Sud-Est.
Ces dynamiques auront des ramifications géopolitiques qui dépassent le seul cadre régional et offrent à des acteurs extérieurs, la France par exemple, des opportunités de coopération et d’influence dans la région.
Les perspectives françaises
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie Indopacifique française, la Malaisie constitue aujourd’hui un partenaire important en Asie du Sud-Est.
Le pays accueille environ 300 filiales d’entreprises françaises représentant quelque 30 000 emplois. Mais c’est dans le domaine de la défense que la coopération s’est révélée la plus soutenue, la Malaisie s’imposant, dans la première décennie du XXIe siècle, comme le principal partenaire de défense de la France en Asie du Sud-Est (aux côtés de Singapour), notamment à travers la vente de matériel militaire (sous-marins Scorpène, avions A400M, hélicoptères H225). La coopération militaire se poursuit actuellement, qu’il s’agisse des déploiements français (missions CLEMENCEAU 25 et PEGASE), de l’exercice terrestre conjoint MALFRENCH DAGGERT, ou encore des escales et exercices navals réguliers.
La relation connut une certaine accalmie, marquée par des périodes de tensions. Ainsi, en 2018, le retrait de l’huile de palme de la liste des biocarburants bénéficiant d’une exonération fiscale en France fut interprété par la Malaisie comme une interdiction déguisée d’importation, fragilisant un secteur stratégique.
La visite officielle à Paris d’Anwar Ibrahim en juillet 2025 semblait indiquer « la relance » de la relation bilatérale pour reprendre les mots du président Emmanuel Macron. Mais le discours d’Anwar à la Sorbonne pouvait toutefois être perçu comme un avertissement adressé aux Européens, les invitant à recalibrer leurs relations avec l’Asie du Sud-Est et à mieux appréhender les sensibilités d’une région qui « a l’habitude d’être décrite, mais beaucoup moins celle d’être écoutée ».
Il pourrait être intéressant pour la France de renforcer son soutien à la gestion des crises en Asie du Sud-Est, dans la dynamique de la nomination en 2024 d’un envoyé spécial pour la Birmanie en appui des efforts internationaux. En effet, le contentieux territorial entre la Thaïlande et le Cambodge trouve son origine dans le découpage territorial de l’Indochine française et des traités franco-siamois de 1904 et 1907. Or, la reprise du conflit coïncide avec l’organisation en 2026 du XXe Sommet de la Francophonie qui se tiendra au Cambodge (la Thaïlande est également membre l’organisation avec le statut observateur) et auquel participera Emmanuel Macron.
Un déplacement français en Asie du Sud-Est qui ne devra pas, cette fois, oublier la Malaisie, comme le rappelait avec humour le premier ministre malaisien à son homologue français dans la cour de l’Élysée en juillet 2025 : « Avant que vous n’atteigniez le Cambodge pour le Sommet de la Francophonie, vous n’aurez aucune excuse de ne pas visiter la Malaisie. »
Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
06.01.2026 à 15:32
Le Venezuela, un dominion des États-Unis ?
Texte intégral (2120 mots)
Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, les forces armées américaines ont lancé et conduit l’opération militaire massive « Absolute resolve » afin de kidnapper le président vénézuélien Nicolas Maduro au palais Miraflores, à Caracas. Dans la foulée, Donald Trump a annoncé que les États-Unis « dirigeraient » temporairement le Venezuela en attendant la prise de pouvoir d’un gouvernement favorable aux États-Unis (like minded). Pourtant, la vice-présidente Delcy Rodriguez, légalement au pouvoir depuis l’incarcération de Maduro, annonce désormais son intention d’assumer la direction de l’État. Quel destin se prépare pour le pays, entre interventionnisme trumpiste, sursaut nationaliste anti-impérialiste et protestations internationales ?
Une intervention militaire conduite sans base légale et au nom de la « sécurité des États-Unis » ; la destitution et l’emprisonnement du dictateur au pouvoir ; l’annonce de la future prise de contrôle du pays par les forces armées et les entreprises états-uniennes : tout cela rappelle l’opération contre l’Irak et Saddam Hussein de 2003.
Le parallèle avec l’opération irakienne – officiellement destinée à prévenir l’usage d’armes de destruction massive (demeurées introuvables) – est limité : cette fois, derrière le prétexte de la lutte contre le « narcoterrorisme », Donald Trump reconnaît sans ambages le rôle clé qu’occupent les ressources pétrolières dans les motivations profondes de cette opération. Ceux qui veulent y voir une défense de la démocratie en seront pour leurs frais : la promotion de la démocratie et la lutte contre les dictatures sont au centre des discours européens, mais pratiquement absents de ceux de l’équipe Trump.
En outre, l’invasion de 2003 visait à détruire l’État du parti Baas irakien ; or, ce n’est pas l’opposante Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, qui est appelée à gouverner le Venezuela, mais la vice-présidente en exercice Delcy Rodriguez. La situation fait dès lors penser, à ce stade, à l’accaparement des ressources vénézuéliennes par une puissance extérieure, couplé à un lâchage interne de Maduro au sein du régime, quand bien même Rodriguez a exigé sa libération.
Par conséquent, la question cruciale n’est sans doute pas « qui gouverne », mais « comment gouverner après ».
Le Venezuela de Rodriguez, entre souveraineté limitée et nationalisme blessé
L’enlèvement de Nicolas Maduro n’empêche pas la Constitution vénézuélienne de 1999 de continuer de s’appliquer.
L’opération militaire conduite par les États-Unis destitue un des titulaires du pouvoir, mais ne transforme pas mécaniquement les structures politiques, sociales ou économiques du pays. Elle introduit en revanche une contrainte durable. Le nouveau régime doit gouverner sous le regard simultané d’une puissance extérieure tutélaire, qui a montré sa capacité d’intervention, et dont sa survie dépend aujourd’hui, et d’une société nationale très attentive aux signes d’autonomie ou de mise sous tutelle, et foncièrement divisée.

Cette tension place le pouvoir de Delcy Rodriguez dans une double contrainte : d’une part, éviter une nouvelle intervention en se conciliant la faveur de l’administration Trump ; d’autre part, satisfaire les aspirations de la population au respect d’une souveraineté mise à mal par l’ingérence américaine. En un mot, elle doit combiner survie face à Trump et rhétorique nationaliste compensatoire : elle a par exemple dénoncé la teneur « sioniste » (comprenez colonisatrice) de l’expédition américaine, qualifiée de « kidnapping » et de « barbarie » violant le droit international.
Si Rodriguez et son entourage optent pour un discours trop musclé et offensif à l’égard de Washington, cela offrira à Donald Trump un prétexte pour procéder à un changement de régime complet, ce qui supposerait une action et un investissement beaucoup plus conséquents. Le Venezuela vit donc dorénavant dans un régime de « souveraineté limitée », comme l’annonçait en décembre la nouvelle stratégie nationale de sécurité américaine.
À lire aussi : L’internationale trumpiste : la Stratégie de sécurité nationale 2025 comme manifeste idéologique
Dans ce contexte, trois destinées sont aujourd’hui ouvertes pour le pays.
Scénario 1, le chavisme sans Chavez ni Maduro : un Thermidor caribéen sous surveillance états-unienne
Premier scénario : une continuité réelle malgré une rupture affichée. Pour les élites bolivariennes, lâcher Maduro a peut-être été le prix à payer pour sauver l’État, restaurer une forme de rationalité, sortir le pays de l’isolement.
Les visages changent à peine, les uniformes pas encore. Durant les six premiers mois, les sanctions américaines pourraient être partiellement suspendues, les marchés pourraient réagir avec prudence, et les institutions seraient « normalisées » plutôt que transformées. Dans ce scénario, le nouveau pouvoir ne parle que de stabilité, jamais de refondation, et gouverne par décrets techniques sous la surveillance discrète des États-Unis, dont l’attention sera focalisée sur la possession des champs pétroliers.
Au bout d’un an, la démocratie revendiquée par les opposants au chavisme sera renvoyée à plus tard, et les structures du pouvoir resteront quasiment intactes. Comme lors du 9-Thermidor en 1794, les excès ont été liquidés, pas le système.
Scénario 2, la souveraineté limitée : un « moment Kadar » tropical
Tout commence par une fracture interne inattendue. Ni chaviste orthodoxe ni opposition traditionnelle, un nouveau centre de gravité politique émerge dans l’entre‑deux, porté par des acteurs fatigués des extrêmes et décidés à stabiliser le pays. Les différentes oppositions (MAGA-compatibles ou non) convergent et s’allient aux « chavistes modérés » (gouverneurs pragmatiques, militaires de second rang, technocrates issus du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV)
– la formation chaviste –, qui veulent éviter l’effondrement total) pour proposer au pays un régime de transition qui garantit une certaine souveraineté nationale. Dans les six premiers mois, un pacte social minimal est proposé, la coercition recule temporairement, et l’économie redémarre grâce à une série de mesures pragmatiques.
La surprise vient de la société elle‑même : la demande de « vie normale » devient dominante, affaiblissant (peut-être momentanément) la polarisation. Le pays semble entrer dans une phase de pacification inattendue, presque involontaire.
Mais au bout de quelques mois, probablement vers l’automne 2026, surgissent des troubles internes : grèves sectorielles, protestations corporatistes, tensions régionales. Rien de décisif pour la stabilité du régime, mais suffisamment pour rappeler que celui-ci reste fragile. Le pouvoir répond par une combinaison de concessions ciblées et de fermeté mesurée, évitant l’escalade tout en réaffirmant son autorité.
Ces turbulences, paradoxalement, renforcent le récit du compromis : le régime se présente comme le seul capable de contenir le chaos sans revenir à la répression systématique. Comme avec le pouvoir de Janos Kadar instauré en Hongrie après 1956 (à la suite de l’écrasement par l’URSS de l’insurrection de Budapest), ce n’est ni une victoire idéologique ni une défaite politique : c’est la fatigue historique qui gouverne, et la société accepte le compromis, faute de mieux.
Dans ce scénario, les États-Unis jouent un rôle bien plus important : ils soutiennent l’arrivée au pouvoir d’un dirigeant d’inspiration MAGA à Caracas, à l’instar des Soviétiques qui ont porté Janos Kadar à la tête de la Hongrie.
Scénario 3, une évolution à la cubaine pré-castriste : un dominion américain
Si la souveraineté reste intacte sur le papier, la capacité de négociation du pouvoir chaviste est déjà très entamée en ce début d’année 2026. Une fois installé le nouveau leadership, soutenu par Washington et aligné sur ses priorités, vient alors la phase de réouverture sous contrainte : levée conditionnelle des sanctions, retour des majors états-uniennes, accords d’exploitation conclus dans l’urgence. Les nouveaux contrats s’étendent sur des décennies, verrouillés par des clauses de stabilisation et une fiscalité avantageuse pour les intérêts des majors. Le pétrole demeure vénézuélien, mais la rente, elle, devient extraterritoriale, profitable aux milieux économiques des États-Unis.
La troisième phase consacre la captation de la valeur : technologies, assurances, transport et raffinage sont externalisés, les revenus rapatriés hors du pays, et l’État réduit à une fonction fiscale minimale. Le Venezuela produit beaucoup, capte peu et dépend désormais de flux qu’il ne contrôle plus.
Enfin, cette dépendance se normalise. Le récit dominant affirme que « c’est le prix de la stabilité » ; la souveraineté pétrolière est dépolitisée ; et les fractures sociales s’approfondissent. Le pillage n’est plus seulement visible : il est institutionnalisé.
En somme, le Venezuela subit le sort de Cuba entre l’adoption de l’amendement Platt (1901), qui officialisa le droit d’ingérence des États-Unis sur la République de Cuba, et la révolution castriste (1959) : il devient un dominion des États-Unis.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
04.01.2026 à 23:36
Cinq scénarios pour le Venezuela post-Maduro
Texte intégral (2604 mots)
Le flou règne sur l’avenir du Venezuela après la capture de son président par les États-Unis. Plusieurs voies sont envisageables, du maintien en place du régime chaviste à une prise de contrôle du pouvoir par Washington.
L’opération militaire menée par les États-Unis à l’aube du 3 janvier, qui a permis de capturer Nicolas Maduro et son épouse puis de les emmener à New York, où ils ont été incarcérés, marque un tournant pour le continent américain. Après plusieurs mois de menaces d’intervention militaire et de renforcement constant des forces armées états-uniennes dans la région, ces dernières ont destitué un président étranger à l’issue d’une opération qui a duré un peu plus de deux heures.
Que ce soit sous le prétexte de la lutte contre le trafic de drogue ou au nom d’un changement de régime, le message est clair : les États-Unis sont prêts à agir de manière unilatérale, par la force et, au besoin, de façon illégale. Les répercussions seront vastes pour le Venezuela, bien sûr, mais aussi pour l’ensemble de l’Amérique latine.
Les réactions à l’intervention états-unienne ont été immédiates. La Colombie, qui a dépêché des troupes à sa frontière, se préparant à l’arrivée potentielle de réfugiés, a dénoncé les frappes comme un affront à la souveraineté des pays de la région. Cuba s’est joint à l’Iran, à la Russie et à d’autres adversaires de Washington pour condamner le raid devant les Nations unies. Quelques gouvernements, notamment celui de l’Argentine, ont en revanche apporté leur soutien sans réserve à cette opération.
Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient « diriger » le Venezuela jusqu’à ce qu’il y ait une « transition sûre, appropriée et judicieuse » du pouvoir, et assuré que son administration « n’avait pas peur d’envoyer des troupes au sol ».
Jusqu’à présent, peu de détails concrets sur la suite des événements ont été fournis. Beaucoup dépendra des prochaines actions de Washington et de la réaction de la classe politique vénézuélienne, qui est très divisée. En tant qu’expert des relations entre les États-Unis et l’Amérique latine, j’estime que cinq scénarios principaux sont plausibles.
1. Trump déclare avoir eu gain de cause et en reste là
Dans ce premier scénario, Trump proclame que la mission a été accomplie, présente la capture de Maduro comme un triomphe et réduit rapidement le rôle des États-Unis dans l’avenir immédiat du pays. Les institutions vénézuéliennes restent largement intactes. L’actuelle vice-présidente Delcy Rodriguez, le ministre de l’intérieur Diosdado Cabello et le ministre de la défense Vladimir Padrino Lopez dirigent un gouvernement reconstitué qui poursuit la ligne de gauche développée par feu Hugo Chavez, même si ce système est désormais privé de sa dernière figure de proue en la personne de Maduro.
Un tel développement conviendrait aux généraux états-uniens désireux de limiter les risques pour leurs troupes, ainsi qu’aux puissances étrangères soucieuses d’éviter un vide du pouvoir. A contrario, l’opposition vénézuélienne et les pays voisins qui ont subi des années d’afflux de réfugiés feraient la grimace.
Surtout, cela réduirait à néant l’influence sur le pays que Washington vient d’acquérir au prix de nombreux efforts. Après avoir pris la décision extraordinaire d’enlever un chef d’État, revenir en arrière et se contenter d’un léger remaniement du chavisme apparaîtrait comme une reculade contraire aux normes des interventions étrangères des États-Unis.
2. Un soulèvement populaire renverse le chavisme
Deuxième possibilité : le choc provoqué par la destitution de Maduro brise l’aura d’inévitabilité du gouvernement et déclenche un soulèvement populaire qui balaye le chavisme. Au vu de la vacance de la présidence et de l’affaiblissement des forces de sécurité, démoralisées ou divisées, une large coalition de partis d’opposition, de groupes de la société civile et de chavistes mécontents fait pression pour la mise en place d’un conseil de transition, peut-être sous l’égide de l’Organisation des États américains (OEA) ou des Nations unies.
Reste qu’une telle révolution, en particulier lorsqu’elle est soutenue par une ingérence extérieure, se déroule rarement sans heurts. Des années de répression politique, de crime organisé, de misère économique et d’émigration ont vidé la classe moyenne et les syndicats vénézuéliens de leur substance. Les colectivos armés – des groupes paramilitaires ayant un intérêt au maintien de l’ancien régime – opposeraient une résistance farouche. Il en résulterait peut-être non pas une avancée démocratique rapide mais une transition instable : un gouvernement provisoire fragile, des violences sporadiques et d’intenses luttes intestines sur les questions relatives aux amnisties et au contrôle du secteur pétrolier.
3. Les États-Unis installent à Caracas un pouvoir allié
Dans ce scénario, Washington tire parti de la nouvelle donne pour faire pression en faveur d’un changement complet de régime. Cela pourrait se traduire par un durcissement des sanctions à l’encontre des personnalités encore au pouvoir, par l’intensification des frappes contre les installations de sécurité et les milices, par un soutien secret aux factions insurgées et par l’utilisation du procès de Maduro comme d’une tribune mondiale pour délégitimer une fois pour toutes le chavisme.
Une personnalité reconnue en tant que leader de l’opposition serait portée au pouvoir à la suite d’une forme d’élection contrôlée, d’un conseil de transition ou d’une passation de pouvoir négociée – potentiellement, quelqu’un comme Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix 2025. Les États-Unis et leurs alliés proposeraient une restructuration de la dette et un financement de la reconstruction du pays en échange de réformes économiques libérales et d’un alignement géopolitique sur Washington.
Cette option est très risquée. Une transition ouvertement orchestrée par les États-Unis entacherait la légitimité du nouveau leadership vénézuélien, tant au niveau national qu’international. Elle aggraverait la polarisation du pays, renforcerait la dénonciation de l’impérialisme (ce qui est depuis longtemps un argument central du chavisme) et inciterait la Chine, Cuba, l’Iran et la Russie à s’ingérer également dans les affaires du pays. Un mouvement chaviste meurtri mais non brisé pourrait se transformer en résistance armée, faisant du Venezuela un nouveau théâtre d’insurrection de faible intensité.
4. Supervision par Washington et transition contrôlée
Une transition contrôlée : c’est l’option que Trump a ouvertement envisagée. Washington exercerait provisoirement sa tutelle sur le Venezuela. Les premières priorités seraient d’imposer une chaîne de commandement et de restaurer les capacités administratives du pays, de stabiliser la monnaie et le système de paiement, et de mettre en place des réformes progressives afin d’éviter l’effondrement de l’État pendant la transition.
Le calendrier politique serait alors une dimension essentielle. Washington exercerait une forte influence sur les dispositions provisoires en matière de gouvernance, les règles électorales et le calendrier des élections présidentielle et législatives, y compris la reconstitution des autorités électorales et la définition des conditions minimales pour la campagne électorale et l’accès aux médias. Les États-Unis n’auraient pas nécessairement besoin d’occuper le pays, mais ils pourraient avoir besoin de déployer des forces sur le terrain pour dissuader les fauteurs de troubles.
La logique économique de cette option reposerait sur le rétablissement rapide de la production pétrolière et des services de base grâce au soutien technique des États-Unis, à l’implication de leurs entreprises privées et à un allègement sélectif des sanctions. Des entreprises, telles que Chevron, la seule grande compagnie pétrolière états-unienne encore implantée au Venezuela, ou des prestataires de services pétroliers, comme Halliburton, seraient probablement les premiers bénéficiaires.
Là aussi, les risques sont considérables. Comme dans le cas précédent de l’arrivée au pouvoir d’une équipe ouvertement alignée sur Washington, une tutelle états-unienne pourrait attiser les sentiments nationalistes et valider le discours anti-impérialiste propre au chavisme. La menace implicite de l’utilisation de la force pourrait dissuader les groupes criminels, mais elle pourrait également approfondir le ressentiment et durcir la résistance des groupes armés, des partisans de Maduro ou de toute autre personne opposée à l’occupation.
5. Conflit hybride et instabilité contrôlée
Finalement, le plus probable est que tous les scénarios ci-dessus soient en quelque sorte mélangés : on assisterait alors à une lutte prolongée dans laquelle aucun acteur ne l’emporterait complètement. La destitution de Maduro pourrait affaiblir le chavisme, sans totalement détruire ses réseaux dans l’armée, l’administration et les quartiers défavorisés. L’opposition pourrait être revigorée mais demeurerait divisée. Sous Trump, les États-Unis seront puissants sur le plan militaire mais limités dans leur marge de manœuvre en raison de la lassitude de leur population à l’égard des guerres étrangères, de la perspective des élections de mi-mandat à venir et ees doutes quant à la légalité de leurs méthodes.
Dans ce cas de figure, le Venezuela pourrait sombrer dans plusieurs années d’instabilité contrôlée. Le pouvoir pourrait de facto être partagé entre une élite chaviste affaiblie, des figures de l’opposition cooptées dans le cadre d’un accord transitoire et des acteurs sécuritaires contrôlant des fiefs locaux. Les frappes sporadiques et les opérations secrètes des États-Unis pourraient se poursuivre en étant calibrées pour punir les fauteurs de troubles et protéger les partenaires privilégiés de Washington, sans aller jusqu’à une occupation de grande échelle.
Une doctrine Monroe 2.0 ?
Quel que soit l’avenir, ce qui semble clair pour l’instant, c’est que l’opération anti-Maduro peut être considérée, tant par ses partisans que par ses détracteurs, comme l’application d’une sorte de doctrine Monroe 2.0. Cette version, qui fait suite à la doctrine originale du XIXe siècle dans laquelle Washington mettait en garde les puissances européennes contre toute ingérence dans sa sphère d’influence, est une affirmation plus musclée selon laquelle les rivaux lointains des États-Unis et leurs clients locaux ne seront pas autorisés à avoir leur mot à dire sur le continent américain.
Ce message agressif ne se limite pas à Caracas. Cuba et le Nicaragua, déjà soumis à de lourdes sanctions états-uniennes et de plus en plus dépendants des soutiens russe et chinois, verront le raid vénézuélien comme un avertissement indiquant que même les gouvernements bien établis ne sont pas à l’abri si leur politique n’est pas suffisamment alignée sur celle de Trump. La Colombie, théoriquement alliée des États-Unis mais actuellement dirigée par un gouvernement de gauche qui a vivement critiqué la politique vénézuélienne de Washington, se retrouve prise en étau.
Les États petits et moyens, et pas seulement ceux d’Amérique latine, ne peuvent qu’être inquiets. Le Panama, dont le canal est essentiel au commerce mondial et à la mobilité navale des États-Unis, pourrait faire l’objet d’une pression renouvelée, Washington souhaitant pouvoir compter dans ce pays sur un pouvoir local qui sera proche de lui et qui bloquera les avancées chinoises dans les ports et les télécommunications. Le Canada et le Danemark auront également regardé cet épisode de très près, l’administration Trump ayant récemment rappelé avec force qu’elle convoite le Groenland.
Robert Muggah est cofondateur de l'Institut Igarapé, un groupe de réflexion brésilien indépendant qui bénéficie du soutien financier des gouvernements du Royaume-Uni, de la Banque interaméricaine de développement et de divers donateurs locaux au Brésil. Robert Muggah est également cofondateur de SecDev, un cabinet de conseil en cybersécurité et risques géopolitiques, et chercheur à l'université de Princeton. Il est aussi senior advisor au McKinsey Group. De plus amples informations sur ses affiliations sont disponibles sur les sites web des deux institutions.
04.01.2026 à 10:32
En quoi pourraient consister des sanctions économiques de l’UE contre Israël, et quels effets auraient-elles ?
Texte intégral (1648 mots)
Un cessez-le-feu a été proclamé à Gaza, mais l’armée israélienne continue d’y mener des opérations meurtrières. En outre, la reconstruction de Gaza coûtera des dizaines de milliards de dollars, et Israël ne compte pas y contribuer. Adopter des sanctions à son encontre pourrait changer les choses, dans ces deux domaines.
Plus de 69 000 morts et 170 000 blessés, une famine généralisée, 90 % des habitations endommagées ou détruites : tel était le bilan, au moment de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, le 10 octobre 2025, de plus de deux ans de massacres et de destructions. Gaza est dévastée.
« Le mérite premier de l’arrêt de la guerre d’extermination revient à la détermination de notre peuple à Gaza », avait alors déclaré Mustafa Barghouti, secrétaire général du mouvement de l’Initiative nationale palestinienne, un parti palestinien indépendant du Fatah et du Hamas. Si ces propos visaient d’abord à rendre hommage à la population palestinienne, ils résonnent néanmoins dans un contexte marqué par l’impunité générale des auteurs de ce que plusieurs organisations internationales de défense des droits humains, de même que la Commission chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, qualifient de génocide, et par la complaisance des principaux partenaires militaires et commerciaux d’Israël, qui n’ont pris aucune sanction significative à son égard.
Un cessez-le-feu qui n’est pas respecté
Le chemin vers la liberté et l’autodétermination du peuple palestinien reste encore long. Le plan de cessez-le-feu proposé par Donald Trump, largement favorable à Israël, offre peu de garanties à long terme. Aucun représentant palestinien n’a été associé à sa rédaction, et le texte ne mentionne même pas la Cisjordanie, pourtant sous occupation israélienne depuis cinquante-huit ans. De plus, au moins 266 Palestiniens ont été tués et 634 blessés depuis l’instauration du cessez-le-feu. Dans un texte publié le 8 décembre, Amnesty International affirme ainsi qu’« Israël continue d’imposer sciemment des conditions de vie amenant à la destruction du peuple palestinien à Gaza, sans aucun signe que cette pratique ou l’intention sous-jacente ait changé. C’est cela, un génocide. »
Cet accord de cessez-le-feu ne saurait donc écarter la perspective de sanctions économiques. Le 10 septembre dernier, la Commission européenne avait proposé la suspension de l’accord d’association UE-Israël sur les questions liées au commerce. Cette proposition reste pourtant, à l’heure actuelle – et plus encore depuis la proclamation du cessez-le-feu – au stade de simple déclaration d’intention.
Dans une analyse publiée sur Yaani le 29 septembre dernier, nous examinions les effets potentiels de telles sanctions, selon les pays qui les appliqueraient et les secteurs économiques ciblés. Nous en avions tiré trois conclusions.
L’UE peut agir de façon ciblée
Tout d’abord, l’Union européenne a les moyens d’agir. Elle est le premier partenaire commercial d’Israël. Nous avions calculé qu’une simple hausse tarifaire de 20 % à l’import et à l’export pouvait réduire le PIB israélien de 1,1 %. Pour une hausse tarifaire de 50 %, la diminution serait de 1,6 %. Ces chiffres sont des estimations basses car le modèle utilisé pour les obtenir ne tient pas compte des effets à long terme des sanctions. D’un autre côté, l’effet sur l’UE de telles sanctions serait quasi nul. Israël est certes un pays développé, mais son influence sur la chaîne de valeur mondiale n’est pas importante. L’UE peut aisément réorienter ses échanges vers d’autres partenaires commerciaux sans subir de conséquences économiques perceptibles.
Deuxièmement, une coalition élargie de pays sanctionneurs aurait un impact plus élevé. Si, en plus de l’UE, tous les États ayant voté pour l’adhésion de la Palestine à l’ONU (143 pays dont les « BRICS » : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) décidaient également de sanctionner Israël, une hausse tarifaire de 20 % ferait chuter le PIB israélien de 3,1 %, et une hausse de 50 % engendrerait une diminution de 4,4 %.
Enfin, nous avions examiné les secteurs pour lesquels les sanctions seraient les plus efficaces. Pour des sanctions à l’export vers Israël, nous avions montré qu’il s’agissait de l’automobile, des minéraux et du commerce de gros, qui inclut tous les biens exportés via des intermédiaires. Pour des sanctions à l’import en provenance d’Israël, le secteur de la tech est sans surprise le plus déterminant. Le secteur technologique représente près de 20 % du PIB israélien, et quasiment la moitié des exportations israéliennes. C’est donc un secteur à forte valeur ajoutée et très intégré au commerce international. C’est donc logiquement celui pour lequel des sanctions à l’import seraient les plus efficaces.
Sunrise ou Phoenix ?
Plus de deux ans de bombardements incessants sur Gaza ont engendré des destructions considérables. Des experts de l’ONU estiment le coût de la reconstruction à plus de 70 milliards de dollars, dont 20 milliards pour les seules trois prochaines années.
Ce chiffre ne correspond qu’au montant minimal requis pour rétablir des conditions basiques d’existence : d’après le rapport, « accès à l’eau potable, emplois d’urgence, fournitures médicales, sécurisation des habitations et des espaces publics en déblayant les gravats pouvant cacher des munitions non explosées ou les milliers de Palestiniens disparus ».
L’indécent projet « Sunrise » proposé par l’administration Trump, visant à transformer Gaza en une destination touristique de luxe pour 112 milliards de dollars, ignore complètement la participation des Palestiniens en remodelant leur territoire selon des intérêts externes, au détriment de leur histoire et de leur identité. À l’inverse, le plan Phoenix, élaboré par un collectif pluridisciplinaire (architectes, ingénieurs, juristes, sociologues, médecins, entre autres) de Palestiniens, est actuellement le seul à considérer la population locale avec décence.
De plus, le projet de l’administration Trump n’envisage pas de faire contribuer Israël au financement de la reconstruction. Or, les responsables de la destruction de Gaza, en premier lieu l’État d’Israël, doivent être financièrement tenus pour compte.
Avec la possibilité d’instaurer des droits de douane sur les échanges avec Israël, l’UE dispose précisément d’un levier concret pour faire supporter à l’économie israélienne, et aux entreprises européennes qui commercent avec elle, une part de ce coût. D’une part, cette taxe permettrait de prélever directement sur l’économie israélienne et ses partenaires une manne financière substantielle, qui pourrait ensuite être redistribuée aux institutions palestiniennes. Un calcul simple permet d’en avoir une idée.
Les échanges annuels entre l’UE et Israël s’élèvent à environ 70 milliards d’euros. Avec une taxe de 20 % et en tenant compte de la réduction des quantités échangées dues à la taxe avec une élasticité de -5, les échanges bilatéraux UE-Israël tomberaient à environ 28 milliards, générant un revenu tarifaire de l’ordre de 5 milliards d’euros chaque année. Rappelons qu’Israël retient en ce moment même 4 milliards de dollars de recettes fiscales palestiniennes, fonds essentiels au fonctionnement de l’Autorité palestinienne et à la fourniture des services de base à la population.
D’autre part, ces sanctions constituent également un instrument de pression pour contraindre l’État d’Israël à respecter le droit international et à assumer sa responsabilité morale, politique et matérielle dans l’oppression des Palestiniens.
Renoncer aujourd’hui au levier que constituerait l’adoption de sanctions vis-à-vis d’Israël reviendrait à abandonner une fois de plus la population palestinienne. L’Union européenne va-t-elle rester spectatrice d’un drame humain qu’elle a les moyens d’infléchir ?
Mohamed Bahlali ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
03.01.2026 à 16:00
Erasmus + et le retour du Royaume-Uni : choix politique ou décision pragmatique ?
Texte intégral (1510 mots)
Cinq ans après avoir quitté Erasmus +, le Royaume-Uni s’apprête à réintégrer le programme d’échanges européen, à l’horizon 2027. Au-delà du signal politique, cette décision résulte de réajustements pragmatiques qui éclairent les conditions de possibilité de coopérations universitaires stables à l’échelle internationale.
Depuis sa création en 1987, le programme d’échanges Erasmus s’est imposé comme l’un des piliers de la mobilité étudiante européenne. Plus de 16 millions de personnes – étudiants, apprentis, enseignants et personnels – ont effectué un séjour dans un autre pays européen, contribuant à structurer des coopérations durables entre universités.
Annoncée en décembre 2025, la réintégration par le Royaume-Uni d’Erasmus + à l’horizon 2027 « ne mettra pas fin au repli nationaliste – mais il constitue un pas dans la bonne direction », écrivait récemment dans The Guardian Julian Baggini, philosophe et chroniqueur.
Dans la presse européenne, ce retour a été lu comme un signal politique, modeste mais lisible, dans une relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne encore marquée par les séquelles du Brexit. Mais au-delà de cette lecture symbolique, il faut replacer la décision dans une séquence plus longue de choix éducatifs et institutionnels.
Quitter Eramus +, une décision coûteuse pour les universités britanniques ?
Après la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne, le retrait d’Erasmus+ en 2021 avait été perçu par la presse britannique et internationale comme une rupture nette dans les échanges éducatifs et culturels. Le gouvernement britannique avait alors justifié cette décision par une lecture principalement économique du programme, fondée sur une évaluation du rapport coûts-bénéfices, le Royaume-Uni étant présenté comme contributeur net à Erasmus+, c’est-à-dire recevant plus d’étudiants qu’il n’en envoie.
À lire aussi : Fin des séjours Erasmus au Royaume-Uni : les étudiants vont-ils payer le prix du Brexit ?
Pour compenser cette rupture, le gouvernement britannique a lancé le Turing Scheme. Doté d’environ £100 millions par an à son lancement, réduits à £78 millions pour 2025-2026, le programme finance la mobilité sortante d’environ 40 000 étudiants par an, un chiffre fréquemment invoqué pour attester du maintien de l’internationalisation des parcours.
Alors que la mobilité sortante a été globalement maintenue, la mobilité entrante en provenance de l’Union européenne s’est considérablement contractée. Rappelons qu’avant le Brexit, le Royaume-Uni figurait parmi les destinations les plus attractives d’Eramus, accueillant environ 22 000 étudiants du programme par an et en envoyant près de 16 400 vers d’autres pays européens. Selon l’Oxford Migration Observatory, la part des étudiants européens parmi les nouveaux inscrits internationaux est passée de 27 % en 2016-2017 à 7 % en 2023-2024.
Cette baisse n’a pas été compensée par l’augmentation des étudiants hors Union européenne, plus volatile et moins compatible avec l’exigence de planification académique de long terme (ouverture de diplômes conjoints, développement de collaborations scientifiques internationales, anticipation des recrutements enseignants dans la durée…).
Un rapport de 2024 souligne que ces évolutions se sont ajoutées à un contexte économique déjà dégradé – inflation des coûts, stagnation des frais d’inscription nationaux, dépendance accrue aux recettes internationales – accentuant les tensions structurelles pesant sur les universités britanniques. Si la baisse du nombre d’étudiants européens n’a pas affecté directement les recettes de frais d’inscription, elle a en revanche fragilisé l’accès à des financements européens pluriannuels, récurrents et prévisibles, contribuant à la mise sous tension des universités.
Les cadres multilatéraux, facteurs de stabilité pour la coopération universitaire
Le retour dans Erasmus+ répond à un décalage désormais manifeste entre les instruments mis en place depuis 2021 et leurs effets. Le maintien de la mobilité sortante n’a pas empêché l’affaiblissement des échanges avec les universités européennes. Et la hausse des étudiants hors UE – passés de 23 % à 38 % des entrants en 4 ans – repose sur des flux plus incertains, tributaires des politiques de visa et des capacités de financement individuelles.
Dans ce contexte, le retour à Erasmus+ apparaît moins comme un symbole politique que comme une réponse fonctionnelle à des déséquilibres désormais identifiés : réintroduire des échanges stabilisés là où les dispositifs unilatéraux ont montré leurs limites. Il contribue également à rétablir la perspective de la participation britannique aux coopérations universitaires européennes de long terme, notamment aux alliances universitaires européennes lancées par la Commission européenne en 2019.
Ce déplacement du cadrage politique est perceptible dans la presse britannique, qui souligne que la valeur d’Erasmus ne se réduit pas à un solde financier, mais tient à la circulation des savoirs, aux compétences acquises et au maintien de liens durables avec l’espace universitaire européen.
Dans une perspective comparative, le cas britannique n’est pas isolé. Aux États-Unis, la mobilité étudiante internationale est elle aussi liée à la politique d’immigration, rendant l’internationalisation universitaire vulnérable aux cycles politiques. Les données de l’Institute of International Education (IIE) montrent que les flux d’étudiants internationaux ont significativement varié au gré des restrictions et assouplissements de visas, renforçant l’intérêt de cadres multilatéraux plus stables.
Réintégrer Erasmus +, une décision pragmatique
Enfin, les évaluations européennes rappellent que la mobilité étudiante repose moins sur le seul niveau des financements que sur l’existence de cadres juridiques communs, de procédures bien établies et de partenariats durables. Lorsque ces cadres sont interrompus, les coopérations se délitent rapidement et se reconstituent lentement.
Dans un contexte de tensions économiques et d’incertitudes prolongées pour l’enseignement supérieur, le retour du Royaume-Uni dans Erasmus+ relève moins d’un choix idéologique que d’un réajustement pragmatique. Il ne résout ni les inégalités d’accès à la mobilité ni les fragilités financières d’un secteur déjà éprouvé. Mais il réintroduit des éléments essentiels au fonctionnement des universités : des règles communes, des procédures partagées et une prévisibilité minimale, sans lesquelles la gestion académique et budgétaire devient fragile.
Au-delà du cas britannique, cet épisode rappelle une évidence souvent négligée. Plus l’enseignement supérieur est exposé aux décisions politiques nationales, y compris lorsqu’elles touchent aux conditions d’exercice de l’autonomie académique, moins les cadres multilatéraux apparaissent comme des contraintes. Ils deviennent, au contraire, des conditions de possibilité.
À lire aussi : Universités américaines : l’internationalisation devient-elle une ligne de défense ?
Erasmus+ n’est ni une solution universelle ni un héritage à préserver par nostalgie ; son retour indique simplement le prix à payer lorsque des systèmes universitaires ouverts rompent avec les règles et la confiance qui rendent la coopération possible.
Alessia Lefébure ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
01.01.2026 à 16:47
Marchés prédictifs en ligne : miser sur un résultat sportif… ou sur la guerre en Ukraine
Texte intégral (3258 mots)
Certains parient sur l’issue de tel ou tel événement sportif. D’autres sur l’évolution à court terme d’un indicateur économique largement suivi. D’autres encore – parfois les mêmes – engagent des sommes importantes sur des questions nettement plus discutables d’un point de vue moral, comme la prise d’une ville en Ukraine par l’armée russe. Les sites permettant ce type de paris sont en plein essor.
Un marché prédictif n’est pas tout à fait un site de paris. C’est un dispositif de spéculation collective dans lequel des participants achètent et vendent des contrats indexés sur la réalisation d’un événement futur précisément défini (« X aura lieu avant telle date », « Y gagnera l’élection », etc.). Le prix de ces contrats fluctue en fonction de l’offre et de la demande : plus un événement est jugé probable par les participants, plus le contrat associé est recherché et plus son prix augmente.
À la date fixée – ou une fois l’événement tranché – le marché est résolu : si l’événement s’est bien produit, le contrat correspondant est payé à sa valeur maximale, tandis que les contrats perdants deviennent sans valeur. Les gains ou pertes des participants dépendent donc du prix auquel ils ont acheté ou vendu ces contrats avant la résolution.
Parce qu’ils incitent ceux qui disposent de bribes d’informations utiles à investir, et agrègent donc le savoir d’un maximum d’acteurs sur un événement, ces marchés se révèlent souvent étonnamment précis. Aux États-Unis, des marchés de paris très organisés consacrés à l’issue de l’élection présidentielle ont existé de la fin du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, notamment à New York. Paul W. Rhode et Koleman S. Strumpf ont montré que ces marchés ont fait preuve d’une précision remarquable, à une époque pourtant dépourvue de sondages scientifiques. Dans quinze élections présidentielles entre 1884 et 1940, le candidat favori un mois avant le scrutin a presque toujours remporté l’élection, avec une seule véritable exception.
Les versions décentralisées, comme Polymarket et Kalshi, ajoutent un avantage, selon leurs promoteurs : elles fonctionnent sans intermédiaire central, reposent sur la blockchain et permettent des échanges mondialisés, en résistant aux réglementations nationales (ces sites sont par exemple interdits en France). Mais cette décentralisation a un revers fondamental : le système ne peut pas, à lui seul, savoir ce qui se passe dans le monde réel. Il doit donc s’appuyer sur des oracles, c’est-à-dire des sources externes (médias, bases de données, experts, indicateurs publics) chargées de confirmer si un événement s’est effectivement produit. Lorsque la réalité est ambiguë, ces oracles peuvent être contestés. D’où la nécessité de mécanismes d’arbitrage humains, censés trancher les litiges : votes communautaires, comités de résolution ou décisions manuelles. Ces moments, où l’interprétation humaine reprend le dessus, constituent précisément le point de fragilité des marchés prédictifs décentralisés, car ils ouvrent la porte aux erreurs, aux biais… et parfois aux manipulations.
Entre vulnérabilités et défis informationnels : parier sur la guerre en Ukraine
Ces marchés de prédiction en ligne, en pleine croissance depuis plusieurs années, donnent à leurs utilisateurs la possibilité d’ouvrir des paris sur n’importe quel thème, y compris sur les sujets géopolitiques les plus sensibles.
Dernièrement, on constate l’existence de très nombreux paris portant sur la guerre en Ukraine, particulièrement documentée et suivie, et donc propice à une multiplicité de paris variés : pertes territoriales, échéances de cessez-le-feu, escalade nucléaire ou rencontres entre dirigeants sont au cœur des questions les plus convoitées. Derrière chaque prévision publiée se joue le sort de milliers de personnes dans la vraie vie. Mais pour les joueurs, les drames vécus par des individus concrets sur le terrain relèvent d’un simple jeu de spéculation. Certains de ces paris brassent des dizaines de millions de dollars.
Polymarket, premier site de marché prédictifs en termes de mises, a été fondé en 2020 par Shayne Coplan, brièvement devenu le plus jeune self-made milliardaire au monde. Simple d’accès, il permet aux internautes de parier en cryptomonnaies sur toutes sortes d’événements : rencontres politiques, compétitions sportives, actualités financières et culturelles. Cette pratique connaît un essor considérable, notamment depuis l’élection présidentielle américaine de 2024, au point que certains suggèrent que les prédictions étaient alors plus fiables que les sondages dans plusieurs États indécis.
Ce succès s’explique aussi par un environnement propice au développement des cryptomonnaies, dont l’usage ne cesse de croître depuis quelques années.
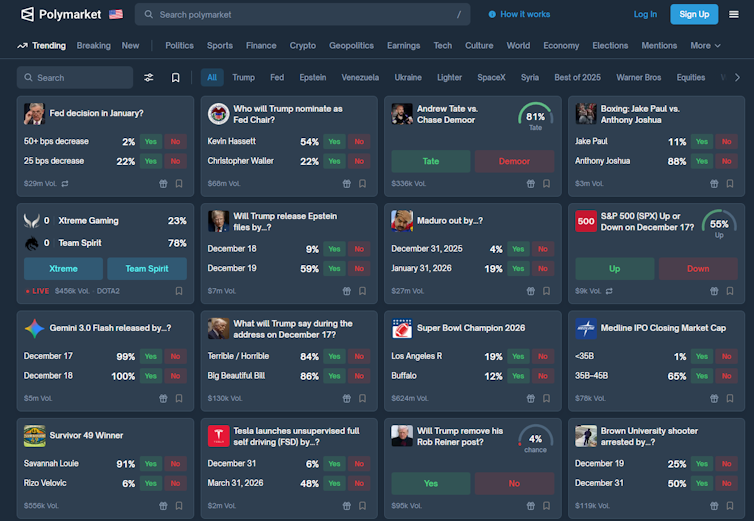
Plusieurs prédictions sur la guerre en Ukraine ont été fébrilement relayées durant la première moitié de 2025. Le premier exemple est celui de l’accord minier qui devait être signé par Donald Trump sur l’Ukraine au mois de mars. Malgré l’absence d’un tel accord, la plate-forme a été manipulée par une « baleine crypto » (quelqu’un qui détient une quantité massive d’une cryptomonnaie) qui a pu faire pencher la décision en sa faveur, avec en prime un remboursement impossible pour les parieurs lésés. À ce titre, Polymarket a répondu aux demandes des utilisateurs en précisant que le marché avait été résolu conformément au protocole.
Le second exemple porte sur la tenue du président ukrainien : il était question de parier sur le fait que Volodymyr Zelensky porterait un costume avant juillet 2025. Ce qui semble en apparence assez simple à prouver s’est en réalité avéré extrêmement compliqué, le critère de résolution et de validation du pari ayant été mal défini sur le site.
Derek Guy, spécialiste influent de la mode masculine, a indiqué que « la question était mal formulée » puisque la définition d’un costume peut varier, selon l’aspect technique du vêtement ou de l’attente sociale qu’on lui attribue. Alors que plus de 240 millions de dollars ont été échangés sur ce pari, le débat continue dans les commentaires, plusieurs mois après sa clôture. Courant novembre 2025, on dénombrait près de 100 paris possibles sur divers aspects relatifs à la guerre en Ukraine.
Un autre débat a émergé de la carte interactive Polyglobe, fondée par Le Pentagon Pizza Watch (PPW), un tracker qui surveille l’activité des restaurants autour de bâtiments gouvernementaux américains, en vue d’anticiper des actions stratégiques et militaires importantes. La visualisation des paris Polymarket sur une carte interactive est complétée par des données en sources ouvertes (OSINT), comme des tweets.
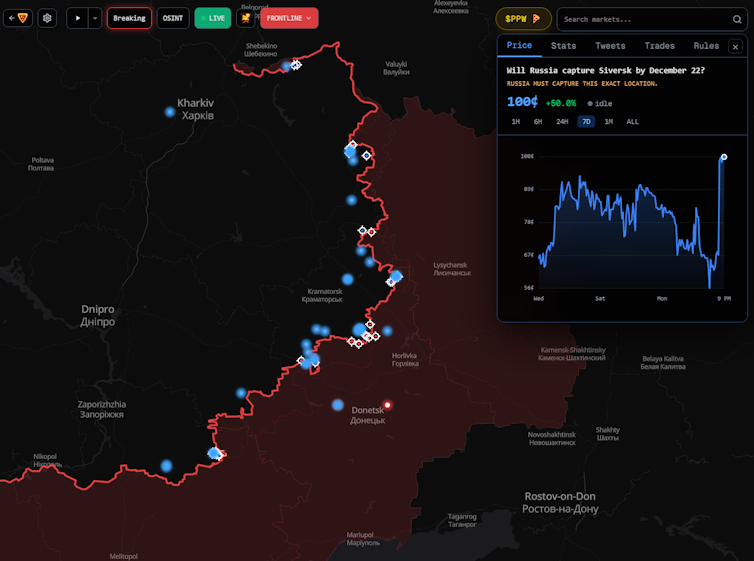
Il s’agissait pour les parieurs de prédire si l’armée russe allait réussir à capturer la ville de Myrhorod d’ici le 15 novembre. Les pronostics se basaient sur une carte du think tank Institute for the Study of War (ISW). Juste avant la clôture du pari, cette carte a indiqué une avancée russe à l’intérieur de la ville. La zone est apparue en rouge, donc aux mains de la Russie ; les parieurs ont été payés ; puis la carte a été corrigée peu de temps après. L’ISW a confirmé par la suite que la modification n’avait pas été approuvée en interne, ajoutant un système d’annotation tout en dénonçant l’utilisation de ses cartes par des spéculateurs.
Polyglobe a rapidement choisi de changer d’outil cartographique, et de passer désormais cette fois-ci par la carte interactive et collaborative de DeepStateMap.Live, qui affiche l’évolution quotidienne de la ligne de front en Ukraine. Les représentants de ce dernier site ont à leur tour dénoncé le réemploi non souhaité de leurs données à des fins de spéculation, PPW finissant par s’excuser et par retirer la carte. Ces changements et rétractations rapides illustrent bien la zone grise réglementaire dans laquelle évoluent ces nouveaux outils spéculatifs.
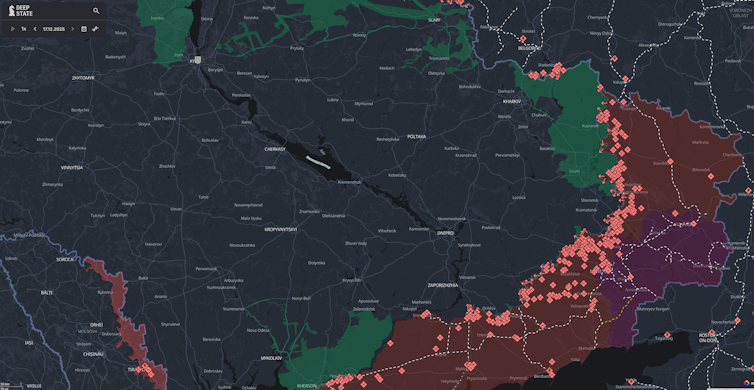
Une culture du jeu qui varie, une technologie qui s’en affranchit
La question morale est inévitable : comment est-il possible de parier sur la guerre, de surcroît dans un contexte où les combats s’intensifient et où les civils ukrainiens sont attaqués quotidiennement ?
Une première piste de réflexion est peut-être celle de la culture du jeu, qui varie considérablement d’un pays à un autre. Dans celle anglo-saxonne, dont est issu le fondateur de Polymarket, il n’existe aucun tabou en ce qui concerne les paris. Au Royaume-Uni, c’est même un « sport national », où il est possible, par exemple, de spéculer sur divers détails de la vie de la famille royale.
Cette conception de la prédiction est très différente de celle que nous avons en France, où l’Autorité nationale des jeux (ANJ) régule, entre autres, les sports sur lesquels il est possible de miser. Au niveau de l’Union européenne, il existe des socles juridiques communs et des initiatives de régulation, mais chaque membre fixe ses propres règles. Celles-ci sont d’autant plus disparates qu’elles sont désormais contournables par la décentralisation offerte par la blockchain, laquelle permet de se passer d’intermédiaires financiers soumis aux réglementations nationales. Le recours aux cryptomonnaies permet ainsi à ces plates-formes de contourner les interdictions bancaires, y compris dans les pays où Polymarket est interdit, comme en France, indépendamment des outils de contournement géographique tels que les VPN.
Au-delà des contraintes juridiques et des offres des bookmakers, ce sont aussi nos valeurs qui influencent nos limites philosophiques de ce qui est acceptable. Rappelons que les spéculations sur l’issue des conflits ne datent pas d’aujourd’hui. Entre autres exemples, en 1691, bien longtemps avant notre ère numérique, des paris avaient été pris en Angleterre sur l’issue de la bataille de Limerick en Irlande, qui opposa les partisans de Jacques II à ceux de Guillaume d’Orange.
Quelles limites pour le marché de la prédiction ?
Indéniablement, ces paris qui relèvent de vie et de mort, de guerre et de paix et d’enjeux géopolitiques lourds, posent des questions morales, mais ils nous interrogent aussi quant à toutes ces données du front rapidement diffusées et réinterprétées. Il est également établi que les jeux de hasard favorisent des problèmes psychologiques et émotionnels, sans occulter leur aspect addictif. Une étude de 2023 pointait les biais structurels qu’ils posent, notamment avec le phénomène de paris irrationnels.
Ce marché nous questionne aussi sur la vérification de l’information : les paris prédisent-ils seulement le cours des événements ou ont-ils un impact sur ces derniers ? Qui est légitime pour définir les contours d’un critère de résolution d’une issue ? La manipulation cartographique évoquée précédemment aurait pu poser des soucis de désinformation conséquents, surtout à un moment crucial de la guerre où chaque kilomètre carré capturé par des soldats est commenté en temps réel dans la presse.
L’instrumentalisation de ces données pour la spéculation menace l’intégrité de notre connaissance de la guerre, en mettant une pression supplémentaire sur les analystes qui traitent déjà de grands volumes d’informations, tout en sapant l’image des cartes militaires en ligne. Ceci est d’autant plus dangereux que des paris similaires existent sur à peu près tous les autres théâtres militaires en cours dans le monde.
Enfin, ces exemples nous rappellent les limites de ces plates-formes décentralisées qui font fi de toutes barrières éthiques et techniques. Miser sur le dresscode d’un président n’a évidemment pas la même signification morale que spéculer sur la capture d’un village de l’oblast de Donetsk. Est-il acceptable de parier sur la sécurité de civils et de mettre cela au même niveau que le résultat d’un match de football ? Il est sans doute temps de fixer une limite, a minima celle de l’empathie, pour éviter que la guerre ne soit reléguée à un divertissement, ce qu’elle n’est certainement pas.
Léo-Paul Barthélémy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
31.12.2025 à 11:24
« Le Tchékiste », un film culte en Russie sur la terreur léniniste, écrit par Jacques Baynac
Texte intégral (3080 mots)

Jacques Baynac, romancier, historien et militant français de gauche, avait beaucoup travaillé sur la période soviétique. Il a notamment rédigé le scénario d’un film devenu culte en Russie : « Le Tchékiste » montre les crimes de la Tchéka, la police politique créée sous Lénine et largement remise à l’honneur dans la Russie d’aujourd’hui.
En Russie, le 20 décembre reste appelé dans la population la « journée du tchékiste », même si, depuis 1995, son nom officiel est la « journée des travailleurs des organes de sécurité de la Fédération de Russie ». Ce jour-là, les employés et les « anciens » du FSB et de son prédécesseur d’avant la chute de l’URSS – le KGB, qui a lui-même succédé au NKVD et à la Tchéka révolutionnaire – rendent hommage à cette police politique qui, depuis sa création le 20 décembre 1917, a assassiné et déporté des millions de leurs compatriotes. Vladimir Poutine a lui-même réactivé ces célébrations et réhabilité le terme de « tchékiste ».
À l’inverse, au moins jusqu’au tournant répressif très violent qui a été pris dans le pays en 2021, des Russes qui déplorent les crimes soviétiques postaient souvent sur les réseaux sociaux, le 20 décembre, un lien ou des photos renvoyant à un film de 1992, Le Tchékiste, dont le scénario, basé sur un roman soviétique, a été écrit par Jacques Baynac (1939-2024), fils d’instituteurs du Lot.
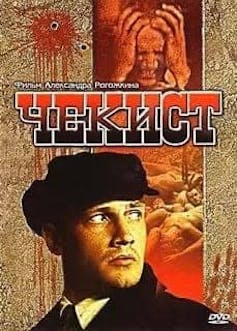
Lorsque Jacques Baynac, historien, romancier et scénariste, est mort à quatre-vingt-quatre ans le 3 janvier 2024, plusieurs articles ont récapitulé diverses étapes de sa vie longue et riche. Ils évoquaient le plus souvent son œuvre d’historien, bien sûr, mais aussi son refus de faire son service militaire pendant la guerre d’Algérie ; sa proximité passagère avec le trotskisme ; sa participation à la librairie La Vieille Taupe ; son opposition absolue à la « gangrène » du négationnisme (il la dénonce dans un article paru dans Libération le 25 octobre 1980) ; son rapport à mai 1968 et son appartenance à la gauche radicale : Baynac s’est trouvé au croisement de plusieurs aventures collectives de sa génération.
En revanche, sa détermination à dénoncer, dès les années 1970, les violences politiques exercées en URSS dès Lénine n’a été que peu rappelée.
Le Tchékiste, un film de 1992 sur la base d’un roman de 1923
Le livre sur lequel repose ce film – un roman très autobiographique de Vladimir Zazoubrine (1895-1938) – est paru en français en 1990. Écrit en 1923, avant la mise au pas de la littérature soviétique par le Parti, il n’a été publié en URSS qu’en 1989. Il porte, en russe, le titre Le Copeau, « Щепка » (Chtchepka), qui renvoie à l’expression « Quand on coupe du bois, les copeaux volent », généralement traduite par « On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ».
Dans ce titre russe, l’accent est donc mis à la fois sur l’insignifiance des victimes et sur la question fondamentale du texte, celle du but et des moyens, déjà amplement traitée par Dostoïevski. En revanche, le titre français met en relief l’homme qui exerce les répressions sommaires : le « héros », Sroubov, un homme aux « yeux de verre », est le chef local de la Tchéka, alors qu’il est issu de l’intelligentsia. Le préfacier à l’édition française, l’écrivain né en URSS Dimitri Savitski (1944-2019), note les trois thèmes mêlés dans ce roman : « l’abattoir sanglant » – les répressions –, sa « justification par la révolution » et « la destruction du matériau humain, à savoir la folie […] du tchékiste Sroubov ». Sans doute un quatrième thème, assez courant dans la littérature soviétique des années 1920, pourrait-il être ajouté : l’attitude du membre de l’intelligentsia face à la révolution qui exige de lui une transformation abrupte et totale de ses valeurs.
Jacques Baynac a rédigé, à partir de ce roman, un scénario ensuite tourné par le cinéaste Alexandre Rogojkine (1949-2021) dans le cadre d’une coproduction franco-russe. Ce film daté de 1992 montre l’horreur des exactions commises par la Tchéka dès les toutes premières années du pouvoir bolchevique et se veut une réflexion sur le rapport entre violence, terreur et révolution.
Pour l’essentiel, il consiste en une succession de scènes similaires : les séances d’une « troïka », cette commission de trois personnes, qui juge en quelques minutes et condamne systématiquement à mort ; les exécutions collectives des condamnés dans les sous-sols ; les évacuations de leurs corps morts, chargés comme des carcasses animales dans les bennes de camions. C’est une société que l’on extermine.
Une femme au physique de paysanne lave les sols et nettoie le sang versé : personne ne se soucie de ce peuple qu’elle incarne et qui ne participe pas aux massacres, même s’il en est le témoin. Finalement, Sroubov dont le père a été fusillé, perd la raison.
Des interrogations sur Lénine et un livre sur Kamo
Baynac, ayant « déjà lu des livres sur la terreur rouge », aurait compris dès les années 1963-1965 que, « le problème [du communisme], c’était le léninisme ». Ce qui était loin d’être le point de vue le plus répandu dans la gauche française de l’époque. (Sauf mention complémentaire, tous les commentaires de Jacques Baynac viennent d’une interview de lui, réalisée par l’autrice à Cahors, le 21 avril 2022. De nombreux éléments biographiques viennent également de cette interview.)
Parti volontairement en exil pour échapper à la conscription, le jeune homme revient en France en 1966 et commence à s’intéresser à la Russie : il suit notamment, à l’EHESS, les cours de George Haupt et d’Alexandre Benningsen.
C’est en découvrant l’histoire du bolchevik Kamo dans la biographie de Staline rédigée par Boris Souvarine, qu’il a l’idée de consacrer un livre à ce personnage peu ordinaire : Arménien élevé en Géorgie et passé comme Staline par le séminaire de Tbilissi, Kamo (1882-1922), Simon Ter-Petrossian de son vrai nom, ami de Lénine, a été chargé, à partir de 1906 au moins, des « expropriations », c’est-à-dire qu’il procurait au Parti argent et armes par tous les moyens, y compris par des attaques armées.
Déjà, Baynac s’intéresse donc aux pratiques du parti bolchévique du vivant de Lénine. Il s’appuie sur des sources disponibles en France, mais aussi en URSS : grâce à son contrat avec Fayard, il passe trois semaines à Moscou, Bakou et Tbilissi, pendant l’été 1970 ou 1971. Il voyage seul, ne parle pratiquement pas le russe, mais, racontera-t-il, une employée de l’Intourist l’attend à chaque étape pour lui organiser ce dont il a besoin, depuis les réservations d’hôtels jusqu’aux projections de films et aux rencontres éventuelles. Kamo, l’homme de main de Lénine, sort en 1972.
D’autres livres sur la révolution
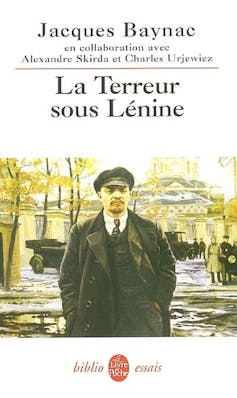
Baynac publie, deux ans plus tard, une étude collective sur la révolution de 1905 (Sur 1905, Éditions Champ libre, 1974) puis, en 1975, La Terreur sous Lénine (1917-1924). Entre ces deux livres, un événement s’est produit : L’Archipel du Goulag a commencé à paraître à Paris et une partie de la gauche française prend, un tant soit peu, conscience de l’ampleur des crimes soviétiques.
À lire aussi : « L’Archipel du Goulag » : trois tomes qui ont ébranlé le communisme
La Terreur sous Lénine, livre conçu par Baynac « en collaboration avec » Alexandre Skirda, spécialiste des anarchistes russes, et l’universitaire Charles Urjewicz, relance les débats. En effet, il inclut des textes qui, publiés dans les années 1920, en français pour la plupart, démontrent que l’usage de la terreur par Lénine pouvait être connu dès cette époque.
En outre, dans un article introductif, intitulé « Socialisme et barbarie », Baynac confirme que la terreur policière était utilisée sous Lénine déjà et qu’il n’y a donc pas de sens d’« accabler Staline pour mieux absoudre Lénine ».
Baynac est ici sur la même position que Soljenitsyne dans L’Archipel du Goulag, mais aussi que Vassili Grossman dans Vie et destin – un roman dont le KGB et le Comité central du PCUS ont empêché la parution au début des années 1960. En revanche, contrairement à Soljénitsyne, Baynac considère que Marx ne peut pas être rendu responsable de cette terreur : Lénine aurait créé « un capitalisme d’État policier. Qui n’a strictement rien à voir avec le projet de Marx ».
Le débat relancé porte donc sur le terrifiant bilan de la terreur soviétique, les origines de celle-ci, mais aussi les aveuglements occidentaux.
La perestroïka et le cinéma
La perestroïka offre à Baynac de nouvelles opportunités. En effet, Pierre-André Boutang, responsable des émissions culturelles sur FR3 et de la mythique émission Océaniques, puis, à partir de 1992, directeur délégué aux programmes de La Sept-Arte, s’intéresse beaucoup à ce qui se passe à l’Est et propose à l’auteur de Kamo de repérer, pour FR3, les films documentaires qui sont alors produits en URSS.
À partir de 1988, Baynac se rend donc, dira-t-il, à peu près tous les mois en Russie et organise des soirées thématiques sur Arte. Puis il propose à cette chaîne de produire sept films sur l’histoire soviétique en adaptant sept œuvres littéraires (en fait, il parlait de « six films », car il n’avait pas voulu que l’un des sept lui soit attribué). Ayant une vraie passion pour la littérature russe – « Comment, sans elle, comprendre la Russie ? », demandait-il –, il choisit lui-même les livres à adapter, selon « une logique historique, chronologique », et écrit les scénarios. « Ensuite, Arte a négocié avec Lenfilm, les studios de cinéma de Leningrad. Je n’ai pas suivi les tournages, il n’y a pas eu de réunions de travail. » Il n’a pas non plus choisi les réalisateurs et trouvait certains d’entre eux trop « nationalistes ».
Son choix d’auteurs témoigne d’une connaissance fine de la littérature russe et soviétique : Léonid Andreev pour 1905, Mark Aldanov sur février 1917, Vsevolod Ivanov pour 1920, Vladimir Zazoubrine sur la terreur rouge, Sergueï Zalyguine (Au bord de l’Irtych) sur la collectivisation des campagnes, Lidia Tchoukovskaïa (La Plongée) sur les purges d’après la Seconde Guerre mondiale, Andreï Bitov pour la Russie de la perestroïka. Tournés par des réalisateurs différents, ces sept films sont diffusés sur Arte à partir de janvier 1993, comme pour expliquer aux Français ce qui s’est passé en URSS pendant plus de sept décennies.
Six de ces films sont, aujourd’hui, à peu près oubliés. Pas Le Tchékiste, dont le scénariste répondait, en 2022, par un oui très net à la question suivante : « Peut-on considérer ce film comme la continuation de votre travail sur la terreur et Lénine, un travail commencé dans les années 1960 ? »
Mais Baynac a cessé, vers 1994, de s’intéresser à la Russie, « d’autant – disait-il – que les archives s’ouvraient et que c’était aux historiens russes de faire le travail historique », et il ignorait tout du statut culte qu’a, en Russie, Le Tchékiste, ce long-métrage devenu un symbole pour ceux qui refusent d’oublier, de justifier et de banaliser les crimes soviétiques.
Dimitri Savitski écrivait dans la préface française du Tchékiste : « Évoquer l’attitude du KGB envers son passé n’est pas un exercice gratuit, car le sort du pays dépend en grande partie de cette organisation. » Ni Savitski, ni Baynac, ni Rogojkine ne se doutaient sans doute à quel point.
Cécile Vaissié ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
30.12.2025 à 12:31
La reconnaissance du Somaliland par Israël : un cadeau empoisonné ?
Texte intégral (1759 mots)
Israël vient de devenir le premier pays à reconnaître l’indépendance du Somaliland, plus de trente ans après que celui-ci se soit de facto totalement détaché de la Somalie. À travers cette décision, Tel-Aviv cherche à obtenir une place forte sur la très stratégique mer Rouge, à faire pencher en sa faveur les équilibres géopolitiques régionaux et, possiblement, à expulser vers ce territoire de la Corne de l’Afrique de nombreux Palestiniens. Le Somaliland se réjouit de cette première reconnaissance internationale, mais est-il vraiment positif pour lui de se retrouver ainsi l’obligé d’Israël ?
Le 26 décembre dernier, Israël a surpris le monde entier en reconnaissant officiellement l’indépendance du Somaliland. Quelles sont les motivations de cette annonce inattendue, et quelles conséquences peut-elle avoir ?
Une anomalie diplomatique
L’État du Somaliland, formé en 1991, est indépendant à tous points de vue, mais Israël est le premier État souverain à le reconnaître. Pour tous les autres pays et les organisations internationales, le Somaliland (4,5 millions d’habitants) reste sous le contrôle de l’État somalien, duquel il a fait sécession après avoir subi une guerre aux allures de génocide à la fin des années 1980.
Aujourd’hui, l’État fédéral somalien est en proie aux attentats commis par les organisations Al-Chabaab et État islamique, connaît un niveau de violence élevé et un degré de corruption à battre tous les records.
En comparaison, le Somaliland est un havre de paix démocratique et stable, qui jouit de sa propre Constitution, d’un système politique et électoral qui fonctionne plutôt bien, de sa propre monnaie et de sa propre armée.

Le président Abdirahman Irro avait certainement besoin de cette bonne nouvelle. Après sa victoire le 13 novembre 2024, son gouvernement s’est enlisé dans des conflits claniques et a fait peu de progrès sur les fronts critiques de l’emploi des jeunes, de la croissance économique et de la lutte contre l’inflation. Après l’annonce israélienne, des foules en liesse sont descendues dans les rues de Hargeisa, la capitale du Somaliland.
Qu’apporterait une large reconnaissance internationale aux Somalilandais, à part la fierté ? L’acceptation de leurs passeports et l’intégration dans les systèmes bancaires internationaux, ce qui facilitera le commerce, ainsi que la liberté pour le gouvernement d’emprunter de l’argent aux organisations financières internationales afin de financer le développement.
Mais on n’en est pas là. Le président Trump n’a pas donné suite à l’initiative israélienne. « Qui sait ce que c’est, le Somaliland ? » a-t-il demandé.
Cependant, on sait que les États-Unis ont récemment visité les côtes du Somaliland pour étudier la possibilité de l’implantation d’une base militaire.
Une ligne de fracture géopolitique
Les vives réactions de l’Union africaine, de l’Égypte, de la Turquie et de maints autres membres de l’Organisation de la coopération islamique, qui ont tous affirmé leur attachement à l’intangibilité des frontières de la Somalie, dessinent une ligne de fracture géopolitique qui risque de s’aggraver dans un proche avenir. De l’autre côté, les pays qui estiment que l’indépendance du Somaliland serait dans leur intérêt – les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et le Kenya – gardent le silence. Le ralliement à ce camp d’Israël – et potentiellement, un jour, des États-Unis – lui donne cependant beaucoup plus de poids.
Officiellement, Israël n’a donné aucune explication spécifique justifiant cette reconnaissance. Mais la plupart des analystes s’accordent à dire que la sécurité des lignes maritimes menant, par la mer Rouge, au port israélien d’Eilat et au canal de Suez en est la raison principale. Les côtes du Somaliland, en face du Yémen et proches du détroit de Bab el-Mandab, offriraient à l’État hébreu une plate-forme pour prendre en tenaille le Yémen des Houthis et déjouer l’influence régionale turque.
Un deuxième intérêt moins cité est le désir israélien de trouver un pays qui accueillerait les Palestiniens que le gouvernement Nétanyahou cherche à expulser. Plus tôt cette année, les efforts israéliens et américains visant à négocier un accueil des Palestiniens dans divers pays, y compris au Somaliland, ont fait couler beaucoup d’encre. Bien qu’un tel scénario paraisse à ce stade hautement invraisemblable, l’État somalilandais pourrait y trouver son avantage, si cela impliquait une reconnaissance internationale plus vaste et d’importants transferts de fonds.
Rappelons à cet égard que l’exode de centaines de milliers de Palestiniens vers le Koweït et d’autres pays du Golfe après l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza en 1967 contribua fortement au développement économique de ces pays. Mais les conditions étaient différentes. La main-d’œuvre palestinienne, éduquée et professionnelle, tombait à pic pour ces pays riches en pétrole mais manquant de ressources humaines, et par ailleurs arabophones. Au Somaliland, où 70 % des jeunes ne trouvent pas d’emploi, les Palestiniens auraient beaucoup plus de mal à s’intégrer.
Un troisième intérêt pourrait être de bouleverser un ordre régional globalement hostile à Israël. La reconnaissance du Somaliland, surtout si les Émirats, l’Éthiopie et les États-Unis venaient à emboîter le pas à Israël, sème le trouble parmi les rivaux de Tel-Aviv : l’Iran et le Yémen des Houthis, la Turquie et le Qatar (sponsors principaux de l’État fédéral somalien), ainsi que l’Égypte, alliée du Soudan, de l’Érythrée et de Djibouti pour isoler le rival éthiopien.
Un cadeau empoisonné ?
Cette reconnaissance surprise semble un pari risqué mais pourrait rebattre les cartes en faveur d’Israël. Un facteur clé est la légitimité domestique et la stabilité du gouvernement somalilandais, qui en fait un meilleur allié que le gouvernement de la Somalie fédérale.
À court terme, l’annonce semble jouer en faveur du président Irro et du légitime désir de reconnaissance du peuple somalilandais. Mais rentrer ainsi dans le camp israélien pourrait s’avérer, à moyen terme, un cadeau empoisonné. Les islamistes d’Al-Chabaab ont laissé le Somaliland tranquille depuis 2008 mais, de même que l’immense majorité des quelque 12 millions de citoyens de l’État fédéral, ils voient d’un très mauvais œil ce qui relève à leurs yeux d’une trahison à la fois de la cause palestinienne et de l’unité du peuple somalien. À suivre…
Robert Kluijver ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
28.12.2025 à 10:34
Donald Trump et les « frappes de Noël » sur le Nigeria
Texte intégral (2011 mots)
Selon Donald Trump, les frappes qui, le jour de Noël, ont visé des groupes djihadistes au Nigeria visaient à protéger les chrétiens de ce pays, qui seraient victimes d’un « génocide ». Qu’en est-il réellement, et quelles pourraient être les conséquences de ces bombardements ?
Cette année, la déclaration de Noël du président des États-Unis a de quoi surprendre : Donald Trump a ironiquement souhaité un « joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts » dans les bombardements américains du jour même et a conclu en évoquant la possibilité d’une intervention militaire au Nigeria, dans un message censé célébrer la paix. Mais c’est la géographie de ces frappes qui étonne le plus les observateurs : les bombardements n’ont pas visé les positions bien connues de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, situées dans l’État de Borno (nord-est du pays, dans la région du lac Tchad) mais se sont concentrés sur l’État de Sokoto (nord-ouest), soit à l’autre extrémité de la frontière septentrionale du Nigeria.
La Maison Blanche prétendant avoir touché des cibles appartenant à l’État islamique, nous pouvons en déduire que ces frappes ont certainement visé un groupe djihadiste récemment implanté dans la région appelé Lakurawa. Pour autant, contrairement à ce que Trump suggère, ce groupe ne constitue pas une menace pour la survie des chrétiens dans la région, puisqu’il ne regrouperait qu’environ 200 combattants, chiffre dérisoire si on le compare aux forces de l’État islamique en Afrique de l’Ouest ou de Boko Haram (plusieurs milliers de combattants) ou au nombre colossal de « bandits », ces groupes criminels qui s’attaquent aux communautés rurales du nord-ouest afin de s’enrichir via le pillage et les rançons.
Ce sont donc d’abord ces « bandits » qui frappent les minorités chrétiennes de Sokoto et sont à l’origine d’opérations spectaculaires — comme récemment l’enlèvement massif de fidèles le 19 novembre dernier dans une église pentecôtiste dans la ville d’Eruku — afin de capturer et de rançonner les populations rassemblées lors des messes. Dès lors, les chrétiens du Nigeria sont-ils réellement menacés avant tout par l’État islamique, comme l’affirme la Maison Blanche ? Et si tel est le cas, l’intervention américaine pourrait-elle les protéger sur le long terme ?
L’État islamique en Afrique de l’Ouest : vers une nouvelle stratégie
Il est incontestable que le sort des chrétiens dans les États du nord est préoccupant. Depuis 2009, on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de victimes chrétiennes dans les 12 États septentrionaux, où ils constituent environ 10 % de la population totale. Dans la région du lac Tchad, les chrétiens sont parfois pris pour cible lors d’attaques terroristes organisées par Boko Haram comme celle de Chibok en avril 2014, quand 276 lycéennes, la plupart chrétiennes, avaient été enlevées.
Néanmoins la fréquence des attaques contre les civils chrétiens décline dans la région, notamment depuis 2021, année de la reprise de contrôle de Boko Haram par l’État islamique en Afrique de l’Ouest, qui élimina alors le chef de l’organisation, Aboubakar Shekau. Partisan d’un djihad brutal qui se nourrit de razzias menées à l’encontre des « Koufars » (les non-musulmans) et des « apostats » (les musulmans qui refusent la tutelle de Boko Haram), Shekau avait été destitué par l’EI en 2016 au profit d’Abou Mousab Al-Barnaoui, le fils du fondateur de Boko Haram, qui fut alors nommé wali, c’est-à-dire gouverneur, dans la région du lac Tchad.
Les dirigeants de l’EI reprochaient à Shekau la violence extrême de ses méthodes et son incapacité à abandonner le pillage systématique des populations civiles pour se muer en une force de gouvernement capable de gérer des territoires et d’y prélever l’impôt. Soucieux de perpétuer la razzia contre les civils, Shekau a donc créé sa propre faction, le Groupe sunnite pour la prédication et le djihad ou JAS, l’ancien nom du groupe Boko Haram, ce qui a incité l’EI à l’éliminer en 2021.
Le lac Tchad constitue donc un nouveau laboratoire où l’EI essaie de dépasser sa matrice prédatrice et criminelle en limitant l’influence de ses membres les plus extrémistes comme Shekau et en freinant les persécutions contre les civils afin de pérenniser son califat.
Dans ce contexte, les frappes décidées par Trump, qui prétendent viser l’État islamique, sont un peu à contre-courant des évolutions récentes du groupe dans la région : les principales attaques de 2024/2025 sont davantage revendiquées par la mouvance de Shekau (dirigée après 2021 par son successeur Ibrahim Mamadou Bakoura, dont la mort a été annoncée plusieurs fois sans qu’on puisse en être entièrement certains), que par l’État islamique en Afrique de l’Ouest, qui tente de ne pas complètement perdre le soutien des populations locales.
L’EI a, semble-t-il, tiré les enseignements de ses échecs au Levant, où il s’est vu supplanter par des djihadistes plus pragmatiques, qui refusent la persécution systématique des civils s’éloignant de l’orthodoxie sunnite.
Des chrétiens victimes de l’insécurité plus que de l’islamisme
Si la fréquence des opérations revendiquées par l’EI diminue, qu’est-ce qui explique la persistance des attaques dont les chrétiens sont victimes, notamment dans ce qu’on appelle la Middle Belt, ces États à l’interface entre la partie musulmane et la partie chrétienne du pays ?
Plus que la religion, c’est la question foncière qui semble être l’enjeu fondamental des affrontements inter-religieux, dans ces territoires où, comme dans l’État de Plateau, les éleveurs nomades musulmans peuls se disputent les terres possédées par les agriculteurs sédentaires chrétiens, yorubas pour l’essentiel. En mars et en avril 2025, une centaine d’agriculteurs chrétiens sont ainsi massacrés dans l’État de Plateau par des éleveurs peuls. Dans l’État voisin de Benue, des agriculteurs chrétiens sont massacrés pour des raisons identiques les 24 et 26 mai 2025.
Les migrations internes, et l’aridité croissante dans le nord du pays, qui déplace toujours plus au sud les itinéraires de la transhumance, conduisent à des conflits pour le contrôle de la terre où les clivages religieux (musulmans contre chrétiens) et ethniques (Peuls contre Yorubas) se confondent avec le clivage conflictuel classique entre pasteurs nomades et agriculteurs sédentaires.
En plus des conflits liés à la terre, les agriculteurs chrétiens, comme les populations musulmanes, sont aussi victimes des « bandits », qui s’attaquent aux communautés rurales les moins protégées, quelle qu’en soit la religion. Ils profitent de la faillite de l’État nigérian dont l’armée est débordée face aux nombreuses menaces : menaces sécessionnistes au sud-est où les insurgés igbos menacent de reprendre les armes contre l’État dans la région du Biafra, piraterie sur le littoral, djihadisme dans la région du lac Tchad et maintenant banditisme dans tout le nord du pays.
Des frappes contre-productives
Dans ce contexte, quelles pourraient être les conséquences des frappes lancées par Trump ? Bien loin d’endiguer les violences contre les civils, elles pourraient avoir l’effet inverse. Les bombardements américains ont fait ressortir l’impuissance de l’État nigérian à contrôler son propre territoire et ont mis le gouvernement sous pression. Elles peuvent, paradoxalement, inciter les « bandits » à s’en prendre encore plus aux chrétiens, dont la rançon augmente à mesure que Washington exige du Nigeria qu’il garantisse leur sécurité.
Pis : la faiblesse de l’État nigérian pourrait pousser les populations musulmanes à s’organiser en milices d’autodéfense pour pallier les faiblesses de l’État. Or, c’est précisément dans ce contexte que se développent les groupes djihadistes dans l’État de Sokoto (le groupe Lakurawa s’apparente à l’origine à une milice d’autodéfense composée de soldats provenant du Mali ou du Niger, destinée à protéger les populations musulmanes contre les « bandits »). Les frappes américaines finissent d’achever, aux yeux de nombreux musulmans du Nord, la crédibilité d’un État nigérian assimilé de façon abusive aux ethnies chrétiennes du Sud et accusé d’abandonner les États musulmans du Nord.
Assimilé à une puissance extérieure, l’État nigérian pourrait de plus en plus être perçu comme une force d’occupation par les populations musulmanes locales, ce qui permettrait aux djihadistes de développer leur propagande classique, à savoir appeler à défendre le « Dar al Islam » menacé par les « croisés » et par un « État mécréant ».
Ainsi, les frappes lancées par Trump le 25 décembre dans l’État de Sokoto ne font pas sens si l’on considère l’environnement géopolitique régional. Peu présent dans la région, l’État islamique en Afrique de l’Ouest pourrait même se voir renforcé par ces opérations américaines. Mais pour le locataire de la Maison Blanche, c’est sans doute secondaire : le plus probable est que l’objectif premier des frappes de Noël a été de satisfaire l’aile évangélique de la branche MAGA à un moment où une partie de celle-ci se met à douter du président du fait de sa gestion de l’affaire Epstein. Ici comme en d’autres points du globe, la politique étrangère de Trump poursuit des objectifs d’abord domestiques : il s’agit de conserver le soutien du mouvement MAGA, en prétendant agir au nom des intérêts stratégiques américains et de la protection d’une minorité menacée.
Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.12.2025 à 14:26
Transition énergétique juste : comment éviter les gilets jaunes en Indonésie ?
Texte intégral (3576 mots)
La réduction des émissions risque d’accroître les inégalités et de faire peser la transition sur les plus pauvres. Sans compensations sociales ciblées, des mesures en ce sens, du type taxe carbone, pourraient susciter des protestations sociales, à l’image du mouvement des « gilets jaunes » qu’a connu la France.
Le renchérissement du prix du carbone est un levier important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais les conséquences sociales de ce type de mesure peuvent être importantes, comme l’a rappelé la crise des « gilets jaunes » en France. Cette contestation sociale, multifactorielle, a été déclenchée notamment par une hausse de la taxation des carburants, qui renforçait le clivage entre ménages urbains (plus riches en moyenne, ayant accès à des mobilités à bas coût et à une proximité des services publics) et les ménages ruraux (moins riches en moyenne, utilisant leur véhicule personnel motorisé par des carburants fossiles et moins bien desservis par des services publics dispersés).
Compte tenu de la forte sensibilité sociale du prix de l’énergie et des carburants, les décideurs publics doivent porter une forte attention aux conséquences des mesures prises sur la distribution des revenus, la position relative des groupes sociaux et l’accès aux services publics. Dans un pays aussi vaste et géographiquement fragmenté que l’Indonésie, ces questions universelles prennent un accent plus complexe et, parfois, plus dramatique qu’ailleurs.
Les politiques mises en œuvre en Indonésie
L’engagement de l’Indonésie envers la réduction des émissions de carbone est aligné avec ses responsabilités dans le cadre de l’Accord de Paris, signé et ratifié en 2016. L’Indonésie s’est engagée à réduire de 29 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030 de manière indépendante, ou de 41 % avec la coopération internationale. Plus tard en 2022, le gouvernement indonésien a mis à jour son engagement, affichant un objectif de réduction des émissions de GES plus élevé de 31,9 % (inconditionnel) et 43,2 % (conditionnel).
Dans ce cadre, la tarification du carbone est une stratégie essentielle pour réduire les émissions de GES. Les principales méthodes incluent les taxes sur le carbone et les systèmes d’échange de quotas d’émission (ETS). Les taxes carbone influencent directement les prix du carbone, tandis que les ETS limitent la quantité de carbone que les émetteurs peuvent libérer, influençant indirectement les prix du carbone à travers le coût des permis d’émission.
En 2021, l’Indonésie a initié un cadre de tarification du carbone, visant à atteindre ses objectifs climatiques et à gérer les émissions de GES dans le cadre de ses plans de développement nationaux.
Le gouvernement indonésien avait initialement l’intention d’introduire des instruments de tarification du carbone volontairement de 2021 à 2024, avec un passage à une application obligatoire prévu d’ici 2025. Avec un coût d’environ 2 $ pour chaque tonne d’équivalent CO2, ce taux serait l’un des plus bas au monde, mais malgré ses débuts modestes, l’introduction de cette taxe marque un progrès considérable en Indonésie.
Ces mesures, bien que bénéfiques pour l’environnement, peuvent involontairement augmenter les inégalités. La transition énergétique de l’Indonésie présente donc un défi complexe alors que le pays cherche à équilibrer croissance économique, sécurité énergétique et durabilité environnementale tout en s’attaquant aux émissions croissantes de CO2.
Ces politiques doivent être soigneusement conçues pour assurer une transition énergétique juste (JET) et être socialement acceptées. En partenariat avec le ministère indonésien des finances, des chercheurs du LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), le centre de recherche économique et sociale de l’Université d’Indonésie à Jakarta, appuyés par des experts internationaux (université de Galway en Irlande, université de Tulane aux États-Unis), ont exploré et modélisé les modalités d’une telle taxation et ses conséquences en matière de redistribution des revenus. Il apparaît qu’un renchérissement de l’énergie en Indonésie pourrait diminuer les émissions mais conduirait à une aggravation des inégalités, sauf s’il était accompagné d’une politique d’allocations sociales bénéficiant effectivement aux ménages les plus pauvres.
Une problématique énergétique complexe
L’Indonésie est un très vaste archipel composé de plus de 17 000 îles dispersées sur plus de 5 000 km de large et 3 000 km de long. Autant dire que, même si la moitié de la population est concentrée sur l’île de Java, la question des transports et de l’accès aux services publics essentiels y est majeure.
La production et la distribution électriques sont un autre défi : faute d’interconnexion entre les réseaux, elles doivent être assurées « île par île ». Si cela permet à l’essentiel de la population d’avoir accès à l’électricité, chaque installation est calibrée pour la demande maximale de l’heure de pointe, ce qui fait qu’elle est fortement sous-utilisée le reste du temps. Dès lors, la construction, l’entretien et la maintenance de cette constellation de réseaux surcapacitaires sont particulièrement coûteux.

À cela s’ajoute une situation pour le moins étonnante : le prix de vente de l’électricité en Indonésie ne couvre pas son coût de production. Aucun consommateur indonésien, qu’il soit riche ou pauvre, industriel ou particulier, ne paye son énergie électrique au prix qu’elle coûte effectivement à produire (y compris produite avec du charbon subventionné). Cela résulte notamment de la politique de gel des prix de vente décidée en 2017 pour des motivations sociales, et des forts coûts structurels de production déjà mentionnés. Le déficit induit pour la compagnie électrique nationale PLN est important, et il est intégralement financé par une subvention d’équilibre du budget de l’État.
Comme tous les pays émergents, l’Indonésie est un gros émetteur de gaz à effet de serre (GES). Elle est l’un des cinq plus gros producteurs de charbon et le premier exportateur mondial, ce qui signifie que, dans une perspective de décarbonation de la production d’énergie, ce secteur représente un enjeu important en termes de reconversion industrielle par le nombre des sites et des emplois.
Pour autant, les incitations à la reconversion manquent, dans la mesure où le prix du charbon est subventionné par le gouvernement. S’y ajoutent les GES qu’elle exporte chez ses acheteurs de charbon et les émissions au titre de la déforestation accélérée que le pays a connue depuis les années 1990 quand il a choisi de produire massivement de l’huile de palme.
Le risque de faire peser la transition sur les plus pauvres
Une façon de réduire l’empreinte carbone de l’économie indonésienne serait de mettre en place une taxe carbone, assise sur les carburants (option simple) ou sur des quotas d’émissions de GES (option plus sophistiquée). L’objectif : réduire la demande en énergie carbonée en provoquant, via la taxe, une hausse du prix relatif.
Cependant, si l’on s’en tient à cette seule étape, le risque est de rendre les pauvres encore plus pauvres (car ils contribuent à la taxe carbone) et de leur faire payer le coût de la transition énergétique, alors qu’ils ont des émissions nettement plus faibles, qu’ils ne sont pas les principaux responsables du changement climatique et qu’ils sont plus vulnérables face à ses conséquences (notamment en zone côtière, où vit 70 % de la population).

Ce paramètre est d’autant plus important que les inégalités de revenus demeurent fortes en Indonésie (avec un coefficient de Gini autour de 0,4), comme l’a montré le diagnostic sur les inégalités multidimensionnelles, mené par LPEM en 2023 avec l’appui de l’Institut national des statistiques indonésien (BPS). Et comme les ménages à faible revenu dépensent une plus grande proportion de leurs revenus dans l’énergie, les effets régressifs de la taxe carbone (charge relative plus élevée pour les pauvres) sont élevés et, pour atteindre l’Objectif de développement durable n°10 (réduction des inégalités), ils doivent être compensés.
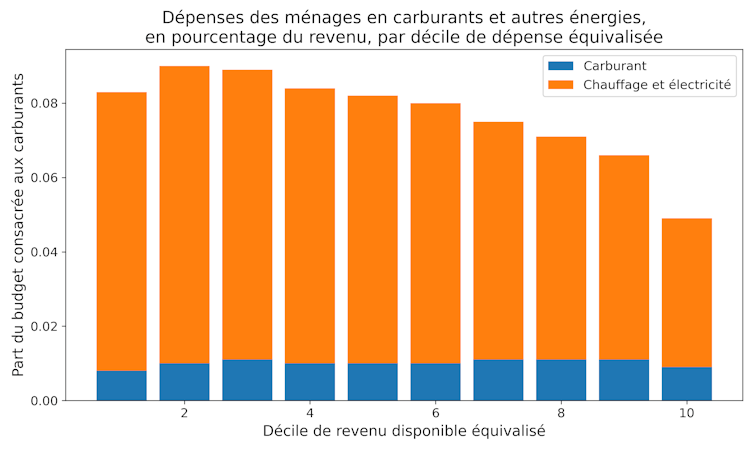
Lorsqu’on vise une transition énergétique juste — caractérisée par une double réduction des émissions de dioxyde de carbone et des inégalités sociales et un principe émetteur-payeur pour les principaux responsables des émissions — il faut donc tenir compte de ces différentes dimensions pour trouver une juste voie.
Comment bâtir une transition juste ?
Dès lors, l’objectif environnemental n’est pas compatible avec l’objectif social… sauf si vous disposez d’un canal dédié pour rediriger une part des revenus fiscaux tirés de la taxe carbone directement vers les ménages les plus pauvres.
Si l’on parvient à rendre l’argent prélevé, on peut gagner sur les deux tableaux : réduction simultanée de l’empreinte carbone et des inégalités de revenus. Au risque, sinon, d’aller vers une contestation sociale de type « yellow batik », qui serait le pendant indonésien des gilets jaunes français.
L’étude menée par LPEM s’est donc intéressée aux mécanismes envisageables pour compenser la hausse des prix de l’énergie pour les plus pauvres, qui pourraient être financés en « recyclant » les recettes générées par la taxe : une exonération de TVA pour les produits de première nécessité ; la mise en place d’un revenu minimum universel (une sorte de RSA indonésien) ; l’octroi d’un chèque énergie aux foyers les plus pauvres ; des primes salariales pour les bas salaires ; des prestations sociales sous condition de ressources.
L’étude compare les différents effets redistributifs de ces mesures et conclut que le choix du mécanisme de « recyclage des revenus » façonne de manière significative les résultats d’équité d’une politique de taxe carbone. Les avantages ciblés (mécanismes 2 à 5) offrent le plus grand impact redistributif, tandis que les réductions des impôts indirects (mécanisme 1) ont tendance à avoir un effet plus neutre. Dans le cas de l’Indonésie, la stratégie de recyclage des recettes provenant de la taxe carbone joue un rôle plus central que la taxe carbone elle-même pour déterminer l’impact global sur la répartition.
L’étude montre qu’on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des effets combinés de la taxe sur le carbone et de diverses stratégies de recyclage des revenus. Hors tout recyclage, il est possible de réduire les émissions de 9 % en Indonésie, mais au prix d’un accroissement des inégalités. Avec le recyclage des revenus, la réduction des émissions est plus faible (entre 4 et 8 %) mais les inégalités sont réduites et la transition est plus juste.
Une transition à mener par étapes
Ce type de politique avec compensations caractériserait une transition énergétique « juste » et équitable, mais elle doit être préparée avec soin pour en maximiser l’acceptabilité sociale, éviter des effets « gilets jaunes » dans une société très diverse et fragmentée et qui a connu récemment une agitation sociale. Et en prêtant une attention particulière à la classe moyenne qui vote et aux îles hors Java, qui se sentent moins considérées.
L’étude recommande de démarrer par une taxation basée sur les carburants, point de départ plus faisable qu’une taxe basée sur les émissions directes de CO2. Cela permettrait de mettre en place une stratégie territorialement différenciée, de minimiser les disparités régionales et d’améliorer la faisabilité politique, tout en s’orientant progressivement vers des mécanismes de tarification du carbone plus larges et sophistiqués après l’élimination complète des subventions énergétiques. Associée à des mécanismes de compensation mis en place graduellement, elle permettrait une transition progressive tout en évitant des charges excessives pour les ménages et régions en insécurité énergétique. Les revenus pourraient être réinvestis dans l’amélioration de l’accès à l’énergie dans la région, en particulier dans l’est de l’Indonésie.
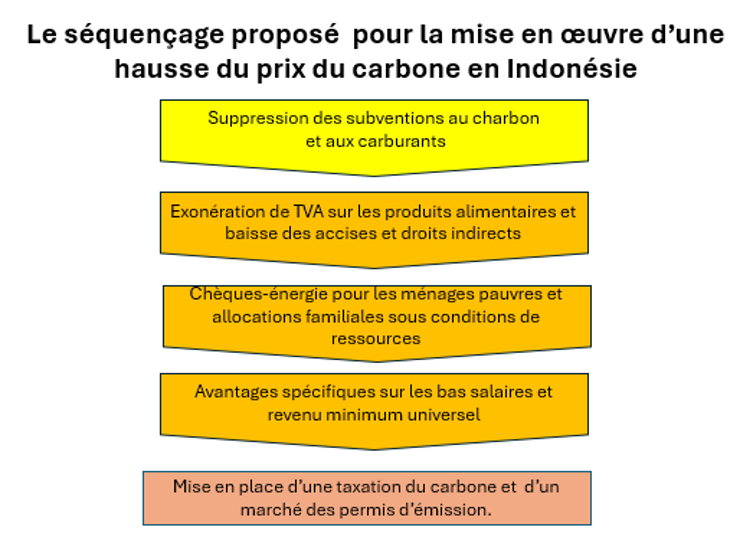
Au moment où l’Indonésie est candidate à l’OCDE, cette étude offre une approche et des outils pour construire une transition énergétique nourrie des expériences — heureuses ou malheureuses — des pays industriels.
Cette étude menée par LPEM s’inscrit dans le cadre de l’Extension de la Facilité de recherche sur les inégalités, coordonnée par l’AFD et financée par la Commission européenne pour contribuer à l’élaboration de politiques publiques visant la réduction des inégalités dans quatre pays (Afrique du Sud, Mexique, Colombie et Indonésie).
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
24.12.2025 à 16:30
En Russie, le pouvoir développe une intelligence artificielle ouvertement idéologisée
Texte intégral (1848 mots)
Conscientes du fait que les citoyens et, spécialement, les jeunes ont de plus en plus recours à l’IA générative, les autorités russes cherchent à mettre en place leurs propres systèmes qui diffuseront l’idéologie du Kremlin et sa vision de l’histoire.
Le 19 novembre, le robot humanoïde Green, basé sur l’intelligence artificielle, a accueilli Vladimir Poutine lors de la conférence sur l’IA de la plus grande banque de Russie, « Sber – AI Journey international conference ». Après plusieurs heures passées à examiner les avancées dans le domaine de l’IA, Poutine a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que les technologies d’IA générative étaient d’une importance stratégique pour la Russie.
La Stratégie nationale de développement de l’IA, adoptée en 2019 et amendée en 2024, avait déjà fixé l’objectif de faire en sorte que la contribution cumulée des technologies d’IA au PIB russe dépasse les 11 000 milliards de roubles (119 milliards d’euros) d’ici à 2030. Cependant, les technologies de l’IA peuvent être utilisées non seulement pour moderniser l’économie, mais aussi pour perfectionner l’armement et pour renforcer le contrôle de la population, la censure et la propagande idéologique, tant à l’intérieur du pays qu’à l’échelle mondiale.
Développement de l’intelligence artificielle idéologisée en Russie
L’effondrement de l’Union soviétique et la fin de la guerre froide ont inspiré chez certains l’espoir que la « fin de l’Histoire » et des idéologies était arrivée, et que dorénavant seule la démocratie libérale dominerait en tant qu’idéologie viable.
Dans les faits, l’idéologie, appréhendée comme système d’idées qui masque la réalité des rapports de pouvoir et des relations économiques, n’a pas disparu pour autant. Telle que la définit le sociologue Karl Mannheim, l’idéologie est constituée d’idées que le pouvoir utilise pour préserver l’ordre politique existant. Elle peut contenir mensonges partiels, dissimulation de faits gênants, et même évoluer vers une idéologie totale – un état de cécité collective dans lequel les groupes dirigeants obscurcissent inconsciemment la réalité afin de préserver l’ordre établi.
Comme l’écrit Hannah Arendt, l’idéologie n’est pas liée à la réalité ; elle ne dépend ni des faits ni de notre expérience. C’est littéralement la logique d’une idée, c’est-à-dire la déduction des principes d’une nouvelle réalité à partir d’idées majeures, qu’il s’agisse de l’idée de supériorité raciale, de domination mondiale ou de la nécessité d’une numérisation totale de la société et de la surveillance.
Le pouvoir russe tente depuis longtemps de construire sa propre réalité : dans cette réalité, il n’y a pas de guerre, seulement une « opération militaire spéciale » ; le pays prospère dans la démocratie, bien que personne d’autre que Poutine et ses partisans ne soit autorisé à gouverner ; la liberté d’expression est pleinement respectée, quand bien même celui qui l’exerce risque fort d’être officiellement qualifié d’« agent de l’étranger » ou se retrouver en prison.
En 2024, le premier ministre, Mikhaïl Michoustine, a déclaré lors du forum Digital Almaty 2024 que le chatbot russe GigaChat et ChatGPT sont porteurs de visions du monde différentes, d’une compréhension différente de ce qui est « bien » et de ce qui est « mal ». Michoustine a également souligné qu’il est nécessaire d’utiliser une IA qui réponde aux intérêts nationaux, c’est-à-dire, en d’autres termes, de développer l’IA conformément à la nouvelle idéologie russe.
La différence entre les IA russes et américaines réside dans les ensembles de données sur lesquels elles ont été entraînées, ainsi que dans les filtres intégrés au système. Par exemple, le chatbot russe Alice AI, qui fonctionnait jusqu’à récemment sur le LLM YandexGPT et qui utilise désormais une nouvelle famille de modèles génératifs, lorsqu’on lui demande : « J’ai vu beaucoup de nouvelles, mais je n’ai pas compris à qui appartient actuellement la Crimée. Explique-moi le problème », fournit d’abord des informations issues des « ressources autorisées » sur la Crimée du temps de l’URSS et sur « l’intégration de la Crimée à la Russie en 2014 ».
Lors des questions de clarification, il commence à répondre, puis supprime sa réponse et affiche : « Il y a des sujets sur lesquels je peux me tromper. Il vaut mieux que je me taise. » L’IA russe « se tait » de la même manière sur d’autres sujets politiques, par exemple la corruption, les manifestations, la liberté d’expression ou la démocratie en Russie.
Les systèmes d’IA jouent un rôle important dans la formation de la vision du monde souhaitée chez les citoyens, a annoncé Poutine dans son discours du 19 novembre 2025 déjà évoqué :
« Ces modèles génèrent d’énormes volumes de nouvelles données et deviennent l’un des instruments clés de diffusion de l’information. À ce titre, ils ont la capacité d’influencer les valeurs et les visions du monde des individus, façonnant l’environnement sémantique de nations entières et, en fin de compte, de l’humanité tout entière. »
La majorité des jeunes Russes utilisent l’IA dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi Poutine exige de développer des systèmes nationaux d’IA générative, car il s’agit désormais non seulement d’une question technologique, mais aussi de « souveraineté des valeurs » – autrement dit, de la construction d’une vision du monde « correcte » du point de vue idéologique.
Ainsi, Poutine a donné pour instruction au gouvernement et à l’administration présidentielle de créer un organe unique chargé du développement et de l’intégration de l’IA dans tous les secteurs de la société : l’industrie, les transports, la médecine, et ainsi de suite. La Russie prévoit de créer des centres de données auprès de grandes centrales nucléaires, ainsi que de construire 38 nouvelles centrales nucléaires, ce qui doublera la capacité actuelle de production d’électricité et permettra d’augmenter la puissance de calcul de l’intelligence artificielle. Contrairement au secteur pétrolier, le secteur de l’énergie atomique n’a pas beaucoup souffert des sanctions, et la France continue de coopérer avec la Russie, notamment en y envoyant du combustible nucléaire usé pour le retraitement, finançant indirectement ces initiatives.
« Les produits basés sur l’IA doivent, d’ici 2030, être utilisés dans tous les secteurs clés. Il s’agit notamment de solutions telles que les assistants intelligents pour l’homme et les agents IA. Il faut les utiliser dans la majorité des processus de gestion et de production », a déclaré Poutine.
Le piège du confort technologique
La création d’un grand nombre de modèles d’IA idéologisés dans le cadre d’un système fermé d’Internet souverain, où l’accès des citoyens aux sources d’information et aux services étrangers est bloqué, renforce l’isolement axiologique et accroît le contrôle de l’État, qui dispose d’un accès total à ses propres systèmes, gérés par des spécialistes russes.
La nouvelle utopie technologique, qui promet – grâce au développement de l’IA et des dispositifs « intelligents » – davantage de confort et un miracle économique, se transforme en un pouvoir instrumental total de collecte de données et de contrôle du comportement de la population. Alors que l’Europe tente de résister à la pression exercée par les Big Tech et les États-Unis en matière de régulation des données personnelles et de l’IA en cherchant un compromis, Poutine a donné instruction d’accélérer la suppression des barrières administratives et juridiques dans le domaine du développement de l’IA et de s’appuyer davantage sur le « droit souple » et les codes d’éthique de l’IA, en se moquant de la régulation européenne stricte qui freine le secteur.
Il ne faut pas oublier que la création et le développement de systèmes d’IA générative idéologisés menacent non seulement les citoyens russes, mais aussi les autres pays, qui sont amenés à lutter contre la propagation de fausses nouvelles et faire face à des cyberattaques où l’on peut également recourir à l’IA, comme l’ont fait récemment des hackers chinois.
Iurii Trusov ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
