22.01.2026 à 17:24
Quand les morts quittent les cimetières : nouvelles pratiques funéraires en pleine nature
Texte intégral (2049 mots)

À bas bruit et hors de portée du marché du funéraire se développent des pratiques qui déplacent les morts et leur mémoire à l’extérieur des cimetières dans des espaces bien réels, au plus près des valeurs et des façons de vivre dont témoignaient les défunts de leur vivant.
Lorsque les espaces et les pratiques funéraires sont évoquées dans les médias ou dans le débat public français, c’est souvent aux approches des fêtes de la Toussaint, pour relater des évolutions en cours dans la gestion des funérailles et des cimetières, et pour mettre en lumière des services, objets, techniques ou technologies dites innovantes. Il était ces dernières années beaucoup question de l’écologisation des lieux et techniques funéraires (cimetière écologique, humusation/terramation, décarbonation des produits funéraires) et de la digitalisation du recueillement et de la mémoire (deadbots, gestion post-mortem des volontés et des données numériques, cimetières et mémoriaux virtuels, télétransmission des cérémonies). Mais discrètement, d’autres pratiques voient le jour.
Avec la crémation devenue majoritaire dans de nombreux territoires français, la dispersion des cendres dite « en pleine nature » se révèle très importante dans les souhaits et de plus en plus dans les faits. Pourtant, beaucoup méconnaissent le cadre légal et pratique de son application. Cet article dévoile les premiers éléments d’une enquête en cours sur ces pratiques discrètes qui témoignent d’une émancipation créative face à la tradition contraignante de la tombe et du cimetière.
Des cimetières de moins en moins fréquentés
Le cimetière paroissial du Moyen Âge qui plaçait la communauté des morts au plus près de l’église et de ses reliques, dans la promesse de son salut et de sa résurrection, était un espace multifonctionnel et central de la vie et de la ville.
Le cimetière de la modernité matérialiste et hygiéniste est déplacé dans les faubourgs, puis dans les périphéries de la ville et se marginalise petit à petit des fonctions urbaines. Il devient, comme le dit Foucault, « l’autre ville, où chaque famille possède sa noire demeure », puis s’efface dans l’étalement urbain du XXᵉ siècle.
À l’intérieur des murs d’enceinte qui deviennent souvent de simples clôtures, les aménagements pour gagner de la place se rationalisent, le mobilier d’un marché funéraire en voie d’industrialisation et de mondialisation se standardisent. Les morts y sont rangés pour des durées de concessions écourtées au fil des décennies, sous la pression d’une mortalité en hausse (génération des baby-boomers) et de la saturation de nombreux cimetières urbains.
Dans les enquêtes régulières sur « Les Français et les obsèques » du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc), les Français montrent peu d’affection envers leurs cimetières qu’ils jugent trop souvent démesurés, froids et impersonnels. Alors qu’ils étaient encore 50 % en 2005, seulement un tiers des Français de plus de 40 ans continuent vingt ans plus tard à les fréquenter systématiquement à la Toussaint. Pour les Français de moins de 40 ans, ils sont encore moins souvent des lieux de sens et d’attachement.
Cette désaffection des cimetières, pour beaucoup synonymes d’enfermement tant matériel que mental, explique en partie l’essor de la crémation et de la dispersion des cendres. Les dimensions économiques et écologiques de ces options funéraires viennent renforcer cette tendance et s’exprime par la volonté de ne pas être un poids pour ses descendants (coût et soin des tombes) et/ou pour la planète (bilan carbone important de l’inhumation avec caveau et/ou monuments), et illustre la proposition de garder l’espace pour les vivants et le vivant.
La crémation gagne du terrain
La crémation était répandue en Europe avant sa christianisation et a même été conservée marginalement en périodes médiévales dans certaines cultures d’Europe du Nord. Elle se pratiquait sur des bûchers à foyer ouvert. Sa pratique, telle que nous la connaissons aujourd’hui en foyer fermé, a été rendue possible par la technique et l’essor du four industriel au XIXᵉ siècle, et par la plaidoirie des crématistes depuis la Révolution française jusqu’à la fin du XXᵉ siècle où la pratique va définitivement s’instituer.
Si les fragments calcinés étaient conservés communément dans des urnes, c’est avec l’apparition d’une autre technique industrielle dans le crématorium que la dispersion a pu être imaginée : la crémulation, c’est-à-dire la pulvérisation des fragments sortant du four, permettant d’obtenir une matière plus fine et moins volumineuse. Cette matière aseptisée par le feu et homogénéisée par le crémulateur peut alors rejoindre d’autres destinations que les urnes et le cimetière.
En 1976, un nouveau texte de loi insiste sur le fait que les cendres doivent être pulvérisées afin que des ossements ne puissent y subsister, effaçant ainsi ce qu’il restait de la forme d’un corps. Cette nouvelle matérialité peut alors se fondre discrètement dans nos lieux familiers, les morts se retrouvent inscrits dans nos paysages privilégiés, et leur souvenir cohabiter avec les activités récréatives et contemplatives qui prennent place dans les espaces naturels non aménagés.
Dispersions, disséminations
Alors que de nombreux Français pensent cette pratique interdite, son cadre légal et la notion de « pleine nature » ont été précisés en 2008 et en 2009. Ce cadre relativement souple permet de disperser les cendres en de nombreux espaces publics (sauf sur la voie publique) à distance des habitations et zones aménagées (parcs naturels, forêts, rivières, mers éloignées des côtes), plus difficilement dans des espaces privés avec la contrainte d’obtenir l’accord du propriétaire d’un droit d’accès perpétuel, ce qui peut poser des difficultés au moment des ventes de biens.
La « pleine nature » correspond aujourd’hui à une proportion d’un quart à un tiers des destinations des cendres des défunts crématisés. À travers un appel à témoignages anonymes en ligne ouvert dans le cadre d’une recherche en cours depuis 2023, une cinquantaine de micro-récits de dispersion ont été rassemblés et constituent un premier corpus pour appréhender ces pratiques discrètes et peu documentées. Ces récits inédits révèlent l’émergence de nouvelles manières de rendre hommage aux défunts et de donner du sens à la mort et à la vie dans des mondes contemporains en crise.
Le milieu du funéraire et de l’accompagnement du deuil se montre réservé face à cette pratique donnant lieu à des sépultures labiles en proie aux éléments, sans traces tangibles identifiant les défunts et sans garantie de se transmettre au fil des générations, parfois difficilement accessibles, isolant ces morts des autres morts.
Faisant écho de craintes parfois avérées de rendre les deuils plus difficiles, les professionnels doivent pourtant reconnaître que malgré ces nouvelles contraintes et en en connaissant les impacts, une grande majorité de ceux qui ont opté pour la dispersion des cendres de leurs proches reconduiraient le choix de la dispersion. Celui-ci procure en effet pour beaucoup le sentiment de satisfaction d’une promesse tenue, car ces destinations en pleine nature sont le souhait des vivants et se déroulent par là même souvent sans conflit au sein de l’entourage des défunts, dans une ambiance de sérénité, d’un chagrin joyeux, dans les plis de paysages et de territoires intimes aux défunts et à leurs proches.
De manière assez naturelle découlent de ces gestes et territoires de dispersion des prises pour imaginer des suites, des revisites, des retrouvailles sous forme de balades discrètement ritualisées, de pique-niques et baignades mémorielles, des façons de reconfigurer et d’entretenir les liens avec les défunts dans ces territoires familiers.
La diversité des lieux, des configurations sensibles et des éléments en jeu dans les dispersions renouvelle les possibles en termes de gestes et d’actes d’hommage envers les défunts, lors de la dispersion comme après, imbriquant la mémoire du mort dans des souvenirs de moments de vie partagés.
Les mises en gestes de la dispersion partiellement décrites dans les témoignages et rejouées dans le collectif de chercheurs pour en révéler des parts implicites montrent aussi des moments de flottement, des maladresses, des surprises et des improvisations qui se dénouent souvent avec des rires. Ce sont autant de marges dans lesquelles peuvent s’engouffrer des marques de la singularité des personnes en jeu, manœuvrer avec audace les acteurs pour s’approprier ces moments importants et en faire des lieux d’individuation, un premier pas actif sur le chemin du deuil.
Avec la dispersion des cendres, le lieu de nos morts n'est plus l'espace autre, l’autre ville des noires demeures, mais l‘espace même qui accueille nos moments de vie, là où nos beaux souvenirs avec eux font gage d’éternité. La suite de l’enquête permettra d’affiner les contours et les potentialités de ces pratiques.
Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.
Pascaline Thiollière ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
21.01.2026 à 16:15
« Une bataille après l’autre » et « The Mastermind » : quand le cinéma révèle les échecs de la gauche aux États-Unis
Texte intégral (1622 mots)
Explorant les failles et la défaite de la gauche américaine, les films Une bataille après l’autre, de Paul Thomas Anderson, et The Mastermind, de Kelly Reichardt, sont sortis en 2025, tandis que Donald Trump faisait un retour en force. Chacun à leur manière, ils invitent les membres et les partisans du parti démocrate comme les activistes de la gauche radicale à faire leur introspection.
La victoire de Donald Trump en novembre 2024 a provoqué une profonde remise en question dans les forces de gauche de la politique états-unienne. Après avoir échoué, les dirigeants du Parti démocrate ont passé l’essentiel de l’année 2025 à panser leurs plaies, tandis que Trump lançait ce que ses opposants considèrent comme une attaque frontale contre la démocratie américaine.
La nouvelle année a commencé par de nouveaux scandales, tant sur le plan intérieur qu’extérieur, l’administration Trump agissant avec une impunité de plus en plus effrayante.
À lire aussi : Le raid de Donald Trump sur le Venezuela laisse présager un nouveau partage du monde entre les grandes puissances
Combinée à la poursuite de la montée du populisme de droite et de l’autoritarisme dans le monde entier, la version « 2.0 » de Trump est vécue comme une crise existentielle pour la gauche.
Le pays a déjà connu une telle situation. Les mouvements de protestation de gauche des années 1960 aux États-Unis ont contribué à d’importants changements législatifs – en particulier dans le domaine des droits civiques –, mais ils ont souvent été caricaturés comme étant « antipatriotiques », notamment s’agissant de la guerre du Vietnam. Le sentiment que le pays se désagrégeait sous l’action de jeunes radicaux violents a conduit la « majorité silencieuse » conservatrice à offrir la victoire électorale à Richard Nixon en 1968.
Depuis lors, la gauche institutionnelle étasunienne s’est détournée de l’idéalisme des années 1960 et a plutôt proposé des changements progressifs et limités. Mais cette stratégie ne s’est sans doute pas révélée très efficace au cours du dernier demi-siècle.
Dans le contexte d’une nouvelle défaite et d’un énième cycle d’introspection, il semble donc approprié que deux films portant sur les échecs de la politique révolutionnaire de gauche des années 1960 et 1970 émergent presque simultanément avec le retour en force de Trump.
Explorer l’activisme de gauche
Bien que très différents par leur style et leur ton, Une bataille après l’autre (2025), de Paul Thomas Anderson, et The Mastermind (2025), de Kelly Reichardt, critiquent ce qu’ils présentent comme l’insuffisance stratégique et l’autosatisfaction de l’activisme de gauche, tout en explorant son coût personnel.
Une bataille après l’autre met en scène l’ancien révolutionnaire Pat Calhoun, alias Bob, (Leonardo DiCaprio) qui tente de sauver sa fille Willa (Chase Infiniti) des griffes d’un colonel suprémaciste blanc, qui a tout d’un psychopathe, Lockjaw (Sean Penn). Bien que Bob ait autrefois résisté aux politiques d’immigration cruelles et racistes du gouvernement fédéral à travers une série de raids audacieux contre des centres de détention, la paternité et une consommation excessive de cannabis ont émoussé son ardeur révolutionnaire.
Au lieu de cela, Bob est désormais un bouffon quelque peu incompétent. Le film exploite à des fins comiques ses tentatives chaotiques pour communiquer avec la « French 75 », l’armée révolutionnaire dont il faisait autrefois partie, inspirée de groupes révolutionnaires réels des années 1960 et 1970, comme les Weathermen.
Déambulant en peignoir, il a oublié tous les codes et les conventions nécessaires pour évoluer dans cet univers. Des mots de passe aux pronoms, Bob est en décalage avec son époque.
Cependant, le film se permet aussi de se moquer du moralisme de la gauche. Alors que Bob devient de plus en plus agressif faute d’obtenir des informations sur un point de rendez-vous crucial, le radical à qui il parle au téléphone l’informe que le langage qu’il emploie nuit à son bien-être. Si Bob manque de compétences pour soutenir la révolution, ceux qui la dirigent sont trop fragiles pour en mener une à bien.
À l’inverse, The Mastermind suit J. B. Mooney (Josh O’Connor) dans ses tentatives d’échapper aux autorités après avoir orchestré le vol de quatre œuvres d’art dans un musée de banlieue. Mari, père et fils d’un juge, Mooney est privilégié, sans direction, désorganisé, égoïste et, semble-t-il, indifférent à l’impact de la guerre du Vietnam alors que le conflit fait rage autour de lui.
Sa désorganisation est évidente dès le moment où il réalise que l’école de ses enfants est fermée pour une journée de formation des enseignants, le jour du casse. Son privilège apparaît clairement lorsqu’il lui suffit de mentionner le nom de son père lors de son premier interrogatoire par la police pour qu’on le laisse tranquille.
Même ses tentatives de convaincre sa femme, Terri (Alana Haim), qu’il a agi pour elle et pour leurs enfants sont maladroites, puisqu’il finit par admettre qu’il l’a aussi fait pour lui-même.
Alors qu’il est en fuite, Mooney semble ignorer ce qui se passe réellement autour de lui, des jeunes hommes noirs qui discutent de leur déploiement imminent au Vietnam, aux bulletins d’information relatant la réalité de la guerre. Sans rien dévoiler, Mooney ne peut finalement échapper aux conséquences de la guerre du Vietnam sur la société américaine.
Des moments révélateurs dans les deux films suggèrent également l’engagement vacillant envers la révolution de la part de ses anciens adeptes. Dans The Mastermind, Mooney se cache chez Fred (John Magaro) et Maude (Gaby Hoffmann), un couple avec lequel il a fréquenté l’école d’art. Malgré son passé militant, Maude refuse de l’héberger plus d’une nuit par crainte d’attirer l’attention des autorités. Dans Une bataille après l’autre, la volonté de Bob de prendre des risques pour sa sécurité et sa liberté diminue lorsqu’il devient parent et il est, de manière assez problématique, prompt à juger la mère de Willa, Perfidia (Teyana Taylor), qui continue à agir à ses risques et périls.
Le cinéma politique des années 1970
Les deux films rappellent inévitablement les œuvres tout aussi politiques produites par le cinéma états-unien à la fin des années 1960 et au début des années 1970, telles que Cinq pièces faciles (1970), Macadam à deux voies (1971) et Chinatown (1974). Au cœur du contrecoup nixonien face au radicalisme des années 1960, ces films adoptent un ton de résignation défaitiste, mettant en scène des protagonistes sans direction et des fins malheureuses.
La conclusion de The Mastermind ressemble à celle de ces films des années 1970. Le film s’achève sur des policiers présents lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam, se félicitant mutuellement après avoir arrêté un nouveau groupe de manifestants et de les avoir envoyés en prison.
Bien qu’Une bataille après l’autre soit beaucoup plus pétillant dans son style, la politique révolutionnaire de gauche y apparaît aussi comme une impasse. Des victoires à plus petite échelle restent possibles : Sergio (Benicio del Toro) continue de se battre pour les immigrés sans papiers, et Willa s’enfuit pour rejoindre une manifestation Black Lives Matter à la fin du film.
Mais en regardant ces deux films depuis la perspective d’une nouvelle année où l’administration Trump menace de provoquer de nouveaux bouleversements violents, tant au plan national qu’international, je repense à la lamentation mélancolique de Captain America (Peter Fonda) vers la fin du classique de la contre-culture Easy Rider (1969) :
« On a tout gâché. »
Gregory Frame ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
20.01.2026 à 15:04
Agatha Christie : la reine du crime était aussi la reine du châtiment
Texte intégral (1767 mots)

Agatha Christie, souvent surnommée la reine du crime, demeure l’autrice de fiction la plus vendue au monde : plus de 2 milliards d’exemplaires de ses livres ont été écoulés depuis leur première publication. Ses intrigues captivantes – de Ils étaient dix au Crime de l’Orient-Express – ont été traduites dans plus de 100 langues, plaçant Christie non seulement au sommet du genre policier mais aussi parmi les auteurs les plus lus de tous les temps. Mais l’habileté littéraire dissimule un autre aspect de son œuvre et de sa personnalité : Agatha Christie était aussi, dans ses fictions, la reine de la répression.
Pourquoi (re)lire Agatha Christie ? Pour prendre conscience du fonds idéologique de son œuvre. Pour saisir ce qui peut échapper à la (première) lecture, le lecteur étant implacablement pris et entraîné par la mécanique de l’intrigue policière, tournant les pages vers la résolution finale tant attendue. Les énigmes policières, qui pourraient sembler n’être que des constructions abstraites suspendues dans le vide, des casse-têtes brillants mais sans enjeux concrets, des jeux pour divertir l’esprit, portent, en leur sein ou dans le décor fictionnel dans lequel elles s’inscrivent, un discours sur la société. Lire le Meurtre de Roger Ackroyd pour la prouesse littéraire, oui, bien sûr, il le faut. Mais le relire aussi pour y percevoir « l’arrière-fable », selon une expression du philosophe Michel Foucault, et décrypter les messages ainsi adressés au lecteur, à son insu souvent.
Les romans policiers à énigme ne sont donc pas des produits littéraires jetables, dont la relecture serait du temps perdu. Bien au contraire : délivré de l’emprise de l’intrigue, le lecteur y gagne une nouvelle intelligence du texte. Il peut prendre le temps de discerner certains fils dans la trame policière qui disent quelque chose de la philosophie ou de la politique de l’auteur.
Alors, relisez Agatha Christie. Les rééditions infinies de ses textes vous y encouragent. Relisez-la en usant d’une clé de lecture tout à fait efficace pour avoir accès à sa vision du monde : les représentations de la justice pénale. Tous ces romans et nouvelles sont, en effet, porteurs d’une philosophie répressive singulière. Une philosophie répressive, c’est-à-dire une manière de concevoir les fonctions sociales de la peine.
Trois modèles de justice pénale
Il est plusieurs conceptions possibles de la sanction pénale, qui peuvent d’ailleurs coexister. La peine peut tout d’abord être la réponse violente à l’infraction, le prix à payer par le criminel pour le crime qu’il a commis – le prix du sang. Il s’agit alors de justice rétributive : l’harmonie du monde est rétablie dès lors que le mal infligé à la victime est compensé par le mal subi par l’auteur du crime. La peine peut ensuite être un moyen d’empêcher un nouveau passage à l’acte, de dissuader les potentiels récidivistes. La justice pénale est, dans ce cas, utilitariste et elle se fonde sur l’idée que les individus peuvent être corrigés, améliorés. Enfin, la peine peut perdre son nom et devenir une « mesure » de justice restaurative : l’État est laissé de côté, l’objectif est dès lors de permettre à l’auteur et à la victime de l’infraction de trouver ensemble, par le dialogue, une issue satisfaisante à leur conflit.
Qu’en est-il chez Agatha Christie ? Dans son œuvre, la justice pénale est résolument rétributive. Elle est même, par certains de ses aspects, réactionnaire. Ne vous fiez pas trop aux aimables photographies présentant la romancière dans son bureau en inoffensive grand-mère. Tous ses récits à énigme enseignent que la justice humaine est inefficace, que les procédures légales tournent à vide, que les procès ne permettent pas d’aboutir à la vérité. Ce sont des agents d’une justice supérieure, surnaturelle, qui triomphent chez elle : le silencieux et mélancolique Harley Quinn, l’avocat des morts, messager de l’au-delà. Mais aussi Hercule Poirot – personnage à la vanité assumée et délicieusement comique, méthodique jusqu’à l’obsession, qui se prend pour Dieu le Père et qui finira sa carrière en assassin. Enfin Miss Marple, à l’apparence bienveillante, mais redoutablement lucide et plus perfide qu’il n’y paraît, incarnation de la déesse grecque de la vengeance Némésis. Némésis et non Thémis, la déesse de la justice.
Némésis l’implacable
Pour Agatha Christie, la vengeance est une forme de justice, et c’en est la forme la plus efficace. En effet, selon elle, le meurtre appelle la mort du meurtrier. Pas de place pour le pardon, ni pour la correction des comportements. Non, elle est très claire, elle l’écrit noir sur blanc dans son Autobiographie : les criminels doivent soit être exécutés, soit accepter d’être des cobayes pour la science, « la marque de Caïn enfin effacée de leur front ». Elle écrit ceci non pas en 1930 mais en 1977.
Toutes les morts se valent d’ailleurs. Que le criminel se suicide, qu’il succombe lors d’un accident ou qu’il soit exécuté sur le gibet, toutes ces issues sont satisfaisantes pour l’écrivain, dès lors que le prix du sang est payé.
Notre sensibilité européenne actuelle sera peut-être heurtée, mais l’évidence s’impose : Agatha Christie défend la peine de mort, c’est la seule peine qui lui semble juste. Il est d’ailleurs intéressant de relever qu’à chaque réforme adoptée en Angleterre en faveur de l’abolition de la peine capitale, Agatha Christie a fait connaître sa désapprobation dans ses récits de fiction. Relisez le Train de 16 h 50, relisez le Crime d’Halloween. Dès 1930, elle faisait dire à Miss Marple :
« Les scrupules humanitaristes modernes à propos de la peine capitale m’exaspèrent. »
Rétablir l’ordre du monde
Le monde littéraire d’Agatha Christie est un monde ordonné, un monde harmonieux, une bibliothèque où chaque ouvrage est à sa place. Le cadavre qui y surgit doit être évacué, les taches de sang effacées, la vérité dévoilée et le meurtrier châtié. Et peu importe le temps qui passe : la prescription de l’action publique n’existe pas dans l’œuvre d’Agatha Christie (elle n’existait pas non plus en droit anglais à l’époque où elle écrivait). Némésis possède une mémoire d’éléphant. C’est pourquoi Hercule Poirot peut enquêter seize ans après les faits dans Cinq petits cochons. Idem pour Miss Marple qui intervient dix-huit ans après l’affaire, dans la Dernière Énigme.
Réordonner le monde dérangé par le meurtre passe aussi par un moyen plus doux : le mariage. Innombrables sont les romans d’Agatha Christie dans lesquels l’intrigue policière se double d’une intrigue amoureuse trouvant son dénouement dans un mariage ou dans un projet de mariage. Hercule Poirot n’est pas qu’un détective, c’est aussi un entremetteur, un facilitateur de fiançailles. Or, réunir des amants, c’est, de fait, rétablir l’ordre du monde : l’infraction a sectionné le lien social, le mariage le retisse. Si, comme dans les contes de fées, le héros se marie à la fin d’un roman d’Agatha Christie, ce n’est pas par goût frivole du happy end, mais c’est encore pour traduire une philosophie pénale qui a été distillée dans l’esprit de millions de lecteurs, en sourdine.
Relire Agatha Christie, c’est finalement se donner les moyens de prendre conscience qu’un texte littéraire – même un texte relevant de la littérature populaire – est porteur d’un discours philosophique, social ou politique. Relire Agatha Christie, c’est également comprendre qu’il est possible d’aimer un auteur, sans nécessairement adhérer aux valeurs qu’il diffuse.
Nicolas Bareït ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
19.01.2026 à 16:24
Comment « Bluey » s’appuie sur des paraboles religieuses pour donner des leçons de vie aux enfants
Texte intégral (2343 mots)

Derrière ses histoires pleines d’humour et de tendresse, la série australienne Bluey cache des références culturelles et philosophiques bien plus profondes qu’il n’y paraît. En s’inspirant de récits bouddhistes, chrétiens ou taoïstes, certains épisodes proposent aux enfants – et à leurs parents – une manière accessible de réfléchir à la souffrance, à l’attente, à la perte ou à l’acceptation.
Bluey est une série intelligente qui puise dans toutes sortes d’inspirations pour ses histoires pleines de charme, y compris religieuses. Ma recherche récemment publiée examine ce que la série dit de la religion, et de la religion du jeu, qui sert de principe directeur à leur vie (NDLT : Bluey raconte la vie d’une famille de chiens anthropomorphes qui explorent le monde par le jeu.)
Trois épisodes en particulier montrent la diversité des religions dans l’Australie contemporaine et nous aident à réfléchir à la diversité et à la profondeur de la culture de ce pays.
Ces épisodes transmettent, de manière accessible et réfléchie, aux enfants et aux parents des leçons concises issues de religions bien réelles. Ils récompensent la curiosité et un regard réflexif sur les histoires, en encourageant les parents à s’investir plus profondément dans les programmes préférés de leurs enfants.
Voici donc ce que trois épisodes de Bluey disent de la religion, et les leçons qu’ils offrent aux enfants de toutes les religions, comme à ceux qui n’en ont aucune.
La parabole bouddhiste
L’épisode « Bumpy et le vieux lévrier sage » est une reprise à peine voilée de la parabole bouddhiste de Kisa Gotami et des graines de moutarde (mais avec les fameuses graines de moutarde remplacées par des sous-vêtements violets !).
Dans l’épisode, Bluey et Bandit réalisent une vidéo racontant une histoire pour remonter le moral de Bingo, hospitalisée. Dans cette histoire, une femme (Barnicus) a un chiot appelé Bumpy, qui tombe gravement malade. Elle l’emmène voir le vieux lévrier sage pour demander de l’aide. Celui-ci est représenté assis en position du lotus, vêtu d’une robe faite de serviettes et coiffé d’une couronne de fleurs.

Le vieux lévrier sage lui demande une paire de sous-vêtements violets provenant de quelqu’un qui n’a jamais été malade. Comme Barnicus ne trouve personne qui n’ait jamais été malade, elle comprend que le sage cherchait à lui apprendre que tout le monde tombe malade un jour ou l’autre. La maladie fait simplement partie de la vie, et Bingo se sent réconfortée de ne pas être seule.
Dans la parabole originale des graines de moutarde, qui remonte au Ve siècle avant notre ère, Kisa Gotami est une mère dont le fils unique meurt. Lorsqu’elle se tourne vers le Bouddha pour obtenir de l’aide, celui-ci lui demande de récupérer des graines de moutarde auprès de familles où il n’y a jamais eu de décès. En cherchant à accomplir cette tâche impossible, Kisa Gotami comprend que la mort et la souffrance sont inévitables.
En réinterprétant ce récit religieux avec une touche d’humour et des enjeux atténués, l’épisode permet aux enfants d’apprendre un enseignement fondamental du bouddhisme. La maladie et la souffrance sont terribles, mais le fait de savoir que tout le monde y est confronté un jour peut nous réconforter et nous aider à relâcher notre attachement, ou notre besoin d’un bonheur et d’un bien-être permanents.
Pâques chrétiennes
L’épisode « Pâques » fait écho à certains thèmes du récit chrétien associé à cette fête. Bluey et Bingo craignent que le lapin de Pâques les ait oubliées. Chilli et Bandit leur rappellent la promesse de ce dernier : il reviendra à coup sûr le dimanche de Pâques.
Mais ne trouvant pas les œufs en chocolat, elles s’inquiètent, en particulier quand le jeu exige du courage ou une forme de souffrance (mettre les pieds dans les toilettes de Papa). Elles se demandent alors si elles ne risquent pas d’être oubliées.

On peut y voir un parallèle avec la manière dont la Bible donne à voir la crainte des disciples de Jésus au lendemain de sa mort, pensant que Dieu les avait oubliés malgré la promesse qu’il leur avait déjà faite de revenir après trois jours. Cet enseignement reflète l’inquiétude que beaucoup de personnes ressentent : celle d’être peut-être trop insignifiantes ou trop pécheresses pour que Dieu se soucie d’elles.
L’épisode se termine lorsque Bluey et Bingo font rouler un ballon de gymnastique (la pierre) pour dégager une cavité sous le bureau (le tombeau) et découvrent que le lapin de Pâques ne les a pas oubliées : il a pensé à elles, s’est soucié de leur sort et est bien revenu pour leur offrir de beaux œufs en chocolat (la vie éternelle).
À travers cette relecture décalée d’un récit religieux, les enfants sont encouragés à penser qu’ils sont aimés et à faire confiance aux promesses qui leur sont faites, même lorsqu’ils ont l’impression d’être petits, oubliables ou désobéissants.
La fable taoïste
Dans « Le panneau », la maîtresse de Bluey, Calypso, lit une fable issue à l’origine du texte taoïste Huainanzi, datant du IIe siècle avant notre ère. En français, cette fable est souvent appelée « Le paysan et le cheval blanc ».
Le récit enchaîne une série d’événements qui arrivent à un vieil homme, et, après chacun d’eux, ses voisins commentent les faits, estimant qu’il s’agit de chance ou de malchance. Le vieil homme répond toujours « On verra », dans l’attitude du wú wéi.). Dans la conception taoïste du wú wéi appliquée à la fortune, toutes choses se valent, et ce n’est que le jugement humain (ou, en l’occurrence, canin) qui qualifie un événement de bon ou de mauvais. Ainsi, la seule réponse appropriée face à un événement marquant est le « non-agir » ou la sérénité, jusqu’à ce que le passage du temps en révèle le véritable sens.

Au départ, Bluey comprend mal le message et pense que Calypso veut dire que tout finira forcément par s’arranger. Mais à la fin de l’épisode, elle apprend à adopter l’attitude du wú wéi de manière positive. Elle reste calme, voire sereine, face à la perspective de quitter son quartier bien-aimé.
À travers ce récit religieux, les enfants apprennent qu’une approche douce et fluide de la vie, qui n’impose pas ses propres désirs au monde, permet d’éviter des souffrances inutiles et de trouver la paix et l’acceptation.
Sarah Lawson ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
18.01.2026 à 07:49
Ursula K. Le Guin, l’autrice de science-fiction qui nous invite à réinventer le monde
Texte intégral (2158 mots)

Alors que Rennes (Ille-et-Vilaine) s’apprête à donner son nom à une rue et que la chanteuse Rosalia la cite en interview, Ursula K. Le Guin, disparue il y a six ans, nous a laissé une œuvre qui alimente plus de réflexions et de discussions que jamais, débordant largement les contours des littératures dites de l’imaginaire. De l’utopie anarchiste des Dépossédés à l’école des sorciers de Terremer en passant par les pérégrinations des ethnographes intergalactiques du Cycle de l’Ekumen, les mondes de fiction de Le Guin et leur philosophie nourrie de taoïsme continuent de nous proposer des manières alternatives de penser la crise et de concilier l’inconciliable.
Fille d’anthropologues et autrice multiprimée de romans de science-fiction et de fantasy, l’autrice américaine Ursula K. Le Guin (1929-2018) porte sur le monde un regard venu de loin. Aux yeux de l’autrice, inspirée depuis son enfance par la pensée taoïste (elle publie en 1997 sa propre traduction du Daodejing), les sociétés occidentales contemporaines et les récits glorieux qui les fondent ou les font vibrer souffrent d’un excès de yang – le principe masculin d’expansion, de chaleur et de lumière, de dureté, d’action et de contrôle, dans le taoïsme.
Pour guérir de nos maux et résoudre les crises qui nous traversent, l’autrice propose d’explorer des alternatives yin (principe féminin de réception et d’acceptation, froid et obscur, humide, aussi souple et modulable que l’eau, selon le taoïsme), en pensant en termes de processus plutôt que de progrès. Dans ses œuvres, Le Guin imagine des « utopies ambiguës » – pour reprendre le sous-titre de son roman les Dépossédés – loin de la fixité minérale et impersonnelle d’un idéal quasi mythologique, et qui se conçoivent, à l’inverse, comme des mondes vivants, humains, imparfaits, ouvrant des fenêtres sur d’autres manières de vivre, de faire et de penser.
Penser le politique : la rencontre plutôt que la conquête
Sur le plan politique, l’autrice propose une philosophie mêlant le concept taoïste du wuwei (l’action par l’inaction) aux principes de respect de l’autre dans sa différence, de liberté individuelle et de responsabilité collective. Inspirée par cette pensée yin, Le Guin nous appelle à questionner notre propre rapport aux questions politiques : la nouvelle « Ceux qui partent d’Omelas », régulièrement enseignée au lycée en France comme aux États-Unis, est une fable interrogeant la part de responsabilité individuelle dans le fonctionnement des systèmes oppressifs – à quel moment notre ignorance se mue-t-elle en complicité ?
Celles et ceux qui partent d’Omelas ne combattent ni par les armes ni par l’anathème ; leur résistance est celle des lignes de fuite et de l’appel à l’imaginaire pour ouvrir de nouveaux espaces dans le réel. Le refus de la résignation et l’ouverture sur l’ailleurs constituent ainsi des gestes politiques fondateurs. De même, dans les Dépossédés, Le Guin – qui fustigeait régulièrement le capitalisme dans ses discours et défendit ardemment les auteurs du bloc de l’Est pendant la guerre froide – se demande à quoi pourrait ressembler une véritable société anarchiste. Elle en propose une des réalisations les plus totales jamais offertes par la fiction comme la non-fiction, et montre que seule la vigilance d’individus responsables et libres empêche les régimes de basculer dans l’autoritarisme : pour que l’utopie vive elle doit demeurer mobile, ouverte à toutes ses contradictions, en constante quête d’équilibre.
Enfin, le Cycle de l’Ekumen, dans lequel s’inscrit ce roman et beaucoup d’autres, se propose plus largement de subvertir les récits traditionnels de conquête qui peuplaient les romans de SF de l’âge d’or (les années 1960 et 1970), eux-mêmes inspirés de la geste glorieuse de la conquête de l’Ouest. Le Guin imagine au contraire une expansion affranchie des dominations, où la violence laisse la place à la rencontre et où les sociétés humaines, dans leur infinie diversité, s’enrichissent mutuellement de leurs différences.
Penser le vivant comme une même communauté
Le Guin fut aussi une grande penseuse de la crise écologique et du rapport entre l’humain et le non-humain.
Dès le premier tome du Cycle de Terremer, l’autrice met en scène un monde dans lequel tous les êtres vivants – du chardon à l’épervier, du dragon aux vagues de la mer – parlent le même langage sacré de la création. Le magicien y devient gardien de l’équilibre du monde, et les aventures des protagonistes au fil des tomes n’ont de cesse de rétablir et d’entretenir l’équilibre fragile entre humains et non-humains, entre la parole et le silence, entre le monde des vivants et le royaume des morts.
Dans la Vallée de l’éternel retour – œuvre la plus radicale et la plus dense de l’autrice –, Le Guin imagine une archéologie du futur : elle dépeint la société traditionnelle du peuple Kesh, dans une Californie au relief totalement redessinée par les cataclysmes et le changement climatique. En lisant, guidés par l’ethnographe Pandora, nous suivons les mœurs et les vies de ces humains du futur ayant renoué avec les modes de vie des peuples autochtones américains ; les plantes et les animaux sont pour eux des personnes à part entière, avec qui l’humain partage le monde sans hiérarchies – et si l’on peut les mettre à mort pour s’en nourrir, cela doit se faire dans le respect de rituels assurant la dignité de tous.
Télescopant le passé et le futur, Le Guin décrit un monde où la solution à la crise climatique ne se trouve ni du côté de la technologie, ni à l’échelle globale, mais bien à une échelle locale, dans un « faire monde » commun, basé sur l’immanence et le respect mutuel entre humains et non humains, tous membres d’une même communauté.
Penser l’individu autrement
C’est aussi sur le plan intime que Le Guin interroge radicalement ce qui fait l’humain et l’origine de nos crises personnelles. Dans la Main gauche de la nuit, elle montre à quel point les rapports de genre sont déterminants dans notre expérience du réel, en mettant en scène un peuple humanoïde androgyne dont les membres ne sont sexués que quelques jours par mois – aussi bien au féminin qu’au masculin. L’ethnographe (humain de sexe masculin) envoyé sur cette planète pour l’inviter à rejoindre l’Ekumen, alliance intergalactique pacifique, est décontenancé par ce monde où l’on peut être père de certains de ses enfants et mère des autres, où il n’existe ni galanterie ni misogynie, ni rapports de force ou de séduction basés exclusivement sur le genre.
Dans la nouvelle « Solitude », l’autrice se livre à une autre expérience de pensée en imaginant une société entièrement structurée par l’introversion ; sur Eleven-Soro, planète hantée par les ruines d’anciennes mégalopoles ultratechnologiques, la civilisation représente une ombre mortifère. Pour les lointains descendants de ce monde disparu, revenus à un mode de vie aux apparences primitives, toute forme de relation interpersonnelle – ou même de communication – est devenue un objet de menace et de méfiance. Ce mouvement de recentrement rejette la civilisation au profit d’une communion directe de l’être avec le monde ; il revient à chacun et chacune, dès l’enfance, de « faire son âme » à l’aide d’un sac personnel où collecter des objets signifiants, glanés au fil d’une vie et qui acquièrent ainsi une valeur sacrée.
Penser le récit : la « fiction-panier »
Cette figure du contenant, du panier que l’on remplit au fil du chemin, est une constante chez Le Guin. Elle l’érige en étendard de son écriture : contre l’éternel héros mythique qui parvient à occire les monstres pour sauver son peuple (et en devenir le chef), l’autrice invente et met en pratique une théorie de la « fiction-panier », où le soin mutuel et l’art du glanage sont les éléments centraux.
Car, en plus de ses œuvres en science-fiction et fantasy (SFF), Le Guin a aussi beaucoup écrit de poésie (une douzaine de recueils) et d’essais sur l’art de l’écriture. Elle achève d’ailleurs sa trajectoire romanesque par une œuvre étonnante, Lavinia, qui reprend et étend l’Enéide en adoptant le point de vue de Lavinia, ultime épouse du héros, à qui Virgile n’accorde que quelques vers et aucune parole. Entre courage, désir de liberté et piété filiale, l’héroïne est témoin de la bêtise et de la violence propres aux récits héroïques comme celui dans lequel elle est prise : que peut l’étoffe tissée des mains d’une mère face à la pointe d’une lance transperçant la chair ? Dans ce texte conçu comme une conversation avec Virgile et qui souligne à quel point la littérature est un monde partagé, en constante mutation, Le Guin fait dialoguer une Lavinia consciente de son propre statut fictif avec le poète qui lui a donné vie – une vie toute entière faite de mots, où rien ne s’efface mais où tout peut toujours s’ajouter.
La pensée de Le Guin ne fait pas système, au sens où une théorie irréfutable rendrait ses propos péremptoires. Comme Lavinia elle-même, Le Guin, doute, hésite, reprend. Ainsi, renouant après des décennies, avec son cycle de fantasy Terremer, l’autrice change totalement sa façon d’écrire : ses protagonistes ont vieilli, leur regard s’est affûté, et Le Guin explore sans concession les ambiguïtés de son propre imaginaire. Remettant en question la relation des individus au pouvoir, elle confie à une femme d’âge mûr le soin de répondre à l’appel du héros, pour le bien commun, avant de pouvoir revenir avec soulagement à sa ferme, à son potager, et à l’homme qui l’y attend.
Aujourd’hui, alors que nous commémorons la disparition d’Ursula K. Le Guin il y a huit ans, des autrices et auteurs du monde entier (Rivers Solomon, Han Song, Wu Ming-yi, Céline Minard, Luvan et bien d’autres), revendiquent l’influence de cette légende des lettres états-uniennes, dont la sagesse n’a pas fini de nous éclairer :
« Lorsque nous parlons d’avancer vers l’avenir, c’est une métaphore, de la pensée mythique interprétée littéralement, peut-être même du bluff, né de notre peur machiste d’être un instant inactifs, réceptifs, ouverts, silencieux, immobiles. […] C’est lorsque nous confondons nos rêves et nos idées avec le monde réel que les ennuis commencent, quand nous pensons l’avenir comme un endroit qui nous appartient. »
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
17.01.2026 à 21:02
La série médicale « The Pitt », aux frontières du réel
Texte intégral (1964 mots)

The Pitt s’est imposée comme la série médicale de référence de l’ère post-Covid, tant pour le grand public que pour les soignants eux-mêmes. Accueillie avec un enthousiasme rare et une quasi-unanimité critique, elle cristallise une attente de vérité et de justesse, après des années de fictions médicales où le spectaculaire l’emportait souvent sur le vraisemblable. Alors que débute sa deuxième saison, reste une question centrale : la réputation de la série est-elle à la hauteur de son ambition de réalisme médical ?
Le récit médical constitue depuis longtemps un genre à part entière, doté de ses codes et de ses déclinaisons. Il s’est prêté à toutes les tonalités : du soap opéra (Grey’s Anatomy, depuis 2005), où l’hôpital devenait avant tout un théâtre sentimental, à la farce (Scrubs, de 2001 à 2010), jusqu’au drame médical réaliste, dont l’étalon demeurait jusqu’à présent Urgences (1994-2009).
Cette dernière a profondément marqué l’histoire de la télévision. En représentant les urgences de Chicago avec une crudité et une nervosité inédites, elle proposait un réalisme alors sans équivalent. Elle a surtout façonné l’imaginaire de générations entières de médecins, contribuant, parfois à leur insu, à faire naître leur vocation et à inscrire l’hôpital comme lieu de destin autant que de soin.
La fiction et ses accommodements avec le réel
Toutefois, même les œuvres les plus exigeantes n’échappent pas à une romantisation implicite du soin, acceptée par le public au nom des nécessités dramaturgiques. Cette concession se manifeste notamment par une confusion systémique des rôles, les personnages étant régulièrement amenés, pour les besoins du récit, à franchir les frontières entre spécialités, au mépris de la segmentation réelle des compétences médicales.
Cette dérive atteint son paroxysme dans Dr House (2004-2012), où un interniste se mue tour à tour en ophtalmologue, microbiologiste, neurologue ou infectiologue, au prix de processus plus proches de la devinette que du raisonnement clinique. La tension narrative y prévaut clairement sur toute ambition d’authenticité.
Un réalisme pluriel et incarné
The Pitt se distingue précisément par son refus de cette facilité. Son réalisme ne se limite pas à la véracité des gestes techniques : il s’incarne d’abord dans la construction des personnages.
Les figures étudiantes, ancrées dans le modèle états-unien, reposent néanmoins sur des caractéristiques suffisamment générales pour dépasser les frontières : l’étudiante brillante, sûre d’elle jusqu’à l’aveuglement ; l’étudiante socialement inadaptée, maladroite dans ses interactions ; l’étudiant sacrificiel, littéralement usé par le service, que l’on voit contraint de se changer à répétition après avoir été souillé par l’urine, le sang ou les vomissures des patients, véritable running gag de la série. En découlent les scènes liées au manque de crédits de pyjamas du distributeur automatique, dans lesquelles tout soignant se reconnaîtra.
La série aborde également, sans pathos excessif, la précarité matérielle et sociale de certains étudiants, composant un tableau crédible et familier de l’hôpital contemporain.
Gestion des proches et fin de vie
L’un des sommets de justesse se trouve à l’épisode 4 de la saison 1, à travers la représentation d’une situation de fin de vie. Le refus d’intubation exprimé par le patient dans ses directives, face au désir de ses enfants (adultes) de prolonger coûte que coûte des thérapeutiques actives, donne à voir avec une remarquable acuité ces situations où la souffrance familiale entre en collision avec ce que les soignants peuvent encore raisonnablement proposer.
Le personnage de Rabinovitch incarné par Noah Wyle, le docteur Carter d’Urgences, chef de service dans The Pitt, agit alors comme une figure démonstrative, presque pédagogique : patience, empathie, sens de la temporalité et maîtrise du langage non verbal. Il incarne une application concrète du célèbre modèle du Dr Elisabeth Kübler-Ross sur les stades du deuil.
Le quotidien dans ce qu’il a de plus trivial
Au-delà des grandes scènes, The Pitt excelle dans la représentation des microsituations ordinaires. La scène où Rabinovitch, empêché à plusieurs reprises de satisfaire un besoin élémentaire, parvient enfin à un urinoir après une succession d’interruptions, frappe par son évidence. Elle condense ce sentiment d’intranquillité permanente, constitutif des soins critiques, dans une acception que Fernando Pessoa a rendue familière.
Autre moment frappant : cette tentative de débriefing à l’ouverture de l’épisode 9, là où le spectateur attend un moment de gravité émotionnelle, brutalement interrompue par une urgence, laissant surgir ce réel qui, pour reprendre Lacan, se manifeste toujours comme un heurt.
Une précision technique rarement atteinte
La série ne sacrifie jamais la crédibilité médicale à la facilité narrative. Les erreurs médicales présentées sont plausibles et fréquentes, jusque dans les rappels pédagogiques adressés aux étudiants (« Ne perds jamais le guide de vue quand tu cathétérises ») – le guide étant le fil métallique souple introduit en premier dans le vaisseau et servant de rail pour faire glisser le cathéter au bon endroit.
Les gestes techniques impressionnent par leur exactitude : l’usage généralisé de la FAST-echo – échographie rapide de dépistage des hémorragies internes – devenu le pilier de la réanimation traumatologique moderne, le recours systématique aux vidéolaryngoscopes, l’évocation de l’anesthésie locorégionale qui consiste à endormir une région du corps en ciblant un nerf ou un plexus nerveux, ou encore le recours au REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta), dont l’usage s’est développé au cours des quinze dernières années, qui consiste en l’occlusion de l’aorte descendante par un ballonnet inséré par voie artérielle périphérique en cas d’hémorragie réfractaire (bien que son efficacité ne fasse pas l’unanimité dans la littérature médicale).
Les limites inhérentes au genre
Le genre n’échappe cependant pas à certaines limites récurrentes des séries médicales : ici des patients parlant pendant l’auscultation (peu crédible, tant l’écoute en est rendue très incertaine), là des détresses respiratoires clairement surjouées ; ou encore une sous-représentation du travail informatique, pourtant omniprésent et un « oversharing » émotionnel avec les patients, peu réaliste bien que fonctionnel sur le plan narratif.
On retrouve enfin une légère tentation à la Dr House, avec une exagération ponctuelle des compétences diagnostiques, notamment sur des pathologies qu’il est peu courant de diagnostiquer aux urgences (comme la neurocysticercose, maladie se caractérisant par la présence de kystes dans le cerveau principalement).
Parallèlement, le propos peut par moments s’inscrire dans une dynamique globalisante, tendant à traiter de front tous les sujets, du poids des directions hospitalières à la défiance envers la science, dans une Amérique où cette suspicion irrigue jusqu’aux plus hautes sphères sanitaires. Une vaste ambition qui, plus qu’une limite, témoigne surtout de la densité des enjeux contemporains que la série choisit d’affronter.
Une austérité formelle au service de l’émotion
L’absence de musique et le rythme quasi documentaire de la série, tournée en majorité en plan-séquence, laissent néanmoins émerger des moments d’une beauté brute, comme cet épisode du patient ancien secouriste, mémoire vivante du système de santé, racontant l’histoire des premiers secours devant des étudiants suspendus à ses mots, assumant dimension historique et pédagogique jusqu’au bout.
La série adopte parfois une veine plus lyrique, quand face au flux incessant des patients, l’un des personnages évoque Albert Camus et cette réponse devenue nécessité plus que consolation :
Au final, bien qu’elle reprenne les ressorts fondateurs des séries d’urgences, l’entrée conjointe des cas et des personnages, les inévitables « What do we got ? » (« Qu’est-ce qu’on a ? »), The Pitt, sans musique dramatique mais avec une intensité rare, s’impose comme une représentation majeure du soin hospitalier contemporain, appelée, si elle maintient cette exigence, à devenir une référence durable et, peut-être, à susciter des vocations. À l’image de sa grande sœur Urgences, il y a plus de trente ans.
Khalil Chaïbi a reçu des financements de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), du programme d'échange franco-américain Fulbright et du ministère de la santé dans le cadre d'appels à projets différents. Khalil Chaïbi est également visiting researcher au Department of Biomedical Informatics, Harvard Medical School, Boston
17.01.2026 à 17:32
L’avortement, un sujet de cinéma et de littérature ?
Texte intégral (2541 mots)

Est-il toujours important d’évoquer l’avortement ? Depuis plus de cinquante ans, le cinéma et la littérature racontent les combats pour l’IVG, donnent voix aux femmes et dénoncent les attaques. En transmettant une mémoire collective, en brisant les tabous et en exposant les stratégies des mouvements ultraconservateurs, ces œuvres rappellent que l’IVG n’est pas seulement un droit juridique, mais un combat politique et culturel toujours d’actualité.
En décembre 2025, le Parlement européen a approuvé l’initiative « My voice, my choice » soutenue par 1,2 million de signatures dans 19 états membres et a adopté une résolution demandant un mécanisme européen de solidarité pour garantir un avortement sûr et légal pour toutes les Européennes. On estime que 20 millions de femmes, au sein de l’Union européenne, n’ont toujours pas un accès aisé à ce droit à disposer de leurs corps.
Des lois nécessaires pour défendre le droit à l’avortement
La France célébrait, en 2025, les 50 ans de la loi Veil autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG), de 1975, sous certaines conditions. Car une multitude de femmes mourraient suite à un avortement clandestin en France jusque dans les années 1970.
Depuis, la loi a évolué et levé de nombreux obstacles, notamment, allongé le délai légal qui permet de bénéficier d’une IVG. Désormais, la France est même le premier pays à avoir inscrit dans la constitution le 8 mars 2024 que :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».
Cependant, la constitution n’est pas un bouclier total. La loi peut réduire les circonstances qui autorisent le recours à l’avortement, comme c’est le cas en Pologne où l’IVG ne peut être pratiquée que si la grossesse résulte d’une agression sexuelle, d’un inceste ou si elle constitue une menace directe pour la vie ou la santé de la mère.
Une montée des attaques ultraconservatrices contre l’IVG en France aussi
Des groupes s’emploient à envahir l’espace public de messages contre ce droit.
En 2023, à Paris, le groupe « les survivants » avait ainsi collé des stickers antiavortements sur des vélib à Paris, puis procédé à des collages sauvages d’affiches dans le métro.
L’IVG est également source de désinformation dans des médias ultraconservateurs. En 2024, la chaîne CNews a dû présenter ses excuses après avoir présenté l’avortement comme « la première cause de mortalité dans le monde », ce qui a conduit à plusieurs saisines de l’Arcom, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. En 2021, la chaîne C8, du groupe Bolloré, avait diffusé un film antiavortement en prime time produit par des Texans évangélistes.
Les opposants à l’IVG occupent également les réseaux sociaux, via des influenceurs et créent des sites et des lignes téléphoniques de désinformation, visant à convaincre les femmes de renoncer.
Raconter pour ne pas oublier
En 2024, 25 1270 interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées en France, selon la Drees. Pour que ce droit à disposer de son corps et de sa vie reste effectif, il importe de ne pas en faire un sujet tabou. Le cinéma et la littérature sont essentiels pour diffuser la mémoire, la connaissance, la parole et l’expérience des femmes.
Le cinéma nous rappelle les combats historiques menés pour la liberté à disposer de son corps. Il a été aux avant-gardes du combat en diffusant de façon clandestine Histoire d’A, de Charles Belmont et Marielle Issartel. En 1973, ce documentaire a éveillé les consciences sur les actes et les actions des MLAC (Mouvements pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Interdit par le ministre de l’époque en charge des affaires culturelles, ce film a été diffusé dans le cadre de projections clandestines.
Le cinéma a également montré les pratiques des avortements clandestins, dont celles des « faiseuses d’ange » cachées dans les cuisines, avec des instruments peu médicalisés (aiguilles à tricoter, cintres…), comme dans Une affaire de femmes, de Claude Chabrol (1988), avec Isabelle Huppert, ou le film anglais Véra Drake, de Mike Leigh (2004) avec Imelda Staunton.
Il a aussi mis en lumière la détresse de jeunes filles en quête d’avortement, des anonymes, dans l’Une chante, l’autre pas d’Agnès Varda (1977) ou dans l’Événement, de Audrey Diwan (2021), adaptation du roman d’Annie Ernaux, qui raconte l’avortement dans une résidence étudiante dans les années 60.
En 2022, la solidarité au sein des réseaux d’entraides clandestines a été au cœur de deux films : Call Jane aux États-Unis, avec Sigourney Waver et Annie Colère en France, avec Laure Calamy. Le film français de Blandine Lenoir raconte l’histoire des MLAC (Mouvements pour la liberté à disposer de son corps) qui ont formé ainsi des femmes non médecins à la méthode Karman par aspiration et organisé des voyages vers Londres ou Amsterdam.
Enfin, les combats de figures féminines courageuses, qui se sont battues pour défendre la liberté d’autres femmes de disposer de leurs corps, ont donné lieu au portrait de Simone Veil dans Simone le voyage du siècle d’Olivier Dahan (2022), ou de Giselle Halimi dans le Procès de Bobigny, de François Luciano (2006), et dans un biopic, interprété par Charlotte Gainsbourg, dont la sortie en salle est prévue pour 2026.
Le cinéma a révélé ce que sont ces avortements clandestins, des décès évitables, et montré que le droit est le fruit d’un combat collectif. Il importe de ne pas oublier cette réalité. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les avortements non sécurisés sont, de nos jours, la cause de la mort de 39000 femmes environ par an dans le monde.
Écouter les femmes : briser les obstacles et le tabou de la culpabilité
« Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. »
C’est ce que déclare Gisèle Halimi dans son livre la Cause des femmes.
La littérature, elle, a mis les mots sur les maux des femmes dans Victoire ou la douleur des femmes, de Victor Schlogel (1999), l’Évènement, d’Annie Ernaux (2000), Dix sept ans, de Colombe Schneck (2015), jusqu’au roman de Sophie Adriansen le Ciel de Joy (2025).
À lire aussi : Pourquoi faut-il voir (et lire) « L’Événement » ? Histoire et actualité de l’avortement
La littérature a replacé la question de la liberté individuelle à choisir pour son corps, sa vie, le droit à sa liberté de conscience face aux politiques. Françoise Vergès dans le Ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme (2017) a montré combien le traitement des femmes noires poussées à l’avortement par « misogynoire », c’est-à-dire mysogynie et racisme anti-noir, était contraire à la stigmatisation des femmes avortées blanches.
Enfin, la littérature a mis en valeur l’importance de l’accueil médical et de l’écoute des femmes par exemple dans le Choeur des femmes de Martin Winckler, adapté en roman graphique par Aude Mermilliod (2021).
L’avortement n’est un traumatisme que si on le rend traumatisant par un parcours éreintant, un accueil culpabilisant. Il est essentiel de former les médecins, mettre en place des services de qualité, supprimer la double clause de conscience, spécifique à l’avortement, comme le demande le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Les sociologues Marie Mathieu et Laurine Thizy dans Sociologie de l’avortement (2023) et Raphaël Perrin, dans le Choix d’avorter, contrôle médical et corps des femmes (2025), insistent sur l’importance de la formation de tous les professionnels de santé. Une femme doit pouvoir choisir librement, sans obligation de justification, une IVG médicamenteuse ou instrumentale à l’hôpital.
Pour permettre à chaque personne de faire des choix éclairés, il convient de dénoncer les projections alarmantes, culpabilisantes et d’éduquer à une sexualité comprise et maîtrisée, dès l’école, dans le cadre des programmes gradués officiels d’éducation à la vie affective relationnelle et à la sexualité (EVARS) qui permettent de prévenir et d’éviter les IVG.
À lire aussi : Éducation à la sexualité : ce que disent vraiment les programmes scolaires
Les associations et plannings familiaux représentent également des lieux de paroles essentiels pour informer et soutenir les femmes mais fort mis à mal par les coupes budgétaires.
Un droit sous pression : dénoncer les attaques
Aujourd’hui, les nouvelles attaques contre ce droit font aussi l’objet de films, documentaires. Les Croisées contre attaquent (2017), d’Alexandra Jousset et Andrea Rawlins-Gastonou ou encore la Peur au ventre (2025), de Léa Clermont Dion, révèlent la force de ces lobbys puissants. Après s’être attaquée au cyberharcèlement des femmes dans Je vous salue salope :la misogynie au temps du numérique, cette réalisatrice québécoise dénonce, dans la Peur au ventre, la propagande de ces groupes « anti-choix » venus au Canada depuis les États-Unis. Parodiant le discours des droits de l’homme, sous le prétexte fallacieux de défendre la vie, ils attaquent le droit à l’avortement, à l’euthanasie comme les droits LGBTQIA+. Avec des slogans chocs, des images macabres, ils cherchent à culpabiliser les femmes, intimider les médecins, dans le but de promouvoir une vision sociale rétrograde.
Informer, raconter, transmettre : la littérature et le cinéma ne se contentent pas d’accompagner le droit à l’avortement, ils le défendent. En donnant voix aux femmes, en portant la mémoire des luttes passées et en révélant les attaques contemporaines, ils rappellent que ce droit n’est jamais acquis et fait l’objet d’attaques incessantes.
En décembre 2025, le parlement a réhabilité les femmes condamnées pour avortement avant 1975. Le projet d’ériger un monument parisien dédié aux milliers de femmes mortes dans des avortements clandestins a été annoncé, rappelant, au pays des droits de l’homme, l’importance du droit de disposer librement de son corps, de sa vie et de sa conscience.
Cet article a été coécrit avec Véronique Séhier, ancienne coprésidente du Planning familial, rapporteure de l’étude du Conseil économique social et environnemental (Cese) « Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès » publié en 2019.
Sandrine Aragon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.01.2026 à 15:53
Faut-il arrêter de croire en la culture pour la sauver ?
Texte intégral (1417 mots)

Le secteur culturel se trouve aujourd’hui pris en étau. D’un côté, les attaques se multiplient : restrictions budgétaires, controverses autour d’un élitisme supposé, accusations de déconnexion ou de coût excessif. De l’autre, les acteurs du secteur, malgré leur engagement, peinent à regarder leur situation avec lucidité : une grande partie de la population demeure à distance de l’offre culturelle, tandis que beaucoup d’institutions continuent d’agir comme si leurs propositions s’adressaient « à tout le monde ».
Les difficultés que rencontre le milieu culturel sont parfois évoquées par les acteurs du secteur culturel, mais aussitôt amorties par des formules qui neutralisent leur portée. L’argument du manque de moyens est souvent présenté comme une explication suffisante, comme si l’énoncer résolvait le problème. L’échec de la démocratisation culturelle est constaté, mais compensé par des « j’ai envie d’y croire » ou « j’ai le droit d’être idéaliste ». Autant de manières de maintenir un récit devenu fragile. Dans ces moments, la croyance tient lieu d’analyse et empêche d’examiner les causes structurelles des tensions actuelles.
Or ces causes ne tiennent pas uniquement au contexte budgétaire ou politique. Elles sont aussi liées à la persistance de trois idées fausses qui continuent de structurer le secteur et d’orienter la manière dont la culture se raconte à elle-même, selon une croyance magico-lyrique, disait Jean Caune.
Une partie de la population n’aurait pas accès à la culture
Cette affirmation repose sur une définition restrictive, qui identifie la culture aux œuvres reconnues par l’histoire de l’art et par les institutions. Vu sous cet angle, une partie du public apparaît effectivement éloignée. Mais si l’on envisage la culture à partir des expériences esthétiques vécues que chacun d’entre nous peut vivre (même hors institution), le constat change. L’expérience du beau, de l’émotion existe partout, dans tous les milieux sociaux, mais elle s’appuie sur des pratiques et des sociabilités différentes. Les formes institutionnelles ne sont qu’une partie de ce paysage. Les pratiques culturelles de nombreux Français relèvent de moments festifs, de loisirs expressifs, de pratiques variées où l’artistique se mêle au plaisir et à la relation aux autres. On parle bien de culture néanmoins, parce que ces moments sont tous structurés autour d’une expérience esthétique qui mobilise des formes artistiques, même si elles ne correspondent pas aux canons de l’histoire de l’art. Dire que certains « n’ont pas accès » revient à confondre absence de fréquentation des institutions et absence de pratiques culturelles et à invisibiliser des pratiques bien réelles, mais non reconnues comme telles.
Il existe des œuvres universelles
Ce deuxième postulat, encore solidement ancré, suppose que certaines formes artistiques possèdent une valeur évidente pour tous. Il continue de guider de nombreuses programmations et une part majeure du financement public. Pourtant, dans la réalité, ces œuvres suscitent souvent indifférence, évitement, voire répulsion chez une large partie de la population. Non (seulement) parce que les publics seraient insuffisamment éduqués, mais parce que ces œuvres appartiennent à un univers symbolique particulier, façonné par des groupes sociaux précis – en premier lieu les professionnels de la culture identifiés aux classes supérieures.
Leur présentation comme « universelles » sert alors de justification à une hiérarchie esthétique qui ne dit pas son nom. Malgré des évolutions avec les droits culturels, elle permet de financer majoritairement des formes consacrées tout en reléguant au second plan les pratiques festives, vernaculaires, relationnelles ou populaires, pourtant largement partagées. L’erreur consiste à prendre un goût particulier – celui des élites culturelles – pour une norme collective, et à imposer cette norme au nom de l’intérêt général. Cette confusion empêche de reconnaître qu’il existe, dans la société, plusieurs régimes légitimes de culture. Certains, ceux des professionnels, reposent sur la contemplation artistique, d’autres sur l’hédonisme et le plaisir, d’autres encore sur l’intérêt relationnel et la dimension sociale de la pratique. Les traiter comme secondaires ou « non culturels » revient à nier la diversité des expériences esthétiques qui structurent aujourd’hui les usages culturels réels.
À lire aussi : Dionysos vs Apollon : expériences esthétiques et milieux sociaux
La culture crée du lien social
Cette croyance est devenue un réflexe défensif : si la culture produit du lien, elle serait légitime par principe. Pourtant, la culture engage des identités, des manières de se situer, des frontières symboliques. Dire ce que l’on pratique ou ce que l’on apprécie revient à exprimer une appartenance, parfois une prise de distance. Une même pratique peut rapprocher certains individus et groupes sociaux et tenir d’autres à l’écart. Le lien qui en découle est donc variable, parfois fragile, parfois conflictuel, loin de l’image d’un ciment social universel. Ainsi, les formes culturelles qui véhiculent des messages politiques, comme certains textes de rap, ne créent par l’adhésion des personnes qui font l’objet de leurs critiques, voire de leurs invectives, par exemple envers les policiers. Le lien qui s’établit entre ces derniers et de jeunes chanteurs, certes social, est surtout conflictuel.
Cette croyance a un autre effet, plus discret : elle évite d’examiner ce que financent réellement les politiques publiques. L’argent public ne soutient pas toutes les pratiques culturelles, mais un ensemble restreint de formes considérées comme légitimes. Les pratiques festives, quotidiennes ou relationnelles, pourtant largement partagées, demeurent marginales dans les arbitrages. De même, sont exclues des financements des formes artistiques qui seraient trop politisées ou revendicatives. En découle également un formatage de l’offre artistique institutionnelle : en recherchant un lien consensuel, les productions deviennent policées, ni trop expérimentales, ni trop politiques, sans exubérance surtout. En invoquant un lien social supposé, on contourne la question essentielle : quelles cultures sont effectivement soutenues, avec quelles attentes ? Lesquelles restent en marge, et pour quels publics ?
L’ensemble de ces croyances rassurantes a longtemps protégé la politique culturelle de ses angles morts. Elles ne suffisent plus. La situation actuelle exige d’autres repères : reconnaître la diversité des pratiques, comme le font déjà certaines collectivités territoriales ; admettre les hiérarchies existantes ; assumer les choix que produit l’argent public. La culture n’a pas besoin de récits unifiants, mais d’un diagnostic lucide. C’est seulement en clarifiant ce qui est soutenu, pour quels motifs et au bénéfice de qui, que la politique culturelle pourra se réinventer et répondre aux attentes d’une société plus diverse qu’elle ne l’a jamais été.
Fabrice Raffin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
14.01.2026 à 12:28
Mettre un patch sur ses boutons, une mode qui date de plusieurs siècles
Texte intégral (1564 mots)

Aujourd’hui populaires sur les réseaux sociaux, les patchs anti-boutons ne sont pas une invention moderne : leur ancêtre, la « mouche », décorait déjà le visage des élégantes et des coquettes du XVIIe siècle.
Vous avez sans doute déjà croisé des personnes qui se promènent avec de petits stickers sur le visage. Peut-être avez-vous vu des lunes, des étoiles, des nuages ou même des visages souriants orner les joues et le menton des gens que vous rencontrez. Peut-être en portez-vous vous-même. Si certaines personnes les utilisent comme des accessoires de mode, ces autocollants colorés sont en réalité des « patchs anti-imperfections » médicamenteux, conçus pour traiter les boutons ou l’acné.
Certains de ces patchs contiennent un gel qui s’attaque à l’imperfection en cours d’apparition en la maintenant humide afin de favoriser la cicatrisation. D’aucuns préfèrent des patchs en film quasi transparent afin d’en tirer les mêmes bénéfices, mais de manière plus discrète.
Loin d’être une mode récente, les patchs de beauté ont une longue histoire sous leur précédent nom de « mouche ». La tendance a pris son essor une première fois dans l’Europe du XVIIe siècle, avec des patchs fabriqués en papier, en soie ou en velours, voire en cuir fin, découpés en formes de losanges, d’étoiles ou de croissants de lune.
Ils pouvaient être fabriqués dans de nombreuses couleurs, mais on privilégiait généralement le noir, parce qu’il offrait un contraste parfait avec le teint pâle idéalisé des hommes et des femmes de la haute société occidentale, teint qu’ils envisageaient comme un marqueur de statut social, indiquant qu’ils ne travaillaient pas en plein air. La pièce Blurt, Master-Constable (1602) explique un autre attrait des mouches : lorsqu’elles étaient bien disposées, elles pouvaient « attirer les yeux des hommes et provoquer leurs regards ».
Le signe de Caïn
Les mouches sont fréquemment mentionnées dans les textes, de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Tout comme aujourd’hui, ces patchs avaient une double fonction. Dans sa pièce de 1601 Jack Drum’s Entertainment, John Marston explique ainsi : « Les mouches sont portées, certaines par fierté, certaines pour retenir l’écoulement, et certaines pour cacher une croûte. »
Ainsi coexistaient des pièces portées par coquetterie, et d’autres – parfois thérapeutiques – destinées à assécher des plaies. Elles servaient également à dissimuler les cicatrices laissées alors par des maladies, comme la variole ou la syphilis.
C’est ce dernier usage qui a conduit les moralistes à s’opposer aux mouches. Un livre anonyme de 1665 affirmait qu’un aumônier du roi d’Angleterre Charles Ier avait prononcé un sermon les comparant à la marque de Caïn. Il allait jusqu’à laisser entendre que le port de ces accessoires favorisait les épidémies de peste :
« Les mouches et les grains de beauté artificiels […] étaient les précurseurs d’autres taches et marques de la peste. »
D’autres moralistes semblaient davantage préoccupés encore par le fait que, tout comme le maquillage, leur fonction était de présenter une fausse apparence, susceptible de tromper son monde. Cette critique s’est généralisée au XVIIIe siècle, lorsque l’usage des mouches s’est retrouvé associé à une conduite sexuelle jugée légère.
La Carrière d’une prostituée, de William Hogarth (1731), est une série de tableaux représentant la chute d’une jeune fille de la campagne, Moll Hackabout. Nouvellement arrivée à Londres, elle est trompée par la tenancière de maison close Elizabeth Needham. Le visage de Needham est couvert de ces mouches.
Sa majesté et les mouches
Le diariste anglais Samuel Pepys mentionne ces patchs à plus d’une douzaine de reprises dans son journal, entre 1660 et 1669. Il les rencontre pour la première fois au printemps 660, lors d’un voyage d’affaires à La Haye, où il croise « deux très jolies dames, très à la mode et portant des mouches noires, qui chantaient joyeusement tout le long du trajet ».
Le lendemain, au cours d’une promenade en ville, il note :
« Tout le monde à la mode parle français ou latin, ou les deux. Les femmes, pour beaucoup d’entre elles, sont très jolies, bien vêtues, élégantes et portent des mouches noires. »
Il précise également que ces dernières étaient souvent humidifiées avec de la salive afin de les faire tenir. En mai 1668, il se souvient avoir vu Lady Castlemaine – maîtresse de Charles II – réclamer une mouche que portait sa servante, la mouiller dans sa bouche puis l’appliquer sur son propre visage. Nous savons aussi, grâce à Pepys, que Jacques, duc d’York, appréciait lui aussi de porter une ou deux mouches.
Dès le mois d’août de la même année, Pepys note dans son journal que son épouse Elizabeth portait des patchs lors d’un baptême. Il semble toutefois l’avoir oublié lorsqu’il écrit en novembre :
« Ma femme m’a paru très jolie aujourd’hui, car c’était la première fois que je lui avais donné la permission de porter une mouche noire. »
Lui-même arbora une mouche en septembre 1664, lorsqu’il se réveilla avec la bouche couverte de croûtes.
La French Touch
La mode des mouches connut son apogée durant la Restauration Stuart (1660-1700), lorsque les royalistes revenus d’exil rapportèrent des modes françaises qu’ils jugeaient le summum du raffinement.
L’écrivaine anglaise Mary Evelyn expliquait ainsi que « mouches » était le terme français en vogue pour désigner les « patchs noirs », un terme parfois utilisé également en anglais. Son poème Mundus Muliebris : Or The Ladies Dressing-Room Unlock’d, and Her Toilets Spread, publié à titre posthume en 1690, constitue une satire mordante des modes francophiles du Londres de la Restauration, auxquelles Evelyn estimait que seules les personnes vulgaires pouvaient céder.
S’il est difficile d’imaginer que les personnes qui portent aujourd’hui des patchs anti-boutons puissent faire l’objet du même type de critiques moralisatrices qu’autrefois, il existe néanmoins certains recoins d’internet où l’on se moque de celles et ceux qui sortent en public avec ces stickers.
Qu’ils soient efficaces ou non, les patchs anti-boutons restent un accessoire inoffensif. À partir de la fin du XVIIe siècle, les ouvrages commencent à mentionner les boîtes à mouches, de petits écrins ouvragés spécialement conçus pour les ranger.
Les personnes à la mode aimaient se montrer avec une petite boîte en argent, destinée à contenir leurs mouches en velours ou en soie. Peut-être faut-il y voir la prochaine étape du retour à la mode de ces patchs anti-boutons.
Sara Read ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
13.01.2026 à 15:42
« Stranger Things » : pourquoi le final divise tant les fans
Texte intégral (1936 mots)

Le 31 décembre 2025, Netflix diffusait le dernier épisode de la série Stranger Things. Intitulé « The Rightside Up », cet épisode de deux heures conclut dix années de fiction et d’hommage à la culture populaire des années 1980. Sur les réseaux sociaux, les réactions des fans explosent. Certains crient à la trahison, d’autres défendent les choix narratifs des frères Duffer. Beaucoup pleurent parce que c’est tout simplement la fin. Mais ce qui frappe, c’est l’intensité du débat où se joue une bataille collective pour donner sens à ce qu’on vient de regarder.
Attention, si vous n’avez pas vu la série, cet article en divulgâche l’intrigue !
Pendant dix ans, Netflix a construit un univers tentaculaire autour de l’œuvre des frères Duffer, transformant la série en un véritable espace immersif qui dépasse la fiction : réalité augmentée permettant aux fans de visiter les lieux de la série, jeux vidéo les replongeant dans la ville fictive d’Hawkins, sites interactifs les invitant à participer à l’histoire… Toutes ces expériences ont permis à la plate-forme d’alimenter un lecteur modèle au sens de Umberto Eco, c’est-à-dire un spectateur doté de compétences narratives très développées, capable d’interpréter les codes de la série et d’y participer activement.
Chaque saison a renforcé les attentes de ce spectateur, qui ne se contentait alors plus seulement de regarder la série mais participait également à la construction de l’univers de la série. Mais comment le final de la série peut-il honorer dix ans de participation et satisfaire une communauté qui a appris à co-créer le sens ?
L’histoire sans fin
Le final peut se lire en deux parties. La première concerne la bataille finale contre Vecna et le Flagelleur mental qui vient clore l’arc narratif principal de la série. La seconde concerne l’épilogue se déroulant dix-huit mois plus tard.
La première partie de ce season finale a beaucoup fait parler d’elle en raison de la faible durée à l’écran de la bataille finale. Les fans se sont alors amusés à comparer la durée de cette scène avec celle où l’un des protagonistes fait son coming-out dans l’épisode précédent.
Mais c’est l’épilogue qui a le plus engendré de réactions divisées de la part des fans. Lors d’une ultime partie de Donjons & Dragons dans le sous-sol des Wheeler, Mike suggère une hypothèse sur ce qui s’est vraiment passé concernant la mort du personnage de Eleven. Kali aurait créé une illusion pour sauver Eleven, la laissant s’échapper. Et puis une vision finale : Eleven vivante, dans un petit village lointain bordé par trois cascades, pour y vivre en paix.
Les frères Duffer laissent volontairement planer le doute, comme ils l’expliquent dans une interview :
« Ce que nous voulions faire, c’était confronter la réalité de sa situation après tout cela et nous demander comment elle pourrait mener une vie normale. Eleven a deux chemins à suivre. Il y a celui qui est plus sombre, plus pessimiste, et celui qui est optimiste, plein d’espoir. Mike est l’optimiste du groupe et a choisi de croire en cette histoire. »
Pour comprendre pourquoi certains fans acceptent cette ambiguïté plutôt que de la rejeter, nous pouvons convoquer le concept du « double visage de l’illusionné » proposé par Philippe Marion. Selon le chercheur, pour entrer pleinement dans une fiction, il faut accepter d’être dupé tout en sachant qu’on l’est.
Les spectateurs de Stranger Things acceptent volontairement les règles du jeu narratif. Ce contrat implicite entre l’œuvre et le spectateur est fondamental. Il explique aussi pourquoi la boucle narrative du final fonctionne. La série débute en 2016 par une partie de Donjons & Dragons et se termine par une autre partie, dans le même lieu. Cela suggère que tout ce que nous avons regardé était en quelque sorte le jeu lui-même, comme l’illustre le générique de fin où l’on voit apparaître le manuel d’utilisation du jeu Stranger Things.
Pendant dix ans, les fans ne sont pas restés passifs. Ils ont débattu, théorisé, réinterprété chaque détail. Et en faisant cela, ils ont construit collectivement le sens de la série. Le théoricien Stanley Fish nomme cela les communautés d’interprétation : des groupes qui créent ensemble la signification d’une œuvre plutôt que de la recevoir. Le final ambigu d’Eleven n’est donc pas une faille narrative mais une invitation à imaginer des suites, à co-créer le sens ensemble.
Mais certains fans ont refusé cette fin. Ils ont alors inventé le « Conformity Gate » : une théorie diffusée sur les réseaux sociaux selon laquelle le final serait une illusion, un faux happy-end. Selon cette théorie, un vrai dernier épisode révélerait que Vecna a gagné. Et pendant quelques jours, les fans y ont cru, espérant un épisode secret qui confirmerait leur lecture.
« J’y crois »
Il se joue dans la conclusion d’une œuvre sérielle un enjeu qui dépasse le simple statut du divertissement ou de l’art. Achever une série, c’est refermer une page de sa vie. La série fonctionne comme un espace de vie organisé parfois autour d’un groupe d’amis, d’un couple, d’une famille, etc.
Infusée pendant des années de rendez-vous répétés, l’implication émotionnelle atteint des sommets qui donnent parfois des réflexions troublantes : « Je connais mieux les personnages de Mad Men que ma propre famille » nous dit un témoignage dans le documentaire d’Olivier Joyard, Fins de séries (2016).
Il y aurait des séries que nous quittons en bons termes, celles qui nous quittent et celles que nous quittons. Ainsi, la fin est une affaire d’affect.
Historiquement, certaines séries ont refusé de conclure explicitement. The Sopranos se termine sur un noir brutal où le destin de Tony reste en suspens. Plus récemment, The Leftlovers, de Damon Lindelof, opère une manœuvre similaire : deux personnages prennent le thé et l’une raconte un voyage dans une réalité alternative. Mais la série refuse d’authentifier ce récit par l’image. Elle laisse les spectateurs décider s’ils y croient ou non.
C’est une stratégie que James Matthew Barrie utilisait déjà dans Peter Pan (1904) où il demandait au public de crier « J’y crois » pour sauver la Fée clochette.
Stranger Things opère la même opération de décentrement final entre deux versions du récit : Eleven s’est-elle sacrifiée ou a-t-elle rejoint cette image d’Épinal de paradis que Mike lui promettait ? C’est d’ailleurs ce même Mike qui apparaît alors en démiurge narratif, alter ego des frères Duffer, maître du jeu et de l’univers ramenant la série entière à sa métafinalité. Il crée deux récits dont l’authentification est laissée à la conviction des auteurs dans la pièce ou presque.
Les personnages font le choix de croire en cette fiction, mais comment peut-il en être autrement puisqu’ils sont eux-mêmes dans la fiction ? Le détail qui diffère de The Leftovers, c’est le choix d’authentifier par l’image la survie d’Eleven dans un plan qui la révèle dans un paysage islandais. Le choix n’est donc pas totalement libre, l’authentification par l’image donne une force supplémentaire à ce happy end dans l’interprétation de la conclusion.
Le débat va néanmoins durer, les fans vont faire vivre la série par la manière dont elle se termine, réactivant ainsi les affects qui lui sont liés.
« Je refuse d’y croire » ou le clivage de la réception
Par ailleurs, l’épilogue final donne à voir quelques images du futur de chaque protagoniste dans les mois à venir prenant soin de laisser hors champ tout un pan à venir de leur vie d’adulte. Rien ne dit que dans quelques années, l’univers de Strangers Things ne sera pas ressuscité à l’instar de tant d’autres œuvres avec une suite directe où Mike et ses amis, devenus adultes, devront faire face à une terrible menace, engageant des retrouvailles inévitables avec Eleven. Pour cela, il suffit de murmurer : « J’y crois. »
Dans une sorte d’ironie finale que seule la fiction sérielle peut nous réserver, les paroles de la chanson de Kate Bush semblent prophétiser la réaction du final pour une partie de l’audience qui souhaite prendre la place des frères Duffer pour réécrire la fin, pour réécrire leur fin, « I’d make a deal with God. And I’d get Him to swap our places » (« Je passerais un accord avec Dieu. Et je lui demanderais d’échanger nos rôles »).
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
12.01.2026 à 15:53
La Terre du Milieu de Tolkien, un lieu imaginaire pour repenser notre rapport à la nature
Texte intégral (2908 mots)

L’écrivain anglais J. R. R. Tolkien (1892-1973) était un cartographe de l’imaginaire. Dans le Seigneur des anneaux (1954-1955), il invente un monde dans lequel la frontière entre humanité et animalité est floue. Ses cartes de la Terre du Milieu construisent la cohérence spatiale et la densité narrative de la quête de la Communauté de l’anneau. Montagnes, forêts, rivières y constituent tantôt des épreuves spatiales, tantôt des espaces protecteurs ou de refuge. La géographie y structure le récit et façonne la fiction.
Les mondes imaginaires sont performatifs. Ils se nourrissent du réel dans une projection fictionnelle tout en l’interrogeant. Le Seigneur des anneaux n’y fait pas exception, nous invitant à réfléchir à nos liens avec la nature, à reconnaître sa valeur intrinsèque et à dépasser une conception dualiste opposant nature et culture, ne lui accordant qu’une valeur d’usage ou de ressource, à nous engager dans une éthique environnementale.
En suivant la Communauté, métissée, sur les chemins, parfois de traverse, les menant vers le mont Destin, nous sommes confrontés à différentes manières d’habiter et de transformer la nature : utopies rurales, zones industrieuses, refuges écologiques et lieux symboliques où des choix engagent l’avenir du monde. La fiction devient un outil pour questionner le réel, interroger nos pratiques et réfléchir aux enjeux environnementaux contemporains dans une ère désormais anthropocénique.

Habiter (avec) le monde : utopies rurales et résistance
La Comté repose sur un système agraire vivrier de polycultures fondé sur de petites exploitations familiales où le tabac réputé n’est que peu exporté. Les Hobbits vivent en autarcie et habitent littéralement une nature jardinée, dans des terriers. Le bocage, les prairies forment un maillage qui limite l’érosion et protège la biodiversité et organisent un territoire où nature et société coexistent harmonieusement. Cet idéal préindustriel s’éteint peu à peu dans le monde occidental moderne où une agriculture intensive et centralisée s’est imposée pour devenir norme sur un territoire remembré.

La forêt de Fangorn, elle, représente une nature qui résiste à la manière d’une zone à défendre (ZAD). Les Ents, gestionnaires du peuplement forestier, incarnent des arbres doués de parole, capables de révolte. Ils refusent la domination humaine fermant les sentiers d’accès avant de s’engager dans une guerre contre l’industrialisation menée par Saroumane en Isengard. Le chantier stoppé de l’autoroute A69 témoigne de la façon dont la nature peut parfois aujourd’hui par elle-même poser des limites aux projets d’aménagement voulus par l’humain.
La Lothlórien, enfin, symbolise une écotopie, un espace préservé du temps et des pressions humaines, où nature, société et spiritualité vivent en harmonie. La réserve intégrale de la forêt de la Massane, les forêts « sacrées » d’Afrique de l’Ouest ou celles du nord de la Grèce (massif du Pindes) font écho à cet idéal. Pensées comme des écosystèmes dont les dynamiques naturelles sont respectées et où l’intervention humaine contrôlée se fait discrète, elles permettent d’observer et de suivre les espèces, la régénération spontanée des habitats et leur résilience. Mais à l’image de la Lothlórien, un tel système de gestion reste spatialement rare, fragile. Il nécessite de construire la nature comme bien commun dont l’accès et l’usage sont acceptés par les communautés qui cohabitent avec ces espaces forestiers.

Ces trois types de territoires montrent qu’habiter le monde n’est pas simplement occuper, encore moins s’approprier, un espace de nature mais engager un dialogue avec lui, considérer qu’il a une valeur par lui-même, juste parce qu’il existe, et pas uniquement en tant que ressource. Il s’agit alors de cohabiter dans des interactions où chaque existant prend soin de l’autre.
Exploiter une nature ressource : de l’artificialisation à la destruction
La transformation des espaces de nature, comme le montre Tolkien, peut aussi répondre à une logique d’exploitation intensive, la nature offrant des ressources permettant d’asseoir la domination des humains sur la nature comme sur d’autres humains. Il ne s’agit plus d’envisager une cohabitation être humain/nature mais d’asservir la nature par la technique.
Isengard, le territoire de Saroumane au sud des monts Brumeux, contrôlé par la tour d’Orthanc, incarne la transformation radicale du milieu par et pour l’industrie ; une industrie dont la production d’Orques hybrides, sorte de transhumanisme appliqué à la sauvagerie, vise à renforcer le pouvoir de Saroumane et construire son armée pour prendre le contrôle d’autres territoires. La forêt est rasée, les fleuves détournés, le paysage mécanisé, dans l’unique but d’alimenter l’industrie. Les champs d’exploitation des schistes bitumineux en Amérique du Nord montrent à quel point l’exploitation de la nature peut détruire des paysages, polluer une nature qui devient impropre et dont les fonctions et services écosystémiques sont détruits).

La Moria, ancien royaume florissant du peuple Nain, est l’exemple de l’issue létale de la surexploitation d’une ressource naturelle. Si le mithril, minerai rare de très grande valeur a construit la puissance du royaume Nain, son exploitation sans cesse plus intense, vidant les profondeurs de la terre, va conduire à l’effondrement de la civilisation et à l’abandon de la Moria. Ce territoire minier en déshérence fait écho aux paysages des régions du Donbass par exemple, qui conservent aujourd’hui encore les traces visibles de décennies d’extraction charbonnière : galeries effondrées, sols instables et villes partiellement abandonnées.
Lieux de rupture et enjeux planétaires
On trouve enfin chez Tolkien une mise en scène d’espaces qui représentent des lieux de bascule pour l’intrigue et l’avenir du monde, en l’occurrence la Terre du Milieu.
Le « bourg-pont » de Bree, zone frontière matérialisée par une large rivière, marque la limite entre l’univers encore protégé, presque fermé, de la Comté et les territoires marchands de l’est, ouverts et instables. Mais Bree est aussi un carrefour dynamique, lieu d’échanges où circulent et se rencontrent des personnes, des biens et des récits. Un carrefour et une frontière où toutefois la tension et la surveillance de toutes les mobilités sont fortes.

Lieu de transition, symbolisant à la fois ouverture et fermeture territoriales, Bree est un point de bascule dans le récit où convergent et se confrontent des personnages clés de l’intrigue (les Hobbits, Aragorn, les cavaliers noirs de Sauron), les figures du Bien et du Mal autour desquelles vont se jouer l’avenir de la Terre du Milieu. Comme Bree, Calais est un point de friction entre un espace fermé (les frontières britanniques) et un espace ouvert où s’entremêlent société locale, logiques nationales et transnationales, mais où les circulations sont de plus en plus contrôlées.
Enfin, la montagne du Destin, volcan actif, incarne le lieu de rupture ultime, celui où le choix d’un individu, garder l’anneau pour lui seul dans un désir de pouvoir total ou accepter de le détruire, a des conséquences majeures pour toute la Terre du Milieu. Certains espaces jouent un rôle similaire sur notre terre. La fonte du permafrost sibérien ou de l’inlandsis antarctique pourrait libérer d’immenses quantités de carbone pour l’un, d’eau douce pour l’autre, accélérant le dérèglement climatique et la submersion de terres habitées.
Ces lieux où des actions localisées peuvent déclencher des effets systémiques globaux, au-delà de tout contrôle, concentrent ainsi des enjeux critiques, écologiques, géopolitiques ou symboliques.
La fiction constitue un puissant vecteur de réflexion quant à notre responsabilité collective dans la gestion de la nature, quant à nos choix éthiques et politiques dans la manière d’habiter la Terre en tant que bien commun et ainsi éviter d’atteindre un point de bascule qui sera celui d’un non-retour.
Léa Menard, médiatrice scientifique au laboratoire Passages (UMR -Université Bordeaux Montaigne), a participé à la rédaction de cet article. Les illustrations ont été produites dans le cadre d'une exposition au GeoDock sur Les cartes de l'Imaginaire réalisée par le laboratoire Passages, en partenariat avec le label SAPS de l'Université Bordeaux Montaigne par l'artiste Léa Dutemps.
Véronique André-Lamat ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
09.01.2026 à 11:41
« Cloud Dancer » : la couleur Pantone de l’année révèle les risques d’une esthétique du retrait
Texte intégral (2247 mots)

En désignant « Cloud Dancer » comme couleur de l’année 2026, le Pantone Color Institute consacre une nuance de blanc présentée comme aérienne, apaisante et propice à la concentration. Mais que révèle vraiment ce choix sur notre époque, au-delà du discours marketé ?
Depuis 2000, Le Pantone Color Institute fait la pluie et le beau temps dans le monde de la mode et du design en déclarant chaque année quelle couleur est « tendance ». Le discours officiel de la marque inscrit la couleur de 2026, « Cloud Dancer » dans un récit de transition collective : nous vivrions dans un monde saturé d’images et d’informations, épuisé émotionnellement, en quête de simplicité, de clarté et de reconnexion. Face à une « cacophonie » globale, « Cloud Dancer » représenterait une pause, un retrait, un silence visuel permettant de respirer.
Ce récit, en apparence consensuel, mérite pourtant d’être interrogé, car le blanc n’est jamais une absence de sens : il est historiquement, culturellement et politiquement chargé.
« Cloud Dancer » n’est donc pas une pause chromatique innocente, mais s’inscrit dans un régime esthétique du retrait, dans lequel l’effacement, la neutralisation et la pacification visuelle sont présentés comme des réponses souhaitables aux tensions. En érigeant le calme et le neutre en horizon désirable, Pantone ne suspend pas le monde : il requalifie des conflits politiques et sociaux en troubles sensoriels appelant des réponses individuelles et commerciales.
Chromophobie et hiérarchisation des couleurs
L’histoire occidentale de la couleur est traversée par une méfiance persistante que l’artiste britannique David Batchelor a qualifiée de « chromophobie ». Celle-ci désigne l’ensemble des discours qui dévalorisent la couleur, la reléguant au décoratif, au superficiel ou au suspect, tandis que la vérité, la profondeur et la raison seraient du côté de la forme, de la ligne ou de la structure.
Cette hiérarchisation est profondément située : historiquement, la couleur est associée au corps, aux émotions, à l’ornement et au féminin, tandis que le dessin, le noir ou le blanc sont valorisés comme rationnels, sérieux et maîtrisés. Comme l’a expliqué l’historienne de l’art Jacqueline Lichtenstein, dès le XVIIᵉ siècle, les débats artistiques opposent ainsi une peinture du dessin, jugée intellectuelle, à une peinture de la couleur, soupçonnée de séduire l’œil sans nourrir l’esprit.
Cette logique déborde largement le champ artistique pour structurer des rapports de pouvoir plus vastes : la couleur est assignée aux femmes et aux peuples racisés et colonisés, tandis que la sobriété chromatique devient un marqueur de civilisation, de maîtrise et de légitimité. La couleur fonctionne ainsi comme un opérateur de hiérarchisation sociale, où ce qui est coloré est minoré au profit d’un idéal de neutralité présenté comme universel.
Pour autant, la couleur ne disparaît pas : elle est omniprésente mais rendue invisible sur le plan critique. La chromophobie ne supprime pas la couleur mais la neutralise.
Dans ce système, le blanc occupe une position stratégique : perçu comme non-couleur alors qu’il est bien une couleur à part entière, il organise l’espace visuel tout en donnant l’illusion de la neutralité. Le présenter comme vide ou apaisant revient à masquer son rôle actif dans la production des normes visuelles et sociales.
Pantone et la fabrique industrielle du consensus visuel
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’action de Pantone, qui n’est pas un simple observateur des tendances. Par ses nuanciers, ses rapports prospectifs et surtout sa « couleur de l’année », il fournit une infrastructure chromatique globale aux industries de la mode, du design, de l’architecture, du marketing ou de la tech. La prévision des tendances couleur constitue aujourd’hui un marché de plusieurs millions de dollars, fondé sur l’idée que la couleur serait l’expression visible de l’« esprit du temps », capable de condenser l’humeur d’une époque en une teinte.
La couleur de l’année fonctionne comme un dispositif performatif : une fois annoncée, elle est immédiatement reprise, déclinée et normalisée, et devient tendance parce qu’elle a été désignée comme telle. Or cette croyance repose sur des bases scientifiques fragiles et l’exactitude de ces prévisions est rarement évaluée. La force du système tient moins à sa capacité prédictive qu’à sa capacité à produire un consensus culturel et industriel et des effets d’influence en cascade. Les effets de cette logique ont déjà été observés avec la tendance Millennial Pink, popularisée à l’échelle mondiale après sa consécration par Pantone en 2016.
Avec « Cloud Dancer », Pantone ne met pas en avant une couleur singulière, mais le neutre lui-même comme solution esthétique. Cette promesse masque une réalité bien documentée : le neutre est déjà dominant. La prépondérance du blanc, du noir et du gris dans les objets industriels – notamment dans l’automobile – et la progression continue des tons neutres dans les objets du quotidien témoignent d’un monde déjà largement décoloré. Présenter le blanc comme réponse apaisante ne suspend donc pas le monde : cela reconduit un ordre visuel hégémonique fondé sur l’effacement.
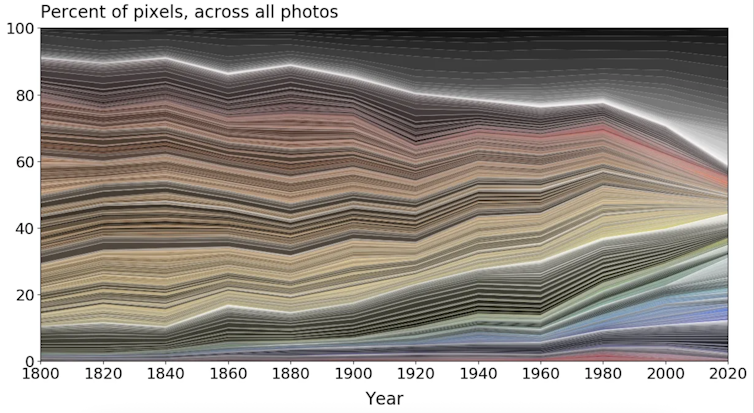
Blanc, blanchité et pouvoir
Bien qu’il soit une couleur à part entière, le blanc est fréquemment perçu comme une absence : page vierge, mur neutre, toile disponible. Cette perception est pourtant historiquement construite : l’historien Michel Pastoureau a montré que, depuis l’Antiquité, le blanc est associé à la lumière, au sacré et à l’ordre, puis le christianisme en a renforcé la charge morale en en faisant la couleur de la pureté et de l’innocence. À l’époque moderne, ces valeurs se déplacent : le blanc devient fond, norme, évidence, présenté comme universel et rationnel.
Cette naturalisation se cristallise dans le mythe de la Grèce blanche : en interprétant comme originellement immaculées des statues dont la polychromie avait disparu, l’Europe moderne a fabriqué l’image d’une civilisation fondatrice blanche, abstraite et supérieure, opposée à des cultures perçues comme colorées ou excessives. Loin d’un simple contresens archéologique, ce récit constitue un socle idéologique durable, articulant blancheur, civilisation et légitimité.
Le blanc fonctionne ainsi comme un opérateur de hiérarchisation raciale, dans lequel la blanchité ne renvoie pas seulement à une couleur de peau, mais à un régime social et culturel qui se présente comme universel, neutre et apolitique, tout en structurant silencieusement les rapports de pouvoir fondés sur la race. En s’imposant comme norme invisible, elle définit ce qui apparaît comme pur, rationnel et légitime, et relègue la différence du côté du trouble ou de la déviance.
« Cloud Dancer » face au monde contemporain
Dans un contexte marqué par la montée des extrêmes droites à l’échelle mondiale, le choix de « Cloud Dancer » ne relève pas d’un simple bien-être visuel. Il s’inscrit dans des esthétiques contemporaines de retrait, dont les figures les plus visibles sont l’esthétique de la « clean girl » qui valorise une féminité lisse, disciplinée et faussement naturelle, et l’esthétique « quiet luxury », qui prône une richesse discrète fondée sur la neutralité et l’effacement des signes de distinction.
Dans cette perspective, « Cloud Dancer » apparaît moins comme une couleur que comme une politique visuelle du retrait. Le blanc n’y agit pas comme un fond apaisant, mais comme une norme culturelle naturalisée, historiquement liée à la blanchité : il valorise lisibilité et ordre tout en produisant une dépersonnalisation des corps et des subjectivités. Cette neutralité impose un idéal de maîtrise où les différences ne sont acceptables qu’à condition d’être discrètes et non conflictuelles.
Ce régime visuel pourrait entrer en résonance avec certaines logiques fascisantes contemporaines, non par adhésion idéologique directe, mais par affinité formelle : refus du conflit visible, idéalisation de la pureté, valorisation de l’ordre, pacification des tensions. Sans faire de Pantone un acteur politique au sens strict, l’élévation du calme et de la neutralité en valeurs esthétiques dominantes contribuerait alors, de manière diffuse, à des modes de gouvernement des conflits où la conflictualité serait atténuée, déplacée ou rendue illisible. Dans cette perspective, le calme ne s’opposerait pas nécessairement à la violence des pouvoirs fascisants, mais en constituerait l’un des régimes esthétiques possibles, en amont ou en accompagnement de formes plus explicites de contrainte.
Rose K. Bideaux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
08.01.2026 à 17:13
En quoi le cas du Louvre questionne-t-il la sécurité des musées ?
Texte intégral (1992 mots)

Le cambriolage du Louvre en 2025 n’a pas seulement été spectaculaire. Il rappelle également que, malgré la sophistication croissante des dispositifs numériques, la sécurité des musées reste avant tout une affaire humaine. Alors, comment sécuriser les œuvres tout en les rendant accessibles au plus grand nombre ?
En octobre 2025, le Louvre a été victime d’un cambriolage spectaculaire. De nuit, les voleurs ont pénétré dans le musée grâce à un simple monte-charge, déjouant un dispositif de sécurité pourtant hautement technologique, pour emporter l’équivalent de 88 millions d’euros de bijoux.
Ce contraste illustre un paradoxe contemporain : à mesure que la sécurité se renforce technologiquement, ses vulnérabilités deviennent de plus en plus humaines et organisationnelles. Le Louvre n’est ici qu’un symbole d’un enjeu plus large : comment protéger la culture sans en altérer l’essence ni l’accessibilité ?
Les musées, acteurs méconnus de la sécurité mondiale
Le cambriolage du Louvre n’a fait que révéler un problème plus profond. Un prérapport de la Cour des comptes de 2025 pointe un retard préoccupant dans la sécurisation du musée : 60 % des salles de l’aile Sully et 75 % de celles de l’aile Richelieu ne sont pas couvertes par la vidéosurveillance. De plus, en quinze ans, le Louvre a perdu plus de 200 postes de sécurité, alors que sa fréquentation a augmenté de moitié. Les budgets consacrés à la sûreté, soient à peine 2 millions d’euros sur 17 millions prévus pour la maintenance, traduisent une érosion structurelle des moyens humains.
Selon les lignes directrices du Conseil international des musées, la sécurité muséale repose sur trois piliers. D’abord, la prévention, qui s’appuie notamment sur le contrôle d’accès, la gestion des flux et l’évaluation des risques. Ensuite, la protection, mise en œuvre par la vidéosurveillance, la détection d’intrusion et les protocoles d’urgence. Enfin la préservation, qui vise à assurer la continuité des activités et la sauvegarde des collections en cas de crise.
Mais dans les faits, ces principes se heurtent à la réalité des contraintes budgétaires et des architectures muséales modernes, pensées comme des espaces ouverts, transparents et très accessibles, mais structurellement difficiles à sécuriser.
Les musées français ont déjà connu plusieurs cambriolages spectaculaires. En 2010, cinq toiles de maître (Picasso, Matisse, Modigliani, Braque et Léger) ont été dérobées au musée d’Art moderne de la Ville de Paris. En 2024, le musée Cognac-Jay a été victime d’un braquage d’une grande violence en plein jour pour un butin estimé à un million d’euros. Ces affaires rappellent que les musées, loin d’être des forteresses, sont des espaces vulnérables par nature, pris entre accessibilité, visibilité et protection. Le Louvre incarne une crise organisationnelle plus large où la sûreté peine à suivre l’évolution du risque contemporain.
Le musée, nouveau maillon du système sécuritaire
Longtemps, la sécurité des musées s’est pensée de manière verticale, centrée sur quelques responsables et des protocoles stricts. Or, ce modèle hiérarchique ne répond plus à la complexité des menaces actuelles.
La sûreté muséale repose désormais sur une circulation horizontale de l’information, c’est-à-dire partagée entre tous les acteurs et mobilisant conservateurs, agents, médiateurs et visiteurs dans une vigilance partagée. Cela prend la forme d’un musée où chacun a un rôle clair dans la prévention, où l’information circule rapidement, où les équipes coopèrent et où la sécurité repose autant sur l’humain que sur la technologie.
Les risques, quant à eux, dépassent largement les frontières nationales : vol d’œuvres destinées au marché noir, cyberattaques paralysant les bases de données patrimoniales et, dans une moindre mesure, activisme climatique ciblant les symboles culturels. La protection du patrimoine devient ainsi un enjeu global impliquant États, entreprises et institutions culturelles.
Au Royaume-Uni, les musées sont désormais intégrés aux politiques antiterroristes, illustrant un processus de sécurisation du secteur. En Suède, des travaux montrent que la déficience de moyens visant à la protection muséale entraîne une perte d’efficacité, dans la mesure où la posture adoptée est plus défensive que proactive.
Protéger le patrimoine, une façon de faire société
Mais cette logique de soupçon transforme la nature même du musée. D’espace de liberté et de transmission, il tend à devenir un lieu de contrôle et de traçabilité. Pourtant, dans un monde traversé par les crises, le rôle du musée s’élargit. Il ne s’agit plus seulement de conserver des œuvres, mais de préserver la mémoire et la cohésion des sociétés.
Comme le souligne Marie Elisabeth Christensen, chercheuse spécialisée dans la protection du patrimoine en contexte de crise et les enjeux de sécurisation du patrimoine culturel, la protection du patrimoine relève du champ de la sécurité humaine. Ses travaux montrent comment, dans des zones de conflits comme Palmyre en Syrie, la sauvegarde d’un site ou d’une œuvre devient un acte de résilience collective, c’est-à-dire une manière, pour une communauté frappée par la violence et la rupture, de préserver ses repères, de maintenir une continuité symbolique et de recréer du lien social, contribuant ainsi à la stabilisation des sociétés.
Cependant, cette transformation demeure profondément inégale. Les grands musées européens et américains disposent des moyens et de la visibilité nécessaires pour assumer ce rôle tandis qu’au Sud, de nombreuses institutions restent fragmentées, marginalisées et subissent le manque de coordination au niveau international. Cette disparité révèle une gouvernance patrimoniale encore inachevée, dépendante d’agendas politiques plus que d’une stratégie mondiale de solidarité culturelle.
La protection du patrimoine devrait être pleinement intégrée aux politiques humanitaires internationales, au même titre que la santé ou l’éducation. Car protéger une œuvre, c’est aussi protéger la mémoire, les valeurs et l’avenir d’une société.
Le piège du technosolutionnisme
Face aux menaces qui pèsent sur les lieux culturels, la tentation est forte de répondre par une surenchère technologique. Après chaque incident, la même conclusion s’impose : il aurait fallu davantage de caméras, de capteurs ou d’outils de surveillance. Reconnaissance faciale, analyse comportementale, biométrie… autant de dispositifs souvent présentés comme des réponses évidentes. Les dispositifs se multiplient, nourrissant l’idée que le risque pourrait être entièrement maîtrisé par le calcul.
Ce réflexe, qualifié de technosolutionnisme, repose pourtant sur une illusion, celle d’une technologie capable de neutraliser l’incertitude. Or, comme l’ont montré des travaux en sciences sociales, la technologie ne se contente pas de « faire mieux fonctionner » les choses : elle change la façon dont les personnes se font confiance, la manière dont le pouvoir s’exerce et la répartition des responsabilités. Autrement dit, même avec les outils les plus sophistiqués, le risque reste profondément humain. La sécurité muséale relève donc avant tout d’un système social de coordination, de compétences humaines et de confiance, bien plus que d’un simple empilement de technologies.
La rapporteuse spéciale de l’ONU pour les droits culturels alertait déjà sur ce point : vouloir protéger les œuvres à tout prix peut conduire à fragiliser la liberté culturelle elle-même. La sécurité du patrimoine ne peut se limiter aux objets. Elle doit intégrer les personnes, les usages et les pratiques culturelles qui leur donnent sens.
Protéger sans enfermer
Contre la fascination technologique, une approche de complémentarité s’impose. Les outils peuvent aider, mais ils ne remplacent ni l’attention ni le discernement humain. La caméra détecte, mais c’est le regard formé qui interprète et qualifie la menace. Les agents de sécurité muséale sont aujourd’hui des médiateurs de confiance. Ils incarnent une forme de présence discrète mais essentielle qui relie le public à l’institution. Dans un monde saturé de dispositifs, c’est cette dimension humaine qui garantit la cohérence entre sécurité et culture.
La chercheuse norvégienne Siv Rebekka Runhovde souligne, à propos des vols d’œuvres du peintre Edvard Munch, le dilemme permanent entre accessibilité et sécurité. Trop d’ouverture fragilise le patrimoine, mais trop de fermeture étouffe la culture. Une sursécurisation altère la qualité de l’expérience et la confiance du public. La sécurité la plus efficace réside dans celle qui protège sans enfermer, rendant possible la rencontre entre œuvre et regards.
La sécurité muséale n’est pas seulement un ensemble de dispositifs, c’est également un acte de communication. Elle exprime la manière dont une société choisit de gérer et de protéger ce qu’elle estime essentiel et de négocier les frontières entre liberté et contrôle. Protéger la culture ne se réduit pas à empêcher le vol. C’est aussi défendre la possibilité de la rencontre humaine à l’ère numérique.
Fabrice Lollia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
07.01.2026 à 17:58
Pourquoi reconstruisons-nous les monuments « à l’identique » ?
Texte intégral (2041 mots)

En 2019, la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris « à l’identique » des matériaux d’origine et de leur mise œuvre a été présentée comme une nécessité technique, historique et parfois même mystique. Or ce type d’attitude, relativement récente, mérite d’être interrogée en tant que fait culturel qui interroge le rapport de nos sociétés à leur histoire.
Fort de la mission qui lui avait été confiée par l’État dans les années 1830, le service des Monuments historiques fut pendant près de cent cinquante ans l’unique garant du patrimoine national.
Confronté aux dévastations de la Grande Guerre, il mit en place une doctrine de reconstruction des édifices ou parties d’édifices détruits qui fut reprise après la Seconde Guerre mondiale et se maintint inchangée jusqu’au milieu des années 1990. Il ne s’agissait pas de refaire les monuments « à l’identique » de ce qu’ils étaient avant la catastrophe, mais de leur redonner leur apparence originelle tout en les améliorant d’un triple point de vue, technique, archéologique et artistique.
Les charpentes furent par exemple reconstruites en béton armé pour des raisons d’économie, de facilité d’entretien et de résistance au feu. Le matériau pouvait aussi être utilisé pour renforcer des structures instables ou remplacer à moindre coût les maçonneries traditionnelles. À Rouen, la grande voûte en bois de la salle des procureurs du palais de justice, incendiée en mars 1944, fut reconstituée dans son apparence grâce à un voile mince de béton armé supportant à la fois un lambris de bois intérieur et la couverture extérieure en ardoises épaisses. La modification concernait l’ensemble de la structure de l’édifice : du fait de la poussée de la nouvelle voûte, trois fois plus lourde que l’ancienne, il fallut renforcer les fondations en sous-œuvre et forer l’épaisseur des murs pour y installer des tirants métalliques reliant la voûte, le plancher intermédiaire en béton et les fondations.
Retrouver un état de « référence »
Sur le plan archéologique, il était courant de supprimer des éléments considérés comme non pertinents, en particulier ceux du XIXᵉ siècle, une période dévalorisée de l’histoire de l’art. Le but était de retrouver un état de référence, souvent le plus ancien connu. Par exemple pour la reconstruction de l’église de Carignan (Ardennes) détruite en 1940, l’architecte en chef Yves-Marie Froidevaux choisit de revenir à l’état de 1681 en remplaçant la tour-porche du XIXe en pierre par un clocher en charpente de style classique.
Politiques de création
Enfin, la dernière amélioration concernait le domaine de la création. Si les éléments décoratifs répétitifs (corniches, garde-corps, décor géométrique ou végétal, modénature étaient refaits tels qu’ils étaient avant la catastrophe, ce n’était généralement pas le cas des éléments artistiques uniques, tels que tympans sculptés, chapiteaux, vitraux, mobilier. Leur remplacement était alors une occasion de faire appel à des créateurs contemporains.
Lors de la première reconstruction, des commandes furent passées auprès des artistes au cas par cas pour remplacer les éléments mobiliers détruits. Lors de la seconde, le service des Monuments historiques vit dans les destructions une opportunité de développer une politique de création dans les monuments anciens, en particulier dans le domaine du vitrail. L’intervention n’était pas uniquement réparatrice : les objets et vitraux du XIXe siècle, considérés comme inappropriés, étaient souvent supprimés, qu’ils soient endommagés ou non, au profit de créations neuves. La commande reposait sur une conception corporatiste : l’objectif était de créer une classe d’artisans spécialisés dans l’intervention en milieu patrimonial. Ce n’est qu’en 1955 que les commandes commencèrent à s’ouvrir à des artistes qui n’étaient pas aussi des maîtres-verriers, comme Jacques Villon (à Metz) ou Marc Chagall (à Reims).
Les dernières interventions sur les monuments endommagés par la seconde guerre mondiale datent du milieu des années 1980. À Rouen, la flèche de la tour Saint-Romain de la cathédrale fut reconstruite en 1984 avec une charpente en béton armé.
Incontestée, la reconstruction-amélioration s’appliquait à toutes sortes d’interventions, post-catastrophe ou non : la reconstitution des combles du Parlement de Bretagne à Rennes après l’incendie de 1994, la remise en état d’usage du château de Falaise (Calvados) à partir de 1997 ou de celui de Suscinio (Morbihan).
Nouvelles pratiques de reconstruction
Mais le milieu des années 1990 fut aussi celui de l’émergence de nouvelles pratiques de (re)construction, en dehors du champ d’action du service des Monuments historiques. Les interventions s’inspiraient des méthodes de l’archéologie expérimentale qui cherchait, par la reproduction du geste créateur, à mieux comprendre les artefacts originaux. À Saint-Sylvain-d’Anjou, une association initiée par le maire de la commune restitua un château à motte en bois de l’an mil à quelques du site originel afin de l’ouvrir à la visite. À Rochefort la reconstruction de la frégate l’Hermione débuta en 1992 avec un double objectif. Il s’agissait non seulement de refaire un objet à valeur mémorielle et patrimoniale, mais aussi de mettre en scène sa fabrication dans le cadre d’un chantier immersif ouvert au public.
La construction du château (imaginaire) de Guédelon qui débuta en 1997 reposait sur la même stratégie, mais avec une exigence supplémentaire dans le domaine de l’archéologie de la matière et du geste. Il s’agissait de retrouver les savoir-faire et les matériaux correspondant à la période de référence qui avait été choisie. Les interférences avec le présent étaient évacuées pour la science mais aussi pour le spectacle, avec par exemple des ouvriers vêtus de costumes médiévaux.
Le patrimoine-spectacle existait déjà : le premier son et lumière avait eu lieu à Chambord en 1950 avec un succès planétaire et de multiples avatars au fil du temps comme celui du Puy-du-Fou. Guédelon y ajoutait une dimension scientifique et son succès témoignait de la profondeur des attentes du public, qui n’était pas seulement consommateur de divertissement.
Les actuels chantiers de la charpente de la cathédrale de Paris et de la flèche de l’abbatiale de Saint-Denis sont dans la continuité de ce renversement des pratiques engagé dans les années 1990. La triple amélioration qui caractérisait les reconstructions suivant les deux guerre mondiales s’est évaporée. Dévalorisées, les techniques modernes sont considérées comme inappropriées au moment même où leur utilisation plus que centenaire aurait pu en démontrer la pertinence économique et structurelle.
Quant à l’amélioration créative, elle paraît désormais anachronique comme le montre le procès intenté à l’encontre de l’insertion de vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris voulue par le président de la République. Appliquant les leçons de Rochefort et Guédelon, les deux chantiers parisiens convoquent science et spectacle. Il s’agit tout autant de retrouver l’apparence ancienne que de s’assurer du geste et de la matière ancienne, sous le regard du public qui est invité à suivre l’avancement des travaux, sur site (à Saint-Denis) ou en différé (à Paris) par médias interposés. Enfin l’équilibre économique est assuré de la même manière, par les dons et les recettes du chantier-spectacle.
La reconstruction de tout ou partie du patrimoine disparu a-t-elle trouvé un nouveau départ ? Le patrimoine-spectacle, qui est aussi patrimoine-science a trouvé son public, mais il ne s’applique qu’à des édifices iconiques de l’histoire nationale. Peut-être marque-t-il la fin de cette expansion patrimoniale dénoncée par les experts dans les années 1990, de l’historienne Françoise Choay, qui y voyait le signe d’un « narcissisme collectif », au directeur de l’architecture et du patrimoine François Barré qui s’inquiétait de l’abus patrimonial. Quoiqu’il en soit, le patrimoine-spectacle-et-science peut dès maintenant être érigé en emblème du champ culturel patrimonial des années 2020.
Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.
Patrice Gourbin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
06.01.2026 à 16:48
Ce que l’Athènes antique nous enseigne sur le débat – et la dissidence – à l’ère des réseaux sociaux
Texte intégral (1622 mots)

Dans l’Athènes antique, l’agora était un forum public où les citoyens pouvaient se réunir pour délibérer, débattre et prendre des décisions ensemble. Elle était régie par des principes sociaux profondément enracinés qui garantissaient des débats animés, inclusifs et sains.
Aujourd’hui, nos places publiques se sont déplacées en ligne vers les flux numériques et les forums des réseaux sociaux. Ces espaces sont pour la plupart dépourvus de règles et de codes communautaires. Ce sont plutôt des algorithmes qui décident quelles voix s’élèvent au-dessus du tumulte et lesquelles sont étouffées.
L’idée optimiste selon laquelle Internet serait un espace radicalement démocratique semble désormais un lointain souvenir. Nos conversations sont désormais façonnées par des systèmes opaques conçus pour maximiser l’engagement, et non la compréhension mutuelle. C’est la popularité algorithmique, et non l’exactitude ou la diversité des voix, qui détermine la portée des propos publiés en ligne.
Cela a créé un paradoxe. Nous jouissons d’une liberté d’expression sans précédent, mais notre discours est limité par des forces qui échappent à notre contrôle. Les voix fortes dominent. Les voix nuancées s’estompent. L’indignation se propage plus vite que la réflexion. Dans ce contexte, la participation égalitaire est pratiquement inaccessible, et s’exprimer honnêtement peut comporter un risque très réel.
Entre les marches de pierre d’Athènes et les écrans d’aujourd’hui, nous avons perdu quelque chose d’essentiel à notre vie démocratique et à notre dialogue : l’équilibre entre l’égalité de la parole et le courage de dire la vérité, même lorsque cela est dangereux. Deux anciens idéaux athéniens de liberté d’expression, l’isegoria et la parrhesia, peuvent nous aider à le retrouver.
Des idées anciennes qui nous guident encore aujourd’hui
À Athènes, l’isegoria désignait le droit de s’exprimer, mais elle ne se limitait pas à un simple droit. Elle représentait une responsabilité partagée, un engagement en faveur de l’équité et l’idée que la vie publique ne devait pas être gouvernée uniquement par les puissants.
Le terme parrhesia peut être défini comme l’audace ou la liberté d’expression. Là encore, il y a une nuance : la parrhesia n’est pas une franchise imprudente, mais un courage éthique. Elle désignait le devoir de dire la vérité, même lorsque celle-ci provoquait un malaise ou un danger.
Ces idéaux n’étaient pas des principes abstraits. Il s’agissait de pratiques civiques, apprises et renforcées par la participation. Les Athéniens comprenaient que le discours démocratique était à la fois un droit et une responsabilité, et que la qualité de la vie publique dépendait du caractère de ses citoyens.
La sphère numérique a changé le contexte, mais pas l’importance de ces vertus. L’accès seul ne suffit pas. Sans normes qui soutiennent l’égalité des voix et encouragent la vérité, la liberté d’expression devient vulnérable à la distorsion, à l’intimidation et à la manipulation.
L’émergence de contenus générés par l’intelligence artificielle (IA) intensifie ces pressions. Les citoyens doivent désormais naviguer non seulement parmi les voix humaines, mais aussi parmi celles produites par des machines qui brouillent les frontières entre crédibilité et intention.
Quand être entendu devient un privilège
Sur les plateformes contemporaines, la visibilité est répartie de manière inégale et souvent imprévisible. Les algorithmes ont tendance à amplifier les idées qui suscitent des émotions fortes, quelle que soit leur valeur. Les communautés déjà marginalisées peuvent se retrouver ignorées, tandis que celles qui prospèrent grâce à la provocation peuvent dominer la conversation.
Sur Internet, l’isegoria est remise en question d’une nouvelle manière. Peu de personnes en sont formellement exclues, mais beaucoup sont structurellement invisibles. Le droit de s’exprimer demeure, mais la possibilité d’être entendu est inégale.
Dans le même temps, la parrhesia devient plus précaire. S’exprimer avec honnêteté, en particulier sur des questions controversées, peut exposer les individus à du harcèlement, à des déformations ou à une atteinte à leur réputation. Le prix du courage a augmenté, tandis que les incitations à rester silencieux ou à se réfugier dans des chambres d’écho se sont multipliées.
À lire aussi : Social media can cause stress in real life – our 'digital thermometer' helps track it
Former des citoyens, pas des spectateurs
Les Athéniens avaient compris que les vertus démocratiques ne surgissent pas toutes seules. L’isegoria et la parrhesia se maintenaient grâce à des habitudes acquises au fil du temps : écouter était considéré comme un devoir civique, parler comme une responsabilité partagée, tout en reconnaissant que la vie publique dépendait de la personnalité de ses participants. À notre époque, c’est à travers l’éducation civique que les citoyens mettent en pratique les dispositions requises par le discours démocratique.
En transformant les salles de classe en agoras à petite échelle, les élèves peuvent apprendre à vivre la tension éthique entre l’égalité des voix et l’intégrité de la parole. Les activités qui invitent au dialogue partagé, à la prise de parole équitable et à l’attention portée aux voix les plus discrètes les aident à faire l’expérience de l’isegoria, non pas comme un droit abstrait, mais comme une pratique vécue de l’équité.
Dans la pratique, cela prend la forme de discussions et de débats au cours desquels les élèves doivent vérifier des informations, formuler et justifier des arguments, réviser leurs opinions publiquement ou débattre de manière respectueuse avec des arguments contraires. Toutes ces compétences cultivent le courage intellectuel associé à la parrhesia.
Il est important de noter que ces expériences ne dictent pas ce que les élèves doivent croire. Elles leur permettent plutôt de s’exercer à adopter des habitudes qui les rendent responsables de leurs convictions : la discipline de l’écoute, la volonté d’exposer ses arguments et la disposition à affiner sa position à la lumière de nouvelles connaissances. De telles pratiques rétablissent le sentiment que la participation démocratique n’est pas seulement liée à la liberté d’expression individuelle, mais relationnelle et construite grâce à un effort commun.
Ce que l’éducation civique offre en fin de compte, c’est de la pratique. Elle crée des agoras miniatures où les élèves s’entraînent aux compétences dont ils ont besoin en tant que citoyens : s’exprimer clairement, écouter généreusement, remettre en question les idées reçues et dialoguer avec ceux qui pensent différemment.
Ces habitudes contrebalancent les pressions du monde numérique. Elles ralentissent la conversation dans des espaces conçus pour la rapidité. Elles introduisent la réflexion dans des environnements conçus pour la réaction. Elles nous rappellent que le discours démocratique n’est pas une performance, mais une responsabilité partagée.
Retrouver l’esprit de l’agora
Le défi de notre époque n’est pas seulement technologique, mais aussi éducatif. Aucun algorithme ne peut enseigner la responsabilité, le courage ou l’équité. Ce sont des qualités qui s’acquièrent par l’expérience, la réflexion et la pratique. Les Athéniens l’avaient compris intuitivement, car leur démocratie reposait sur la capacité des citoyens ordinaires à apprendre à s’exprimer d’égal à égal et avec intégrité.
Nous sommes confrontés au même défi aujourd’hui. Si nous voulons des places publiques numériques qui soutiennent la vie démocratique, nous devons préparer les citoyens à les utiliser à bon escient. L’éducation civique n’est pas un enrichissement facultatif, c’est le terrain d’entraînement des habitudes qui soutiennent la liberté.
L’agora a peut-être changé de forme, mais son objectif demeure. Se parler et s’écouter d’égal à égal, avec honnêteté, courage et attention, reste au cœur de la démocratie. Et c’est quelque chose que nous pouvons enseigner.
Sara Kells ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
05.01.2026 à 15:38
Pourquoi faisait-on l’amour à plusieurs dans l’Antiquité ?
Texte intégral (3392 mots)

On trouve dans la Bible et chez les auteurs grecs et latins de l’Antiquité divers exemples de relations sexuelles impliquant plusieurs partenaires, qu’il s’agisse de « trouples », comme on dit aujourd’hui, ou d’orgies sexuelles. Pourquoi faisait-on l’amour à plusieurs dans l’Antiquité ?
Les premiers « trouples » apparaissent dans la Bible. Le patriarche Jacob a épousé deux sœurs : Léa l’aînée et Rachel la cadette. Or Rachel n’arrive pas à avoir d’enfants de son mari ; elle est jalouse de Léa qui a, elle, réussi à mettre au monde quatre fils. C’est alors que lui vient une idée : « Voici ma servante Bilha, dit-elle à Jacob, va vers elle, et qu’elle enfante sur mes genoux ; d’elle j’aurai moi aussi, un fils » (Genèse 30, 3).
Rachel propose donc à son mari une relation sexuelle à trois. Bilha est installée sur les genoux de sa maîtresse. Elle lui prête, pourrait-on dire, son vagin, Rachel se dédoublant en quelque sorte.
L’astuce fonctionne parfaitement, puisque, neuf mois plus tard, Bilha met au monde un fils que s’approprie aussitôt Rachel. Puis, espérant désormais rattraper son retard sur Léa, Rachel incite Jacob à une nouvelle union à trois. Nouveau succès : Rachel-Bilha accouche d’un second garçon.
C’est alors que Léa se met à craindre de perdre son avance sur sa sœur et rivale. Imitant Rachel, elle livre elle aussi à Jacob le vagin de sa servante, une dénommée Zilpa, qu’elle installe sur ses genoux, offrant à son époux deux vagins à pénétrer.
Le patriarche n’y voit rien à redire : il s’exécute volontiers, acceptant cette nouvelle manière de procréer. Par l’entremise de Zilpa, Léa donne encore deux fils à Jacob. « Quel bonheur pour moi ! », s’écrie-t-elle.
Au-delà de la signification sociale de cette histoire, on soupçonne que le rédacteur se soit aussi fait plaisir, en exposant cette totale domination patriarcale de Jacob sur ses femmes dont les désirs de maternité et la rivalité ne font qu’aggraver la soumission. Le comble étant que ce n’est même pas lui, mais ses épouses qui le poussent à faire l’amour avec les deux servantes. Et pour la bonne cause ! Car, si le patriarche multiplie ses relations sexuelles, ce n’est pas pour son plaisir personnel, mais afin d’accroître sa descendance, tout en satisfaisant les désirs de gloire maternelle des deux rivales vaniteuses…

Absalom et la partouze politique
La Bible nous offre aussi un exemple de partouze dont la signification est avant tout politique. Le prince Absalom, fils du roi David, se révolte contre son père et prend le pouvoir à Jérusalem. C’est alors que, sur les conseils d’un de ses proches, il décide de faire l’amour avec dix concubines du harem paternel. L’usurpateur pense ainsi affirmer sa virilité, tout en galvanisant ses partisans.
« On monta pour Absalom une tente sur la terrasse et Absalom alla vers les concubines de son père sous les yeux de tout Israël » (2 Samuel 16, 22).
Absalom fait installer, sur la terrasse du palais royal, une tente dans laquelle il possède les dix femmes qu’il a réunies, non à la vue mais au su de tous. Le peuple spectateur, à défaut de contempler les ébats du souverain, en perçoit seulement les râles, tandis que la toile de la tente qui les couvre en répercute les secousses. Cette spectaculaire prise de possession des concubines royales était censée légitimer le pouvoir du successeur qui se plaçait, phalliquement parlant, dans le sillage de son père.
Plaisirs masculins dans des sociétés patriarcales
Dans la Grèce antique, les unions à plusieurs ont d’abord pour fin d’assurer le plaisir d’hommes en position dominante. Aux VIe ou Ve siècles avant notre ère, les riches citoyens grecs, à Athènes ou à Corinthe, organisent des partouzes où ils convoquent des courtisanes de luxe, appelées hétaïres, chargées de les divertir par leurs chants, leurs danses ou leurs prestations sexuelles. Au cours de ces soirées, les convives pénètrent parfois à plusieurs les mêmes prostituées, comme le montre certaines peintures pornographiques sur des céramiques.
À lire aussi : Les Grecs et les Romains aimaient-ils vraiment les orgies ?
Les Grecs ne se cachent pas dès lors que leurs pratiques sexuelles sont reconnues comme valorisantes pour eux. Leur phallus est à l’honneur, pénétrant la bouche ou l’anus des prostituées. Les hommes libres doivent, en effet, toujours se trouver dans une position sexuelle vue comme supérieure : ils sont des individus « jouissant » grâce aux corps qu’ils exploitent.
Certaines prostituées de luxe pouvaient être louées par plusieurs hommes en même temps. La « colocation » permettait de réduire le coût de la prestation de la jeune fille, partagé entre ses clients, mais aussi à des amis d’en jouir en même temps au cours d’un moment considéré comme convivial et festif.

Une hypersexualité féminine condamnée
Les textes antiques évoquent aussi des plaisirs féminins. Aphrodite, Vénus pour les Romains, est décrite comme une véritable déesse libérée des carcans de la société patriarcale. Elle choisit elle-même ses amants, que ce soit parmi les dieux ou les hommes. Son époux, le dieu Héphaïstos est vu comme ridicule et impuissant.
Cependant, seule cette grande déesse bénéficie du droit de coucher avec qui elle veut, en tant que divinité de l’amour et de la beauté. Les femmes humaines ne partagent pas ce privilège divin.
Ainsi, la reine d’Égypte Cléopâtre est conspuée par les écrivains romains, car elle aurait entretenu des relations sexuelles avec de nombreux amants. Insatiable figure de l’hypersexuelle, elle aurait même couché, dit-on, avec ses propres esclaves. Un comble aux yeux de la société patriarcale romaine.
Au Ier siècle de notre ère, l’impératrice romaine Messaline est elle aussi condamnée puis assassinée par son époux, l’empereur Claude, en raison de ses infidélités. Pline l’Ancien raconte qu’elle faisait l’amour avec 25 amants par jour et organisait des orgies sexuelles au palais impérial (Pline l’Ancien, Histoire naturelle X, 83).
Elle serait aussi allée se prostituer la nuit dans des bordels de Rome, uniquement pour le plaisir.
À lire aussi : Depuis quand la vulve est-elle obscène ?
En fait, Cléopâtre et Messaline incarnent la peur de la société phallocratique romaine face à l’hypersexualité féminine, vue comme une monstruosité. L’idéal pour les Romains est qu’une femme ne connaisse qu’un seul homme à la fois : son époux. Dite univira en latin, elle est considérée comme l’épouse parfaite.
La fidélité, une qualité féminine
Dans l’Antiquité gréco-romaine, la fidélité sexuelle ou amoureuse est uniquement conçue comme une qualité féminine. Le héros grec Ulysse nous en offre un bel exemple dans l’Odyssée, d’Homère : au cours de son périple en Méditerranée, il a des relations avec plusieurs amantes, comme Circé ou Calypso, tandis que son épouse Pénélope l’attend sagement dans sa demeure d’Ithaque où elle repousse scrupuleusement tous ses prétendants.
La fidélité conjugale s’inscrit logiquement dans le prolongement de la virginité antérieure au mariage, autre qualité vue comme exclusivement féminine. Les femmes ne sont pas réputées maîtresses de leur corps qui ne leur appartient pas.
À l’inverse, le fiancé puis l’époux peut avoir toutes les relations sexuelles qu’il souhaite avec des personnes, hommes ou femmes, étrangers ou de statut inférieur : prostitués des deux sexes, esclaves, filles ou garçons non citoyens. Les sociétés grecque et romaine sont fondamentalement inégalitaires dans le sens où la loi n’est pas la même pour toutes et tous. Elles reposent sur trois oppositions fondamentales : hommes/femmes, citoyens/étrangers, maîtres/esclaves.

Une pornographie pour rire… en rappelant la morale dominante
Des fresques romaines représentant des relations sexuelles à plusieurs ont été découvertes à Pompéi. Elles ont été réalisées, au Ier siècle de notre ère, dans un but à la fois humoristique et moral : faire rire le spectateur et délivrer un message moral.
Cet humour sexuel exprime la morale du moment, comme le suggère une scène de triolisme visible dans les vestiaires des thermes suburbains de Pompéi. On voit un homme sodomisé par un autre homme, alors qu’il est lui-même en train de pénétrer une femme à quatre pattes devant lui.
On peut rapprocher cette peinture d’une histoire d’adultère racontée par le romancier antique Apulée. Le mari, de retour chez lui à l’improviste, surprend sa femme avec un jeune amant. Non sans ironie, il dit renoncer à intenter un procès pour adultère, car il partage les mêmes goûts que sa femme. Il préfère donc leur imposer une réconciliation « à trois dans un seul lit » (Apulée, Métamorphoses, IX, 27).

Une autre scène montre cette fois quatre partenaires : l’homme à gauche pénètre l’homme à sa droite, qui reçoit une fellation de la femme, qui à son tour reçoit un cunnilingus de la femme la plus à droite. L’homme qui se trouve tout à fait à gauche se trouve en position dominante, car il n’agit que pour son propre plaisir. Il adresse au spectateur un geste de la main droite, proclamant la jouissance qu’il ressent. C’est lui le vainqueur de la scène qui se présente comme une sorte de bataille entre quatre partenaires, dont trois sont soumis.
Ainsi, les peintures pornographiques romaines vantent la satisfaction sexuelle, vue comme légitime, d’individus dominants. Elles ont aussi pour but de faire rire ces mêmes hommes dominants, toujours par rapport aux attendus et préjugés de leur morale sexuelle phallocratique.

Rencontrer le divin : la partouze mystique
Les partouzes antiques peuvent aussi s’inscrire dans un contexte religieux. Selon l’historien latin Tite-Live, les adeptes du dieu Bacchus, se livraient à toutes sortes d’unions charnelles au cours de cérémonies nocturnes, à la fois sexuelles et mystiques, nommées Bacchanales.
« Le vin, la nuit, le mélange des sexes et des âges eurent bientôt éteint tout sentiment de pudeur, et l’on se livra à des vices de toute nature, chacun trouvant à satisfaire sa passion favorite » (Tite-Live, Histoire romaine, XXXIX, 8-19).
Ces antiques bacchanales seraient-elles les ancêtres des soirées libertines aujourd’hui en vogue dans certaines capitales occidentales ?
Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
05.01.2026 à 14:06
Quand la tragédie grecque éclaire les crises : que nous apprend le braquage du Louvre ?
Texte intégral (1230 mots)
Le vol du Louvre a eu un retentissement mondial. Les failles de sécurité et autres mesures de mauvais management ont été décortiquées et révélées. Mais une autre approche est possible, inspirée de la tragédie grecque. Et si ce vol était l’expression d’une fatalité.
Le 19 octobre 2025, le Musée du Louvre a été frappé par un braquage spectaculaire, mettant en lumière la vulnérabilité même des institutions réputées être les mieux protégées. Au-delà du vol, cet événement invite à réfléchir sur la manière dont les organisations gèrent l’imprévisibilité, à la lumière des leçons des tragédies grecques.
Le cambriolage du Louvre a eu un retentissement mondial, à la hauteur de la réputation de ce lieu. En quelques minutes, des bijoux historiques ont été volés. Une part du prestige du Louvre a aussi disparu à cette occasion.
Si cet événement a d’abord été présenté comme le résultat d’une défaillance sécuritaire, il révèle aussi la vulnérabilité humaine et l’illusion de la maîtrise. Et si ce braquage n’était pas seulement un incident technique, mais une tragédie au sens grec ? C’est ce que se propose d’éclairer cet article.
À lire aussi : Crise en Grèce : une tragédie qui finit bien ?
Coupable aveuglement ?
Comme les héros antiques, les institutions se heurtent parfois à leurs propres limites. Cette lecture de la crise à la lumière de la tragédie de grands dramaturges grecs (Eschyle, Sophocle, Euripide) nous invite à voir la crise non pas seulement comme le résultat d’une erreur, voire d’une faute, mais aussi comme une occasion de lucidité, voire de résilience.
Dans les tragédies antiques, le héros ne chute pas toujours par faiblesse, mais aussi par aveuglement. C’est en tentant de fuir la prophétie de l’oracle de Delphes, qu’Œdipe la réalise. Dès lors, son erreur n’est tant pas morale qu’existentielle. Refusant de reconnaître sa vulnérabilité, il interprète mal les avertissements qui lui sont envoyés. Au Louvre, un scénario de ce type s’est déroulé. Des alertes sur des failles de sécurité, même faibles, avaient été signalées depuis plusieurs années (le Figaro, 2025), mais n’ont pas été prises en compte.
La leçon donnée par la tragédie grecque dans ce contexte est d’apprendre à être lucide. Cela signifie savoir écouter les signaux d’alerte, qu’ils soient faibles ou évidents. Se préparer à une crise, c’est avant tout savoir reconnaître les avertissements et anticiper les vulnérabilités. Une fois cette disposition d’esprit adoptée, il devient possible de bien se préparer.
Penser l’imprévisible
L’approche par la tragédie invite à penser l’imprévisible. Comme les héros grecs, les personnes responsables de la sécurité dans le cas du braquage du Louvre, agissent au quotidien selon des routines et protocoles de pointe pour prévenir le vol. Pourtant, c’est arrivé. Rien ne le rendait certain, mais rien ne prévoyait qu’il ne surviendrait pas. La tragédie grecque nous enseigne que l’imprévisibilité ne vient pas toujours d’une faute, mais plutôt d’un écart irréductible entre ce que l’on prévoit et ce que le réel produit. Œdipe, en fuyant Corinthe, croit préserver ses parents. Toutefois, c’est précisément ce mouvement qui a accompli la prophétie.
La tragédie grecque nous invite ainsi à distinguer responsabilité et maîtrise absolue. Accepter l’imprévisible ne signifie pas considérer le braquage comme inévitable mais reconnaître l’idée que nul dispositif humain n’est infaillible. Le théâtre grec, nous fait prendre conscience de nos limites humaines tout en cherchant à anticiper les dangers. Il nous ouvre les yeux sur le risque et l’inscrit dans une conscience plus juste de la vulnérabilité humaine.
Le tragique et la pédagogie du dilemme
Le braquage du Louvre pose une question universelle : faut-il ouvrir largement les portes au public ou renforcer la sécurité au risque de dénaturer l’expérience culturelle ? La perspective tragique rappelle que toute décision comporte une perte. Œdipe en fuyant Corinthe pour sauver ses parents, sacrifie son statut royal pour devenir un « métèque » (au sens grec) à Thèbes. Se préparer à gérer une crise, c’est donc apprendre aux managers à faire des choix difficiles, accepter qu’une décision « moins mauvaise » soit parfois le seul possible et privilégier une éthique de la prudence. Elle invite a agir avec discernement et à réduire les risques sans viser une perfection illusoire.
Ainsi, la tragédie grecque, nous invite à former le dirigeant à faire des choix satisfaisant et réaliste et non des choix parfaits.
Après la crise : la sagesse tragique
Pour les Grecs, la tragédie était un rituel collectif de catharsis. Elle purifiait les émotions et permettait de réfléchir aux peurs et fautes de la cité (Aristote, La Poétique, IV.6, trad. 1997). De même, capitaliser sur une crise peut devenir une ressource pour les institutions culturelles. Il ne s’agit pas d’effacer le chaos, mais de le transformer en savoir partagé.
Plutôt que de clore l’affaire du Louvre dans une logique de blâme, la crise peut être une mise en récit – enquêtes, témoignages, débats internes, restitutions publiques – pour en tirer une leçon commune. Elle nous invite à la question suivante : comment réagirons-nous la prochaine fois, sachant qu’aucune institution culturelle n’est à l’abri de l’imprévisible ?
Ainsi, la tragédie devient un outil de résilience organisationnelle : non par l’oubli du drame, mais par l’intégration lucide de ses leçons, rappelant que la vraie maîtrise consiste moins à prévenir toutes les chutes qu’à apprendre à se relever ensemble.
Mary-Lieta Clement ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
03.01.2026 à 08:35
Que reste-t-il de nos argots ?
Texte intégral (1877 mots)
Lorsque l’on parle d’argot français, on imagine souvent un langage secret. Mais qu’entend-on réellement par ce mot aujourd’hui ? Entre héritage historique et usages modernes, l’argot demeure un phénomène complexe, tant pour les linguistes que pour les locuteurs du français.
Pour désigner l’argot, on parle parfois de « langue verte », expression liée au tapis vert du jeu ou de l’adverbe « vertement »… Curieusement, cette couleur rappelle la comparaison de l’argot à la végétation produite par « une greffe malsaine » que décrit Victor Hugo, et qui trouve ses racines « dans le vieux tronc gaulois ». Bien que cette image puisse refléter une forme d’« argotophobie », l’argot suscite aussi fascination et nostalgie : certains parlent même d’« un blues » de l’âge d’or argotique. Alors, que nous en reste-t-il ?
Une histoire ancienne
Dans l’imaginaire collectif, l’argot est en partie associé à la littérature du XIXe siècle et au cinéma du XXe. Cependant, il est évident que l’argot ne se limite pas à ces périodes. Au XIIe siècle, chez Jehan Bodel, on trouve la première trace écrite d’un dialogue produit entre deux brigands dans une taverne. Cet acte montre déjà une volonté de permettre l’identification d’un groupe social (les voyous) par un usage non standard. L’argot a toujours véhiculé une dimension identitaire souvent associée aux malfaiteurs, bien avant l’urbanisation qui a façonné son évolution moderne (on pense aussi au fameux Vidocq – arrageois tout comme Jehan Bodel). Mais l’argot est surtout connu pour sa fonction cryptique : il permet de reconnaître l’appartenance d’un locuteur, tout en cachant des informations aux non-initiés.
C’est là qu’il diffère du jargon dans son sens moderne, davantage lié à un usage professionnel sans volonté de dissimulation. Le mot « argot » lui-même ne prend son sens actuel qu’à partir du XVIIe siècle. Il désignait d’abord un « royaume », celui des marginaux de la célèbre Cour des Miracles, avant de renvoyer à leur façon de parler qu’on appelait alors à ce moment-ci… « jargon du Royaume d’Argot » !
Un outil pour dire le réel ?
Bref, depuis longtemps, l’argot est lié à l’idée de marginalité. François Villon, poète du XVe siècle, est un des anciens auteurs les plus connus à utiliser l’argot de manière littéraire pour signaler son appartenance sociale (cela démontre qu’il fréquentait la bande des « Coquillards »).
Au tournant des XIXe et XXe siècles, l’argot est aussi un outil littéraire critique : le poète Jehan-Rictus, dans Les Soliloques du Pauvre (1896), s’en sert pour dénoncer la misère et moquer les auteurs bourgeois qui prétendent la raconter en empruntant leurs mots, tel, selon lui, Aristide Bruant.
Aujourd’hui, des pratiques argotiques contemporaines artistiques existent toujours : avec de la littérature que certains appelleront « de banlieue » ou « urbaine », et, surtout, avec un rap français très présent dans la culture populaire. Celui-ci entretient en effet un rapport étroit avec ce qui peut parfois être appelé un parler « des cités » ou encore un « argot des jeunes ». Il ne s’agit pas d’un système homogène mais d’un ensemble de pratiques langagières mouvantes (on peut déjà le constater de par les appellations qu’on tente de lui donner… quelles cités ? quels jeunes ?).
Des néologismes argotiques contemporains
La pratique argotique contemporaine repose largement sur le français populaire. L’argot ne crée pas une langue à part entière : il fait naître des actualisations linguistiques diverses et trahit souvent l’habitus du locuteur.
Le linguiste Albert Dauzat notait en 1946 que « l’argot accélère le renouvellement du langage ». Cette créativité lexicale se poursuit bien aujourd’hui à travers ce que l’on peut appeler « la néologie argotique », c’est-à-dire la création de mots nouveaux mais aussi d’emplois nouveaux de mots existants.
La notion de « nouveauté » reste cependant relative : un mot peut être courant dans un groupe et inconnu ailleurs. Il faut souligner aussi que l’argot connaît une dimension diatopique : il n’est pas un patois, mais peut présenter des formes locales. On rencontre par exemple un argot à clef « en -zer », associé à la région de Grigny, ou l’ajout du suffixe « -stre » en fin de mot, propre à Marseille.
Enfin, on notera que certains mots traversent les siècles : c’est le cas de « daron », attesté dès le XVIIe siècle. C’est un mot-valise issu de « dam » (seigneur) et baron. Il signifiait « maître de maison », puis « patron », avant de prendre son sens actuel de « père ».
Les couleurs de l’argot
La néologie argotique contemporaine se manifeste par divers procédés dont la grande majorité existe depuis bien longtemps. Il est important de comprendre que n’est pas tant leur nature mais leur fréquence qui la caractérise et lui donne ses couleurs.
Ils sont variés : troncations (suppression de certaines syllabes, comme « déter » < « déterminé »), siglaisons (« BG » < « Beau Gosse »)… Les emprunts sont très nombreux, on pense principalement à l’anglais « stalker » (< « espionner »), à l’arabe « bélek (à) » (< « fais attention (à) ») ou le célèbre « wesh », au non moins célèbre « poucave » (< « mouchard) faisant partie des emprunts à la langue romani, mais aussi par exemple au nouchi, un argot ivoirien (par exemple : « tchoin » < « prostituée »). Le verlan est plus complexe à analyser qu’il n’y paraît : il suit des règles précises suivant le nombre de ses syllabes et peut impliquer notamment des troncations et réagencements complexes. Il existe même un verlan du verlan, dit « veul », c’est le cas du mot « feumeu » (de « femme », cela devient « meufeu », puis…). Enfin, il faudrait noter que le jargon du jeu vidéo influence fortement l’argot courant (par exemple : « GG » < « Good Game »), tout comme l’algospeak (avec notamment le fameux « Tanaland », s’il ne fallait en citer qu’un).
Parce que c’est aussi amusant !
Les réseaux sociaux (notamment, oui, pour cacher du contenu sur Internet) et le rap accélèrent la création mais aussi la circulation des mots. La culture hip-hop, fortement ancrée dans l’oralité, diffuse en effet largement des termes qui se propagent dans la « jeunesse » et au-delà. Si les artistes s’en emparent, c’est aussi qu’il y a une dimension poétique des pratiques argotiques. Le jeu est indissociable de l’usage de la langue, qu’il soit littéraire ou quotidien. Le linguiste Roman Jakobson, qui parle de « fonction poétique » pour désigner cela, rappelle que cette fonction « est présente dès la première enfance » et accompagne les locuteurs tout au long de leur vie, révélant un certain goût pour le jeu avec les mots. Cette dimension du jeu fait partie intégrante des dynamiques sociales et identitaires au sein des groupes.
Comme l’évoque une recherche menée auprès d’adolescents scolarisés, le recours à l’argot apparaît aussi comme une forme de relâchement face à la pression du langage institutionnel, qu’ils associent à un cadre contraignant.
Ainsi, lorsque des collégiens ou des lycéens utilisent des termes ou des expressions argotiques, leur intention va bien au-delà de la simple volonté de « cacher » leur propos. Ils s’amusent avant tout avec la structure même de la langue. Oui, les pratiques argotiques contemporaines peuvent encore répondre à un besoin de communication secrète ou marginale, mais, par sa fonction ludique, la pratique témoigne qu’elle n’est pas seulement un outil de subversion, mais aussi un moyen de s’amuser, de se libérer des contraintes sociales.
L’usage ludique de l’argot ne concerne évidemment pas que les jeunes : chaque locuteur possède son propre répertoire linguistique dans lequel puiser des styles, qu’il active selon le contexte de son interaction. L’argot devient une manière de dire le monde autrement, selon ses compétences, son désir poétique, sa recherche de connivence humaine et de sa volonté de s’affranchir de la convenance hégémonique.
Anne Gensane ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
01.01.2026 à 09:45
Le Paris de Bilal Hamdad, vivifiant hommage aux maîtres de la peinture
Texte intégral (1067 mots)
À travers ses peintures, Bilal Hamdad transforme l’ordinaire en mythique, en donnant à voir des scènes et des postures contemporaines nimbées d’une lumière intemporelle et mystérieuse.
Ces dernières années, à Paris, des fonds privés ont investi dans d’anciennes institutions parisiennes afin d’en transformer les espaces pour accueillir des œuvres contemporaines. Les foules affluent par exemple à la Bourse du Commerce-Pinault Collection : autrefois marché aux grains, puis marché du travail, elle a été transformée par l’architecte japonais Tadao Ando en un espace blanc et épuré. Il en va de même pour la nouvelle Fondation Cartier, récemment inaugurée, qui abritait auparavant un hôtel et le Louvre des antiquaires. L’architecte français Jean Nouvel l’a réaménagée en un vaste musée d’art contemporain. À l’intérieur, tout n’est que lignes épurées et verre.
Le Petit Palais, en revanche, a conservé ses courbes fin de siècle et ses ferronneries alambiquées. Il est calme, et l’entrée des collections permanentes y est gratuite, comme dans tous les musées de la Ville de Paris. Mais s’il fait exception dans le paysage artistique toujours plus riche de la capitale, c’est aussi pour l’originalité des expositions qu’il propose.
Dans ce majestueux bâtiment, j’ai découvert avec surprise « l’ivresse du moderne », telle que la définissait le poète Charles Baudelaire : « La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. »
L’événement éphémère en question se nomme « Paname », une exposition du peintre émergent Bilal Hamdad. Elle illustre brillamment la combinaison magique exprimée par Baudelaire : une vision fraîche et vibrante de la vie urbaine installée au milieu des trésors de la collection permanente du musée. L’exposition présente 20 œuvres de Hamdad, dont deux spécialement créées et inspirées par la collection du musée.
Né en Algérie en 1987 et aujourd’hui installé à Paris, Hamdad est un habitué du Petit Palais, où il s’est imprégné des enseignements de grands maîtres tels que Claude Monet, Paul Gauguin et Edgar Degas. Son œuvre s’inspire de ces derniers dans des compositions représentant la vie quotidienne dans les villes contemporaines. La solitude y est un thème récurrent, comme elle l’était pour Baudelaire qui, à l’instar de Hamdad, accordait une attention particulière aux travailleurs de la ville qui arpentaient les quais de Seine, boîte à outils à la main (« Et le sombre Paris, en se frottant les yeux,/Empoignait ses outils – vieillard laborieux ! »)
Dans ses magnifiques peintures à l’huile grand format, on voit des femmes qui attendent sur le quai du métro, des sacs qui pèsent sur les épaules, et des jeunes hommes perchés sur des balustrades ou des rambardes qui attendent du travail ou une rencontre. On y voit des scènes de marché à la sortie du métro, avec des femmes vendant des épis de maïs dans des caddies, et des vendeurs à la sauvette qui croisent des hipsters ou des touristes avec leurs lunettes de soleil et leurs sacs à main.
Bien que Hamdad travaille à partir de photographies, qu’il décrit comme son carnet de croquis, ses œuvres ont une profondeur et une intensité qui transforment l’ordinaire en mythique, projetant les détails de la mode et des postures contemporaines dans une lumière intemporelle et mystérieuse. La peinture la plus énigmatique de cette exposition est sa subtile réinterprétation du tableau d’Édouard Manet de 1882, Un bar aux Folies Bergère, qui est exposé à la Courtauld Gallery de Londres.
Dans l’original, Manet joue avec les effets d’un grand miroir terni derrière le bar. Le miroir reflète le dos d’une serveuse qui fixe un point à l’extérieur du tableau, à côté des bouteilles et du bol de clémentines sur le bar. Avec ce jeu de reflets, Manet représente la serveuse à la fois comme l’objet de notre regard scrutateur et comme éloignée de nous, dans une forme de solitude et de vulnérabilité.
Dans Sérénité d’une ombre (2024), Hamdad développe l’intention de Manet, la poussant davantage dans l’ombre. Le premier plan, baigné de lumière, nous montre le bar, clin d’œil à celui de Manet, avec un magnifique bol d’oranges et une délicate composition florale. À l’arrière-plan, on distingue à peine un barman en chemise blanche, un peu voûté, manifestement fatigué par sa journée de travail.
Le moment est mélancolique, en retrait, mais il fait écho au brouhaha de la ville contemporaine. Ce tableau est accroché, comme toutes les toiles de Hamdad, au cœur des galeries éclectiques du Petit Palais, ouvrant une fenêtre sur un temps qui mêle passé et présent. Et dans ce dialogue entre l’ancien et le nouveau, le spectateur comprend immédiatement que cette œuvre est là pour durer.
« Paname » de Bilal Hamdad est présenté au Petit Palais à Paris jusqu’au 8 février 2026
Anna-Louise Milne ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
28.12.2025 à 13:51
Brigitte Bardot a défini la femme moderne tout en défiant les normes sociales
Texte intégral (1721 mots)
De Et Dieu… créa la femme à ses engagements controversés, Brigitte Bardot a incarné la liberté, la sensualité et les contradictions d’une époque en mutation. Elle est décédée dimanche à l'âge de 91 ans.
La mort de Brigitte Bardot, à l’âge de 91 ans, met un terme à l’une des carrières les plus extraordinaires de la vie culturelle française de l’après-guerre.
Surtout connue comme actrice, elle fut aussi chanteuse, icône de mode, militante pour les droits des animaux et symbole de la libération sexuelle en France. Assez célèbre pour être désignée par ses seules initiales, B.B. incarnait une certaine vision de la féminité française — rebelle et sensuelle, mais aussi vulnérable.
Son influence sur les normes de beauté et sur l’identité nationale française fut considérable. À l’apogée de sa carrière, elle rivalisait avec Marilyn Monroe en termes de célébrité et de reconnaissance mondiale. Simone de Beauvoir, grande figure du féminisme, eux ces mots célèbres en 1959 à propos de Bardot : « « Elle est une force de la nature, dangereuse tant qu’elle n’est pas disciplinée, mais il revient à l’homme de la domestiquer ».
Une étoile est née
Bardot naît en 1934 dans une famille parisienne aisée. Élevée dans un foyer catholique strict, elle étudie le ballet au Conservatoire de Paris avec l’espoir de devenir danseuse professionnelle. Sa beauté saisissante la conduit vers le mannequinat. À 14 ans, elle apparaît déjà dans le magazine Elle, attirant l’attention du réalisateur Roger Vadim, qu’elle épouse en 1952.
Elle débute sa carrière d’actrice au début des années 1950, et son interprétation de Juliette dans Et Dieu… créa la femme (1956), réalisé par Vadim, la propulse sur le devant de la scène.
Bardot est aussitôt propulsée au rang de star internationale. Vadim présente son épouse comme l’expression ultime d’une liberté juvénile et érotique qui choque autant qu’elle fascine le public français.
En regardant aujourd’hui ce film relativement sage, il est difficile d’imaginer à quel point la performance de Bardot a pu briser les tabous. Mais dans la France catholique, conservatrice et assoupie des années 1950, elle impose de nouvelles normes de sexualité à l’écran. Le film devient un phénomène mondial. Les critiques l’adorent, tandis que les censeurs et les groupes religieux s’inquiètent.
Une icône des années 1960
Le fait qu'elle n'ait jamais reçu de formation d'actrice devient paradoxalement l’un de ses atouts : elle adopte un jeu spontané, autant physique que verbal. Elle est saisissante dans Le Mépris (1963), le chef-d’œuvre de Jean-Luc Godard sur un couple en train de se désagréger. Godard utilise sa beauté et son aura à la fois comme spectacle et comme objet de critique. La séquence la plus célèbre du film est une conversation de 31 minutes entre Bardot et son partenaire Michel Piccoli. Bardot n’a sans doute jamais été aussi juste.
Dans le drame judiciaire intense d’Henri-Georges Clouzot, La Vérité (1960), elle révèle toute son ampleur dramatique en incarnant une jeune femme jugée pour le meurtre de son amant.
En 1965, elle partage l’affiche avec Jeanne Moreau dans Viva Maria, de Louis Malle, un film de copines mêlant comédie et satire politique. L’énergie anarchique de Bardot y demeure éblouissante.
Dans Vie privée du même Louis Malle (1962), elle avait incarné une femme consumée par la célébrité et pourchassée par les médias. L’intrigue se révèle étrangement prémonitoire du destin à venir de Bardot.
Elle impose des modes comme la coiffure choucroute ou les ballerines. Le col Bardot — tops et robes aux épaules dénudées — porte son nom. Elle va même jusqu’à porter du vichy rose lors de son mariage en 1959.
Séduction et provocation
Le pouvoir d’attraction de Bardot tenait à ses contradictions. Elle paraissait à la fois naturelle et provocante, spontanée et calculatrice. Son glamour ébouriffé et sa sexualité apparemment sans effort ont contribué à façonner l’archétype moderne de ce qu'on appelle en anglais la « sex kitten », jeune femme ultra-sensuelle. On lui attribuait ces mots : « il vaut mieux être infidèle que fidèle sans en avoir envie ».
En rejetant les carcans de la morale bourgeoise, Bardot a incarné un engagement radical en faveur de la liberté émotionnelle et sexuelle. Sa vie amoureuse tumultueuse en est l’illustration : elle s’est mariée quatre fois, a connu des dizaines de relations orageuses et de nombreuses liaisons extraconjugales. On lui attribuait d'ailleurs ces mots : « il vaut mieux être infidèle que fidèle sans en avoir envie ».
À jamais immortalisée comme une ingénue libre d’esprit, Bardot joua les muses pour de nombreux cinéastes, artistes ou des musiciens, d’Andy Warhol à Serge Gainsbourg. Plus tard, Kate Moss, Amy Winehouse et Elle Fanning l'ont citée comme source d’inspiration.
BB est également connue pour n’avoir jamais cédé à la chirurgie esthétique. Comme elle l’a un jour expliqué :
Les femmes devraient accepter de vieillir, parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus beau d’avoir une grand-mère avec des cheveux blancs et qui a l'air d'une femme âgée, plutôt que d'avoir une grand-mère décolorée, teinte, et maquillée qui a l'air encore bien plus âgée, mais qui a l'air vraiment malheureuse.
Une vie après le cinéma
Bardot quitte le cinéma en 1973, à seulement 39 ans, évoquant sa désillusion face à la célébrité. « Cela m’étouffait et me détruisait », confiait-elle à propos de l’industrie du film.
Elle concentre alors son énergie sur la défense des animaux, fondant en 1986 la Fondation Brigitte Bardot. Elle devient une militante inflexible et très active, luttant contre la maltraitance animale, l’élevage pour la fourrure, la chasse à la baleine et la corrida.
Mais Bardot suscite la controverse dès le milieu des années 1990 en raison de ses opinions politiques d’extrême droite, de ses déclarations sur l’islam et l’immigration, ainsi que de ses multiples condamnations pour incitation à la haine raciale. Elle a défendu publiquement l’acteur disgracié Gérard Depardieu et contesté le mouvement #MeToo en France.
Ces prises de position ont entaché sa réputation, surtout à l’international, et ont contribué à créer une image problématique : le sex-symbol jadis libérateur désormais associé au conservatisme nationaliste.
Si elle ne s’est jamais revendiquée féministe, son autonomie assumée, sa retraite précoce et ses opinions tranchées ont amené certains à la réévaluer comme une figure de rébellion proto-féministe.
L'opinion publique française a progressivement commencé à se détourner de Bardot, gênée par ses opinions tranchées. Mais certains saluaient son attitude désinvolte et son refus de se plier aux règles.
En fin de compte, en rejetant la célébrité à ses propres conditions, elle a transformé sa liberté d’esprit des années 1950 en un acte audacieux contre la conformité et les normes sociales.
Dans ses dernières années, elle confiait à Danièle Thompson, scénariste et réalisatrice de la mini-série de 2023 sur sa carrière : « Je ne comprends pas pourquoi le monde entier parle encore de moi ».
La réponse est simple : Bardot continue de nous fasciner, avec toutes ses imperfections.
Ben McCann ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
28.12.2025 à 11:10
Avatar : la réincarnation néo-colonialiste du « bon sauvage » et ses impasses écologiques
Texte intégral (2327 mots)

Pandora n’est pas l’Amazonie. Pourtant, depuis plus de quinze ans, la saga Avatar entretient la confusion entre fiction et réalité, nourrissant le mythe séduisant mais problématique du « bon sauvage écologiste ».
La sortie d’Avatar : de Feu et de Cendres le 17 décembre, donne l’occasion de revenir sur un parti pris représentationnel qui irrigue la saga : « le bon sauvage écologiste ».
Le « bon sauvage » reste encore un important référent dans nos imaginaires occidentaux ainsi que nous le présentions dans notre récent ouvrage, L’héroïsation du bon sauvage de l’antiquité au XXIᵉ siècle : émergence de l’éco-spiritualisme. À ce titre, l’actualisation moderne de cette figure se fait autour d’une vision romantique et écologistante dominante dans notre société du spectacle. Cela représente un impensé problématique, puisque le mythe du bon sauvage lie les peuples autochtones à une norme impossible et une assignation identitaire archaïque.
L’appropriation culturelle de James Cameron
Le parallèle entre la réalité amazonienne des peuples premiers et les personnages du film, remplis de pureté et de sagesse mythologique, est directement assumé par le réalisateur. L’univers d’Avatar nous plonge dans un imaginaire édénique sur la planète Pandora, couverte d’une jungle luxuriante qui devient le théâtre d’un choc entre une population autochtone idéalisée et des barbares humains venus exploiter un minerai rare. Cet imaginaire occidental est problématique à plusieurs titres.
James Cameron assume directement la comparaison entre son film de science-fiction et la réalité complexe de l’Amazonie. Par exemple, il a demandé aux acteurs de s’immerger dans la jungle amazonienne auprès des indigènes du Brésil avant le tournage du deuxième film, déclarant : « Je veux amener mes acteurs ici, pour pouvoir mieux raconter l’histoire ». Il dresse ensuite un parallèle direct entre son film et la lutte contre le barrage de Belo Monte, multipliant les interventions dans la presse où fiction et réalité amazonienne semblent absolument comparables.
Le rêve d’une wilderness hollywoodienne
Par ailleurs, l’internationalisation de la « wilderness » étatsunienne et son imaginaire socio-politique transparaît aussi dans l’œuvre de James Cameron. La wilderness traduit un rapport particulier à la nature sauvage et édénique, où l’humain n’est qu’un visiteur temporaire, comme défini par le Wilderness Act de 1964 aux États-Unis. Outre-Atlantique, elle occupe une place centrale dans l’histoire et la culture : elle symbolise d’abord la frontière à conquérir pour l’expansion pionnière, puis devient un idéal de préservation. Cet éco-imaginaire de wilderness doit être appréhendé culturellement.
L’étude de Lawrence Buell a déjà montré le rôle de la wilderness dans la formation, dès les années 90, d’un « imaginaire environnemental » aux États-Unis. Cette pensée nourrit les différents mouvements écologistes, en particulier l’écologie profonde et le monde libertaire. Dans ce cadre, l’Amazonie, par sa force évocatrice, constitue la quintessence d’une « wilderness » : une nature sauvage peuplée de simples « bons sauvages » dans un Éden préservé, propice aux idéalismes. L’Amazonie se transforme ainsi dans l’imaginaire occidental en une nature fabuleuse, animée de monstruosités ou d’angélisme. Cette nature sauvage globalisée dans les éco-imaginaires modernes est pourtant une construction sociale et historique qu’il convient d’interroger. La wilderness est une représentation collective de la nature sauvage, non pas une réalité objective.
Échos d’un néo-colonialisme du quotidien
Dans le contexte du buzz autour du premier film en 2009-2010, le reportage « Le monde d’Avatar en vrai » (magazine « Haute Définition », diffusé sur TF1 le 17 mai 2010) part à la rencontre de la tribu des Yawalapiti. Ce document, toujours disponible sur YouTube, attire massivement les internautes en montrant à l’excès la pureté et l’Éden coupé du monde de ces « bons sauvages », avec des séquences fortement caricaturales. Il s’agit de mettre en scène pour assurer le spectacle par exemple des commentaires sur le 11 septembre pour illustrer leur incompréhension de la violence, ou encore la découverte prétendue de la civilisation occidentale via de multiples images sur un ordinateur.
La persistance du mythe du « bon sauvage » au cinéma
Les rares études sur le sauvage/bon sauvage au cinéma traitent essentiellement des dimensions techniques ou esthétiques. Une exception remarquable est le travail de l’anthropologue Roger Bartra dans son ouvrage Los salvajes en el cine. Ce chercheur mexicain, renommé pour ses travaux sur le « bon sauvage » dans les années 90, démontre la profondeur et la contemporanéité de ce mythe au cinéma et dans notre société occidentale.
Selon Bartra, le mythe de l’homme sauvage est issu d’un stéréotype enraciné dans la littérature et l’art européens depuis le XIe siècle, cristallisé dans un thème précis et facilement reconnaissable. Ce mythe dépasse les limites du Moyen Âge ou de la colonisation et traverse les millénaires, se confondant avec les grands problèmes de la culture occidentale. La civilisation n’a pas fait un pas sans être accompagnée de son ombre : le sauvage. De nos jours, l’idée du « bon sauvage » prend progressivement le pas sur son jumeau « le sauvage ». Bartra met en avant la notion de « néo-sauvages » pour décrire les représentations au sein des industries culturelles dominantes, et notamment via le « soft power » hollywoodien, de personnages : héroïques, valeureux, simples et proches de la nature (ex. : dans « Game of Thrones », Tarzan ou encore Apocalypto de Mel Gibson).
Ainsi, le mythe du « bon sauvage » est une tendance de fond au sein de la culture populaire, particulièrement via le septième art. Cette circulation médiatique du mythe s’adapte aux contextes de nos sociétés. La crise climatique engendre une réactivation de ce mythe vers celui d’un « bon sauvage écologiste », dont Avatar semble être la quintessence.
Déconstruire le mythe du « bon sauvage »
Dans un article critique intitulé « L’Amazonie n’est pas Avatar », l’économiste Hernando de Soto dénonce cette comparaison qui tend à s’installer en Occident. Il fait valoir que de nombreux « mythes et idées reçues persistent à marginaliser les populations indigènes et à les exclure de toute intégration dans l’économie mondiale ».
Selon lui, Avatar perpétue l’idée rousseauiste d’un état de nature idéalisé, dont la figure du « bon sauvage » est clef : « Nous sommes nombreux à avoir adhéré automatiquement aux messages véhiculés par le film, à savoir que les peuples indigènes du monde sont satisfaits de leur mode de vie traditionnel, qu’ils s’épanouissent dans un état d’harmonie rousseauiste avec leur environnement et qu’ils ne voient certes pas l’intérêt de prendre part à l’éconoime de marché de leur pays, mondialisation ou pas. »
Avatar est l’un des rares contenus où la représentation problématique des « bons sauvages » a été dûment traitée par différents chercheurs. Les conclusions sur l’aspect néo-colonialiste sont déjà connues concernant une œuvre caricaturale, à tel point que la chercheuse Franciska Cetti appelle à « décoloniser la science-fiction ».
De notre côté, nous mettons en lumière le caractère systémique de cette représentation du « bon sauvage » au sein d’un ouvrage de vulgarisation de notre thèse. Le bon sauvage est le héros, malgré lui, des errances de l’imaginaire social dans une société occidentale en crise de sens devant l’urgence climatique. Ainsi, la résurgence médiatico-politique du mythe, que Fanon aurait probablement qualifiée de « masque blanc écologique », a nourri les débats durant la COP30 d’un faux multilatéralisme paternaliste. Notre ouvrage permet de mieux saisir l’historicité et le degré civilisationnel de cet impasse écologique et spirituelle.
Vers une critique métapolitique globale
Le « bon sauvage écologiste » n’est pas une construction neutre. Il constitue un dispositif idéologique qui cristallise et légitime un discours vague de reconnexion à la nature. L’universitaire Kent H. Redford appelle à ne plus instrumentaliser cette figure, tout en valorisant les peuples premiers sans recyclage néo-colonialiste.
Alors que l’animisme ou le mélange écologie-spiritualité devient une tendance en Occident, il convient de s’interroger sur la cohérence de cette appropriation culturelle. Selon l’anthropologue Wolfgang Kapfhammer : « La question simple est : est-il viable de penser aux cosmologies des cultures marginalisées pour réanimer la cosmologie hégémonique occidentale qui est tombée en crise ? Ou cela signifie-t-il à nouveau abuser de ces cultures indigènes comme un simple espace de projection pour compenser nos mécontentements culturels ? »
La pensée rousseauiste imprègne encore profondément nos imaginaires. Selon le philosophe, l’homme nait bon par nature et c’est la société qui le corrompt. Ce dernier suppose l’existence d’un état naturel humain où tous les hommes seraient nés bons, purs et innocents, heureux avant de rentrer en contact avec la société et de se pervertir.
À l’heure où règne la reconnexion à la nature et à soi, notamment dans certains milieux de l’écologie politique, les évolutions internes de cette mouvance tendent à revaloriser une « écologie profonde » et collapsologue, traditionnellement ouverte aux mysticismes. L’éco-spiritualisme pourrait même devenir à terme majoritaire dans certains milieux de l’écologie politique.
D’après le chercheur Stéphane François : « Les positions scientifiques et rationnelles, au sein de l’écologie (en Allemagne, en Autriche ou en France par exemple), deviennent minoritaires, au profit de conceptions plus mystiques, ou du moins marquées par l’intuitivité, inspirées notamment des pratiques anthroposophiques, telles celles prônées par Pierre Rabhi. Une part de plus en plus importante des militants écologistes, surtout parmi les néoruraux, acceptent ces discours au nom d’un retour à la nature, largement idéalisé, et d’un rejet des solutions scientifiques ».
En bref, si la saga Avatar séduit par sa beauté visuelle et son appel à la préservation de la nature, elle véhicule aussi un mythe du « bon sauvage écologiste ». Ce dernier, loin d’honorer les peuples autochtones, les enferme dans une idéalisation néo-colonialiste dont il est urgent de se défaire.
Au-devant du dérèglement climatique qui réactive avec force ce vieux mythe rousseauiste, il semble utile de dépasser la figure simpliste du bon sauvage pour proposer des représentations plus complexes et respectueuses des réalités indigènes contemporaines. Ce n’est pas la première fois que l’Amazonie, la wilderness, ou la rencontre entre imaginaires civilisationnels et futur eschatologique, excitent et polarisent nos débats publics et pensées instinctives en Occident devant les ravages ineffables d’un certain capitalisme dérégulé.
Néanmoins, la figure moderne du héros « hyperindien », un sage ancestral capable avec ses pouvoirs de conjurer les maux des excès du capitalisme, semble promis à occuper une place importante dans les mythologies écologiques et le bon sens populaire du XXIe siècle.
Pierre Cilluffo Grimaldi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
27.12.2025 à 10:46
Cent ans après sa sortie, « Le Cuirassé Potemkine » d’Eisenstein continue de fasciner
Texte intégral (1577 mots)

S’il ne s’en tient que partiellement à la réalité des événements de cette mutinerie de 1905, « Le Cuirassé Potemkine » montre comment un film historique peut façonner la mémoire collective et le langage cinématographique.
Film phare du cinéma russe, Le Cuirassé Potemkine de Sergei Eisenstein a été présenté pour la première fois à Moscou le 24 décembre 1925. Mais les nombreux hommages rendus par les cinéastes tout au long du siècle qui a suivi démontrent s’il le fallait qu’il est toujours pertinent aujourd’hui. Qu’est-ce qui a donc fait de cette œuvre, connue pour sa manière audacieuse de traiter les événements historiques, l’un des films historiques les plus influents jamais réalisés ?
L’histoire de la réalisation du film apporte quelques éléments de réponse. Après le succès de son premier long-métrage en 1924, La Grève, Eisenstein fut chargé en mars 1925 de réaliser un film commémorant le 20e anniversaire de la révolution russe de 1905. Cette vaste révolte populaire, déclenchée par des conditions de travail déplorables et un profond mécontentement social, secoua l’Empire russe et constitua un défi direct à l’autocratie impériale. L’insurrection échoua, mais sa mémoire perdura.
Initialement intitulé L’Année 1905, le projet d’Eisenstein s’inscrivait dans un cycle national d’événements publics commémoratifs à travers toute l’Union soviétique. L’objectif était alors d’intégrer les épisodes progressistes de l’histoire russe d’avant la Révolution de 1917 – dans laquelle la grève générale de 1905 occupait une place centrale – au tissu de la nouvelle vie soviétique.
Le scénario original envisageait le film comme la dramatisation de dix épisodes historiques marquants, mais sans lien direct entre eux, survenus en 1905 : le massacre du Dimanche rouge et la mutinerie sur le cuirassé impérial Potemkine, entre autres.
Tourner la mutinerie, recréer l’histoire
Le tournage principal débuta à l’été 1925, mais rencontra peu de succès, ce qui poussa un Eisenstein de plus en plus frustré à déplacer l’équipe vers le port méridional d’Odessa. Il décida alors d’abandonner la structure épisodique du scénario initial pour recentrer le film sur un seul épisode.
La nouvelle histoire se concentrait exclusivement sur les événements de juin 1905, lorsque les marins du cuirassé Potemkine, alors amarré près d’Odessa, se révoltèrent contre leurs officiers après avoir reçu l’ordre de manger de la viande pourrie infestée de vers.
La mutinerie et les événements qui suivirent à Odessa devaient désormais être dramatisés en cinq actes. Les deux premiers actes et le cinquième, final, correspondaient aux faits historiques : la rébellion des marins et leur fuite réussie à travers la flotte des navires loyalistes.
Quant aux deux parties centrales du film, qui montrent la solidarité du peuple d’Odessa avec les mutins, elles furent entièrement réécrites et ne s’inspiraient que très librement des événements historiques. Et pourtant curieusement, cent ans après sa sortie, sa réputation de récit historique par excellence repose principalement sur ces deux actes. Comment expliquer ce paradoxe ?
La réponse se trouve peut-être dans les deux épisodes centraux eux-mêmes, et en particulier dans le quatrième, avec sa représentation poignante d’un massacre de civils désarmés – dont la célèbre scène du bébé dans une poussette incontrôlable, dévalant les marches – qui confèrent au film une forte résonance émotionnelle et lui donnent une assise morale.
De plus, bien que presque entièrement fictive, la célèbre séquence des escaliers d’Odessa intègre de nombreux thèmes, historiquement fondés, issus du scénario original, notamment l’antisémitisme généralisé et l’oppression exercée par les autorités tsaristes sur leur peuple.
Ces événements sont ensuite rendus de manière saisissante grâce à l’usage particulier du montage par Eisenstein, qui répète les images de la souffrance des innocents pour souligner la brutalité impersonnelle de l’oppresseur tsariste.
Le Cuirassé Potemkine peut être perçu comme une œuvre de mémoire collective, capable de provoquer et de diriger une réaction émotionnelle chez le spectateur, associant passé et présent pour les redéfinir d’une manière particulière. Mais, un siècle plus tard, la manière dont Eisenstein traite le passé, insistant pour établir un lien émotionnel avec le spectateur tout en recréant l’histoire, reste étroitement liée à nos propres façons de nous souvenir et de construire l’histoire.
Avec le recul de 2025, Le Cuirassé Potemkine, avec son idéalisme révolutionnaire et sa promesse d’une société meilleure, a perdu une grande part de son attrait, après la trahison de ces mêmes idéaux, des purges staliniennes des années 1930 jusqu’à la dévastation actuelle de l’Ukraine. Les spectateurs contemporains auraient besoin que le message originel du film soit revitalisé dans de nouveaux contextes, invitant à résister au pouvoir et à l’oppression, et à exprimer la solidarité avec les marginalisés et les opprimés.
Échos dans le cinéma moderne
Il n’est pas surprenant que le British Film Institute ait choisi cette année pour publier une version restaurée du film, car il a exercé une influence si profonde et omniprésente sur la culture visuelle occidentale que de nombreux spectateurs ne réalisent peut-être pas à quel point son langage est ancré dans le cinéma grand public.
Alfred Hitchcock a repris avec succès les techniques de montage frénétique et chaotique d’Eisenstein dans la scène de la douche de Psychose (1960), où l’horreur naît moins de ce qui est montré que de ce qui est suggéré par le montage. Il rend également un hommage explicite à Eisenstein lors du deuxième meurtre du film, qui se déroule sur l’escalier de la maison des Bates.
Ce schéma a ensuite été repris dans de nombreux films, notamment dans le Batman (1989) de Tim Burton avec le Joker interprété par Jack Nicholson. Nicholson lui-même avait déjà joué une confrontation violente sur un escalier dans Shining (1980) de Stanley Kubrick, tandis que Joker (2019) de Todd Phillips est devenu emblématique pour une séquence de danse controversée sur un escalier public.
L’Exorciste (1973) de William Friedkin semble lui aussi beaucoup devoir au style d’Eisenstein, avec deux morts qui se déroulent au bas de l’escalier désormais iconique de Georgetown. Brazil (1985) de Terry Gilliam fait lui aussi un clin d’œil parodique à Eisenstein, mais c’est Les Incorruptibles (1987) de Brian De Palma qui constitue l’hommage le plus explicite à la séquence des escaliers d’Odessa, notamment avec la scène du bébé dans la poussette incontrôlable, plaçant ainsi l’influence d’Eisenstein au cœur du cinéma hollywoodien contemporain.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
