22.01.2026 à 12:06
Rapport – « Petites entreprises en péril : à qui la faute ? »
Introduction : l’échec d’une politique obsédée par la baisse des cotisations
Septembre 2025 : l’Union des entreprises de proximité (U2P) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) repoussent la proposition d’un grand rassemblement patronal unitaire contre la taxe Zucman faite par le Mouvement des entreprises de France (Medef). L’événement fait date. Les petits patrons refusent de s’aligner derrière les gros et le font savoir. Les deux organisations patronales des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) révèlent les clivages qui parcourent l’ensemble « patronat » prétendument homogène.
Dans les médias et sur les bancs de l’Assemblée nationale, les libéraux sont pourtant bien habitués à mettre en scène l’harmonie du patronat. Les chefs d’entreprises formeraient une grande communauté productive, fédérée par « l’esprit d’entreprise » et réunie derrière des revendications communes. À les entendre, les patrons seraient tous dans le même bateau : assaillis par des politiques publiques qui enserrent l’économie, menant avec courage leur activité contre ceux qui réglementent, taxent la réussite, brident le libre-échange… En 1998, le Conseil national du patronat français (CNPF) devient le Mouvement des entreprises de France (Medef). Les mots « patrons » et « patronat » disparaissent ainsi, au profit des mots « entreprise » et « entrepreneurs ». Qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas un changement cosmétique. Au contraire, cela s’inscrit dans une montée en puissance du discours « pro-entreprise », grâce auquel le Medef a réussi à gommer artificiellement les différences internes à la catégorie « patron ».
Cette entente d’apparence a été mise depuis près d’un demi-siècle au service d’une revendication du grand patronat : payer « toujours moins »[1] de cotisations sociales, d’impôts, de salaires. En 1982, quelques mois après la victoire du programme commun de la gauche, l’ancêtre du Medef impose déjà le thème de « réduction des charges » devant 25 000 patrons réunis pour les « états généraux de l’entreprise » à Villepinte[2]. 44 ans plus tard, ils peuvent se prévaloir d’avoir largement gagné : l’État leur fait désormais cadeau de 211 milliards d’euros par an, selon un récent rapport d’une commission d’enquête sénatoriale[3], principalement en niches fiscales et allègements de cotisations sociales. Et nous, nous pouvons nous prévaloir d’un recul historique. Au bout de près d’un demi-siècle, la situation économique de la France, son appauvrissement relatif, sa désindustrialisation, sa perte de souveraineté, ou l’augmentation du taux de pauvreté sont là pour témoigner de l’échec factuel de cette politique économique. Dans ce rapport, nous allons voir que l’obsession monomaniaque de la baisse du « coût du travail » imposée par le grand patronat n’a pas non plus profité au tissu divers des petites et moyennes entreprises, ni à leurs dirigeants.
Car au nom de quoi les patrons parleraient-ils d’une même voix ? Cela ne colle pas avec la réalité du tissu productif. Les TPE et les PME, que nous regrouperons sous le terme de « petites entreprises », n’ont rien en commun avec les multinationales. Un artisan boulanger, un artisan du bâtiment engagé dans la rénovation thermique, un dirigeant d’une TPE de services informatiques et numériques ou encore un fabricant de pièces détachées vendues en France, ne partagent pas la même condition, ni les mêmes besoins, que Bernard Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH, dont les sacs Louis Vuitton se vendent aux ménages fortunés des quatre coins du monde. On ne parle pas de la même chose. Bien sûr, les petites entreprises ne forment pas un groupe homogène. Une PME franchisée n’est pas la même chose qu’une PME sous-traitante dont l’activité dépend essentiellement d’un grand groupe, et toutes deux n’ont rien à voir avec une PME indépendante, familiale par exemple. Mais il n’en demeure pas moins que la domination des grandes entreprises les rapproche et marque une démarcation claire. Et il ne s’agit pas uniquement d’une question quantitative d’effectifs salariés ou de chiffre d’affaires[4]. La question économique fondamentale se trouve ailleurs : pour qui l’entreprise produit-elle, sur quel marché se situe-t-elle et à qui appartient le capital ? C’est ici précisément que se loge la divergence de fond qui divise le tissu économique productif entre les grandes entreprises d’un côté et les petites de l’autre.
Les grandes entreprises françaises travaillent pour l’international. Elles sont tournées vers les consommateurs et les marchés de toute la planète. Les parts de marché de quelques-unes des entreprises françaises du CAC 40 en témoignent clairement. LVMH réalise plus de 90 % de son chiffre d’affaires hors de France. Kering, groupe de luxe concurrent fondé par le milliardaire François Pinault, en réalise plus des deux tiers en dehors de l’Europe de l’Ouest. Hermès, autre groupe de luxe, fait 9 % seulement de son chiffre d’affaires en France. Pour L’Oréal, grand groupe de cosmétique, c’est encore moins : 7,3 % de son chiffre d’affaires en France. Toutes ces entreprises sont en concurrence avec d’autres groupes mondiaux pour se partager le monde et conquérir de nouvelles parts de marché.
Elles doivent verser des dividendes toujours plus élevés à leurs actionnaires. Elles sont de ce fait irrémédiablement prises dans une course sans fin pour augmenter la part des bénéfices reversés en dividendes. Ainsi, les fonds d’investissement exigent désormais très fréquemment des taux de rentabilité au-delà de 15 %[5].
C’est pourquoi leurs dirigeants réclament de déréguler, de diminuer les salaires et les cotisations sociales, de baisser les impôts. Il leur faut pouvoir s’aligner sur les niveaux les plus bas en vigueur dans le monde. Cela explique leur agressivité et le chantage à la délocalisation auquel ils se prêtent régulièrement. Car telle est la réalité des grandes entreprises : le marché mondial est leur terrain de jeu et l’augmentation de la rentabilité du capital est leur principal objectif.
Les TPE et les PME travaillent quant à elles d’abord pour la demande de leur pays. Leur production est tournée, exclusivement ou en priorité, vers le marché national et les réseaux économiques de proximité. Elles vivent de la consommation domestique. D’abord, la consommation de la population résidente, qui œuvre quotidiennement à la satisfaction de ses besoins. Mais cela inclut également la consommation des administrations publiques, qui emploient une personne sur cinq dans le pays ; l’investissement public, destiné à améliorer les conditions d’existence de la collectivité ; et la consommation des entreprises, qui s’achètent les unes aux autres les matériaux et les services nécessaires pour mener à bien la production. Les petites entreprises ont donc, elles, intérêt à ce que le pouvoir d’achat et les investissements publics soient les plus élevés possible. Leur activité dépend directement de la demande globale nationale. Elles ne peuvent pas partir. La délocalisation n’est pas une alternative : si leur activité tourne au ralenti car la consommation est insuffisante, elles ferment. Cela change tout.
Les petites entreprises et les grandes n’étant pas positionnées sur le même marché, les intérêts économiques des premières entrent en contradiction directe avec le patronat et les actionnaires des secondes. L’idée d’un « ruissellement » économique des grandes vers les petites entreprises qui s’adressent à la demande locale est par nature impossible. Il n’y a pas non plus de développement mutuellement profitable entre les grands donneurs d’ordres et leurs sous-traitants. Les intérêts des premiers ne sont pas alignés sur ceux des seconds. Conséquence : ce que les grands patrons exigent nuit fatalement à l’activité des petits.
Les accords de libre-échange sont le parfait exemple du modèle de développement inégal non combiné des deux types de producteurs. C’est une aubaine pour les grands groupes, à qui ils ouvrent de nouveaux marchés. Mais à l’inverse c’est une menace considérable pour les TPE et les PME. Elles subissent de plein fouet les délocalisations de grands groupes dont elles étaient les fournisseuses et se retrouvent exposées à l’importation de marchandises étrangères bon marché et moins-disantes socialement et écologiquement.
Enfin, la propriété et la rémunération du capital dans les petites entreprises n’ont rien à voir avec celles des grandes entreprises : la rémunération d’un chef de petite entreprise, à hauteur d’un revenu à peu près convenable pour vivre, n’a rien à voir avec le versement de dividendes à des fonds d’investissement ou des grandes fortunes à des taux de rentabilité extrêmement élevés. Dès lors, leurs intérêts sont fondamentalement différents : la taxe Zucman est un « immense problème » pour Bernard Arnault, absolument pas pour l’artisan boulanger ou l’agriculteur.
Pour autant, ne nous trompons pas : l’économie française a aussi besoin de grandes entreprises. Leur utilité pour construire une économie des besoins, pour renforcer notre souveraineté et nous porter aux nouvelles frontières de l’Humanité est réelle. Ce qui est en cause n’est pas la structure « grande entreprise » en tant que telle. C’est bien, d’une part, la volonté d’une toute petite partie du patronat, souvent à la tête d’entreprises multinationales, et plus souvent encore de rentes, d’aligner tous les chefs d’entreprises, et par eux, d’aligner toute l’économie française sur leurs revendications de démantèlement de l’État social et de marchandisation intégrale.
Depuis plusieurs dizaines d’années, et en particulier depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron, les politiques économiques menées en France sont taillées sur mesure pour répondre aux besoins des dividendes d’une minorité de multinationales, contre les besoins de l’écrasante majorité du tissu productif. Libéralisation mondiale des échanges, déréglementation, abaissement de la fiscalité sur le capital, réformes du code du travail, aides sans contreparties captées par les grands groupes… Cette politique de l’offre débridée met l’État au service d’une fraction infime du marché : quelque 300 grandes entreprises françaises ainsi qu’une poignée de multinationales étrangères qui parviennent à avoir l’oreille du pouvoir grâce aux efforts du Medef et de l’Association française des entreprises privées (AFEP)[6]. Et bien sûr, cela porte ses fruits : les marges dégagées par ces entreprises sont à deux chiffres, les dividendes versés aux actionnaires explosent. On peut résumer en disant que leur but est le dividende et non la production.
Les 4,5 millions de TPE et de PME, qui créent pourtant 40 % de la valeur de ce qui est produit chaque année, voient dans le même temps leurs besoins ignorés. Nombre d’entre elles disparaissent silencieusement, englouties par le chaos du marché. Les autres résistent tant bien que mal, mais elles sont étranglées par les difficultés matérielles qui s’accumulent et ne pourront pas être supportées bien longtemps. L’Union européenne ne se soucie pas du poids de la concurrence déloyale sur leur activité. Les politiques budgétaires austéritaires ignorent leur dépendance à la consommation populaire. Le secteur bancaire méprise la fragilité de leur trésorerie et leurs difficultés d’accès au financement. Les grandes entreprises qui dominent le marché, notamment celles qui contrôlent les réseaux d’énergie ou les propriétaires immobiliers, se gavent sur leur dos. C’est ce qui explique, avec les faiblesses inhérentes à l’auto-entreprenariat, que la France connaisse aujourd’hui un record de défaillances d’entreprises.
Ainsi, en cessant d’appréhender le patronat comme un bloc homogène, il est possible d’envisager une politique de progrès social et humain soutenue par une convergence incluant les salariés et d’autres composantes populaires, mais aussi les dirigeants de petites entreprises. Relocalisation et dé-précarisation, augmentation des salaires et carnets de commandes, planification et stabilité peuvent aller de pair. Ceci a une condition : arrêter d’orienter toutes les politiques économiques au profit exclusif des grands groupes multinationaux, distinguer les deux niveaux de production dans les décisions publiques.
La situation est urgente. Ce rapport est une première contribution du département d’économie de l’Institut La Boétie pour sonner l’alerte et proposer une autre organisation de l’économie, sur la base d’un pacte productif de l’État avec les petites entreprises. Il se veut une base de discussion avec leurs chefs d’entreprise et leurs salariés. Il dresse un tableau précis des dynamiques qui détruisent le tissu productif aujourd’hui. Il passe en revue les difficultés matérielles réelles que rencontrent quotidiennement les petits patrons et qui leur rendent la vie impossible. Sur ce fondement, le rapport propose une série de préconisations et de pistes de transformation pour protéger les petites entreprises des mains dévastatrices du tout marché et élaborer avec elles un pacte productif.
Les TPE et les PME sont des unités de production de proximité non délocalisables qui font vivre le pays et réunissent des qualifications précieuses. Elles sont des alliées incontournables dans la construction d’un autre modèle : l’économie des besoins.
1- Les petites entreprises disparaissent dans l’inaction gouvernementale
De quoi parle-t-on ? Anatomie du tissu productif français
Les petites entreprises au cœur de l’économie de proximité
L’immense majorité des entreprises françaises comptent moins de 10 personnes. Elles sont 4,3 millions au total[7]. L’Insee les regroupe dans la catégorie de « micro-entreprises ». C’est une catégorie statistique, qui inclut en fait des situations très diverses. Toutes ne concernent pas des activités productives[8]. Deux points essentiels sont à retenir.
1- Près d’une micro-entreprise sur trois est un auto-entrepreneur, soit deux fois plus qu’il y a dix ans[9]. Leur statut s’inscrit dans les dynamiques de démantèlement du droit du travail en cours et renvoie à une forme de surexploitation du travail. Dans la pratique, les auto-entrepreneurs sont souvent excessivement subordonnés à des donneurs d’ordre. Dans certains secteurs économiques, ils accomplissent les activités que des entreprises plus grandes leur délèguent au lieu de les internaliser en les confiant à un salarié. Dans d’autres, ils sont sous la coupe d’une plateforme numérique qui organise leur travail par le biais d’un algorithme de mise en relation : c’est le cas des travailleurs « ubérisés », livreurs et chauffeurs VTC… Le statut d’auto-entrepreneur, mis en place par Nicolas Sarkozy, est alors le cheval de Troie du libéralisme pour démanteler le code et les droits du travail attachés au salariat. L’auto-entrepreneur est juridiquement responsable de ses actes. En cas d’accident du travail, il n’est pas protégé et ne reçoit aucune indemnité. Il ne cotise pas non plus à l’assurance chômage : si du jour au lendemain les entreprises qui le font vivre rompent les relations de travail, il se retrouve sans activité et sans revenus. Quant à ses droits à la retraite, ils dépendent du chiffre d’affaires généré par son activité ! Les auto-entrepreneurs sont donc souvent de faux indépendants soumis à une pression financière permanente et au travail à la tâche. Pour « joindre les deux bouts », ils sont un tiers à cumuler leur activité avec une activité salariée. En moyenne, leur revenu mensuel ne dépasse pas 670 euros.
2- Près d’une micro-entreprise sur trois est une très petite entreprise (TPE) qui emploie entre 1 et 9 salariés. Parmi elles, 40 % ne comptent qu’un seul salarié, à temps partiel ou à temps plein. Elles embauchent au total près de 2,6 millions de salariés en équivalent temps plein[10].
Les TPE prédominent dans les services marchands (services aux entreprises, prestation d’entretien du jardin de son domicile, assistance informatique…), l’artisanat, le commerce de détail, l’hôtellerie, la restauration, la construction[11]. Elles forment ainsi le socle d’une économie de proximité tournée vers les besoins de la population, là où elle vit : on achète son pain à la boulangerie de son quartier, on fait rapiécer ses chaussures par le cordonnier de sa commune, on mange au restaurant, on passe son permis dans l’auto-école près de chez soi, on fait des travaux de rénovation dans son logement… Autant d’activités qui ne peuvent par définition pas être délocalisées puisqu’elles répondent aux besoins humains quotidiens des habitants. Elles sont de ce fait exclusivement dépendantes de la consommation locale.
La France compte également 160 000 petites et moyennes entreprises (PME), qui emploient entre 10 et 250 salariés. La majorité se compose d’unités de production de petite taille : 6 PME sur 10 comptent moins de 20 salariés dans leurs rangs[12]. Elles embauchent 4,3 millions de personnes à temps plein[13]. Elles forment elles aussi les réseaux économiques de proximité grâce auxquels la population vit. 70 % des PME n’exportent pas, la plupart d’entre elles tout simplement parce que cela n’a pas de sens et que leur activité n’est pas concernée[14]. L’activité des PME se concentre ainsi dans les services marchands, le commerce de détail et la construction. Une partie des PME est également intégrée à la chaîne de valeur de l’industrie française : au total, 17 % de la valeur ajoutée créée par les 160 000 PME du pays est liée au secteur industriel[15]. Elles participent à la production comme sous-traitantes de grands groupes, qui leur délèguent tel ou tel compartiment de la production.
Encadré – L’économie sociale et solidaire dans le tissu productif À côté du secteur marchand conventionnel, il existe un pan transversal de l’économie : l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle pèse pourtant 14 % de l’emploi privé, soit 2,4 millions de salariés. Et elle crée au total un peu plus de 10 % de la richesse nationale chaque année[16]. L’ESS participe d’une logique économique au service de la satisfaction des besoins, en rupture avec la marchandisation lucrative généralisée. Il s’agit de faire primer le partage équitable des richesses créées, de privilégier leur réinvestissement en faveur de l’activité et d’organiser une gestion démocratique des ressources, selon des formes diverses. Les petits et les gros dans l’ESS L’ESS réunit des structures très hétérogènes, appartenant à différents secteurs économiques et ne partageant pas forcément la même finalité. Qu’on ne s’y trompe pas, malgré les principes économiques qui la structurent, elle est traversée par la même dichotomie que le reste de l’économie : des petites structures coexistent avec des grands groupes, et leurs intérêts divergent fondamentalement. D’un côté, il y a les géants. Les groupes de la grande distribution Leclerc et Super U ont par exemple le statut de coopérative. L’ESS compte aussi dans le secteur assurantiel et bancaire des mutuelles géantes dont les activités sont alignées sur les stratégies du grand capital. Le groupe VYV, qui rassemble les grandes mutuelles santé, alimente la concentration de l’économie en rachetant les mutuelles de plus petite taille. De la même façon, la banque mutualiste Crédit Mutuel participe à la financiarisation de l’économie et s’est révélée il y a quelques années maître dans l’art de l’évasion fiscale. De l’autre côté, il y a des petites structures. Plus de 80 % sont des associations, qui se répartissent entre le secteur non-marchand et le secteur marchand, où la production de biens et de services est destinée à la vente sur le marché. On compte également des coopératives de production de petite taille, des fondations et des sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire (SCESS)[17], œuvrant pour l’essentiel dans le secteur marchand. Autrement dit, il n’y a pas lieu d’idéaliser l’ESS. Ses cadres juridiques sont parfois flous, intégrant certains acteurs qui n’ont rien à y faire en l’état. Mais les cas emblématiques des grands groupes en phase avec le néolibéralisme ne doivent pas masquer le fait que l’écrasante majorité des structures de l’ESS partagent avec les TPE et PME du secteur marchand conventionnel une condition commune : ce sont de très petites structures dont l’activité est insérée dans les réseaux économiques de proximité non délocalisables. Les trois quarts des 4 500 SCESS du pays sont aujourd’hui de très petites entreprises, qui emploient moins de 10 salariés[18]. Leur activité se concentre dans le service aux entreprises (comptables, services juridiques, nettoyage, entretien des espaces verts…), le commerce, l’industrie et la construction[19]. De la même façon, les trois quarts des 22 000 entreprises coopératives sont des TPE[20]. Dans l’agriculture, la proportion est encore plus forte : 93 % des coopératives sont des TPE ou PME[21]. Leur production est directement tournée vers les besoins de la population, puisqu’elles sont très implantées dans le commerce de détail, l’agriculture et le secteur bancaire. Les petites entreprises de l’ESS en plein développement ? Les entreprises coopératives connaissent un essor durable et soutenu. Leur chiffre d’affaires total a augmenté de près d’un tiers entre 2012 et 2022[22]. Entre 2020 et 2022, elles ont gagné plus de 4 000 emplois[23]. Et la dynamique pourrait se poursuivre puisque le modèle coopératif a aujourd’hui le vent en poupe à l’heure où la population est épuisée par le chaos du marché et par les effets désastreux provoqués par la dépossession du tissu productif. La reprise fructueuse en société coopérative et participative (Scop) de la verrerie Duralex à l’été 2024 a marqué les esprits. Plus récemment, le refus du tribunal de commerce de Nanterre de considérer le projet de reprise par les salariés du groupe d’électroménager Brandt a suscité des réactions indignées. Dans les dix prochaines années, entre 250 000 et 750 000 entreprises devront être cédées en raison du départ à la retraite de leur dirigeant[24] : c’est une opportunité sans précédent de favoriser la reprise par les salariés eux-mêmes de ces TPE et PME essentielles à la satisfaction des besoins de la collectivité. C’est l’occasion pour le gouvernement de mettre en place avec eux le système global que ces nouvelles entreprises constitueront et d’organiser leurs libres relations avec les objectifs du plan |
Les petites entreprises sont le premier employeur du pays
Les TPE et les PME cumulent près de 7 millions d’emplois salariés à temps plein[25].
Dans le secteur privé marchand, un emploi salarié sur deux se trouve dans une petite entreprise[26] ! C’est beaucoup moins pour les grandes entreprises, qui pèsent pour moins d’un tiers du salariat du secteur privé, avec 4,2 millions de salariés. Les entreprises de taille intermédiaire cumulent elles 3,5 millions d’emplois à temps plein.
Rapportées à l’emploi total, c’est-à-dire en incluant le secteur public, le secteur non-marchand et les emplois non salariés, les petites entreprises sont aussi le premier vivier d’emplois. Elles représentent environ un emploi sur quatre dans le pays. Vient en deuxième position le secteur public, qui représente 20 % de l’emploi total en France, soit 5,8 millions de personnes.
Non seulement les petites entreprises sont les premiers effectifs salariés du pays, mais ce sont elles qui embauchent le plus ! Elles créent plus d’emplois qu’elles n’en détruisent. Entre 2009 et 2020, elles ont un solde positif moyen de 60 000 emplois créés chaque année : 33 000 dans les TPE et 27 000 dans les PME[27]. Soit près de 700 000 au total. C’est l’inverse pour les grandes entreprises, qui détruisent au total plus d’emplois qu’elles n’en créent : elles ont supprimé 17 000 emplois par an en moyenne entre 2009 et 2020[28], soit 200 000 au total. Autrement dit, ce sont les entreprises de proximité qui compensent en partie les délocalisations des multinationales et leurs effets désastreux sur l’emploi.
Un niveau record de petites entreprises surendettées
Une entreprise est en cessation de paiement lorsqu’elle est surendettée. Elle ne dispose plus alors des fonds nécessaires pour faire face à ses obligations financières : le paiement de ses fournisseurs, le remboursement de ses dettes, le versement des salaires… Elle doit alors déclarer sa situation pour qu’une procédure judiciaire soit engagée : on appelle cela déposer le bilan, et l’entreprise est alors en défaillance.
Depuis quelques années, le nombre de défaillances est en augmentation continue. Au total, près de 70 000 entreprises ont déposé le bilan en 2025. Cela représente 260 000 emplois menacés. C’est un record historique, qui fait suite à un précédent record un an auparavant. Et il ne s’agit pas uniquement d’un simple « retour à la normale » après la période Covid, ou d’un « rattrapage » lié au remboursement du prêt garanti par l’État (PGE)[29]. Le niveau actuel de défaillances est largement supérieur au niveau moyen avant 2019 : entre 2010 et 2019, en moyenne 59 000 entreprises étaient en défaillance chaque année[30]. Mais ce n’est pas tout : 70 000 défaillances en 2025, c’est aussi beaucoup plus qu’après la grave crise financière mondiale de 2008, qui a touché l’économie mondiale. À l’époque, le nombre de dépôts de bilan avait explosé, mais il n’avait pas dépassé les 63 000 sur l’année[31].
Le risque de défaillance ne touche pas tout le monde de la même manière. Les petites entreprises ont par définition une trésorerie plus fragile et vulnérable au moindre imprévu. Mécaniquement, elles sont davantage exposées au surendettement.
94 % des défaillances concernent une entreprise de moins de dix personnes, incluant les auto-entrepreneurs[32]. Les activités essentielles pour la vie quotidienne, au cœur de l’économie de proximité, sont les plus touchées. 4 défaillances sur 10 concernent un commerce ou une entreprise de la construction[33]. Les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration connaissent également une hausse préoccupante du nombre de défaillances : entre janvier et août 2025, 9 000 restaurateurs ou hôteliers ont mis la clé sous la porte, soit 30 % de plus qu’avant le Covid !
Les PME sont elles aussi de plus en plus concernées, de même que les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Entre 2019 et 2024, le nombre d’entreprises de plus de 10 salariés qui ont déposé le bilan a augmenté de 50 %. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, les entreprises naissantes ne sont pas les plus touchées : la hausse des défaillances a davantage concerné les entreprises implantées de longue date, ayant 6 à 10 ans d’ancienneté[34]. C’est donc bien tout le secteur productif de proximité qui est en proie à une crise profonde.
La situation est encore plus critique puisqu’il faut ajouter aux défaillances d’entreprises les cessations d’activité volontaires. Car toutes les entreprises dans l’embarras financier ne vont pas jusqu’au dépôt de bilan. Certains patrons interrompent d’eux-mêmes leur activité parce qu’ils anticipent leur surendettement et n’ont aucune visibilité sur leurs résultats à venir : la cessation d’activité s’envole. En 2022, près de 180 000 entreprises ont mis un terme volontairement à leur activité[35]. C’est 60 000 de plus qu’en 2019. C’est plus de deux fois davantage que le nombre de défaillances. Les petites entreprises sont, là encore, quasiment les seules concernées : 90 % des cessations d’activités volontaires concernent des très petites entreprises qui emploient moins de six salariés[36].
Le régime de garantie des salaires (AGS), qui prend le relais financier des entreprises en dépôt de bilan, a versé le plus grand montant de son histoire : 2,3 milliards d’euros de retards de salaires et d’indemnités de licenciement distribués à plus de 212 000 salariés[37].En 2025, 85 % des dossiers gérés par l’AGS concernaient de très petites unités de production de moins de dix salariés.
La majorité des défaillances d’entreprises se font en silence. Seuls les cas de figure emblématiques, qui concernent les entreprises les plus grandes, sont couverts par la presse. Les autres se font dans l’indifférence médiatique. Pour les petits patrons et les salariés concernés, c’est le désastre : on perd son emploi, la stabilité qui va avec et les revenus pour vivre. Mais c’est aussi une situation malheureuse pour les clients : on perd parfois le commerce à deux pas de chez soi, dont on connaissait le gérant et où les prix étaient abordables ; il faudra désormais prendre la voiture ou les transports communs pour trouver une offre équivalente, peut-être plus chère.
Pourtant, rien n’est fait pour stopper l’hémorragie. Les aides publiques n’ont pas été orientées vers les entreprises de petite taille ou vers les secteurs économiques les plus touchés. Or, il n’est pas forcément dans l’intérêt des pouvoirs publics d’aider toutes les entreprises, de tous les secteurs sans discrimination liée aux priorités de politiques publiques. Aucune mesure n’a été adoptée pour rationaliser et épurer dans le temps certaines dettes. Les factures d’électricité des petites entreprises ont explosé, sans que l’État n’accepte d’imposer le blocage des prix de l’énergie.
Encadré – La paupérisation des chefs de petites entreprises Les petites entreprises sont nombreuses à avoir des difficultés de trésorerie. Pour ne pas aggraver la situation et éviter le surendettement, les chefs de petites entreprises rognent parfois sur leur propre rémunération. 50 % des dirigeants de TPE qui se rémunèrent en se versant exclusivement un salaire, et pas des dividendes, gagnent moins que le revenu minimum[38]. Ils touchent moins de 15 000 euros net par an, soit 1 250 euros par mois. Étant donné qu’ils sont nombreux à travailler plus que 35 heures par semaine, leur salaire horaire est très faible. Autrement dit, la dégradation du tissu productif a atteint un niveau tel qu’une grande partie des chefs de petites entreprises ne sont tout simplement plus en mesure de vivre dignement de leur activité. Pour les dirigeants d’entreprise qui viennent de lancer leur activité, la crainte de l’avenir conduit à ne pas se payer du tout, ou alors très peu. Pour faire des économies, certains anciennement au chômage décident de ne pas se verser de salaire et de vivre uniquement de l’aide au retour à l’emploi (ARE), qu’ils continuent de percevoir un temps après la création de leur entreprise[39]. Sachant que le montant de l’ARE est calculé sur la base du précédent salaire, cela équivaut parfois à de maigres revenus. Plus généralement, un dirigeant de TPE qui vient à peine de se lancer touche en moyenne 11 000 euros à l’année sur les dix-huit premiers mois[40], soit moins de 1 000 euros par mois. |
Focus sur les PME industrielles, premières victimes de la désindustrialisation des grands groupes
1975 marque l’apogée de l’industrie française. Depuis, la désindustrialisation s’est amorcée[41], et elle a été particulièrement brutale. En l’espace de cinquante ans, la part de l’industrie dans la valeur ajoutée totale est passée de 25 % à son maximum à moins de 10 % aujourd’hui[42]. Les conséquences sur le niveau de l’emploi industriel sont terribles. Il a été divisé par plus de deux, passant de plus de 5,3 millions de postes en 1975 à un peu plus de 2,5 millions aujourd’hui[43]. C’est là un niveau historiquement bas. Au total, plus de deux millions d’emplois ont ainsi été détruits.
La désindustrialisation se poursuit. En 2025, la France a continué à perdre ses fleurons industriels. Les fermetures de sites font régulièrement les gros titres dans la presse tout au long des douze derniers mois. Rien qu’entre septembre et début de décembre 2025, 165 sites industriels ont été touchés par une fermeture, une réduction d’effectifs ou bien une menace sur l’emploi[44]. C’est près de 50 % de plus par rapport à l’année précédente. L’ampleur de la crise industrielle atteint des sommets. Pour la première fois depuis plus de dix ans, la France a fermé plus de sites industriels qu’elle n’en a ouverts sur deux semestres consécutifs[45]. Au cours des dix-huit derniers mois, la CGT estime qu’entre 200 000 et 300 000 emplois industriels directs et indirects (chez les prestataires industriels) et emplois induits ont été menacés de suppression ou supprimés[46].
Ces fermetures ont des conséquences en cascade sur toute la chaîne de production et en particulier sur les petites entreprises sous-traitantes et fournisseuses. Elles sont les premières victimes du démantèlement de l’industrie parce qu’elles composent l’essentiel du tissu industriel d’exécution des commandes. On recense ainsi 225 000 TPE industrielles, incluant un nombre important d’auto-entrepreneurs. Et près de 25 000 PME industrielles. Au total, cela représente 1 million d’emplois[47].
Les décisions des grandes entreprises ont en cascade une série de conséquences désastreuses. Quand un donneur d’ordre délocalise, tout s’effondre du jour au lendemain pour les TPE et PME sous-traitantes. Le carnet de commandes se vide et il est souvent très difficile de trouver de nouveaux débouchés. Le surendettement arrive vite. Dès lors, c’est la survie de l’entreprise qui se retrouve menacée, et avec elle le sort des salariés et toute l’activité d’une zone géographique.
La crise de l’industrie automobile illustre tristement la situation. En délocalisant leurs usines d’assemblage en Europe de l’Est, en Espagne ou en Turquie, les constructeurs français Renault et Stellantis ont imposé de fait des suppressions d’emplois drastiques chez les équipementiers. Parmi les exemples les plus médiatisés, MA France, Valeo, la Fonderie de Bretagne… Mais d’autres équipementiers de plus petite taille et de rangs plus éloignés ont également été touchés. Les constructeurs automobiles ont pour terrain de jeu le marché mondial. Ils ne se soucient pas de l’état de la filière automobile française et de ses petites entreprises. C’est ainsi que la presse a récemment révélé que Renault pourrait finalement faire appel à un équipementier chinois pour ses moteurs électriques en lieu et place du français Valeo[48].
Focus sur le petit commerce : le capitalisme rase tout
La presse régionale n’en finit pas de tirer la sonnette d’alarme : les villes se vident de leurs petits commerces. Le nombre de locaux commerciaux vacants a été multiplié par deux en vingt ans[49]. Dans certaines communes, 20 à 25 % des commerces ont baissé le rideau, laissant en héritage des devantures murées ou saturées de publicités sauvages. Les petites entreprises et les habitants sont les grandes victimes conjointes de cette épidémie de fermetures. Commerces indépendants, magasins alimentaires, enseignes d’habillement, restaurants, services divers et variés : c’est toute une économie diversifiée, composée de petites unités implantées au cœur des lieux de vie, qui est en train de disparaître.
Pourtant, les besoins demeurent. Ils augmentent même naturellement avec le temps. Les êtres humains continuent de se nourrir, de se vêtir, de prendre soin d’eux et de leurs proches, de s’occuper de leur lieu de vie… Depuis plusieurs décennies, les réseaux économiques de proximité sont tendanciellement remplacés par de nouveaux flux économiques, qui s’appuient sur des grandes entreprises et dont la coordination se déploie à une échelle bien plus grande.
L’étalement urbain contre les petits commerces alimentaires
La deuxième moitié du siècle dernier marque le triomphe d’un nouveau mode d’urbanisation : l’étalement urbain. Les villes s’étirent considérablement vers leurs périphéries. La communauté humaine réorganise en profondeur son implantation dans l’espace.
Dans cette période, les premiers supermarchés et hypermarchés apparaissent, inspirés des pratiques du capitalisme états-unien. D’immenses parkings sont construits pour accueillir les consommateurs venus de leur domicile en automobile. Les grandes surfaces concentrent en un même lieu et en quantités abondantes à peu près tous les produits alimentaires et non alimentaires dont la population a besoin. Grâce aux économies d’échelle réalisées, les prix défient toute concurrence. Elles sont approvisionnées par une industrie agro-alimentaire en plein développement. En quelques années, l’économie est reconfigurée, de la production jusqu’à la distribution : les gros producteurs triomphent des petits, et les grandes surfaces supplantent en bonne partie les petits commerces. Dans les années qui suivent, de nouvelles grandes enseignes spécialisées viennent s’agglomérer autour d’elles : c’est la naissance des zones commerciales. Hideuses dans la plupart des cas, défigurant les entrées de ville, elles génèrent des flux routiers et des habitudes de vie qui désertifient et déshumanisent l’espace urbain où vivent les gens.
Une nouvelle carte des lieux de consommation est ainsi dessinée par le capitalisme. Les commerces sont plus éloignés des lieux de vie. Les pratiques de la population sont ajustées en conséquence. En 1974, on allait faire ses courses à pied dans 53 % des cas. 35 ans plus tard, c’est 17 % seulement[50] ! Une grande partie de la population vit désormais « loin de tout ». Elle est dépendante de la voiture pour aller faire ses courses dans les deux tiers des cas[51], pour un temps de trajet trois fois plus long qu’en 1974 (15 minutes contre 5 minutes)[52].
La concentration des nouveaux réseaux privés de distribution alimentaire conduit inévitablement à l’émergence de « déserts alimentaires » : des aires d’habitation ne disposant d’aucun commerce alimentaire à proximité, ou alors uniquement d’une offre alimentaire lacunaire, souvent de mauvaise qualité et donc dangereuse pour la santé[53]. En 2025, deux communes rurales sur trois n’ont aucun commerce alimentaire[54]. C’est plus de deux fois plus qu’il y a cinquante ans !
Les communes rurales sont loin d’être les seules concernées par les inégalités d’accès à l’alimentation. Ce sont les mondes populaires dans leur ensemble qui sont touchés : les communes urbaines populaires n’échappent ainsi pas au processus de désertification. En Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, le nord d’Aulnay-sous-Bois, le nord de Bondy, Dugny, Noisy-le-Sec, ou encore Tremblay-en-France, sont considérés comme des déserts alimentaires par les autorités[55] : ces communes sont enclavées et l’offre alimentaire y est rare et de faible qualité.
Commerce en ligne : le capitalisme numérique contre les petites entreprises commerçantes
Depuis quelques années, les petits commerçants sont confrontés à une nouvelle menace supplémentaire : l’essor du commerce en ligne, qui représente une concurrence déloyale impitoyable. Plus besoin d’aller en boutique : tout peut être acheté directement depuis son smartphone en un clic à n’importe quelle heure du jour comme de la nuit, et livré à domicile en l’espace de quelques heures. Amazon, eBay, AliExpress, Shein, Temu : une poignée de multinationales états-uniennes et chinoises se partagent le monde. Leur situation de monopole leur permet d’imposer des pratiques prédatrices sur leurs clients. Elles prélèvent un tribut sur l’ensemble des marchandises vendues – par d’autres – sur leur plateforme. Elles suscitent de nouveaux besoins d’achats grâce à des algorithmes qui analysent la masse des comportements en ligne pour mieux les anticiper. Amazon crée ainsi un magasin sur mesure pour chaque client à chaque usage de la plateforme[56].
L’explosion du commerce en ligne s’inscrit dans une transformation plus large du capitalisme mondial : la révolution logistique. La circulation des marchandises est désormais au cœur même du capitalisme et de la création de richesses[57]. En quelques décennies, les processus de production se sont globalisés et externalisés. La fabrication d’un même objet se fait à différents endroits de la planète, là où cela coûte le moins cher, et fait intervenir plusieurs unités de production sous-traitantes. Les infrastructures logistiques deviennent dès lors des réseaux essentiels pour stocker les marchandises, les transporter d’un entrepôt à un autre et assurer la connexion entre les différentes étapes de la production, puis de la distribution.
Avec la complicité des gouvernements successifs, les plateformes se sont installées sans encombre sur le sol français. Elles ont construit de gigantesques entrepôts de stockage pour amener le produit au plus près du consommateur et l’expédier en un temps record. Elles ont pour cela bénéficié d’une distorsion de concurrence fiscale et réglementaire majeure[58]. Comme les entrepôts logistiques ne sont pas considérés comme des surfaces de vente, ils échappent par exemple à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom). Entre 2017 et 2022, Amazon a multiplié par 10 ses entrepôts en France. On en dénombrait 4 en 2017, contre 44 en 2022, sans compter les 14 entrepôts supplémentaires en projet[59].
L’expansion du commerce numérique en France est loin d’être terminée. Jusqu’à présent, les plateformes chinoises privilégiaient l’expédition des colis par avion depuis la Chine dans des centres de tri gérés par La Poste ou par d’autres entreprises logistiques privées en France et en Europe. Mais pour assurer leur emprise et contourner la menace de taxe sur les petits colis en provenance de pays extra-européens, elles modifient désormais leurs chaînes logistiques et s’implantent à leur tour en Europe[60]. Temu possède déjà un entrepôt près de Paris. Quant au géant de la fast fashion Shein, dont l’ouverture d’un magasin de vente en plein cœur de Paris a fait grand bruit, il vient de se doter d’un entrepôt de 740 000 mètres carrés en Pologne pour continuer à déverser ses produits sur les marchés en Europe.
Pour les petites entreprises du commerce, le développement du commerce en ligne monopolisé par les seigneurs du numérique est dévastateur. Depuis 2009, il aurait provoqué la destruction de 82 000 emplois au total dans le secteur du commerce[61]. Concrètement, pour 1 emploi créé dans le commerce en ligne, ce sont 6 qui sont supprimés dans le commerce de proximité. Si aucune mesure n’est prise, 87 000 emplois supplémentaires pourraient être détruits d’ici à 2028. Les TPE et les PME de moins de 19 salariés sont les premières victimes de cette saignée : en moyenne, 12 000 emplois par an y ont été supprimés entre 2009 et 2018[62]. C’est le secteur de l’habillement qui est le plus touché, en proie à la concurrence destructrice de la fast fashion : 37 000 emplois y ont été supprimés en dix ans[63].
La grande distribution et le commerce en ligne sont ainsi les marques d’une mutation profonde du capitalisme qui détruit les petites entreprises au profit d’une économie ultra concentrée où les multinationales contrôlent la production et la distribution. En quelques années, ces transformations ont détruit une partie du tissu économique productif. Mais elles ont aussi détruit quelque chose de plus profond : la fonction sociale et humaine des commerces de proximité. Car les petits commerces ne sont pas uniquement des lieux de vente et d’emploi : ce sont aussi des lieux d’échanges, de vie et d’interactions sociales, où se tissent les réseaux de solidarité qui fédèrent les êtres humains entre eux. Leur disparition n’est donc pas seulement un événement économique, c’est une réorganisation des temps de vie dans l’espace urbain. Il est temps donc d’arbitrer entre les faits qui s’imposent aujourd’hui sans débat. Quel modèle de socialisation urbaine voulons-nous ? Le plan doit y répondre et encadrer la réalisation des objectifs visés.
Surendettement, désindustrialisation, concurrence insoutenable… Le tableau du tissu productif français et des dynamiques dévastatrices économiques qui le déchirent est édifiant. Le capitalisme révèle son vrai visage : celui d’un système économique chaotique qui s’oppose au progrès humain et social.
2- Pourquoi les petites entreprises ont la vie impossible
Les vraies « charges » masquées qui pèsent sur les TPE et PME du pays
Dans le débat public, l’ennemi des entreprises est tout trouvé : le « coût du travail » ! Représentants du Medef, économistes libéraux, éditorialistes, élus du bloc libéral et du bloc d’extrême droite… Tous déplorent en chœur des entreprises asphyxiées par les cotisations sociales, décrites comme un fardeau pour l’emploi et pour la compétitivité internationale. Au point qu’on les nomme frauduleusement « charges ».
Ce discours ne résiste pourtant pas à l’épreuve des faits économiques. Mais il présente pour les grands patrons du pays plusieurs avantages. Un : il donne l’illusion d’un bloc patronal homogène, partageant une condition commune et portant les mêmes revendications. Car des TPE aux multinationales, tous les chefs d’entreprise versent des cotisations sociales. Deux : il ouvre la voie à l’extension du marché privé en lieu et place de la Sécurité sociale, progressivement détruite. C’est ce que convoitent de longue date les grands patrons des secteurs concernés. Trois : il permet de ne jamais évoquer les prélèvements privés qui pèsent sur les petites entreprises, sur le dos desquelles les grands groupes s’enrichissent. Prélèvements privés de plus en plus importants à l’ère du capitalisme tributaire.
La vérité sur les cotisations sociales
Depuis quarante ans, les politiques économiques s’emploient méthodiquement à baisser le « coût du travail », en premier lieu par le biais d’allègements de cotisations sociales[64]. En 1993, la cotisation patronale de 5,4 % du salaire brut versé à la caisse d’allocations familiales (CAF) est ainsi supprimée pour les bas salaires. Plusieurs mesures d’allègements généraux suivent, auxquelles s’ajoutent des allègements ciblés sur un secteur d’activité ou un type de contrat de travail. En 2025, les allègements représentent au total 83,4 milliards d’euros, soit 3 % du produit intérieur brut (PIB)[65] ! Concrètement, l’État prend aujourd’hui en charge 40 % du coût d’un salarié au salaire minimum.
Voilà donc quarante ans que les grands patrons sont exaucés. Et pour quel résultat sur l’emploi ? Aucun ! Les travaux sont unanimes : les politiques de réduction du « coût du travail » n’ont pas conduit à une hausse des embauches[66]. Les entreprises ont utilisé les allègements de cotisations pour augmenter les hauts salaires parmi leurs effectifs mais aussi pour verser plus de dividendes aux actionnaires. Aujourd’hui, une nouvelle envolée du chômage est même à craindre : le taux de chômage pourrait atteindre selon les prévisions 8,2 % en 2026, après avoir augmenté en 2025[67].
La politique de l’offre, avec ses diminutions des cotisations sociales, est un véritable puits sans fond. Tout simplement parce qu’elle s’appuie sur un constat faux : les entreprises ne sont ni étranglées par les cotisations sociales, ni désavantagées par rapport à leurs concurrents économiques. Dans l’industrie allemande, une heure de travail coûte en moyenne 46 euros, contre 44,2 euros en France[68] ! Aux Pays-Bas, en Belgique ou encore au Danemark, une heure de travail dans l’industrie et dans les services coûte plus cher qu’en France[69].
Encadré – Les cotisations sociales font tourner l’économie ! Le débat sur le « coût du travail » éclipse en réalité la question qui importe réellement : à quoi servent les cotisations sociales ? Socialisation des besoins collectifs La France a fait le choix de mutualiser un certain nombre de risques sociaux : la maladie, la vieillesse, la maternité, les accidents du travail, le chômage. Ce sont autant d’événements, la plupart aléatoires, auxquels nous sommes tous individuellement exposés, souvent contre notre gré, et qui affectent directement notre pouvoir d’achat. Les cotisations sociales viennent financer une partie des dépenses collectives de tous ceux qui en ont besoin : remboursements des soins de santé, indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ou d’arrêt maladie, indemnités chômage pour les privés d’emplois, pensions de retraite… Un autre modèle existe, où les cotisations sociales sont très faibles. C’est le cas aux États-Unis, où la population doit en lieu et place souscrire un contrat auprès d’une assurance privée. Les prélèvements obligatoires publics que sont les cotisations y sont donc en réalité remplacés par des prélèvements obligatoires privés, versés aux assureurs. Dans tous les cas, il faut payer, car les besoins de santé ne disparaissent pas ! Aux États-Unis, ceux qui n’en ont pas les moyens se retrouvent privés de protection, ou obligés de s’en remettre aux maigres filets de sécurité assurés par l’État fédéral via les programmes Medicare et Medicaid, auxquels Donald Trump s’attaque aujourd’hui. Au total, près de 8 % de la population n’a aucune couverture médicale, essentiellement les plus précaires : Latino-américains, Afro-américains et auto-entrepreneurs[70]. Les dépenses collectives de santé sont plus efficaces que les dépenses privées[71] Le public coûte moins cher à la fois pour la collectivité et pour les individus. Les frais de gestion de la Sécurité sociale sont ainsi moins élevés que ceux des complémentaires santé françaises : respectivement 7,8 milliards d’euros contre 8,3 milliards, alors même que la Sécu couvre six fois plus de dépenses que les complémentaires[72] ! Pourquoi ? Parce que les organismes de santé privés ont par exemple des frais publicitaires bien plus importants, comme ils sont en concurrence les uns avec les autres. Cela se répercute sur les prix. Aux États-Unis, le prix des assurances est exorbitant : pour une famille, il s’élève en moyenne à plus de 21 000 euros sur l’année[73]. Les personnes âgées, obèses ou diabétiques doivent payer plus cher car elles sont à risque. Et ce n’est pas tout, puisque des franchises sont ensuite à ajouter, pour une somme moyenne de 2 800 euros par an. Le public protège mieux que le privé. On vit moins longtemps aux États-Unis qu’en France : l’espérance de vie est inférieure de cinq années pour les femmes et de quatre années pour les hommes. Aux États-Unis, les prix des produits de santé sont 2,4 fois plus élevés qu’en France[74]. L’économie a besoin d’une population en bonne santé L’économie ne peut pas fonctionner sans travailleurs en bonne santé. Un salarié malade qui n’a pas les moyens de se soigner est contraint de rester chez lui plus longtemps ou de venir travailler en étant amoindri. Dans tous les cas, l’organisation de la production s’en trouve affectée. Et d’autant plus s’il s’agit d’une entreprise avec de très petits effectifs. L’économie ne peut pas tourner sans des travailleurs stabilisés et protégés des aléas de la vie. Les TPE et PME vivent essentiellement de la consommation populaire. Elles ont donc intérêt à ce que celle-ci demeure soutenue et soit protégée des accidents qui peuvent frapper les existences individuelles. Sans mécanismes de protection sociale, un malade est plus rapidement en difficultés financières : pour financer ses soins, il doit se priver et renoncer à certains achats, ou bien renoncer à se soigner et se mettre en péril ainsi que son entourage en famille et au travail. La population est aujourd’hui confrontée à des épidémies et des pathologies nouvelles, dont le capitalisme est directement à l’origine. L’usage intensif des pesticides dans l’agriculture industrielle et la détérioration chimique des aliments dans l’industrie agro-alimentaire exposent la population, et en particulier les classes populaires, au diabète, à l’obésité, au cancer. L’addiction au tabac ou à l’alcool, encouragée par des lobbys puissants, a aussi des effets sanitaires désastreux. À l’exception des organismes de santé privés, dont la nature même est de s’enrichir sur le dos des malades, l’économie dans son ensemble ne sortira pas indemne de cette situation nouvelle. Cela exige une prise en charge collective financée par les cotisations sociales et des politiques de prévention à la hauteur. |
Les charges réelles sont ailleurs : ce sont les rentes !
Les cotisations sociales ne sont en réalité qu’une partie seulement des prélèvements dont les petites entreprises s’acquittent chaque mois. Mais personne ne parle jamais du reste. Les charges qui accablent les petites entreprises sont en effet essentiellement des prélèvements privés, versés à des grands groupes qui contrôlent l’accès à des réseaux d’infrastructures et gèrent la circulation de ressources essentielles à la production. Cette exploitation rentière est caractéristique du capitalisme de notre époque[75]. La rente s’appuie non pas sur la création de valeur par l’activité productive mais au contraire sur l’appropriation exclusive de l’accès à une ressource. Là, de grands groupes rentiers ont constitué un quasi-monopole dans les secteurs de l’énergie, du numérique, de l’immobilier ou encore du transport. La domination économique qui en résulte crée une contradiction profonde entre les petites entreprises et les grandes.
Électricité
L’énergie est un facteur de production essentiel pour transformer les matières premières, faire fonctionner les machines, chauffer, réfrigérer, éclairer. En 2022 et 2023, une hausse sans précédent des prix de l’électricité a frappé les particuliers et les entreprises. Entre 2019 et 2023, le prix de l’électricité hors TVA pour les entreprises a augmenté en moyenne de 100 %, passant d’un peu moins de 100 euros du mégawattheure (MWh) à 200 euros en l’espace de quatre ans[76]. Les petites entreprises sont alors en première ligne. Le tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVE) et le « bouclier tarifaire » ne sont en effet réservés qu’aux entreprises de moins de 10 salariés dont les besoins de puissance électrique sont limités. Toutes les autres – entreprises de moins de 10 salariés ayant un fort besoin de puissance électrique, et toutes les entreprises de plus de 10 salariés – doivent acheter leur électricité via des contrats de marché plus coûteux et volatiles.
Pour les petites entreprises dont l’activité est énergivore, c’est la catastrophe. En 2022, la facture des établissements industriels de plus de 20 salariés augmente de 54 % alors même que leur consommation a baissé pour faire face à la crise[77]. C’est également le cas des boulangeries. Le pain est cuit dans des fours électriques, qui consomment énormément, sans même parler des besoins en électricité pour les armoires réfrigérées ou encore l’éclairage. La presse locale s’est largement fait l’écho de la détresse des boulangers, témoignant de factures d’électricité multipliées par deux, trois, voire dix, selon le fournisseur. Face à ces hausses exorbitantes, certains boulangers ont été contraints de mettre la clé sous la porte. Ils sont devenus malgré eux le symbole de TPE et PME locales livrées à elles-mêmes face au chaos du marché européen de l’énergie et à la spéculation des grands groupes énergétiques.
L’Union européenne (UE) est en effet la principale responsable de la situation. Au début du 21e siècle, elle libéralise le marché de l’énergie, présumant que la concurrence facilitera la baisse des prix. Elle crée pour cela un marché de gros, où les producteurs d’électricité de tous les États membres de l’UE vendent leur énergie à des intermédiaires, les fournisseurs. L’électricité s’y vend à un prix unique, quel que soit son mode de production national et son coût. Les règles de fixation du prix de vente conduisent en pratique à ce qu’il soit indexé sur le prix du gaz, ce qui est absurde ! Les prix du gaz ont été multipliés par vingt en deux ans dans le contexte de la guerre en Ukraine en raison de la destruction des infrastructures liées à la production russe. Conséquence : alors que les coûts de production de l’électricité sont restés sensiblement les mêmes, son prix de vente sur le marché a considérablement augmenté. C’est d’autant plus insensé pour un pays comme la France, qui non seulement n’utilise pas de gaz pour produire son électricité mais en plus approvisionne les autres pays européens. Les fournisseurs, qui achètent l’électricité aux producteurs pour la revendre ensuite aux particuliers et aux entreprises, ont à leur tour répercuté la hausse des prix dans les contrats.
Cette organisation désastreuse n’est pas fondée sur le marché comme les libéraux l’imposent ailleurs dans tous les domaines. Il s’agit d’un cadre imposé aberrant inventé par une technocratie dans le seul but de produire une accumulation du capital particulière et spectaculaire.
Les producteurs et les fournisseurs d’électricité ont profité de cette situation absurde pour s’enrichir abondamment. Entre 2017 et 2024, le taux de marge du secteur de l’énergie, de l’eau et des déchets a progressé de 20 points, alors que dans le même temps la productivité diminuait[78] ! Les profits dégagés ont augmenté de 168 %[79]. Autrement dit, les prix n’ont pas augmenté à cause d’un choc exogène incontrôlable, mais bien parce que les géants de l’énergie s’en sont mis plein les poches.
Aujourd’hui, les prix restent très élevés. Premièrement, certaines TPE et PME continuent de payer l’électricité au prix fort : elles ont souscrit un contrat à prix fixe au pic de la crise, et il n’est pas encore arrivé à échéance. Résilier le contrat serait encore plus cher, car les indemnités de rupture fixées par les fournisseurs sont exorbitantes[80]. Deuxièmement, la libéralisation du secteur de l’énergie se poursuit, au nom de la concurrence. Depuis le début de l’année 2026, la France a mis fin à un mécanisme de plafonnement des prix : l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH). Le dispositif obligeait le producteur EDF à vendre aux fournisseurs environ un quart de sa production à prix fixe. Un mécanisme de remplacement est prévu, le versement nucléaire universel (VNU), mais il va exposer bien davantage les prix de l’électricité aux aléas du marché : le prix de l’électricité pourrait augmenter de 28 % pour une industrie de process et de 18 % pour une boulangerie[81], deux secteurs très énergivores.
Loyers
Les entreprises ne sont généralement pas propriétaires de leurs locaux. Comme les ménages, elles sont dépendantes d’un propriétaire, qui accepte de mettre à disposition son local en contrepartie d’un loyer, dans un contexte de tension sur l’immobilier commercial qui donne un pouvoir d’arbitraire très fort aux propriétaires. Le montant des loyers peut évoluer à la hausse, sans possibilité de s’y soustraire : trouver un local commercial correspondant à ses besoins et bien placé est déjà une aubaine, le quitter pour en trouver un autre moins cher est un risque trop lourd à supporter. Le versement d’un loyer est un exemple typique d’exploitation de rente.
Les TPE et PME sont victimes de la spéculation immobilière. Leur loyer a considérablement augmenté ces dernières années. Chaque trimestre, l’Insee publie un indice des loyers commerciaux (ILC), auquel les propriétaires se réfèrent pour réviser le montant de leur loyer. L’ILC a explosé ces dernières années. Près de 5 % rien que sur l’année 2022[82] : concrètement, une petite entreprise qui renouvelle son bail à ce moment-là peut subir une hausse de 5 % du montant de son loyer. Face à la crise, le gouvernement a pris des mesures temporaires de plafonnement de la hausse des loyers, à hauteur de 3,5 %, qui n’ont pas répondu aux besoins car elles ont seulement ralenti la flambée des loyers sans attaquer le problème à la racine.
S’acquitter du loyer devient un fardeau qui pèse sur l’activité des petites entreprises, et en particulier des commerçants indépendants. Pour certains d’entre eux, il est le premier ou deuxième poste de dépenses, représentant parfois jusqu’à 85 % des charges totales[83]. Les petits commerces implantés en centre-ville sont les plus exposés à l’emprise du capital sur le foncier. Quand ils n’ont plus les moyens de payer, ils ferment et c’est ainsi que les communes se vident de leurs commerces. La hausse des loyers commerciaux est à l’origine de 56 % de la vacance commerciale[84]. C’est pourquoi la durée de vacances de tels locaux doit permettre d’établir des règles de « réquisition socialement utile ».
Frais bancaires
Chaque mois, les entreprises payent pour les différents services bancaires qu’elles ont utilisés. La banque prélève par exemple une marge sur les paiements par carte bancaire, qui avoisine parfois 2 % du montant de la vente ! Mais les frais bancaires sont bien plus nombreux : frais de compte, frais d’incident de paiement, frais de découvert bancaire, frais de report de crédit, frais de dépassement… Ces frais ne sont jamais évoqués, mais ils sont en réalité un motif de difficultés important pour les petits patrons.
En 2020, les principales organisations patronales du pays ont mené une enquête de satisfaction auprès des dirigeants de TPE et de PME, pour déterminer si les services bancaires répondaient correctement à leurs besoins. Résultats : les deux tiers des enquêtés déclarent que les services bancaires ne sont pas, ou pas toujours, adaptés à la situation financière de leur entreprise[85]. Ils dénoncent en particulier des frais bancaires trop élevés, citant notamment : des « frais élevés pour la gestion de compte / carte bancaire », des « frais obscurs, peu clairs et perçus comme injustifiés », des « frais non adaptés à la taille et au chiffre d’affaires des TPE et PME ».
L’enquête rapporte également l’isolement des TPE et PME face à leur situation bancaire, de l’aveu même des chefs d’entreprise : « les frais sont trop élevés “alors que [les petites entreprises] font de plus en plus le travail de la banque” ». Plus une entreprise est de petite taille, moins la banque contacte de sa propre initiative le chef d’entreprise pour le questionner sur ses besoins et proposer d’y apporter des réponses[86]. Résultat : 9 chefs d’entreprise sur 10 à qui la banque refuse un crédit de trésorerie ne sont pas informés par leur banque de la possibilité de recourir à la médiation du crédit[87].
Le montant annuel moyen des frais bancaires pour une entreprise qui utilise le découvert bancaire est estimé à près de 1 700 euros par an[88]. Et la tendance des frais bancaires est à la hausse. Entre 2019 et 2020, le nombre d’entreprises s’acquittant de frais bancaires supérieurs à 150 euros par mois a augmenté de 12 %[89] !
Les petites entreprises ressentent davantage le poids des frais bancaires, pour des raisons structurelles. Elles en payent proportionnellement davantage notamment parce qu’elles sont plus souvent à découvert. Une TPE-PME sur quatre est à découvert en 2024[90]. C’est deux fois plus qu’en 2022. Elle verse en conséquence des agios à la banque. Mais les TPE et PME sont également de plus en plus nombreuses à dépasser leur autorisation de découvert : pendant 1,9 jour en moyenne par mois pour les TPE, et 2,1 jours pour les PME, en augmentation continue ces dernières années[91]. C’est même 2,6 jours de dépassement dans le secteur de la construction. En conséquence, elles sont contraintes de payer des frais bancaires supplémentaires, qui s’ajoutent aux agios. Une réglementation bancaire spécifique doit donc être établie pour briser ce cycle destructeur.
Frais d’assurance
On parle beaucoup des cotisations sociales, mais plus rarement des cotisations d’assurance. Il s’agit pourtant d’un impôt privé obligatoire, versé par les entreprises à des assureurs privés pour se prémunir des risques de dommages corporels professionnels et de sinistres.
Le principe de l’assurance privée est simple : plus on a les moyens de souscrire à un contrat cher, mieux on est couvert individuellement. Autrement dit, les grandes entreprises payent proportionnellement moins de frais que les petites entreprises, alors qu’elles sont mieux protégées contre des risques qui touchent pourtant tout le monde. Par exemple, 9 grandes entreprises sur 10 sont couvertes contre les cyber-risques, tandis que seules 3 PME sur 100 le sont. C’est encore moins pour les TPE[92]. Pourtant, les petites entreprises sont loin d’être épargnées par les escroqueries en ligne, qui se multiplient ces dernières années : virus, rançongiciels, hameçonnage… Les grandes entreprises et les collectivités étant de mieux en mieux protégées, les PME deviennent une nouvelle cible privilégiée.
Les cotisations d’assurance alimentent un marché juteux, qui bénéficie à une poignée de grands groupes spéculateurs. En 2024, les principales compagnies d’assurance du pays ont cumulé 18 milliards de profits sur un an[93]. Et pour cause, les primes augmentent depuis plusieurs années. En 2023, les cotisations totales collectées par les assureurs pour la protection des biens des entreprises étaient en augmentation de 7,1 %[94]. En 2026, les primes d’assurance vont à nouveau augmenter[95], impactant le pouvoir d’achat des ménages et des petites entreprises. Mais pour quelle protection ? Les cas sont nombreux de TPE et PME frappées par un sinistre et livrées à elles-mêmes face à des assureurs qui rechignent à payer et répartissent les responsabilités en leur défaveur. Le contrôle des prix de l’assurance sera une première mesure avant l’intégration directe de cette activité pour le compte du pôle bancaire public.
Rentes numériques
Amazon, Google, Meta sont des quasi monopoles numériques. Ils contrôlent les plateformes et les services numériques. Pour pouvoir accéder à ces services aujourd’hui incontournables afin d’être concurrentiel, les petites entreprises sont obligées de s’acquitter de commissions très coûteuses.
Vendre sur Amazon a un prix. Pour chaque produit, Amazon ponctionne une commission qui varie entre 8 et 15 %. Pour les vêtements par exemple, le montant prélevé est de 5 % du prix de vente pour les articles de moins 15 euros, 10 % si le prix est compris entre 15 et 20 euros, et 15 % pour tous les articles au-delà de 20 euros. Les petits commerces de l’habillement, déjà décimés par la concurrence déloyale en ligne, sont également appauvris par la plateforme dès qu’ils écoulent une partie de leurs stocks en ligne. En 2023, seule une minorité de TPE et PME, tous secteurs confondus, pouvaient se le permettre : 13 000 en tout, alors qu’elles sont pourtant des centaines de milliers à en avoir l’utilité dans le pays[96].
Google domine les trois quarts du marché mondial de la publicité en ligne. Pour les entreprises, sa régie publicitaire est devenue un bien indispensable. Bénéficier d’une annonce ciblée au bon endroit et au bon moment présente un intérêt indéniable pour leur activité. Mais cela coûte cher. La régie publicitaire de Google Ads fonctionne selon un système d’enchères, plus facilement accessible aux plus gros. Dès lors, tous les produits que nous consommons intègrent dans leur prix une portion consacrée à la publicité sur Google[97]. De la même façon, être correctement référencé et visible rapidement dans le moteur de recherche de Google coûte de l’argent à l’entreprise.
Pour les entreprises qui développent une application mobile, c’est la même chose : il faut payer les géants du numérique afin de pouvoir la diffuser. Pour qu’une application soit disponible sur l’Apple Store, il faut s’acquitter d’une cotisation annuelle de 99 euros puis payer des commissions de 15 à 30 % sur chaque téléchargement effectué par les utilisateurs ! Idem pour le magasin d’applications Google Play Store, qui impose une cotisation annuelle ainsi que des commissions.
Crédit bancaire : les banques contre les chefs des petites entreprises
Pour faire tourner leur activité, embaucher mais aussi améliorer les processus de production grâce à de nouveaux équipements ou de nouveaux savoirs faire, les petites entreprises ont essentiellement deux sources de financement à leur portée. La première est l’autofinancement, soit le fait d’utiliser ses bénéfices, donc son épargne, pour les réinvestir au service de la production. C’est le moyen le plus couramment utilisé par les petites entreprises aujourd’hui[98]. Mais cela ne suffit souvent pas. Soit parce que les investissements à réaliser sont importants. Soit parce que l’entreprise fait face à des problèmes momentanés de trésorerie du fait d’une période creuse et a besoin d’assurer sa propre subsistance. Les fonds propres des petites entreprises sont souvent modestes, voire parfois inexistants. Une TPE sur cinq a des capitaux propres négatifs, de même qu’une PME sur dix[99]. C’est là qu’intervient la deuxième source de financement : emprunter de l’argent auprès de la banque. Sauf que les intérêts des banques commerciales ne sont pas alignés sur ceux des petites entreprises.
Accéder au crédit : un parcours du combattant
Les banques commerciales ne sont plus tournées vers le crédit aux entreprises[100]. Elles privilégient davantage les investissements sur les marchés financiers, plutôt que dans l’économie réelle, où les besoins existent pourtant. La part du crédit aux entreprises ne représente que 10 % du bilan total du secteur bancaire français, et elle tombe même à 5 % pour les petites entreprises[101]. Cela se traduit concrètement par des difficultés d’accès au crédit pour les TPE et les PME.
Ces difficultés concernent en premier lieu le crédit de trésorerie, c’est-à-dire un prêt d’argent de court terme, de quelques jours ou quelques mois, pour faire face à des difficultés de trésorerie momentanées ou à une période creuse. Sur l’ensemble de la période 2012-2020, les banques ont refusé 25 % des demandes de crédit de trésorerie émanant d’une TPE ou d’une PME[102]. Les TPE sont les plus nombreuses à être refoulées, alors même que ce sont elles qui en ont le plus besoin : un tiers d’entre elles n’obtient pas l’argent demandé[103], soit 700 000 à 1 million d’unités de production au total.
Le crédit d’investissement, qui désigne un prêt sur plusieurs années, de 3 à 20 ans, est très légèrement moins sélectif pour les TPE. Au total, elles sont 20 % à voir leurs demandes de crédit d’investissement refusées[104], se retrouvant privées des moyens de développer leur activité. Pourtant, les sommes demandées sont généralement loin d’être exorbitantes : la moitié des TPE le font pour un montant d’au plus 5 000 euros[105].
Les biais sexistes pèsent par ailleurs lourdement sur l’accès au crédit bancaire. Les entreprises rencontrent plus de difficultés à obtenir des financements lorsqu’elles sont dirigées par une femme. Les femmes créatrices d’entreprise empruntent tendanciellement des montants moindres que leurs homologues masculins, mais sont deux fois plus nombreuses à voir leurs demandes de crédits rejetées[106] ! Quand il s’agit de créer une entreprise, un homme a 60 % de chances de plus qu’une femme de recevoir un financement. Ces discriminations sont particulièrement marquées en ce qui concerne les start-ups : en moyenne, les start-ups dirigées par une femme lèvent 2,5 fois moins de fonds auprès des investisseurs que celles dirigées par des hommes[107].
S’ajoutent aux petites entreprises refoulées du crédit toutes celles qui s’auto-censurent. Elles ne font pas de demande parce qu’elles anticipent un refus de leur banque. Les cas rapportés par les chefs de petites entreprises sont nombreux. Parmi les motifs à l’origine de leur réticence, on trouve notamment les garanties personnelles qui sont régulièrement exigées par les banques. Craignant de ne pas être remboursées, les banques peuvent demander aux chefs d’entreprise d’engager leurs biens personnels en guise de caution à hauteur de l’intégralité du montant du prêt accordé à l’entreprise.
L’exploitation financière par le crédit
Quand une entreprise contracte un crédit, elle s’engage non seulement à le rembourser intégralement mais également à verser des intérêts à la banque en guise de rémunération. Les TPE et les PME peuvent facilement se retrouver asphyxiées par des taux d’intérêt beaucoup trop élevés pour elles.
Depuis 2020, les taux d’intérêt ont repris leur augmentation, après une décennie de diminution. Aujourd’hui, ils se situent en moyenne à 3,5 %, soit un niveau relativement élevé, équivalent à celui du début des années 2010. Pour les petites entreprises, cela représente des sommes d’argent importantes, a fortiori si le remboursement est étalé sur plusieurs années.
Mais les taux d’intérêt ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les banques les fixent en fonction du risque présumé de non-remboursement. Comme elles estiment qu’une TPE ou une PME a plus de chance d’être insolvable, elles leur appliquent des taux d’intérêt plus élevés. Autrement dit, les taux d’intérêt appliqués sont inversement proportionnels à la taille de l’entreprise : plus une entreprise est petite et plus le pourcentage d’intérêts à verser est élevé. De la même façon, les taux d’intérêt dans les territoires ultra-marins sont supérieurs de près de 1 point à ceux appliqués dans l’hexagone car la population et les structures économiques y sont encore plus précaires[108]. Sur l’ensemble de la période 2007-2023, à une seule brève exception près, les taux d’intérêt des TPE ont toujours été supérieurs à ceux des PME, eux-mêmes significativement plus élevés que ceux des grandes entreprises[109]. En 2014, le ratio entre petits et gros était même de deux : les TPE empruntaient à un taux d’intérêt deux fois plus élevé que celui appliqué aux grandes entreprises.
Le règne économique des grandes entreprises
Le tout marché conduit au chaos parce qu’il garantit la domination du plus fort par des mécanismes économiques implacables. La concurrence supposée libre et non faussée conduit en réalité une poignée de grandes entreprises à acquérir une position de domination sur le marché mondial. Leurs intérêts vont à l’encontre de ceux des TPE et PME implantées sur le marché national. Mais les petites entreprises n’ont pas les moyens de s’y opposer. Elles se retrouvent tantôt menacées de disparition, tantôt sous la coupe de grands groupes auxquels elles sont subordonnées.
L’exploitation commerciale par la sous-traitance
Le capitalisme néolibéral marque l’hyper développement de la sous-traitance[110]. La globalisation de l’économie a considérablement fragmenté les processus de production, qui sont confiés à une myriade de producteurs intermédiaires, souvent de petite taille. Mais ces entreprises ne sont que faussement indépendantes. Elles travaillent sous la domination de puissantes multinationales donneuses d’ordre, guidées par des objectifs de rentabilité.
Les petites entreprises sont donc prises dans des rapports commerciaux fondamentalement asymétriques : elles sont dépendantes de donneurs d’ordre qui s’approprient leur travail.
Les marges records réalisées dans certaines filières de l’industrie peuvent donner l’impression que les entreprises dans leur ensemble se portent très bien. Mais c’est une illusion. Seuls les grands groupes récoltent les richesses. Le reste de la filière se porte mal, les marges des TPE et des PME sous-traitantes ne dépassant pas 5 %. Dans la filière automobile, par exemple, les constructeurs donneurs d’ordre ont enregistré pendant quelques années des taux de marges à deux chiffres[111] tandis que dans le même temps ceux de leurs fournisseurs ne dépassaient pas les 2 %.
La domination des donneurs d’ordre est telle qu’ils peuvent se permettre de payer en retard les sous-traitants, au mépris de la loi qui leur fixe pourtant un délai de paiement maximal de 60 jours. Une grande entreprise sur deux règle sa facture en retard[112]. Les grandes entreprises sont responsables des retards les plus longs dans toute l’économie marchande : 17,8 jours de retard en moyenne pour les entreprises de plus de 1 000 salariés[113] ! Les petites entreprises sont victimes des trois quarts de ces retards. Elles sont au contraire beaucoup plus respectueuses des délais et sont près de deux tiers à s’acquitter de leurs factures dans les temps. Cette situation pénalise lourdement leur trésorerie. Cela représente au total 15 milliards d’euros de trésorerie en moins sur l’année[114]. Les conséquences sont très concrètes : un retard de paiement augmente en moyenne le risque de défaillance de 25 %[115]. Dans ce contexte, le taux d’escompte zéro peut permettre d’organiser rapidement une véritable clause de survie des entreprises concernées.
Pourtant, la dépendance économique des petites entreprises sous-traitantes n’est pas reconnue. Les entreprises donneuses d’ordre sont émancipées de toute responsabilité sociale et économique. Lorsqu’elles stoppent brutalement leurs commandes sans justification économique réelle, elles ne sont juridiquement pas tenues responsables de la faillite des TPE et PME que leur décision peut provoquer. En vertu d’une pyramide juridique sophistiquée, seuls les licenciements dans leur propres établissements seront considérés comme de leur fait.
Les TPE et les PME ne sont plus les seules concernées. Avec le développement du statut d’auto-entrepreneur, la sous-traitance continue de s’étendre sous des formes encore plus sournoises. Le processus d’« ubérisation » de l’économie est l’autre visage de la sous-traitance contemporaine. 13 % des auto-entrepreneurs le sont devenus parce qu’une entreprise le leur a explicitement demandé[116]. En privilégiant de la sorte les relations professionnelles avec un travailleur indépendant, les entreprises concernées assurent leur domination économique.
Comment les grandes entreprises ont imposé le marché mondial
L’Union européenne (UE) a érigé le libre-échange en dogme. 44 accords de libre-échange ont ainsi été passés avec 76 pays dans le monde entier. Sans compter tous ceux en cours de négociation. Aujourd’hui encore, la Commission européenne s’entête avec l’accord UE-Mercosur dont l’ensemble des syndicats agricoles et des parlementaires français ne veut pas.
Tout cela s’est fait au mépris des petites entreprises. Elles se retrouvent jetées en pâture sur un marché mondial qui non seulement ne les concerne pas, puisque leur activité est essentiellement orientée vers le marché local et la consommation domestique, mais en plus les expose à une concurrence déloyale insoutenable. Il leur est impossible de rivaliser avec des productions moins-disantes écologiquement et socialement.
L’ouverture tous azimuts de l’économie française n’a eu aucun effet d’entraînement sur l’économie dans son ensemble. Elle a exclusivement profité aux grands groupes : les entreprises du CAC 40 se développent aujourd’hui surtout à l’international. Elles réalisent 75 % de leur création de richesses en dehors de l’hexagone, où elles ont d’ailleurs réduit leurs effectifs de 15 % en l’espace de dix ans, passant de 1,4 million de salariés à 1,2 million[117]. Les grands groupes, ainsi qu’une poignée d’entreprises de taille intermédiaire, sont les seuls à avoir intérêt au libre-échange généralisé : de nouveaux marchés leur sont ouverts, qu’ils peuvent inonder de leurs marchandises. Dans ce domaine, la logique du protectionnisme solidaire, c’est-à-dire la négociation bilatérale des complémentarités de production entre partenaires, est la solution. Le plan permettra d’identifier et de construire les accords nécessaires.
L’injustice fiscale dans le monde de l’entreprise
Le constat est limpide : en France aujourd’hui, plus on est gros, moins on paye d’impôts. En se mobilisant contre la taxe Zucman et l’ensemble des mesures pour imposer davantage le patrimoine et le capital, le Medef s’érige en défenseur des privilèges fiscaux des grands patrons et des actionnaires les plus riches du pays. Sauf que les petites entreprises n’ont rien à voir avec ce « monde de l’entreprise » là.
Impôt sur les sociétés : la grande injustice
Sur le papier, l’impôt sur les sociétés est un taux unique : 25 % des bénéfices réalisés, pour les TPE comme pour les multinationales. Soit deux fois moins qu’au début des années 1980, où le taux d’impôt sur les sociétés était de 50 % : c’est le résultat de 40 ans d’une politique de l’offre débridée, qui a privé l’État de recettes fiscales précieuses faisant défaut aux besoins de la collectivité. Le taux de l’impôt sur les sociétés n’a pas toujours été le même pour tout le monde. Entre 1989 et 1993, un taux différencié s’appliquait pour encourager l’investissement productif : les entreprises qui distribuaient les bénéfices à leurs actionnaires payaient plus que les autres. Aujourd’hui, non seulement le taux d’impôt sur les sociétés n’est pas progressif selon la taille de l’entreprise, mais il est en pratique plus élevé pour les petites entreprises. Les TPE et PME versent 23 % de leurs bénéfices déclarés, contre 15 % seulement pour les grandes entreprises[118]. Autrement dit, elles paient 50 % d’impôts en plus !
Cela est possible en raison du mode de calcul de l’impôt lui-même, qui profite structurellement aux grandes entreprises. Pour établir le montant des bénéfices d’une entreprise, l’entreprise peut déduire ses charges financières, c’est-à-dire les intérêts qu’elle doit verser à ses créanciers. Les grands groupes sont forcément gagnants[119] : ils se financent beaucoup plus par l’endettement que les TPE et les PME, car ils ont, eux, accès aux marchés financiers.
Et encore : ce déséquilibre ne tient même pas compte de l’évasion fiscale agressive pratiquée par les grands groupes. Apple, Amazon, Total, Renault… : ces géants payent régulièrement 0 euro d’impôt en France, alors qu’ils engrangent pourtant d’importants bénéfices. Les multinationales exploitent tous les moyens à leur disposition pour ne pas comptabiliser leurs bénéfices en France. Elles localisent par exemple en France des activités déficitaires, tandis que le reste des activités dans le monde génère des bénéfices énormes : c’est ce que fait par exemple Total. Elles utilisent également divers montages financiers pour déplacer dans les paradis fiscaux comme l’Irlande ou le Luxembourg les bénéfices réalisés en France. Apple est même parvenue pendant plusieurs années à payer moins de 0,005 % d’impôts en Irlande, où le taux d’impôt sur les sociétés est déjà mondialement bas, à 12,5 %.
Aides aux entreprises sans conditions : une aubaine pour les plus gros
Il existe aujourd’hui près de 2 000 aides différentes aux entreprises, versées essentiellement sans contrepartie, qui représentent 211 milliards d’euros par an[120]. Les subventions versées directement aux entreprises représentent une infime partie de cette somme. Les trois quarts de ces aides (163 milliards) correspondent en fait à des allègements de cotisations sociales et à des dépenses fiscales : c’est-à-dire des exonérations d’impôt, des déductions fiscales, des crédits d’impôt, qui engendrent une perte de recettes fiscales pour l’État. On regroupe tous ces dispositifs sous la catégorie de niches fiscales et sociales. Et c’est sans compter les dépenses fiscales qui sont déclassées par l’administration[121], et n’apparaissent plus dans le calcul.
Le problème est que ces aides ne favorisent pas vraiment l’activité économique car elles bénéficient essentiellement et de façon disproportionnée aux grands groupes.
C’est notamment le cas du crédit d’impôt recherche (CIR), qui est devenu en 2020 la première dépense fiscale de l’État après une augmentation spectaculaire en deux décennies. 50 grands groupes captent 50 % du CIR aujourd’hui. Pour quels résultats ? Très peu d’effets démontrés sur l’emploi et sur l’innovation dans les grandes entreprises, de l’aveu même de France Stratégie[122], mais des délocalisations de grands groupes et des dividendes impressionnants, comme l’illustre le cas de Sanofi. Dans les économies développées, les grandes entreprises contribuent moins à la recherche et développement (R&D) que les TPE et PME : d’après une étude de l’OCDE menée sur 20 pays, dont la France, pour 1 euro d’aide à la recherche reçu, les TPE investissent 1,6 euros et les PME 1,4 euros, contre 0,4 euros seulement pour les grandes entreprises[123] !
Les petites entreprises sont donc les grandes perdantes du fonctionnement actuel des aides aux entreprises. C’est aussi le cas des entreprises de l’ESS, qui ne reçoivent que 7 % des aides publiques aux entreprises alors qu’elles représentent près de 14 % de l’emploi privé[124]. Et ces maigres aides, menacées par les budgets austéritaires, sont loin de profiter à toutes les structures de l’ESS. Aujourd’hui, seuls 4 % de l’ensemble des acteurs de l’ESS touchent des subventions[125]. Les aides versées par l’État sont principalement destinées aux associations mobilisées pour la sauvegarde des droits humains, là où la puissance publique est défaillante : il s’agit ainsi de subventions versées pour l’hébergement d’urgence, l’accompagnement social et alimentaire, l’accueil et l’orientation des réfugiés[126]. De la même façon, les aides financières des collectivités territoriales sont perçues en majorité par des associations. Pour les autres acteurs de l’ESS, comme les coopératives, les aides publiques sont rares et difficiles à obtenir : la Cour des comptes a récemment pointé du doigt l’insuffisance du soutien de la banque publique d’investissement Bpifrance[127]. La verrerie Duralex, reprise en Scop à l’été 2024, en a fait les frais. Bpifrance a consenti à lui accorder un prêt de 750 000 d’euros seulement, beaucoup moins que la somme nécessaire pour financer son activité. Duralex s’en est donc remis directement à la population, levant cinq millions d’euros sur une plateforme de financement citoyen[128].
La réussite du plan nécessite une réforme profonde de ce système qui idéalise les vertus créatrices du marché en matière de production. La règle doit être que les entreprises qui signent librement leur engagement dans les objectifs du plan reçoivent les aides, et elles seules, et en acceptent les contreparties demandées.
La consommation en panne
Les petites entreprises forment le cœur de l’économie de proximité du pays. La plupart d’entre elles dépendent exclusivement de la consommation domestique, composée des achats des ménages et des commandes des administrations publiques. Les TPE et les PME ont donc intérêt à ce que le pouvoir d’achat soit le plus élevé possible, pour bénéficier d’une consommation dynamique.
Les difficultés matérielles rencontrées par les petites entreprises aujourd’hui sont en grande partie le fait du ralentissement structurel de la consommation. Les deux tiers des petits patrons s’accordent à dire que la « faiblesse de la demande » est aujourd’hui le « principal frein à l’activité »[129]. 63 % des commerçants estiment également que la « baisse du pouvoir d’achat de la population » est la première cause de la vacance des locaux commerciaux[130]. La crise du pouvoir d’achat est très profonde. Dans l’ensemble des compartiments de l’existence, les ménages font face à des prélèvements privés nouveaux, à des prix en hausse et à des revenus moindres.
Leur pouvoir d’achat est d’abord contraint par la hausse des dépenses « pré-engagées », liées à un contrat ou à un abonnement : logement pour les locataires, facture d’électricité, primes d’assurances… Ces dépenses frôlent aujourd’hui les 30 % du revenu total en moyenne[131]. C’était 12 % seulement en 1960, et un peu plus de 20 % au début des années 1980. Le logement est devenu le premier poste de dépenses pour les ménages : en moyenne, on consacre chaque mois un quart de ses revenus à son logement, et c’est parfois beaucoup plus pour les catégories précaires ou pour les étudiants.
S’ajoutent à cela les dépenses contraintes liées à l’existence, qui pèsent sur le pouvoir d’achat : il faut se nourrir, se vêtir, se soigner. Tout cela a considérablement augmenté. La population a subi de plein fouet la crise inflationniste. Les produits alimentaires ont augmenté en moyenne de 14 % entre 2022 et 2023[132], parfois beaucoup plus sur certains produits. Dans ces conditions, les salaires n’étant pas indexés sur l’inflation, la privation est devenue la seule solution pour les ménages les plus précaires. Entre 2017 et 2024, la consommation de produits alimentaires en volume a baissé de 8 %[133]. Sur la même période, on recense 1,2 million de personnes supplémentaires en situation de « privation matérielle et sociale »[134].
Dans le même temps, les salaires sont attaqués : baisse du salaire réel depuis 2017, gel total ou partiel du point d’indice des fonctionnaires pendant près de vingt ans, absence de revalorisation du salaire minimum au-delà de l’inflation… Les réformes successives destinées à « réduire le coût du travail »[135] ont réduit la capacité de négociation des salariés en affaiblissant les structures syndicales. Elles ont notamment pris pour cible le principe de faveur, en vertu duquel c’est la disposition la plus favorable pour le salarié qui prévaut sur les autres normes, indépendamment de leur hiérarchie[136].
Pour ne rien arranger, les politiques d’austérité s’attaquent aux dépenses de protection sociale. Les déremboursements de soins et la hausse des franchises médicales accroissent les dépenses des ménages. Entre 2023 et 2024, leurs dépenses de santé ont augmenté trois fois plus vite que l’inflation en raison de la hausse du reste à charge et des primes complémentaires santé[137]. Dans ce contexte, toute perspective de relance de la consommation populaire est à exclure. En 2026, l’austérité devrait diviser la croissance par deux[138].
Du côté des administrations publiques, ce n’est guère mieux. Les investissements de l’État et des collectivités territoriales sont en panne. Ils ont baissé de 1,5 %[139] et la tendance devrait se poursuivre en 2026. La commande publique est en baisse, avec de moins en moins d’appels d’offres. Pour les petites entreprises, c’est un désastre : car ce sont les TPE et PME qui décrochent les deux tiers des marchés publics[140].
Le manque de visibilité des chefs de petites entreprises
La visibilité est la valeur suprême de l’entreprise. Sans elle, l’investissement productif est entravé. C’est elle que le plan satisfait. Comment acheter de nouveaux équipements plus performants si l’on n’est pas certain de pouvoir les rentabiliser ? Comment embaucher un nouveau salarié pour augmenter la production et mieux répartir le temps de travail si l’on redoute de ne plus avoir de travail à lui donner ? Comment souscrire un crédit auprès de sa banque si l’on craint de ne pas pouvoir le rembourser ? Pour les TPE et les PME, dont la trésorerie est plus fragile, la visibilité est vitale. Sauf que le marché est par définition chaotique. Ses mécanismes ne cherchent ni à prévoir ni à planifier mais simplement à organiser l’économie de façon à ce qu’un maximum de profit soit dégagé à court terme.
Les petites entreprises ont été très fragilisées par huit ans de macronisme, où les politiques économiques ont navigué à vue, sans aucune boussole. Le manque d’anticipation les a laissées sans défense face à des chocs brutaux, comme la crise des prix de l’électricité. L’absence de direction des politiques les a exposées à des soubresauts et des revirements qui pèsent lourdement sur leur activité. Les coupes budgétaires récentes touchent en premier lieu les secteurs que l’État avait dit vouloir développer, notamment pour mener la bifurcation écologique.
Le secteur de la rénovation énergétique subit par exemple le va-et-vient des gouvernements successifs sur les aides à la rénovation versées par l’État aux particuliers. Le dispositif MaPrimeRénov a été brutalement suspendu à l’été 2025 pour faire des économies. Il a repris en septembre, avant de se retrouver à nouveau délibérément mis à l’arrêt par le gouvernement de Sébastien Lecornu début 2026. Le manque de cohérence et de stabilité des politiques de rénovation énergétique plonge les artisans du bâtiment dans une situation très difficile : lorsque les ménages ne peuvent plus entreprendre les travaux ou refusent de se lancer de crainte de voir les aides interrompues en cours de route, les carnets de commandes se vident et les emplois sont menacés.
Pour les petits commerçants non plus, rien ne garantit un engagement stable de la puissance publique contre la concurrence déloyale que représente le commerce en ligne. Le gouvernement s’est récemment mobilisé contre la plateforme Shein à l’occasion de l’ouverture d’un magasin à Paris, après avoir déroulé le tapis rouge à Amazon pendant des années.
Le problème de la représentativité des chefs d’entreprises : l’avantage donné au Medef
Dans les médias et dans les cercles politiques, le Medef jouit d’une hégémonie certaine. Il rythme largement les débats économiques qui animent le pays. On l’érige en représentant du « monde de l’entreprise ». Et pourtant, le Medef est loin de représenter le patronat dans son ensemble. Il défend essentiellement les intérêts de certains dirigeants, les entreprises adhérentes au Medef, qui ne forment qu’une portion de l’économie du pays.
Cela se traduit clairement dans les statistiques d’adhésion. Parmi les trois organisations patronales reconnues comme représentatives, le Medef est celle qui compte le moins d’adhérents : 149 000 au total en 2025, contre 221 000 pour l’U2P et 243 000 pour la CPME[141]. C’est un quart des adhésions seulement. Tandis que les petits patrons représentent les trois quarts restants.
La représentativité patronale est précieuse. Elle permet d’abord aux mandataires retenus de siéger dans des institutions et organismes paritaires, et donc d’influencer la négociation collective. Elle leur accorde, ensuite, des fonds publics pour le financement du dialogue social. Ce qui est en jeu : du pouvoir et de l’argent.
Or, moins de 12 % des entreprises françaises sont adhérentes d’une organisation patronale représentative. L’écrasante majorité des chefs d’entreprise du pays ne sont donc pas représentés lors des négociations collectives qui déterminent la norme sociale et dans les organismes paritaires. Force est de constater qu’il y a un problème dans l’organisation de la représentativité patronale.
Pire encore : les adhésions patronales se tiennent en cascade. Un patron adhère à une fédération, laquelle adhère à son tour à une organisation patronale nationale. Par exemple, une entreprise membre de l’Association bretonne des entreprises agroalimentaires est automatiquement adhérente à l’Association nationale des industries alimentaires, elle-même membre du Medef. En conséquence, l’ignorance règne et des organisations se prévalent de représenter des adhérents qui l’ignorent eux-mêmes. Lorsqu’elle a été approchée pour entrer au conseil exécutif du Medef, Laurence Parisot ignorait que l’institut de sondage IFOP qu’elle dirigeait était adhérent au Medef. Et cela, sans évoquer même le statut de double, voire triple appartenance, puisqu’une entreprise peut adhérer à différentes organisations, lesquelles peuvent aussi adhérer à la CPME et au Medef simultanément.
Et pour cause, aucune élection ne se tient ! Les dirigeants d’entreprise ne votent pas pour élire leurs représentants dans les négociations de branche. C’est une excentricité totale. Sur le plan historique d’abord. Entre 1946 et 1967, une élection était organisée pour déterminer la répartition des 25 % de sièges attribués aux dirigeants d’entreprise dans les caisses de la Sécurité sociale[142]. Le résultat de l’élection ne s’appliquait certes pas à la négociation collective, mais il n’en reste pas moins que les organisations patronales n’étaient pas totalement exemptées d’élections. Plus généralement, dans le reste de l’économie, voter est la norme. Les organisations syndicales de chaque secteur économique sont désignées par les salariés lors d’élections professionnelles renouvelées tous les quatre ans. Les critères d’éligibilité requis ont été clarifiés et harmonisés dans l’ensemble des branches depuis une réforme de 2008. Un syndicat doit obtenir au moins 10 % des voix dans l’entreprise et 8 % au niveau de la branche ou au niveau national pour pouvoir négocier et signer les conventions collectives.
Mais pour ce qui est de la représentation patronale, c’est tout autre chose. Pas de vote mais seulement une désignation sur la base de règles de représentativité établies par les organisations patronales elles-mêmes, alors qu’elles ne sont pas d’accord entre elles, qu’elles n’ont pas le même poids dans l’économie, et qu’elles ne défendent pas les mêmes intérêts[143].
Une organisation patronale est représentative si au moins 8 % des entreprises de la branche y sont adhérentes ou si les entreprises adhérentes rassemblent plus de 8 % des salariés de la branche. Les organisations patronales qui souhaitent être représentatives doivent formuler une demande qui est ensuite examinée par le ministère du Travail. Elles sont 437 à avoir déposé un dossier en 2025.
Mais ce n’est pas tout. La sous-représentation des chefs de petites entreprises concerne également la répartition des responsabilités. Une fois les organisations patronales représentatives désignées, la répartition des postes dans les organismes paritaires est profondément défavorable aux TPE et PME. Le nombre de salariés dans les entreprises compte pour 70 % dans cette répartition, contre 30 % seulement pour le nombre d’entreprises. Par définition, les grandes entreprises sont largement avantagées : elles sont numériquement moins nombreuses mais elles embauchent chacune plus de 5 000 salariés. C’est tout l’inverse pour les petites entreprises : 40 % des TPE employeuses ne comptent qu’un seul salarié, et les PME embauchent entre 10 et 250 salariés.
Dans les conseils de prud’hommes, chargés de régler les conflits de droit du travail, le Medef écrase toutes les organisations patronales. Au total, toutes sections confondues, il comptabilise dans le pays 46 % des sièges dévolus aux organisations patronales[144]. C’est autant que le nombre de sièges détenus par la CPME et l’U2P ensemble, alors même que ces deux organisations cumulent à elles deux trois fois plus d’entreprises adhérentes que le Medef. Dans l’industrie, le déséquilibre est encore plus profond, puisque le Medef concentre 60 % des sièges. Quant à l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), elle comptabilise toutes sections confondues 4 % des sièges attribués aux organisations patronales, alors même qu’elle représente 14 % de l’emploi privé et crée chaque année 10 % de la richesse nationale totale[145]. La sous-représentation des petites et moyennes entreprises touche de la même façon les autres organismes paritaires. Dans les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) par exemple, le Medef détient 4 sièges sur les 8 dédiés aux employeurs[146].
Le Medef est donc confortablement installé alors qu’il ne représente qu’une portion minoritaire de l’économie, très mobilisée et visible. Sa faiblesse est d’autant plus criante que nombre de mandats demeurent vacants : il n’est pas en capacité de pourvoir tous les postes que lui procurent les règles actuelles.
En résumé, les petites entreprises sont accablées par l’ensemble des structures économiques. Tous leurs besoins, du financement à la production elle-même jusqu’à l’écoulement des stocks, se heurtent à une organisation de l’économie alignée sur d’autres intérêts. Les grandes entreprises sont le centre de gravité du capitalisme contemporain : elles règnent en maîtres sur les petites unités de production, imposant leurs conditions et leurs intérêts prédateurs. Les politiques néolibérales accompagnent et favorisent ce mouvement de concentration : un pacte productif unit les libéraux aux grandes entreprises.
Pour sauvegarder et développer leur activité, les TPE et PME ont besoin d’une rupture nette avec cette organisation de l’économie qui joue contre elles. Les conditions d’un autre pacte productif, sur des fondements mutuellement profitables, sont réunies.
3- Un nouveau pacte productif : l’économie de la nouvelle France par les petites entreprises
Les petites entreprises ont vocation à prendre leur part dans l’intérêt général humain. Leur santé économique dépend de l’état de la population, de ses revenus, de sa santé, de la qualité de sa formation, de ses modes d’organisation : en bref, de la satisfaction des besoins humains.
Notre modèle, l’économie des besoins, fonde le socle d’un possible nouveau pacte productif au service à la fois de l’activité économique des petites entreprises et des besoins humains.
La puissance publique doit reprendre le contrôle de la direction dans laquelle se déploie l’activité productive qu’elle aide. Les intérêts privés des géants capitalistes sont une force qui ne sait ni où elle va ni de quel environnement productif elle a besoin, et qui pour finir ruine tout autour d’elle. La puissance publique doit élaborer un plan, c’est-à-dire établir des grandes directions claires pour que la production réponde aux besoins impératifs de notre ère : mener la bifurcation écologique, protéger la santé, retrouver une souveraineté économique, développer des emplois dignes… Les entreprises seront confrontées à un choix : suivre le mouvement, y contribuer et être aidées par la puissance publique en conséquence ; ou bien persévérer dans la voie actuelle, qui conduit au désastre.
Les petites entreprises y ont intérêt. La planification a pour elle une vertu que nulle autre organisation économique ne peut lui garantir : la visibilité, c’est-à-dire la certitude de carnets de commande remplis et la possibilité de développer et de perfectionner les processus de production.
Cette partie de notre document n’est pas un programme politique. Elle vise plutôt à explorer les grandes lignes possibles d’un pacte productif et de progrès social, incluant les dirigeants de micro, petites et moyennes entreprises sous forme de recommandations d’ordre général.
Axe 1 – Réserver les aides publiques aux entreprises qui s’inscrivent dans la réalisation du plan
Les aides aux entreprises doivent être réformées de la cave au grenier, afin de favoriser les entreprises qui répondent aux besoins de la collectivité. Pour cela, il est nécessaire de cibler les aides et de les conditionner selon les impératifs de la planification écologique et productive. Les entreprises qui acceptent de prendre part aux objectifs collectivement déterminés par le plan productif, qui s’engagent dans la transformation écologique et qui participent à maintenir ainsi qu’à développer l’emploi seront aidées. Les autres entreprises, qui restent attachées à la production aveugle aux besoins, ne recevront rien. Cette restructuration doit s’accompagner d’un effort de lisibilité des aides et de simplification administrative. Des critères seront établis pour s’assurer que le montant des aides aux petites entreprises engagées dans le plan soit proportionnel à leurs poids dans l’économie et au nombre d’emplois qu’elles créent.
Axe 2 – Baisser et stabiliser les coûts de l’énergie des petites entreprises
Les grands groupes du secteur de l’énergie font des profits juteux sur le dos des entreprises et des ménages en prélevant une rente exorbitante. L’énergie est le carburant de toute activité économique. Elle doit être un bien commun accessible à des prix stabilisés. Cela requiert de s’opposer aux logiques du marché de l’énergie : rétablir le tarif régulé, sortir du marché européen de l’énergie et bloquer les prix en fonction du coût de production national.
Axe 3 – Émanciper les petites entreprises de la domination des grandes
Les TPE et les PME ne peuvent plus être dépendantes uniquement des décisions prises par les grands groupes. Non seulement ces derniers doivent être rendus responsables des licenciements dont ils sont la cause, mais c’est également le pouvoir de négociation des fournisseurs et des sous-traitants qui doit être renforcé – en parallèle d’incitation à la réinternalisation de certaines activités pour éviter les chaînes trop longues de sous- traitants. De même, les retards de paiement des grands groupes doivent être réellement sanctionnés, voire pris en charge, de manière transitoire, par un service public d’affacturage par lequel l’État garantira un paiement dans les temps puis se retournera contre les mauvais payeurs.
Axe 4 – Redéfinir les règles de la représentativité patronale
Contrairement aux organisations syndicales, les organisations patronales représentatives n’ont jamais été élues par les chefs d’entreprise du pays. Ce système donne un poids trop important aux grandes entreprises au détriment des petites, qui représentent pourtant l’essentiel des forces économiques. Il faut de nouvelles règles de représentativité, fondées sur des élections professionnelles patronales, afin que la CPME, l’U2P, l’ensemble des organisations représentant les chefs de petites entreprises et les dirigeants de l’économie sociale et solidaire soient représentés à leur juste poids.
Axe 5 – Protéger les petites entreprises du libre-échange
Les « clauses de sauvegarde » dans les accords de libre-échange ne valent rien : elles sont inopérantes puisqu’il est impossible de contrôler efficacement les millions de tonnes de marchandises importées. Instaurer un protectionnisme solidaire et raisonné est une nécessité pour sauvegarder les capacités productives et les savoir-faire et garder la main sur la façon dont est produit ce que nous consommons. Pour cela, la production française doit être privilégiée dès que cela est possible. Les importations doivent respecter les normes écologiques et sanitaires françaises. La signature à tout va d’accords de libre-échange doit cesser.
Axe 6 – Mettre en place un pôle public bancaire et rendre gratuite l’escompte
Les TPE et PME ont besoin de pouvoir bénéficier de services bancaires fiables, de qualité et peu coûteux afin de surmonter les difficultés de trésorerie, d’évacuer la menace du surendettement et de réaliser les investissements nécessaires au développement de leur activité. Un pôle public bancaire pourrait être en soutien d’entreprises engagées dans la bifurcation écologique et la satisfaction des besoins essentiels de la population, en dehors des logiques marchandes habituelles, notamment en accordant aux petites entreprises des prêts à taux faibles ou nuls.
Axe 7 – Protéger les petits commerces
Sauvegarder l’activité du petit commerce exige de mener une bataille sur tous les fronts. Contre la concurrence déloyale des géants mondiaux du numérique d’abord. Il s’agit pour cela de mettre fin aux privilèges fiscaux et réglementaires dont ils bénéficient. Mais il faut également tuer la spéculation immobilière, qui rend la vie impossible aux petits-commerçants. Cela exige de mettre en œuvre des politiques d’encadrement des loyers et des politiques de mise à disposition du foncier, notamment en facilitant la reconversion des friches commerciales.
Axe 8 – Lutter contre l’ubérisation généralisée
Pour une partie de la nouvelle France, l’auto-entreprenariat est aujourd’hui la seule alternative au chômage et à la précarité. Mais il faut mettre fin aux différentes formes d’exploitation économique subies par les petits entrepreneurs. Cela passera notamment par la requalification d’une grande partie de l’auto-entreprenariat en travail salarié et protégé.
Axe 9 – Rétablir la justice fiscale entre les entreprises
L’égalité des entreprises devant l’impôt doit être rétablie, tant pour soulager les petites entreprises que pour financer les grandes conquêtes économiques et sociales du pays. Des formes de progressivité de l’impôt pour les entreprises en fonction de leur taille pourraient notamment être proposées.
Axe 10 – Soutenir le pouvoir d’achat de la population
Il est temps d’en finir avec la politique de l’offre inconditionnelle. Elle finance les cadeaux faits aux plus riches par des budgets d’austérité qui freinent l’activité économique et pèsent sur le niveau de vie de la population. Les TPE et les PME du pays ont intérêt à ce qu’une politique de soutien fort à la demande soit mise en place. Cela passe par des hausses des salaires, des minima sociaux, des pensions de retraite, mais également par des aides à la consommation visant la transformation écologique de la production, comme celles à la rénovation énergétique des bâtiments.
Axe 11 – Assurer des débouchés aux petites entreprises par la commande publique
Les petites entreprises ont intérêt à une relance de la commande publique. Le pacte productif définit les grandes priorités d’investissement public afin de développer la production : agriculture biologique, logement, énergie, industries stratégiques, transports publics, santé, défense, matières premières, habillement. Les TPE et PME gagnent en visibilité puisqu’elles savent désormais où cela vaut la peine d’engager des investissements privés. Pour mener à bien ces chantiers, elles sont soutenues en priorité par la commande publique. Des critères de proximité des entreprises et d’émissions globales de CO₂ sont établis et guident la commande publique.
Axe 12 – Sortir de la dépendance aux Big Tech
Bâtir la souveraineté numérique doit être une priorité pour s’émanciper de la domination des géants de la tech. Le temps est venu de développer nos propres services numériques, de meilleure qualité et à moindre prix pour les petites entreprises du 21e siècle. Pour cela, il faut planifier le développement de solutions souveraines, voire publiques, pour chacune des couches de l’empilement numérique : les infrastructures matérielles (câbles et data centers), les services cloud, les applications.
Axe 13 – Renforcer et transformer la formation initiale et continue
La crise écologique requiert une transformation profonde de nos manières de produire et d’organiser collectivement la vie humaine : certains secteurs économiques vont devoir être reconvertis ou abandonnés, d’autres seront largement développés. L’apparition de nouvelles maladies liées aux dégâts du capitalisme exige également des changements profonds. Pour relever ces impératifs de notre ère, les petites entreprises du pays ont besoin d’avoir la main-d’œuvre la mieux qualifiée du monde, disposant de savoirs et de savoir-faire généraux précieux. Le pacte productif leur garantit une formation professionnelle publique de qualité tout au long de la vie : formation initiale et continue, insertion, reconversion.
Axe 14 – Abolir le travail détaché en France
Le régime européen du travail détaché ne faiblit pas. En 2024, plus de 650 000 détachements ont été effectués en France[147]. Les entreprises étrangères envoient de la main-d’œuvre moins chère que celle disponible sous contrat de droit français. Et pour cause, les cotisations sociales ne sont pas payées en France mais dans le pays d’origine. Les travailleurs détachés ne sont donc pas couverts en cas d’accident du travail ou de maladie. Pour les TPE et PME du pays, c’est une concurrence déloyale insupportable. Il leur est impossible de rivaliser avec les entreprises dites utilisatrices, qui font venir des travailleurs au statut dégradé, effectuant les mêmes tâches pour moins cher ! Tant que l’Union européenne n’aura pas supprimé ou transformé radicalement le régime du travail détaché, la France suspendra son application sur son territoire.
12.12.2025 à 18:24
Pourquoi baisser le coût du travail ne sert à rien ?
Texte intégral (4488 mots)
| Note de lecture du livre de Clément Carbonnier, Toujours moins ! L’obsession du coût du travail ou l’impasse stratégique du capitalisme français, Éditions La Découverte, 2025 |
Clément Carbonnier est économiste, professeur à l’Université Paris 8, codirecteur de l’axe socio-fiscal du Laboratoire Interdisciplinaire d’Évaluation des Politiques Publiques (LIEPP) de Sciences Po Paris. Il est l’auteur de Le Retour des domestiques (Seuil, 2018, avec Nathalie Morel) et de Les Femmes, les Jeunes et les Enfants d’abord (PUF, 2022, avec Bruno Palier). Il a récemment codirigé l’ouvrage Les politiques publiques par la défiscalisation (Presses de Sciences Po, 2025).
Un spectre hante la politique française : le spectre du coût du travail. Depuis cinquante ans, l’ensemble de nos politiques publiques poursuivent un même objectif : le réduire, dans l’espoir d’augmenter la compétitivité des entreprises et de créer de l’emploi. Baisse de cotisations sociales, gel des salaires, réduction de la protection sociale… Tout a été mis en œuvre pour compresser au maximum le prix du travail dans notre pays.
Pourtant, comme Clément Carbonnier le démontre, ces politiques sont inefficaces : elles n’ont eu aucun effet sur la création d’emplois. Pire : elles sont profondément inégalitaires, et réduisent les marges de manœuvre de l’État en le privant de ses ressources. En s’appuyant sur de nombreuses études empiriques, l’ouvrage revient avec précision sur les raisons de l’inefficacité de cette stratégie politique et la dévoile pour ce qu’elle est vraiment : une arme de la classe dominante pour gagner le conflit de répartition des richesses entre le capital et les travailleurs. Face à cette impasse, il affirme qu’une autre politique est possible pour soutenir les emplois tout en répondant aux besoins sociaux et environnementaux de notre temps.
Le département d’économie de l’Institut La Boétie publie aujourd’hui une note de lecture de cet ouvrage précieux.
I – La mise en place des politiques de baisse du coût du travail à partir des années 1970
Du keynésianisme au néolibéralisme : un changement progressif de paradigme
La baisse du coût du travail n’a pas toujours été le leitmotiv des politiques françaises. Après la Seconde Guerre mondiale, la France connaît un régime de forte croissance par accumulation, c’est-à-dire portée par la hausse quantitative des facteurs de production, capitaux et travailleurs, plutôt que par l’innovation. Cette croissance est fortement tirée par la consommation intérieure, et stimulée par des politiques keynésiennes de soutien au salaire, avec un salaire minimum élevé et un fort pouvoir de négociation des syndicats. C’est aussi l’époque du développement de la Sécurité sociale. Or, ce développement ne s’est pas seulement fait en parallèle. La protection sociale a directement soutenu la croissance économique des Trente Glorieuses, en permettant aux ménages de consommer même hors période d’activité (accidents, retraite, chômage…), et en rendant les travailleurs plus productifs grâce à une amélioration de leur santé générale.
À partir des années 1970, la donne change. Le cadre néolibéral s’impose progressivement. La crise de 1973 a marqué le coût d’arrêt de la croissance et a conduit les pouvoirs publics à enterrer toute stratégie de soutien à la demande. D’autant plus qu’en parallèle, l’ouverture progressive des marchés compromet les effets attendus d’une telle politique, car la demande intérieure risquerait de se porter davantage sur l’extérieur que sur la production nationale. De façon générale, l’ouverture du libre-échange – accentué par l’accélération de l’intégration européenne – poussent les États à vouloir augmenter leur compétitivité-prix et donc à baisser les coûts de la main-d’œuvre.
L’abandon des politiques de la demande vient aussi d’un changement des stratégies patronales. Juste après Mai 68, les patrons jouent le jeu de la négociation salariale pour contenir la contestation alors grandissante. À partir du milieu des années 1970 et en réponse à la crise, ils abandonnent ce vernis social pour basculer vers une stratégie bien plus offensive de réduction du coût du travail. Leur but est simple : conserver leurs profits dans la situation de récession qui s’installe – même s’ils préfèrent présenter la stratégie de baisse du coût du travail comme une simple mesure d’efficacité économique…
Les trois axes de la stratégie de baisse du coût du travail
La stratégie de baisse du coût du travail se compose de trois types de politiques publiques : transférer le financement de la Sécurité sociale à d’autres sources que les cotisations sociales ; diminuer les coûts de la protection sociale ; et, enfin, s’attaquer aux salaires directement. Elles ont toutes les trois été mises en œuvre l’une après l’autre des années 1970 jusqu’à nos jours.
1) Transférer le financement de la Sécurité sociale des cotisations sociales vers d’autres sources
Les politiques publiques ont d’abord cherché d’abord à réduire le poids de la Sécurité sociale dans le coût du travail : il s’agit alors de chercher des sources de financement alternatives aux cotisations sociales, jugées trop lourdes pour les entreprises. Un premier dispositif vise à transférer une partie des cotisations sociales payées sur les bas salaires vers les hauts salaires, dans les années 1980. Mais l’étape la plus importante survient en 1991, lorsque l’État crée un nouvel impôt entièrement affecté au financement de la protection sociale : la contribution sociale généralisée (CSG). Depuis sa création, le poids de la CSG dans les recettes publiques n’a fait que s’accroître : en 2024, les ressources de la CSG représentaient 5,2 points de PIB contre seulement 3 points pour l’impôt sur le revenu.
La pièce maîtresse de cette politique consiste dans les allègements de cotisations sociales. D’abord ciblés – sur les jeunes entre 1977 et 1982 puis de nouveau à partir de 1986, et sur les chômeurs longue durée (1989), ils seront ensuite élargis et généralisés. En 1993, la cotisation patronale de 5,4 % du salaire brut revenant à la CAF est supprimée pour les bas salaires. C’est la première mesure d’allègement général de cotisations sociales. Elle sera régulièrement renforcée et élargie : en 1996 ; au passage aux 35h pour les entreprises qui ne réduisent pas les salaires ; avec les allègements Fillon en 2003 ; etc. En 2013, un nouvel outil massif d’allègement de cotisations est mis en place : le CICE, crédit d’impôt compétitivité-emploi, qui coûte 20 milliards d’euros par an à l’État. Ces différents allègements généraux de cotisations sociales représentent 66,9 milliards d’euros en 2025.
En ajoutant les allègements ciblés (9,6 milliards) et le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (9,6 milliards), le total des allègements représente 83,4 milliards d’euros sur l’année. Cette somme représente 3 % du PIB. C’est 4 fois plus que la somme des dépenses publiques pour l’emploi hors incitations fiscales !
2) Diminuer les coûts de la protection sociale
Le deuxième volet de la stratégie de baisse du coût du travail vise à réduire les coûts de la protection sociale – et donc la protection sociale elle-même. Ici le raisonnement est simple : plus on réduit la Sécurité sociale, moins on a besoin de la financer. On peut donc diminuer le coût du travail autant que l’on souhaite.
Les gouvernements successifs vont s’attaquer en priorité aux deux branches les plus coûteuses de la Sécurité sociale : la santé et les retraites. Du côté de la santé, cela passe par le déremboursement de certains soins, la hausse du ticket modérateur, la restriction du périmètre du dispositif Affection Longue Durée (ALD), la mise en place d’objectifs budgétaires restreints concernant les dépenses de l’Assurance maladie, etc.
Côté retraites, l’objectif est le même : réduire les dépenses en rognant sur les conditions de fin de vie de la population. Plusieurs leviers d’action ont été utilisés de la réforme Balladur en 1993 jusqu’à la dernière réforme en 2023 : reculer l’âge légal de départ, allonger la durée de cotisation, ou encore modifier le calcul du salaire de référence pour qu’il soit moins avantageux pour les travailleurs.
3) S’attaquer aux salaires directement
Le troisième axe des politiques de réduction du coût du travail vise à réduire directement ou indirectement les salaires. Plusieurs techniques ont été mobilisés. D’abord, réformer l’assurance-chômage pour modifier le rapport de forces sur le marché du travail en faveur des employeurs – en plus de réduire directement les dépenses sociales.
Deuxièmement, modifier le rapport de force dans les négociations collectives. Autrement dit, affaiblir le pouvoir des syndicats. La loi Fillon de 2004 a ouvert la voie en détricotant partiellement le principe de faveur, selon lequel les conventions collectives et les accords d’entreprise devaient obligatoirement être plus favorables que la loi générale. L’accord national interprofessionnel de 2008, la loi El Khomri en 2016 puis les « ordonnances travail » de Macron en 2017 ont fini de l’enterrer. Résultat : les négociations salariales se font de moins en moins en faveur des travailleurs, et de plus en plus selon les intérêts patronaux.
Enfin, les gouvernements de droite successifs ont encouragé le développement des statuts d’emplois alternatifs, moins protecteur que le salariat, pour réduire le coût global du travail pour les employeurs. C’est notamment le cas du statut d’auto-entrepreneur, introduit en 2009 en France pour, initialement, « permettre aux salariés de compléter leurs revenus ». Une ambition bien loin de la réalité : aujourd’hui, moins d’un tiers des auto-entrepreneurs exercent une activité salariée en parallèle. Surtout, les deux tiers d’entre eux gagnent en moyenne seulement 800 euros par mois. Le développement de l’auto-entrepreneuriat a donc participé lui aussi, indirectement, à une baisse de la rémunération du travail.
II – Une politique inefficace et coûteuse
Cette politique s’est pourtant révélée résolument inefficace pour remplir l’objectif qu’elle se donnait : créer de l’emploi. Au niveau macroéconomique, on ne décèle aucune corrélation significative entre les moments de baisse massive du coût du travail et les variations de l’emploi ces quarante dernières années.
Dans le détail, plusieurs études empiriques démontrent l’absence d’effet des politiques de baisse du coût du travail, relève Clément Carbonnier. C’est particulièrement le cas des allègements successifs de cotisations sociales. Sur les hauts salaires, l’allègement des cotisations n’a pas augmenté les emplois, mais bien les rémunérations, pourtant déjà élevées. L’évaluation du CICE a montré que l’argent gagné par les entreprises grâce aux salariés peu rémunérés – ce sont eux qui ouvrent le droit au CICE – n’a pas été répercuté sur leurs salaires, mais sur celui des salariés fortement rémunérés. En moyenne, 50 % de l’argent perçu a servi à augmenter les hauts salaires, tandis que les 50 % restants ont été attribués aux actionnaires grâce à la hausse des profits.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avancent les différents gouvernements macronistes, l’allègement des cotisations sur les bas salaires n’a pas eu d’impact non plus. En 2016, France Stratégie – un organisme dépendant du Premier ministre – a produit deux évaluations de ce dispositif : l’une montre une absence totale d’impact, tandis que l’autre montre un impact extrêmement faible. Alors que le gouvernement instrumentalise cette deuxième étude pour justifier sa politique, l’Insee reproduit finalement les deux études et conclut à une absence totale d’effet du CICE sur la création d’emploi. En 2019, un rapport de l’Institut des Politiques Publiques est venu confirmer ces conclusions, montrant qu’un nouvel allègement de cotisations sur les bas salaires n’a eu strictement aucun effet sur l’emploi.
Cette inefficacité se voit d’ailleurs aussi à l’international, montre Clément Carbonnier. La Finlande et la Suède ont mis en place des politiques d’allègements de cotisations sociales assez semblables aux nôtres. Là aussi, aucun effet sur l’emploi n’a été décelé. De même, différentes études ont montré que les politiques de hausse du salaire minimum aux États-Unis n’ont eu aucun effet négatif sur l’emploi (cf. encadré).
Bref, la stratégie de baisse du coût du travail est un échec cuisant du point de vue de l’emploi, tout en pesant très lourdement sur le budget de l’État. Car aux 83,4 milliards d’allègements de cotisations s’ajoutent toutes les dépenses visant à compenser les effets négatifs de cette politique. Entre autres : l’aide au développement de la protection sociale privée (complémentaire santé et épargne retraite), les minimas sociaux et les compléments de salaires. Par exemple, la prime d’activité, créée en 2015 pour soutenir les revenus des travailleurs sans augmenter leurs salaires, coûte 10 milliards d’euros par an à l’État. Et ce, sans lui rapporter d’argent, car elle n’est pas soumise aux cotisations sociales…
|
FOCUS – Des salaires trop élevés ? De nombreuses études montrent que la hausse du salaire minimum n’a aucun effet négatif sur l’emploi. C’est le cas de l’étude très connue de David Card et Alan Krueger, qui a montré que la hausse du salaire minimum dans l’État du New Jersey dans les années 1990 n’avait eu aucun impact négatif sur l’emploi à la frontière à la Pennsylvanie – ce dernier ayant pourtant un coût du travail plus faible. Une autre étude, plus récente, a analysé l’ensemble des réformes du salaire minimum aux États-Unis entre 1979 et 2019. Résultat : aucune de ces réformes n’a entraîné de destruction d’emplois. Autre exemple : en 2018, la province de l’Ontario au Canada a augmenté le salaire minimum de 21 %. Suite à cela, le taux de chômage a augmenté moins fortement que dans les autres provinces ! Un autre argument régulièrement mis sur la table est l’idée que des hausses de salaires sont quoi qu’il en soit impossibles car elles provoqueraient la faillite des entreprises. Ce raisonnement est lui aussi totalement faux. Voici ce que montrent les travaux du Groupe d’experts sur le Smic, composé de membres nommés par le gouvernement lui-même
|
III – Une politique inégalitaire au service du capital et des plus riches
Une hausse des inégalités
Les politiques de réduction du coût du travail ne sont pas seulement inefficaces, elles sont aussi profondément inégalitaires. Les allègements de cotisations sociales en France ont profité aux employeurs, aux actionnaires et aux salariés aisés, mais n’ont eu aucun impact sur les salaires des plus pauvres. On observe le même phénomène en Suède. Par ailleurs, la hausse d’impôt qui a servi à financer ces allègements a été majoritairement prise en charge par les salariés les moins aisés. La CSG, impôt à taux fixe (9,2 % pour les salariés) et non à taux progressif, pèse mécaniquement plus fort sur les pauvres que sur les plus aisés. Par ailleurs, si le taux de la CSG est plus élevé pour les revenus des actionnaires (17,2 %), l’imposition totale des revenus financiers est globalement bien plus faible que celle des travailleurs, notamment depuis la flat tax introduite par Macron en 2018.
Surtout, ces politiques ont considérablement augmenté les inégalités d’accès à la protection sociale, en particulier dans le domaine de la retraite et de la santé. Les réformes successives de report de l’âge de la retraite ont touché plus durement les travailleurs pauvres que les plus aisés. Par exemple, la réforme de 2010 a entraîné une hausse de la part d’ouvriers passant par une période « ni en emploi ni en retraite » dans les quatre années précédant la retraite, ainsi qu’un allongement de cette période. Plus généralement, 56 % des ouvriers atteignent 60 ans en vie et sans incapacité contre 77 % des hommes cadres. Chez les femmes, c’est 56 % des ouvrières contre 81 % des cadres. La différence d’espérance de vie sans incapacité entre les cadres et les ouvriers est de 10,3 ans pour les hommes, et 11 ans pour les femmes.
Les politiques de baisse du coût du travail ont aussi creusé les inégalités dans le domaine de la santé. Elles ont favorisé le développement des complémentaires santé privées, mais n’ont pas permis à tous d’y accéder de la même façon. Au contraire, un large collectif de chercheurs a récemment démontré une forte hausse des inégalités dans l’accès des travailleurs à ces complémentaires. C’est notamment dû au développement de la sous-traitance : avant, un cadre et un agent d’entretien d’une même entreprise avaient le même employeur, et donc la même complémentaire. Aujourd’hui, cet agent d’entretien a de grandes chances d’être employé par une entreprise de ménage sous-traitante, qui n’offre pas le même type de complémentaire, en plus d’une moins bonne protection globale.
Enfin, en parallèle, et pour compenser ses dépenses d’allègement de cotisations sociales à hauteur de 3 % de son PIB, l’État a choisi de désinvestir massivement dans les services publics – hôpital, éducation… – entraînant une hausse massive des inégalités.
FOCUS – Deux arguments visent à minimiser les effets négatifs de ces politiques
|
Se priver de ses propres marges de manoeuvre : le piège du néolibéralisme
En cherchant à tout prix à réduire le coût du travail, l’État s’est piégé lui-même. Il a instauré un système dans lequel augmenter les salaires lui devient financièrement défavorable, puisqu’il paie une part substantielle du salaire brut à la place des employeurs : pour un travailleur au Smic, c’est 40 % du salaire qui est pris en charge par l’État. Ce dernier s’enferme donc dans cercle vicieux, dans lequel toute augmentation des rémunérations lui devient financièrement défavorable, l’incitant donc à s’entêter dans une politique inefficace. En résumé : ni salaires décents, ni création d’emplois, ni protection sociale suffisante. Tel est l’horizon promis par la stratégie de la baisse du coût du travail.
Cette situation est symptomatique du néolibéralisme, qui s’accapare les moyens de l’État pour les mettre directement au service du marché et empêcher de les investir ailleurs. D’une main, arroser les entreprises d’argent public. De l’autre, liquider la protection sociale et les services publics. C’est la logique du capitalisme sous perfusion de notre époque.
Conclusion : Le prix du travail, une lutte de classes
Alors pourquoi poursuivre cette politique aussi inefficace ? D’une part, parce que la fausse croyance idéologique en l’efficacité du marché par rapport à la sphère publique est largement partagée par les néolibéraux. Mais cet entêtement est avant tout une affaire d’intérêt de classe : les politiques de baisse du coût du travail ne visent en réalité pas à améliorer la santé économique de notre pays. Elles sont surtout une arme du capital pour gagner la lutte pour le partage de la valeur ajoutée, c’est-à-dire pour le partage des richesses produites par les travailleurs. Et ce d’autant plus dans un contexte de baisse tendancielle du taux de profit, tendance longue du capitalisme déjà identifiée par Marx.
Face à cette politique absurde, il est possible de faire tout autrement, nous dit Clément Carbonnier. Si on considère que l’État doit aider la production privée, il y a mieux à faire que de subventionner aussi inutilement les entreprises, explique l’auteur. En premier lieu : assurer leurs débouchés en augmentant le pouvoir d’achat de la population, et leur permettre d’embaucher des travailleurs qualifiés et en bonne santé, grâce à des dépenses de formation et de protection sociale. Et la suppression de ces dispositifs n’entraînerait pas de catastrophe économique : il est possible de supprimer au moins 10 % des allègements de cotisations en un an sans risquer d’effet récessif sur l’économie, avant de généraliser progressivement leur suppression, démontre l’auteur.
Tout l’argent public économisé par la suppression des allègements de cotisations pourrait ainsi être réorienté vers des investissements utiles : hausse des salaires, formation, santé, recherche et développement, création d’emplois nécessaires à la bifurcation écologique… Par exemple, 13 milliards d’euros actuellement utilisés tous les ans pour alléger les cotisations peuvent être basculés pour financer directement des emplois publics utiles, sans aucune perte d’emploi privé.
Mais pour sortir du piège de la stratégie de la baisse du coût du travail, il ne s’agit pas seulement de réorienter l’argent des allègements des cotisations sociales. Il faut changer la logique globale de toutes les politiques publiques aujourd’hui contaminées par cette obsession : des politiques sociales aux politiques d’innovation, en passant par le cadre même de la relation de travail, ou encore les politiques commerciales. Bref, une bifurcation totale de notre modèle économique qui mettrait en son cœur la juste rémunération du travail et la satisfaction des besoins sociaux.
05.12.2025 à 17:58
Point de conjoncture #6 – Décembre 2025
Un décryptage précieux de la situation économique et sociale, qui révèle une économie tournant au ralenti, privée de consommation et de croissance et en proie au retour du chômage.
La note revient déconstruit également méthodiquement le chantage à la dette. La France n'est pas surendettée. C'est la financiarisation de la dette publique qui est un problème. Un autre financement est possible, hors des marché financiers.
Texte intégral (11005 mots)
Cette note est la sixième édition du « point de conjoncture » de l’Institut La Boétie.
Le département d’économie vous propose régulièrement, dans ces points de conjoncture, une lecture critique pour décrypter et mettre en perspective l’actualité économique. Dans chaque note, vous découvrirez un focus spécifique sur une question économique d’actualité.
Vue d’ensemble : l’économie mondiale tourne au ralenti
Le ralentissement de l’économie mondiale se confirme. Le capitalisme mondial est de plus en plus moribond, sur fond de ralentissement structurel des gains de productivité (malgré le boom de l’intelligence artificielle). Il nécessite de plus en plus d’aides publiques pour maintenir ses profits. La montée des droits de douane ne fait qu’amplifier cette tendance. La baisse des dépenses publiques (en dehors du secteur de l’armement et des subventions aux entreprises) dégrade le niveau de vie des populations et hypothèque l’avenir, en raison des coupes dans les dépenses d’éducation, dans l’investissement public, ou encore dans la lutte contre le changement climatique.
Cette vue d’ensemble propose un examen des indicateurs économiques aux États-Unis, première puissance économique mondiale en déclin, et en France. Les deux pays connaissent une même dynamique de ralentissement économique, accentuée par un projet de budget austéritaire brutal.
Dégradation de la situation économique aux États-Unis
Aux États-Unis, la situation se dégrade. En apparence, l’économie se porte bien : après une baisse de – 0,6 % en rythme annuel au premier trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) a rebondi avec une hausse de 3,8 % en rythme annuel au trimestre suivant[1]. Mais c’est une progression en trompe-l’œil, purement statistique, liée à la guerre commerciale lancée par Donald Trump en avril 2025[2]. Au premier trimestre de l’année, en prévision de la hausse des droits de douane à venir, les entreprises ont massivement acheté des biens étrangers et elles les ont stockés. Résultat : les États-Unis ont largement plus importé qu’ils n’ont exporté, leur solde commercial s’est déséquilibré et le PIB a chuté. Mais au deuxième trimestre, une fois la guerre commerciale déclenchée, tout s’est inversé : les importations états-uniennes se sont effondrées, et le solde commercial est redevenu positif, contribuant ainsi mécaniquement à hauteur de 4,8 points à la croissance.
La demande interne hors variation des stocks est également peu dynamique : c’est le déstockage massif qui contribue pour 3,4 points à la croissance du PIB. La consommation des ménages est loin d’être florissante (+ 2,5 %), et surtout sa composition trahit une hausse des dépenses contraintes : les dépenses de santé à la charge des ménages expliquent un tiers de cette croissance. L’investissement dans l’intelligence artificielle est très dynamique, mais l’investissement en « structures », c’est-à-dire en nouveaux lieux de production, baisse pour le sixième trimestre d’affilée. La guerre commerciale n’a donc pas favorisé les installations sur le sol états-unien. Enfin, les dépenses fédérales civiles s’effondrent : – 13 % annualisées après une précédente baisse de 4 % alors que dans le même temps, les dépenses militaires progressent.
L’activité états-unienne va nettement ralentir au cours des prochains trimestres. L’inflation va probablement progresser et dépasser les 3 %, renforçant ainsi la stagflation[3]. L’OFCE anticipe une croissance de 1,6 % en 2025 et de 1,7 % en 2026 soit plus d’un point de moins qu’en 2024 (2,8 %), alors même que la Réserve fédérale devrait poursuivre sa politique de baisse de taux d’intérêt, favorable à l’investissement. Tandis que les profits stagnent depuis quelques mois, si les forts investissements dans l’intelligence artificielle (IA) ne parviennent pas à dégager d’importants gains de productivité (inexistants aujourd’hui), la probabilité d’une récession se renforcera sur fond d’éclatement de la bulle de l’IA[4].
À plus long terme, le ralentissement des gains de productivité[5] va se prolonger, dans un contexte de limitation drastique de l’immigration et de budget austéritaire. Le Congrès a adopté en juillet un projet de loi budgétaire destructeur, baptisé par Donald Trump le « One Big Beautiful Bill Act« , littéralement taillé pour les riches[6] : 4 500 milliards d’euros de baisses d’impôts, dont 20 % bénéficieront aux 1 % les plus riches[7], financées par des coupes massives dans la protection sociale[8], dans la recherche médicale et dans les subventions pour la bifurcation écologique. L’état de santé de la population américaine va probablement se dégrader. Et in fine cela va nourrir le déclin des États-Unis par rapport à la Chine, qui réorganise son économie et ses échanges pour faire face à la guerre commerciale déclenchée par Trump.
La panne de l’investissement en France
En France, le marasme économique se prolonge, alors qu’un nouveau projet de budget austéritaire pour 2026 est en discussion au Parlement.
La croissance de 2025 atteindra probablement 0,8 %, la pire performance depuis 2013, à l’exception de la période durant la crise sanitaire. Sans le très fort stockage par les entreprises tout au long de l’année 2025, qui traduit un problème de débouchés, le PIB baisserait légèrement.
C’est l’ensemble des composantes du PIB (en dehors des variations de stocks) qui sont défaillantes[9]. Le commerce extérieur et les dépenses publiques, à l’origine de la faible croissance ces deux dernières années, ne contribuent plus à la croissance. D’un côté, le déficit commercial de la France se creuse. Après quatre semestres consécutifs d’amélioration, il est reparti à la hausse au premier semestre 2025[10]. Des secteurs aussi essentiels que celui des médicaments deviennent déficitaires et dépendants d’approvisionnements étrangers : pour la première fois depuis 50 ans, la France est devenue en 2025 importatrice nette de médicaments. De l’autre côté, les coupes dans les dépenses publiques au nom de l’impératif de réduction du déficit public limitent la contribution des dépenses publiques à la croissance.
La consommation des ménages est atone (+ 0,5 % en 2025) avec un taux d’épargne qui progresse encore.
Les commentateurs et politiques libéraux pointent l’incertitude politique : elle conduirait la population à « surépargner » en prévision de risques futurs, alors même que cet argent qui « dort » pourrait être mobilisé pour faire tourner l’économie[11]. Mais ils passent sous silence la montée des inégalités, qui explique en grande partie la hausse de ce taux d’épargne. Ce sont les plus riches, dont les revenus progressent beaucoup plus que ceux des plus pauvres, qui épargnent davantage. Ils sont en effet en mesure de mettre de l’argent de côté pour le faire fructifier. À l’inverse, les ménages les plus pauvres n’ont pas la possibilité d’épargner, car leurs faibles revenus passent en grande partie ou intégralement dans les dépenses contraintes (logement, frais d’assurances, frais de santé…) et toutes celles nécessaires pour subvenir à leurs besoins.
L’investissement des entreprises baisse pour la deuxième année consécutive. Même si les dépenses de fonctionnement des administrations publiques se maintiennent, l’investissement public baisse (- 1,5 % en 2025).
Le taux de marge des entreprises[12] baisse, non pas tant en raison d’une hausse des salaires qui rééquilibrerait la répartition des richesses entre le capital et le travail, que d’une faiblesse persistante des gains de productivité. Le taux de marge est aujourd’hui légèrement inférieur à celui de l’année 2019, et ce malgré la forte diminution du salaire réel[13] depuis 2019 (- 3 % environ) et la baisse de la fiscalité sur les entreprises[14]. Celle-ci a en réalité davantage profité aux grandes entreprises[15] plutôt qu’aux petites et moyennes entreprises (PME) mais n’a eu aucun effet macroéconomique[16], que ce soit sur le chiffre d’affaires des entreprises, l’emploi, l’investissement ou les exportations. Le capitalisme sous perfusion d’argent public est plus que jamais moribond.
La situation ne va pas s’améliorer au cours des prochains mois. L’OFCE anticipe une nouvelle baisse de 1,6 % de l’investissement des entreprises en 2026[17], et prévoit le maintien d’une consommation atone, qui sera malgré tout la première contribution à la croissance. Le pouvoir d’achat des ménages va probablement diminuer en 2026 (- 0,4 % par unité de consommation). En cause : le gel des prestations sociales prévu initialement par le budget Lecornu-Faure, la progression du chômage et la remontée de l’inflation (visible déjà sur les prix alimentaires, qui ont recommencé à augmenter).
La prévision de croissance de 1 % du gouvernement, sur la base de laquelle le projet de loi de finances (PLF) 2026 a été élaboré, apparaît donc beaucoup trop optimiste. Selon l’OFCE, les efforts budgétaires imposés à la population vont diminuer de 0,8 point la croissance, limitant ainsi la hausse du PIB à 0,7 %[18]. La priorité donnée à « l’économie de guerre » n’entraînera pas un cercle vertueux pour l’économie car elle sera financée au moyen de coupes budgétaires (voir encadré 1).
La situation de l’emploi se dégrade en France
Après une chute prononcée fin 2024, l’emploi total a légèrement progressé au premier semestre 2025 (+ 70 000). Il est cependant reparti à la baisse au troisième trimestre. Les effectifs salariés dans les entreprises privées ont reculé de 61 000 emplois (- 112 000 sur un an). La hausse des embauches au deuxième trimestre concerne les contrats à durée déterminée (CDD), alors que les embauches en contrats à durée indéterminée (CDI) sont en repli : sur les 6,5 millions d’embauches réalisées au deuxième trimestre 2025, 84 % étaient en CDD[19]. Par ailleurs, le nombre de missions d’intérim s’est replié au deuxième trimestre, ce qui est le signe d’une nouvelle dégradation de l’emploi.
D’après la base de données du cabinet Trendeo, la France a fermé plus de sites industriels qu’elle n’en a ouverts au premier semestre 2025, avec un solde négatif de 25 sites[20] (ce solde était de – 34 au deuxième semestre 2024). C’est la première fois depuis 2016 que ce solde est négatif deux semestres consécutifs.
Entre fin 2024 et fin 2026, l’OFCE estime qu’environ 170 000 postes seraient supprimés, ce qui ferait passer le taux de chômage officiel de 7,3 % à 8,2 % (il atteint 7,7 % au troisième trimestre 2025[21]). Ce taux minimise en réalité le nombre de personnes privées d’emploi, en raison de son mode de calcul (voir encadré 2).
La productivité se redresserait mécaniquement avec la suppression de milliers de postes d’apprentis, moins qualifiés et exerçant à temps partiel – cela sous l’effet des coupes drastiques prévues dans le PLF 2026 pour les missions du ministère du Travail, qui s’élèvent à 2,3 milliards d’euros en moins, soit une baisse de 12,6 % par rapport au budget 2025. Mais les gains de productivité resteraient limités.
Encadré 1 : Que signifierait le basculement vers « l’économie de guerre » ?
Ces derniers mois ont marqué le retour des appels à « l’économie de guerre », au gré des épisodes du conflit russo-ukrainien et des sorties de Donald Trump. Un large consensus s’est ainsi formé, regroupant dirigeants politiques, chroniqueurs économiques, éditorialistes de plateaux télé et acteurs financiers. Tous vantent les mérites d’une bifurcation militaire de l’économie. Le ministre des Armées d’Emmanuel Macron de 2022 à 2025, Sébastien Lecornu, fervent défenseur de cette vision, est désormais Premier ministre.
Pourtant, cette surenchère militaire n’aura rien de bénéfique pour la grande majorité de la population et son principal effet sera d’accroître les profits de l’industrie de l’armement.
Tournant militariste antisocial
Entre 2021 et 2024, les pays de l’Union européenne (UE) ont déjà augmenté de plus de 30 % les dépenses totales allouées à la défense. C’est désormais un véritable tournant militariste qui est pris. En mars 2025, la Commission européenne annonçait un plan de 800 milliards d’euros, dont 150 milliards de facilités de prêt garanti par le budget européen, pour « réarmer l’Europe ». Cela équivaut à une hausse de 1,5 point des dépenses militaires dans le PIB européen.
Pour financer son effort de guerre, la Commission européenne autorise exceptionnellement les États membres à s’endetter. Elle consent ainsi à déroger à la fameuse « règle des 3 % » du pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui interdit aux États d’avoir un déficit public supérieur à 3 % du PIB et une dette publique supérieure à 60 % du PIB. C’est le signe d’une application à géométrie variable des règles budgétaires européennes, selon les priorités fixées par la Commission. Quand il s’agit de financer la bifurcation écologique ou d’améliorer les conditions matérielles d’existence de la population, ces règles sont présentées comme intouchables. Elles justifient les pires plans d’austérité, aux conséquences dévastatrices. Mais quand il s’agit d’armement et de défense, elles deviennent soudainement facultatives.
En France, le budget de la défense 2025 s’élève à 50,5 milliards, en hausse de 3,3 milliards par rapport à l’année précédente. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit de le porter à 67 milliards en 2030. Mais selon le ministre des Armées, pour « être à niveau », le budget doit être doublé et atteindre 90 ou 100 milliards en 2030 : cela représenterait 3,5 % du PIB, contre 2 % aujourd’hui. Dans certaines déclarations, Emmanuel Macron envisage même de porter à terme cet effort à 5 % du PIB, conformément aux injonctions de Donald Trump.
Dans le projet de budget 2026, le ministère des Armées échappe spectaculairement aux coupes budgétaires subies par la plupart des autres ministères, puisqu’il bénéficie d’une hausse de 6,7 milliards d’euros de son budget, soit une augmentation de 13,1 % par rapport au PLF 2025 et une accélération de 3,5 milliards d’euros par rapport aux évolutions déjà prévues par la loi de programmation militaire 2024-2030.
Comme il n’est pas question d’augmenter les impôts sur les ménages les plus riches et sur les grandes entreprises[22], le gouvernement prépare les esprits à une diminution massive des dépenses sociales, qui viendrait s’ajouter aux coupes historiques du budget 2025[23]. Face à la « menace existentielle » que représenterait la Russie, il s’agirait de liquider une grande partie de ce qu’il reste de nos conquis sociaux pour construire un État de guerre opérationnel.
Pourquoi le « keynésianisme de guerre » n’a pas de sens ?
Les partisans de « l’économie de guerre » défendent un supposé « keynésianisme militaire ». Selon eux, la hausse des dépenses militaires serait à l’origine d’un cercle vertueux bénéfique pour toute l’économie : la hausse de l’investissement militaire devrait accroître l’activité des entreprises, lesquelles en profiteraient pour augmenter les salaires et ainsi alimenter la consommation populaire, au profit des entreprises. Et ainsi de suite. On parle alors d’effet multiplicateur : la hausse des dépenses publiques entraîne une hausse plus que proportionnelle de la croissance.
L’effet multiplicateur des dépenses militaires est en réalité très faible[24].
1- D’abord, parce que le financement de l’économie de guerre n’est possible que grâce à une énorme ponction de l’État sur la consommation des ménages, via une forte hausse des impôts ou via des emprunts forcés. Les suppléments potentiels de revenus de la population sont donc de fait annulés par la hausse des prélèvements.
2- Ensuite, parce que l’économie de guerre ne produit pas davantage de biens d’investissement et de biens de consommation à destination de la population. Seule la production de biens militaires augmente, mais elle ne profite qu’aux corps militaires, pas aux ménages. Comme toute l’économie est dirigée vers la production d’armement, pour consommer davantage les ménages sont obligés de se tourner vers des biens importés[25]. Dans cette situation, les seuls acteurs économiques qui s’enrichissent sont les capitalistes de l’industrie de l’armement.
Encadré 2 : Quelle est la bonne mesure du chômage ?
Dans le champ politique et dans les médias, les discussions autour de l’évolution du chômage paraissent souvent confuses tant les chiffres sont parfois contradictoires et sont utilisés pour servir des récits opposés. Il y a en fait deux modes de calcul du chômage.
1- Calcul de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
L’Insee s’appuie sur la définition du chômage du Bureau international du travail (BIT), qui est commune à tous les pays et permet d’établir des comparaisons[26]. Selon cette définition, une personne âgée de plus de 15 ans est au chômage lorsqu’elle remplit les trois conditions suivantes : elle n’a pas travaillé du tout au cours du mois précédent, elle a cherché activement un emploi et elle est disponible dans les quinze jours pour occuper un poste. Si l’une de ces trois conditions n’est pas satisfaite, la personne n’est pas comptabilisée dans les chiffres du chômage.
Ainsi, une personne occupée à temps partiel qui cherche un autre emploi et qui est disponible est en situation de sous-emploi mais pas au chômage. De même, une personne qui n’a pas travaillé au cours du mois précédent, mais qui n’est pas disponible ou qui n’a pas recherché, à cause d’une maladie par exemple, est considérée comme « inactive » : on dit qu’elle se trouve dans le « halo du chômage ».
2- Calcul de France Travail, ex-Pôle emploi
France Travail recensait les demandeurs d’emplois inscrits, selon cinq catégories jusque fin 2024.
– Catégorie A : demandeurs d’emploi qui n’ont pas travaillé du tout dans le mois et recherchent activement un emploi.
– Catégorie B : demandeurs d’emploi qui ont travaillé moins de 78 heures dans le mois et recherchent activement un autre emploi.
– Catégorie C : demandeurs d’emploi qui ont travaillé plus de 78 heures dans le mois et recherchent activement un autre emploi.
– Catégories D et E : demandeurs d’emplois qui ne sont pas disponibles immédiatement – en formation, en stage, en arrêt maladie, en contrat aidé[27].
Les catégories F et G ont été ajoutées depuis janvier 2025. Elles recensent les demandeurs d’emploi qui n’étaient pas inscrits jusqu’ici, notamment des titulaires du revenu de solidarité active (RSA).
3- Que faire de ces chiffres ?
La catégorie A de France Travail utilise des paramètres proches de ceux de l’Insee. Dès lors, leurs chiffres devraient être semblables. Or, ils ne le sont plus depuis la crise de 2008. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A est en effet sans cesse plus élevé que le nombre de chômeurs de l’Insee[28] : ils sont 900 000 de plus aujourd’hui.
Pour un même trimestre, les variations du chômage observées sont même contradictoires. Par exemple, durant le Covid, au deuxième trimestre 2020, le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A s’est envolé, alors que l’Insee a enregistré une baisse du chômage. Avec le confinement, la recherche d’emploi a été interrompue : mécaniquement, le nombre de chômeurs selon la définition de l’Insee a diminué.
Même chose au quatrième trimestre 2024. France Travail a compté 116 000 demandeurs d’emploi de catégorie A en plus, contre 63 000 chômeurs en moins selon l’Insee. Et ce alors que 90 000 emplois ont été détruits. En fait, l’Insee note bien une augmentation du « halo du chômage », c’est-à-dire du nombre de personnes inactives, mais leur situation ne leur permet pas d’être comptabilisées comme chômeurs car elles ne recherchent pas assez activement ou ne sont pas tout de suite disponibles[29].
Figure 1 : Nombre de chômeurs entre 1996 et 2024 (en millions)
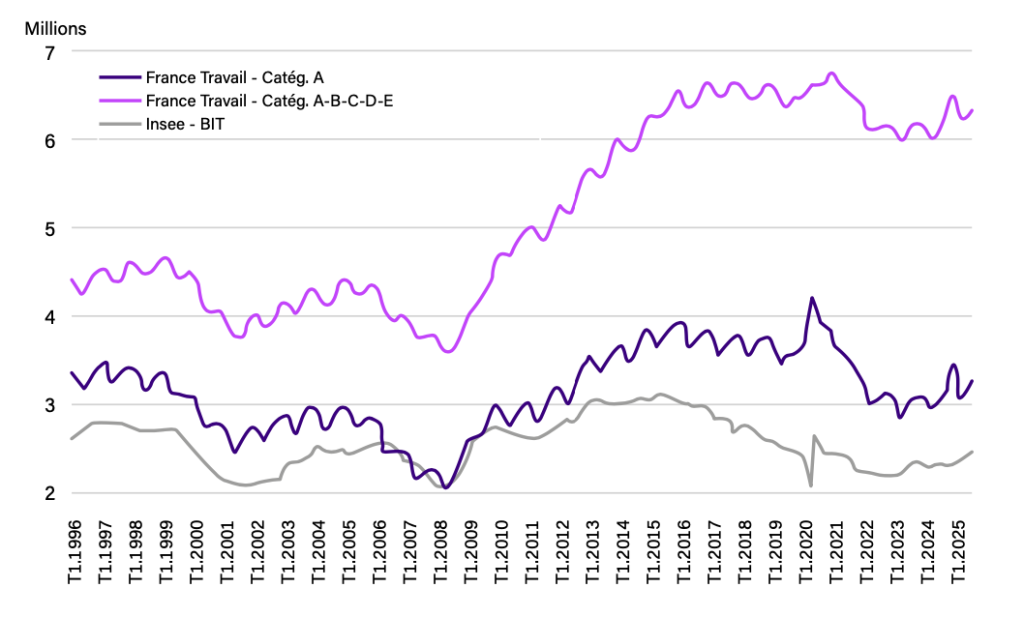
Lecture : Au premier trimestre de l’année 2024, le nombre de chômeurs selon l’Insee s’élevait à 2,3 millions, tandis que France Travail recensait 3,1 millions de demandeurs d’emploi de catégorie A et 6,2 millions de demandeurs d’emplois toutes catégories.
Le gouvernement tente de faire bonne figure avec les chiffres du chômage de l’Insee, qui excluent les « inactifs ». Malgré tout, il y a 2,4 millions de chômeurs selon l’Insee[30], ce dont on ne peut se réjouir. Et près de la moitié des créations d’emplois depuis 2019 ont été des contrats d’alternance ou des micro-entrepreneurs sous-payés[31].
Les « inactifs » sont en réalité des privés d’emploi au même titre que les chômeurs. Une part croissante d’entre eux sont des chômeurs de longue durée ou des seniors en incapacité de chercher « activement » un emploi. Si on les ajoute arithmétiquement aux chômeurs, on atteint le million de chômeurs en plus depuis 2008. C’est même 2 millions de personnes en plus depuis 2008 si l’on tient compte de toutes les catégories de demandeurs d’emploi.
FOCUS : La France est-elle surendettée ?
La dette publique hystérise les débats. Le discours néolibéral impose un chantage bien rodé : la dette est un fardeau qui pénalise notre économie et hypothèque l’avenir des générations futures (argument grossier puisque ces générations héritent des dettes, mais aussi des créances… et de tous les actifs publics qui ont été financés par la dette publique). Il n’y aurait donc pas d’alternative aux politiques d’austérité visant à la réduire à tout prix.
Des voix discordantes, qui osent avancer que la dette peut être un levier utile de la bifurcation écologique, sont discréditées.
La situation actuelle est-elle si catastrophique ? Serions-nous, comme le martelait François Bayrou devant le MEDEF le 28 août dernier, en train « d’accepter [que les jeunes] soient réduits en esclavage en les obligeant pour des décennies à rembourser les emprunts qui ont été décidés le cœur léger par les générations précédentes » ?
Afin de bien comprendre les enjeux de la dette publique, il convient de présenter ses caractéristiques et d’analyser les conditions de sa soutenabilité, ce qui permet de voir que ce sont les politiques actuelles qui plombent nos finances publiques.
La dette publique : de quoi parle-t-on ?
La dette publique désigne la dette des administrations publiques, qui comprennent :
> Les administrations publiques centrales : l’État et les organismes divers d’administration centrale (ODAC), c’est-à-dire les universités, Météo France, France Travail, les musées, etc. Elles concentrent 83 % de la dette publique totale.
> Les administrations de sécurité sociale, qui représentent 9 % de la dette publique totale.
> Les administrations publiques locales, qui pèsent 8 % de la dette publique totale.
Qui détient la dette française ?
Conséquence de la libéralisation financière et des traités européens, l’État ne peut plus s’adresser directement à la banque centrale et doit se financer en émettant des titres sur les marchés financiers.
L’État émet plusieurs types de titres de dettes, par l’intermédiaire de l’Agence France Trésor (AFT)[32] :
> Pour se financer à court terme (1 an ou moins) : des bons du Trésor à taux fixe (BTF), dont les durées les plus fréquentes sont 13, 26 ou 52 semaines.
> Pour se financer à long terme : des obligations assimilables du Trésor (OAT), dont la maturité, c’est-à-dire la date d’échéance pour le remboursement, est comprise entre 2 et 50 ans. Sur le total des OAT, environ 10 % sont indexées sur l’inflation (ce sont des OATi).
Au deuxième trimestre 2025, la dette publique[33] s’établit à 3 416,3 milliards d’euros, soit 115,6 % du PIB.
55,4 % de la dette publique française est détenue par des non-résidents. C’est plus que nos voisins européens allemands ou italiens et près de deux fois plus qu’aux États-Unis ou au Canada. 9,8 % de la dette est détenue par des compagnies d’assurances françaises ; 10,3 % par des établissements de crédit français ; 1,7 % par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français – qui regroupent les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement communs (FCP) ; 23,1 % par d’autres détenteurs français (en particulier la Banque de France).
À quelles conditions la dette publique est-elle soutenable ?
Voir en annexe la démonstration arithmétique
Dans les médias, on répète à longueur de journée, pour effrayer la population, que la dette publique atteint 114 % du PIB. Sauf qu’en réalité, ce chiffre pris en lui seul ne signifie pas mécaniquement que la situation est grave.
Deux éléments sont à prendre en considération pour voir si la dette publique est soutenable – ce que l’on mesure habituellement, même si c’est critiquable, à partir du ratio dette publique/PIB[34].
Le premier élément est la différence qui existe entre d’un côté le taux d’intérêt apparent sur la dette, c’est-à-dire le taux d’intérêt moyen auquel un État emprunte de l’argent sur les marchés, et de l’autre le taux de croissance de l’économie, c’est-à-dire le rythme d’augmentation du produit intérieur brut (PIB). Si le taux d’intérêt à rembourser est inférieur au taux de croissance, alors le poids de la dette diminue. Inversement, si le taux d’intérêt est plus élevé que le rythme d’augmentation du PIB, alors le ratio dette/PIB augmente. On parle alors d’un effet « boule de neige » : le poids de la dette s’accroît. Il faut donc surveiller l’évolution des taux d’intérêt mais également la mettre en relation avec l’évolution de la croissance, tout en tenant compte de l’inflation (qui représente une perte de valeur de la monnaie et réduit mécaniquement le coût réel de chaque euro emprunté). On utilise pour cela le taux de croissance en valeur, qui intègre l’effet de l’inflation.
Le second élément qui pèse sur la soutenabilité de la dette publique est le solde primaire, c’est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses publiques, hors paiement des intérêts sur la dette. Lorsque le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance de l’économie, alors un excédent budgétaire (lorsque les recettes excèdent les dépenses) est nécessaire pour stabiliser le poids de la dette. Mais à l’inverse, si le taux d’intérêt reste inférieur au taux de croissance, un déficit budgétaire (lorsque les dépenses excèdent les recettes) peut être compatible avec la stabilisation de la dette publique
Toutes choses égales par ailleurs, la hausse des taux d’intérêt accroît donc le poids de la dette. À l’inverse, un taux d’inflation plus élevé, un taux de croissance en hausse ou une amélioration du solde primaire diminuent le poids de la dette. C’est donc l’évolution de ces variables qu’il convient de surveiller pour s’assurer que la dette est soutenable[35].
La figure 2 montre que l’effet « boule de neige » a été bien présent de la seconde moitié des années 1980 jusqu’à la crise des subprimes : sur cette période, le taux d’intérêt auquel l’État empruntait sur les marchés était supérieur au taux de croissance du pays, ce qui a en conséquence accru le poids de la dette. La situation s’est avérée beaucoup plus favorable à la réduction du poids de la dette publique depuis la seconde moitié des années 2010, sans que cela se traduise par une baisse effective du ratio dette publique/PIB.
Figure 2 : Croissance du PIB en valeur et taux d’intérêt apparent sur la dette publique, en pourcentage
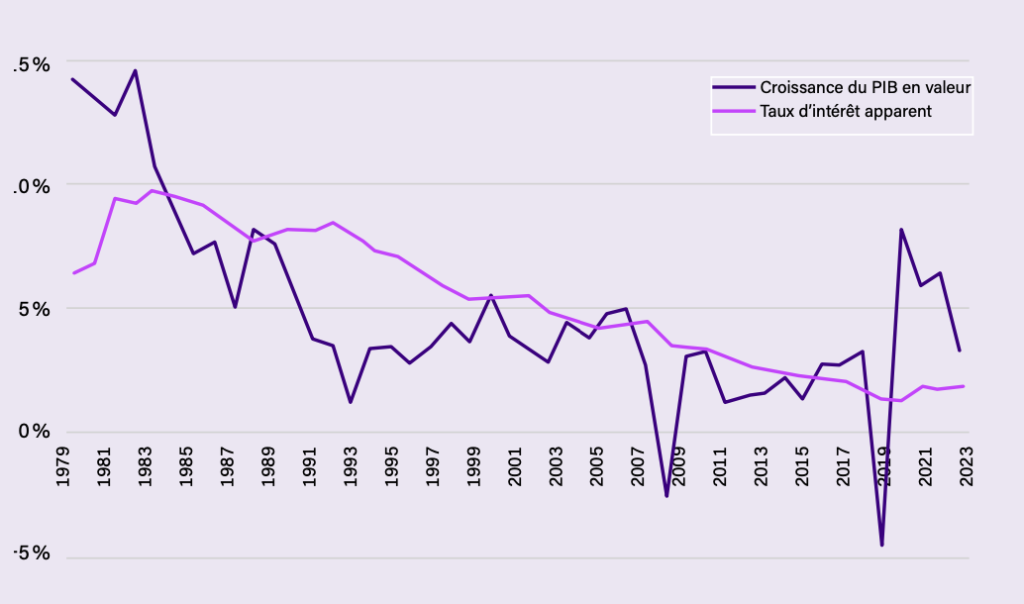
Lecture : en 1993, le taux d’intérêt apparent sur la dette s’élève à 8 %. La même année, la croissance du PIB était de 3,5 %, contre 2 % en 2024.
La raison principale est que, sur la même période, et même depuis le début des années 2000, la France enregistre des déficits primaires. Ceux-ci se sont particulièrement creusés en raison de la crise financière de 2007-2008 et de la crise Covid bien sûr, mais aussi plus récemment, à cause des politiques menées par Emmanuel Macron, qui assèchent les recettes fiscales et freinent l’activité économique (voir figure 3).
Figure 3 : Déficit public et solde primaire (en pourcentage du PIB)

Lecture : en 2000, le déficit public représente 1,7 % du PIB. La même année, le solde primaire est positif et représente un peu moins de 2 % du PIB.
En utilisant de nouvelles séries historiques, on constate que le poids de la dette publique française est loin des niveaux records atteints dans le passé (voir figure 4)[36]. On note aussi que, pour la période récente, c’est depuis la mise en œuvre de la libéralisation financière que le poids de la dette augmente : le ratio dette publique/PIB était ainsi de 20 % en 1980, quand l’État se finançait essentiellement hors marché.
Figure 4 : Évolution de la dette publique française depuis 1815 (en pourcentage du PIB)
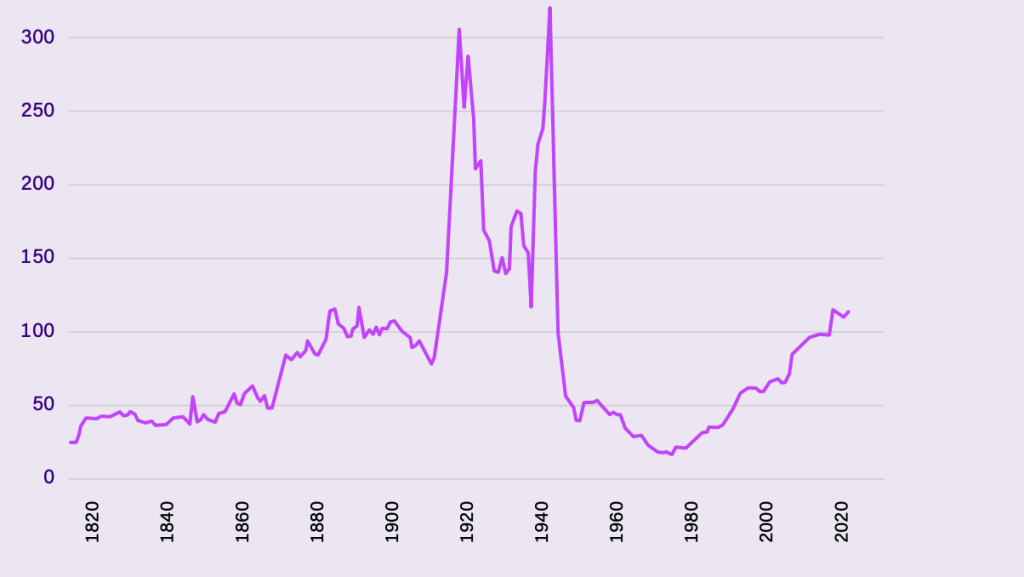
Lecture : la dette publique représente 306 % du PIB en 1919.
La charge de la dette[37] se situe quant à elle à des niveaux historiquement bas aujourd’hui (voir figure 5).
Figure 5 : Évolution de la charge de la dette publique depuis 1815 (en pourcentage des dépenses publiques)
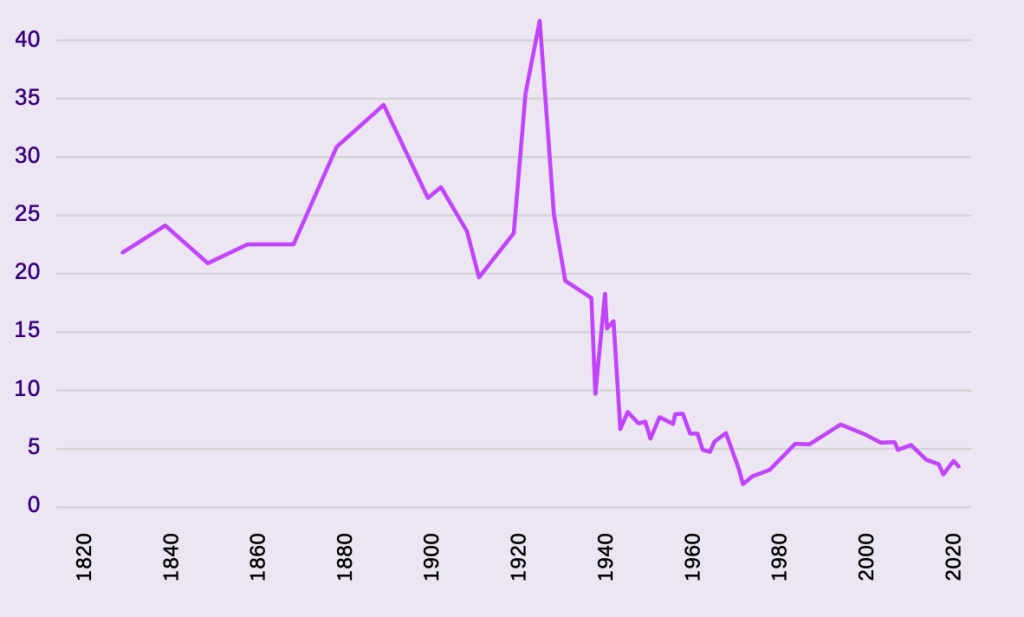
Lecture : en 1926, la charge de la dette représente 42 % des dépenses publiques totales.
Comme le montrent les figures 4 et 5, il n’y a pas de corrélation entre l’évolution du stock de la dette et celle de la charge de la dette. La hausse de l’un n’entraîne pas forcément la hausse de l’autre. Au contraire, de 2010 à 2020, la charge d’intérêt a baissé de 20 milliards d’euros alors que la dette a augmenté de 770 milliards d’euros de fin 2009 à fin 2019.
Depuis 2021, la charge de la dette est certes repartie à la hausse. En 2024, l’État a payé 58,4 milliards d’euros de taux d’intérêt à ses créanciers, soit 2 % du PIB annuel, contre 38,1 milliards d’euros, soit 1,5 % du PIB en 2021[38]. Cette hausse importante s’explique très largement par le choix fait par l’État d’émettre un nombre croissant de titres de dette publique indexés sur l’inflation (des OATi). Comme l’inflation a explosé entre 2022 et 2024, les OATi ont causé un surcoût de 13,5 milliards d’euros de remboursement d’intérêts. Si l’État avait émis des titres à taux fixes plutôt que ces OATi, la hausse de la charge de la dette aurait été entre cinq et six fois moins importante, soit de l’ordre de 2,5 milliards d’euros seulement. Cette tendance à la hausse de la charge de la dette devrait se poursuivre en 2026, pour atteindre 74 milliards d’euros, représentant 2,4 % du PIB[39].
Si l’on se place dans une perspective longue, la période actuelle est celle d’une combinaison inédite entre une charge de la dette faible et une dette publique élevée, ce qui invalide l’idée que la France serait actuellement sur une trajectoire de dette insoutenable. La France a bien connu en 1926 un moment où elle s’est rapprochée le plus d’une crise de la dette publique, même si elle n’a pas fait officiellement défaut. Cette année-là, la charge de la dette atteignait un pic, à 42 % des dépenses publiques totales. Nous en sommes loin actuellement puisque le niveau du service de la dette aujourd’hui est d’environ 3 % des dépenses publiques[40].
Nous ne sommes donc pas sur le point de basculer dans un scénario à la grecque ni à la veille de voir la mise sous tutelle de l’économie française par le Fonds Monétaire International (FMI). La Grèce, en 2015, n’avait plus accès au financement sur les marchés financiers. La dette publique française reste encore attractive : pour chaque échéance d’émission, il y a entre 2 et 3 fois plus de demandes sur les marchés financiers que de titres de dette émis par l’État. Les titres de dette français sont encore parmi les plus sûrs et les plus demandés.
Cela ne signifie cependant pas qu’il n’y a pas actuellement un problème. Mais plutôt que celui-ci est dû aux politiques des gouvernements successifs d’Emmanuel Macron.
La droite affirme lutter contre la dette tout en la creusant beaucoup plus que la gauche
L’État dispose de deux instruments pour financer ses politiques publiques : les prélèvements obligatoires et l’emprunt. Il y a, dans une certaine mesure, un arbitrage à faire entre ces deux formes de financement. Financer l’État par les prélèvements obligatoires (via l’impôt ou les cotisations sociales) suppose que chacun soit mis à contribution. Financer l’État par l’endettement permet aux créanciers de celui-ci, donc aux agents économiques les plus fortunés (entreprises ou ménages), d’être rémunérés pour leur contribution. Dans le premier cas, cela coûte à tout le monde. Dans le second, cela apporte des revenus aux créanciers. D’où la volonté souvent affichée des classes sociales les plus aisées de réduire les impôts et cotisations sociales : de leur point de vue, il vaut mieux financer l’État à l’aide de titres de dette sur lesquels elles peuvent percevoir une rémunération qui, quoique faible ces dernières années, demeure relativement sûre, plutôt que d’être taxées.
Emprunter aux riches plutôt que les taxer, c’est le choix politique qui a été fait ces dernières années, tant du point de vue de la gestion de la dette publique que de la structuration du système fiscal. Ainsi, la situation actuelle est largement due aux décisions prises par les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron. Celles-ci ont conduit à réduire la progressivité du système fiscal, voire à supprimer certains impôts touchant spécifiquement les classes sociales les plus favorisées, comme l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)[41] qui a été transformé en un impôt sur la fortune immobilière (IFI), et à privilégier le recours à l’emprunt. Outre que cela accroît les inégalités, c’est le pouvoir des créanciers qui se trouve ainsi renforcé, faisant de la dette un potentiel outil de domination, surtout lorsque les créanciers sont des non-résidents (voir figure 6).
Figure 6 : Évolution du déficit public entre 1988 et 2024 (en pourcentage du PIB)
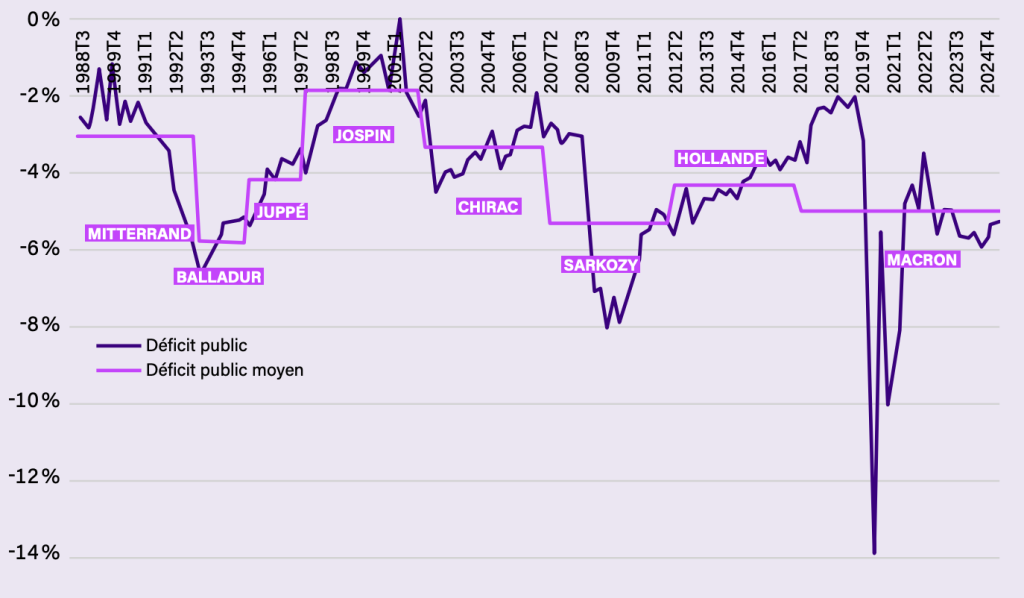
Lecture : au deuxième trimestre de l’année 2002, sous le gouvernement de Lionel Jospin, le déficit public représente 2 % du PIB. Au quatrième trimestre de l’année 2024, sous la présidence d’Emmanuel Macron, le déficit public atteint 5,6 % du PIB.
Ainsi, et contrairement à ce qui est très souvent avancé, ce sont bien les gouvernements de droite qui, en s’inscrivant ouvertement dans une logique néolibérale de baisse de la fiscalité, creusent le déficit public.
Plutôt que de taxer les classes sociales les plus aisées et les grandes entreprises, les gouvernements de droite les favorisent deux fois : une fois par la baisse de leur fiscalité ; une autre fois en s’endettant auprès d’elles.
Certes, les gouvernements de droite ont parfois eu affaire à des crises : crise économique en 1993, crise des subprimes en 2008, crise du Covid en 2020. Mais ces crises n’expliquent que la moitié environ de la hausse de l’endettement[42]. Cette tendance des gouvernements de droite à plus creuser la dette publique (et donc les déficits publics) est d’ailleurs confirmée au niveau international[43].
Financer la bifurcation écologique de nos économies suppose d’investir des centaines de milliards d’euros, ce que le secteur privé seul n’est pas en mesure de faire. Au vu des montants en jeu, il peut être compliqué de jouer uniquement sur les recettes fiscales, et le recours à l’endettement n’est pas à exclure. Mais il doit être minimisé et restreint au financement des investissements massifs qui préparent l’avenir.
La politique actuelle hypothèque l’avenir
La France a bénéficié pendant une partie des années 2010 et jusqu’au début des années 2020 de taux d’intérêt réels négatifs : l’État remboursait moins qu’il n’empruntait. Il aurait fallu en profiter pour diriger l’endettement vers des programmes d’investissement public, dans la bifurcation écologique mais aussi dans la reconstruction des services publics malmenés par les politiques néolibérales.
Les gouvernements d’Emmanuel Macron ont plutôt choisi d’intensifier des politiques d’offre[44] reposant sur la baisse des coûts de production, dont les conséquences ont été de comprimer la demande, ce qui a eu un effet négatif sur l’investissement. Les politiques menées par les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron ont ainsi miné la croissance tout en engendrant une crise politique aiguë (piétinement de l’esprit de nos institutions par le recours répété et abusif au « 49.3 »[45], exercice solitaire et monarchique du pouvoir, criminalisation des mouvements sociaux, refus de reconnaître la victoire du Nouveau Front populaire (NFP) lors des élections législatives de 2024, etc.). Il en résulte une instabilité croissante et beaucoup d’incertitudes, ce qui est particulièrement néfaste pour l’activité économique.
C’est précisément en raison du climat social conflictuel que l’agence de notation Fitch Ratings avait dégradé la note de la France en avril 2023[46], et qu’elle l’a à nouveau dégradée le 12 septembre 2025[47]. Le résultat de tout cela est une perte de confiance dans les capacités de l’économie française, qui explique la remontée des taux d’intérêt sur la dette. S’ajoute à cela l’effet de la politique de la Banque centrale européenne (BCE) qui a participé à la hausse des taux d’intérêt afin de lutter contre l’inflation[48], entraînant ainsi un ralentissement économique. La situation pourrait de ce fait devenir inquiétante si les orientations actuelles en matière de politiques économiques persistaient.
Aujourd’hui, le taux d’intérêt des OAT à 10 ans est de 3,38 % (20 octobre 2025), tandis que le taux d’inflation est égal à 1 % (juillet 2025) et le taux de croissance prévu pour 2025 est de 0,7 %. Nous sommes donc revenus à une situation où le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance. Dans le même temps, le déficit primaire est d’environ 120 milliards d’euros.
Les dérapages récents des finances publiques sont essentiellement le fruit des choix politiques d’Emmanuel Macron dès son arrivée au pouvoir en 2017, en particulier celui de réduire les recettes fiscales (voir figure 7). La Cour des comptes estime à près de 40 milliards d’euros la baisse des prélèvements obligatoires pour les années 2018-2019, auxquels s’ajoutent 25 milliards d’euros entre 2019 et 2021[49]. C’est donc pas moins d’une soixantaine de milliards sur la période qui ont été accordés sous forme de cadeaux fiscaux, sans que cela n’ait d’impact sur la croissance. En 2022, la Cour soulignait « la nécessité de préserver les recettes des administrations publiques ». Cette petite phrase, issue du même rapport, indique qu’il faut cesser les baisses d’impôts. Voilà des pistes pour réduire le déficit public !
Figure 7 : Évolution des recettes et des dépenses publiques (en pourcentage du PIB)
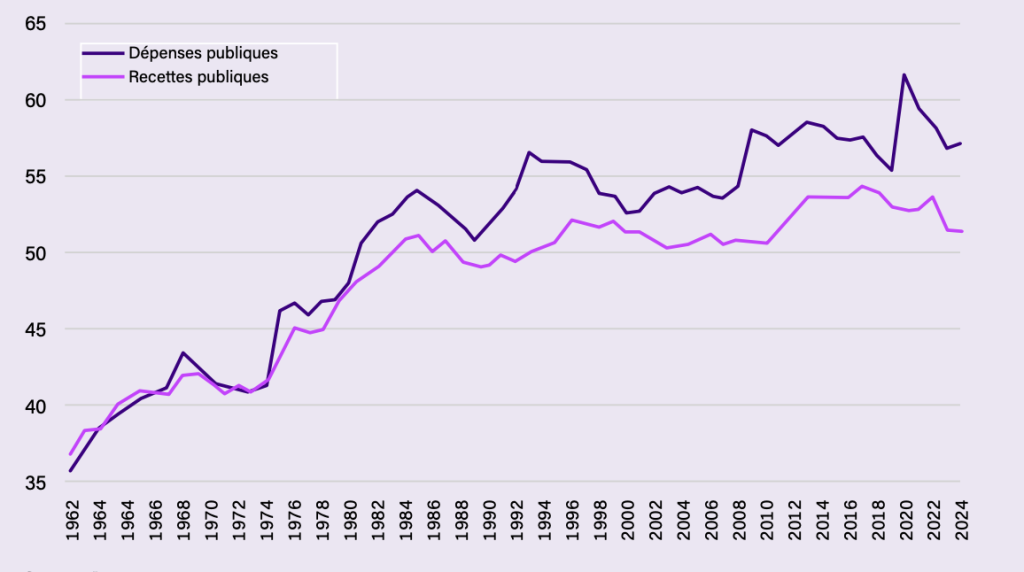
Lecture : en 2024, les dépenses publiques représentent l’équivalent de 57 % du PIB. La même année, les recettes publiques équivalent à 52 % du PIB.
Face à la situation dégradée de nos finances publiques, le Conseil d’analyse économique (CAE) chiffre, dans une note parue en octobre 2025[50], les pistes qui permettraient de réduire le déficit public, que ce soit par la hausse des recettes fiscales, par la baisse des dépenses publiques ou par celle des dépenses fiscales[51].
Du côté des recettes et des dépenses fiscales, le CAE propose un catalogue de mesures permettant d’augmenter les recettes de l’État de 111,4 milliards d’euros. Parmi elles, l’augmentation du taux de prélèvement forfaitaire unique (PFU)[52] de 30 % à 33 % (+ 1,2 milliards d’euros) ; la hausse d’un point du taux de l’impôt pour chaque tranche, sauf celle à 0 % (+ 6,8 milliards d’euros) ; la restauration de la taxe d’habitation sur les résidences principales (+ 21,8 milliards d’euros) ; la suppression ou la révision des dispositifs d’allègement de la taxation de l’héritage (+ 8,0 milliards d’euros) ; ou encore la suppression du taux de TVA réduit dans la restauration (+ 4,2 milliards d’euros).
Du côté des dépenses, le CAE chiffre les mesures d’économies possibles à 108 milliards d’euros d’ici 2030. Cela comprend notamment la diminution des subventions à l’enseignement privé de 75 % à 50 % (3,5 milliards d’euros) ; le gel de l’indexation des retraites de base sur l’inflation (2,6 milliards d’euros en 2026) ; la hausse du délai de carence dans la fonction publique à 3 jours (0,3 milliards d’euros) ; la suppression de 11 000 postes dans la fonction publique d’État et de 19 000 postes dans la fonction publique territoriale (0,7 milliards d’euros en 2026) ; ou encore le gel en volume du budget général de l’État hors charge de la dette (7,2 milliards d’euros en 2026).
Si la plupart des pistes de réduction de dépenses pénalisent les classes populaires et moyennes, les marges de manœuvre semblent plus importantes du côté des recettes. Dans le budget présenté par Sébastien Lecornu, l’effort structurel[53] (environ 31 milliards d’euros) porte pourtant plus sur les dépenses (17 milliards d’euros) que sur les recettes (14 milliards d’euros). L’effort de réduction du déficit et de la dette publics ne doit pas être trop brutal, faute de quoi il aura des effets récessifs importants qui viendront frapper les entreprises (à travers leur investissement) et les ménages (dont la consommation va être impactée). Si l’État est endetté, c’est qu’il y a des créanciers (entreprises et ménages). Les dettes des uns sont donc les créances des autres. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, qu’il faut laisser filer la dette.
Mais il y a d’autres moyens, de contrôler le poids de la dette. Par exemple, bâtir un pôle public bancaire permettrait à l’État, en obligeant les banques publiques à détenir un certain montant de dette publique, de s’affranchir au moins en partie de la domination des marchés financiers tout en limitant la hausse du coût de ce financement. Engager une politique d’investissement public offrirait, du fait de la hausse pérenne et prévisible de la commande publique, plus de visibilité et de stabilité aux entreprises privées. Leur confiance serait ainsi restaurée, ce qui est indispensable pour qu’à leur tour elles se mettent à investir et à embaucher, enclenchant ainsi un cercle économique vertueux. Bien évidemment une telle politique doit privilégier les productions non délocalisables afin de limiter les « fuites » vers les importations.
Le problème aujourd’hui est que l’endettement ne sert pas principalement à financer l’investissement productif, donc la création de richesses. Il finance au contraire largement les cadeaux fiscaux faits depuis 2017, essentiellement aux grandes entreprises et aux ménages les plus aisés, cadeaux qui plombent les finances publiques. Cet endettement-là est dangereux car il n’est pas créateur de richesses.
Conclusion
Le ralentissement de l’économie amorcé depuis des mois se poursuit. L’économie mondiale est en panne. Les menaces qui pèsent sur elle s’accumulent dangereusement : risques d’effondrement financier avec la bulle spéculative de l’IA, progression de l’inflation, cure d’austérité… La perspective d’une récession se renforce peu à peu.
Le capitalisme est en proie à une crise structurelle de faiblesse des gains de productivité. Rien n’y fait, ni la diminution des salaires réels des travailleurs ni la baisse de la fiscalité dont les entreprises ont bénéficié : le taux de marge des entreprises baisse.
Tous les moteurs de la croissance sont défaillants. L’investissement des entreprises est en berne. L’investissement public baisse. La consommation des ménages est atone et se trouve durablement menacée par l’austérité. Le retour du chômage de masse est à craindre.
Face au mur, les néolibéraux persistent et signent. La politique de l’offre, pourtant à l’origine du marasme actuel, est poursuivie avec acharnement. L’ambition du projet de budget en cours de discussion est claire : protéger à tout prix les hauts patrimoines et les grandes entreprises de la fiscalité, et financer les cadeaux qui leur sont faits par des coupes budgétaires dans la santé, la protection sociale et la bifurcation écologique.
Les mêmes causes produiront naturellement les mêmes effets : le budget Lecornu-Faure risque de diviser la croissance par deux.
L’économie de guerre que les néolibéraux appellent de leurs vœux ne fera pas office de remède. L’augmentation de la production militaire n’aura pas d’effet d’entraînement sur les salaires, la consommation et l’emploi. C’est un leurre. En réalité, seuls les profits des pires va-t-en-guerre de l’industrie militaire en bénéficieront.
Dans ce contexte, le chantage à la dette bat son plein. Au nom du bon sens économique, une offensive sans précédent se prépare contre la protection sociale et l’accès aux soins. Mais personne n’est dupe. La France n’est pas au bord de la faillite. Les taux d’intérêt sur la dette restent à un niveau historiquement bas et la dette publique française demeure très attractive. La France est en réalité victime d’une méthode absurde : la financiarisation de la dette et des États et le règne des agences de notation. Plutôt que de faire contribuer les plus riches à son financement, l’État s’endette auprès d’eux sur les marchés financiers. La spirale austéritaire s’enclenche alors : en voulant réduire les dépenses, l’État aggrave la dette car il dégrade la croissance et se prive de recettes.
Annexe : arithmétique de la dette publique[54]
Deux éléments sont à prendre en considération pour voir si la dette publique est soutenable (ce que l’on mesure habituellement, même si c’est critiquable[55], à partir du ratio dette publique/PIB) : le premier est la différence qui existe entre le taux d’intérêt apparent sur la dette r et le taux de croissance en valeur g ; le second est le solde public primaire[56].
Le taux d’intérêt apparent sur la dette représente le taux d’intérêt moyen sur la dette. Il est mesuré en divisant la charge d’intérêt sur la dette de l’année t par l’encours de la dette (c’est-à-dire le stock de la dette) en fin d’année t – 1. Le taux de croissance en valeur (ou nominal) prend en compte l’augmentation des prix, c’est-à-dire l’inflation[57].
La différence r – g peut donc être mesurée de deux façons différentes : soit en retranchant le taux de croissance en valeur au taux d’intérêt apparent nominal ; soit en retranchant le taux de croissance en volume au taux d’intérêt apparent réel[58]. Le taux d’inflation a donc un impact sur la valeur de r – g : toutes choses égales par ailleurs, l’inflation réduit le poids de la dette.
Lorsque le taux d’intérêt sur la dette publique est supérieur au taux de croissance du PIB, alors le ratio dette/PIB augmente. On parle d’un effet « boule de neige » : le poids de la dette s’accroît. Trois éléments jouent jouent donc potentiellement sur la valeur de r – g : le taux d’intérêt apparent ; le taux de croissance ; le taux d’inflation. La hausse du taux d’intérêt apparent favorise l’effet « boule de neige », donc l’accroissement du poids de la dette ; la hausse du taux de croissance et celle du taux d’inflation réduisent au contraire le poids de la dette.
À partir de ces variables – taux de croissance du PIB, taux d’intérêt et montant de la dette accumulée –, il est possible de calculer le solde public qui permet de stabiliser le poids de la dette publique. Lorsque le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance de l’économie, alors un excédent budgétaire est nécessaire pour stabiliser le poids de la dette. Mais à l’inverse, si le taux d’intérêt reste inférieur au taux de croissance, un déficit budgétaire peut être compatible avec la stabilisation de la dette publique.
L’évolution du ratio dette/PIB est décrite par la relation suivante :
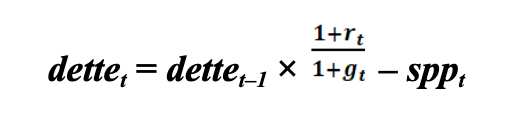
• dettet = dette publique en % du PIB à la fin de l’année t ;
• rt = taux d’intérêt apparent sur la dette ;
• gt = croissance en valeur du PIB l’année t par rapport à t–1 ;
• sppt = solde public primaire en % du PIB l’année t.
L’évolution du ratio dette/PIB peut être approximée par :
dettet – dettet –1 ≈ dettet–1 × (rt– gt) – sppt
dettet–1 × (rt – gt) représente l’effet « boule de neige », c’est-à-dire l’effet du ratio de dette de l’année précédente sur le ratio de l’année en cours à travers le paiement des intérêts et le taux de croissance. Cet effet est positif, quand r > g, ou négatif dans le cas contraire.
Il est alors possible de calculer le solde primaire stabilisant le taux d’endettement (sppstabt) :
sppstabt = dettet–1 × (rt – gt)
Ce solde est positif si r > g, négatif si r < g et nul si r = g. Il dépend aussi du niveau initial de dette. Plus celui-ci est élevé, plus le solde public primaire qui stabilise la dette sera élevé en valeur absolue (il faudra alors un fort excédent si r > g, à l’inverse un déficit primaire plus important pourra être toléré si r < g). Si le déficit primaire en t est plus important que le déficit primaire stabilisant, donc si sppt < sppstabt, alors le poids de la dette augmente même si r < g.
25.11.2025 à 17:08
Pour une stratégie spatiale au service de l’intérêt général
Texte intégral (14340 mots)
Un autre spatial est possible !
Jean-Luc Mélenchon
Dans l’espace infini, nouvelle frontière de l’humanité franchie avec Gagarine quand il s’y est aventuré, qui gouverne ? Des guerriers ou des savants ? Des envahisseurs du commun ou des explorateurs désintéressés ? La France, première puissance spatiale européenne, est directement impliquée dans ces alternatives.
La France est le berceau d’Ariane, la fusée française qui s’envole depuis sa base à Kourou. C’est la patrie du CNES, l’agence organisatrice autrefois figure de modèle à suivre pour nos voisins. Elle abrite le siège de l’agence européenne de l’espace (ESA), dont elle fut la première contributrice. Elle accueille les plus grandes industries du spatial européen. De là viennent chaque jour des merveilles d’innovation. Et celles-ci sont devenues aujourd’hui indispensables aux connexions du quotidien et aux savoirs de l’humanité.
L’espace est l’un des centres de la noosphère, ce savoir global numérisé qui lie les humains entre eux. Il commande le système global des connexions entre chacun. Si l’espace est ainsi constitué de manière très matérielle par les satellites de toutes sortes qui en font une proche banlieue terrestre, il n’abandonne jamais sa puissance évocatrice des horizons du rêve, de la spiritualité du vide infini, de l’imagination, des histoires et de la contemplation qu’il inspire. Son exploration aura permis les grandes découvertes et les avancées scientifiques qui sont passées un jour par lui. L’espace est un liant de l’humanité.
Comme tant de fois dans son histoire, et comme dans tous les enjeux qui l’habitent et la traversent, la France est à la croisée des chemins.
À droite, le grand capital, monstre de prédation qui prétend pouvoir accaparer le commun, pour nuls autres besoins que les siens ; qui s’autoalimente salement, en déversant sur son passage des millions de débris spatiaux au-dessus de nos têtes. À gauche, la préservation. Les réflexions et les pensées humaines s’étendent dans l’immensité du ciel et de l’espace. La nuit, les étoiles, l’infini du mystère par-dessus les regards les plus lointains de l’humanité invitent à la prospective, à la production d’utopies de futurs désirables.
La France a été l’une des premières en Europe à y réfléchir. Par le Traité sur l’espace de 1967, elle fait partie de ceux qui ont décidé que l’espace, l’infini, la nuit, les astres et les étoiles étaient un bien commun de notre humanité. Que nul ne pouvait se prévaloir de leur accaparement. En signant le Traité sur la Lune (1979), la France a au moins émis la volonté de participer à l’effort de préservation de l’espace des prédations marchandes et envahisseuses. Mais c’est en choisissant de ne pas le ratifier ensuite qu’elle aura commis une lourde erreur.
Car aujourd’hui l’espace est saturé par les marchands et les capitalistes avides de profits à court terme. Par les prédations marchandes, Starlink en tête, et son dirigeant aux saluts nazis, et par ceux qui souhaitent y faire la guerre, en y déployant leur arsenal de défense. La France doit donc choisir. Va-t-elle laisser les capitalistes dominer l’orbite terrestre basse jusqu’à ce qu’un accident détruise l’ensemble de nos secteurs stratégiques, brouille nos communications, et anéantisse définitivement ce que l’humanité a mis des décennies à construire ? Ou va-t-elle porter une autre voix ? Celle du bien commun et des usages pacifiques de l’espace. Celle de la science, des recherches sur le climat, celles des communications entre les êtres humains, celles d’un élargissement des possibles pour l’humanité, plutôt que sa destruction assurée.
À l’heure où les États-Unis d’Amérique coupent le budget de la NASA, à l’heure où l’Afrique se dote d’une agence spatiale, où la Chine envoie ses mégaconstellations dans l’espace et renouvelle tous les six mois l’équipage de sa station spatiale, où l’OTAN autoritaire enjoint les pays de l’Alliance à quintupler leur budget de défense aérienne, il était plus que temps que la France se dote d’une réelle stratégie spatiale nationale.
La pensée critique est porteuse de propositions sur ce sujet. Planifier planifier planifier, et gouverner par les besoins : voilà la proposition qu’elle fait. Parce que les conditions d’habitabilité de notre planète en dépendent, parce que le spatial, bien commun largement inexploré, est attaqué par les forces libérales de la guerre et de la prédation, il est du devoir de la société et de son gouvernement de l’en protéger, modestement, mais avec ambition.
La stratégie spatiale proposée ici présentera réflexions, analyses et perspectives pour cette « nouvelle frontière », dont j’ai proposé le principe dans ma campagne présidentielle de 2017. Elle est là pour guider les actions, pour s’adapter aux prochains défis et la prochaine sera écologique du fait du nombre de débris, pour préparer les futures découvertes scientifiques. Elle est là pour protéger, parce qu’il faut s’armer pour désarmer, et parce que la dissuasion du futur sera spatiale. Elle repense l’architecture institutionnelle, pour que ce bien soit réellement commun et que l’intelligence de tout un peuple puisse, par la démocratie, déjouer les tentatives de prédation des milliardaires ou des gouvernements qui voudraient se l’accaparer. Enfin, elle dresse une stratégie diplomatique, s’éloignant des injonctions de l’OTAN, et obligations des États-Unis, ouvre la voie à d’autres alliances, à d’autres coopérations toujours dressées pour la préservation du bien commun, le gouvernement par les besoins, le non accaparement des richesses, l’extension de la science, et la mise en commun de la recherche.
Un autre spatial est possible !
Le spatial français : se ressaisir ou disparaître

Avant sa démission, le gouvernement Bayrou avait annoncé, le 6 mars 2025, le lancement d’une mission visant à définir une « stratégie spatiale nationale ». Cette mission a été confiée au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) et non pas au Centre national d’études spatiales (CNES) ou aux acteurs traditionnels de la politique spatiale. Ses conclusions devaient être présentées à l’occasion du salon du Bourget en juin 2025. Le président de la République l’a finalement exposée le 12 novembre 2025. De nouveau transparaissent l’inertie et le manque d’inspiration des artisans de cette stratégie. L’objectif affiché était pourtant de donner à la France les moyens et les fins de « rester une puissance de premier rang mondial » à horizon 2040. Un effort avait déjà été consenti dans le domaine du spatial de défense, par la formulation d’une doctrine en 2019, la « stratégie spatiale de défense », qui se voulait une réplique de celle des États-Unis d’Amérique. Pour autant, une vision globale, articulée et ambitieuse fait toujours défaut depuis 2017.
Ni fait ni à faire : la sortie de la stratégie spatiale nationale du 12 novembre 2025
Le 12 novembre 2025, Emmanuel Macron a enfin dévoilé sa stratégie spatiale nationale. Cette stratégie s’avère plus politique que stratégique. Le document annonce un effort budgétaire très limité, à 4,2 milliards d’euros, portant le budget spatial pour 2024-2030 à seulement 10,2 milliards. À titre de comparaison, l’Allemagne a annoncé vouloir consacrer 35 milliards d’euros sur la même période, soit un budget plus de trois fois supérieur.
La présentation de cette stratégie lors de l’inauguration du Commandement de l’Espace constitue une nouvelle démonstration de la volonté d’Emmanuel Macron de ne lier les politiques spatiales qu’aux questions de défense.
Par ailleurs, le Président renforce l’arrimage de notre stratégie spatiale à l’Allemagne. Comme dans beaucoup de domaines, Emmanuel Macron conçoit la souveraineté française uniquement dans le cadre franco-allemand. La stratégie publiée impose explicitement de « travailler à la convergence intra-européenne – notamment entre la France, l’Allemagne et l’Italie – à travers une nouvelle répartition des compétences et des technologies spatiales ». Hors Europe, la « stratégie spatiale » du Président est très peu diversifiée. Rien sur le continent africain ou l’Amérique du Sud, ou les « puissances émergentes ». Le CNES est cité comme organisateur, mais sans vision claire de ses missions, de la planification, de la hiérarchie des besoins.
1. Comment en est-on arrivé là ?
1.1. Un bilan accablant des gouvernements successifs
La situation actuelle et le déclin de la France dans l’aérospatial sont inexorablement liés aux politiques menées par les gouvernements du PS et par ceux d’Emmanuel Macron.
L’exemple d’Ariane 6 est particulièrement parlant. Les tergiversations sur l’après-Ariane 5 au tournant des années 2010 ont accouché du choix de privatiser le programme Ariane 6. Cette erreur stratégique et industrielle aboutira à quatre années de retard dans le développement, la construction et finalement le tir inaugural du lanceur en juillet 2024. À l’automne 2025 et Ariane 6 n’a été tiré que trois fois. La décision de Manuel Valls et celles des gouvernements d’Emmanuel Macron, laissant la part belle au privé et sous-investissant largement dans le segment des lanceurs, aura mené à une rupture temporaire de l’accès souverain de la France à l’espace. En effet, deux satellites de la constellation européenne Galileo ont ainsi été tirés en avril 2024 par SpaceX depuis Cap Canaveral en Floride. Ces quatre années de retard pèsent lourd dans un contexte de concurrence féroce livrée notamment par SpaceX.
Plusieurs exemples récents viennent étayer cette démonstration. Le plan France 2030 a doté le spatial d’1,5 milliard d’euros de financements publics. Il n’aura pas été question de flécher les financements en fonction des besoins, mais de saupoudrer l’argent public dans divers projets, répondant à des appels d’offres édictés sans stratégie définie, promettant de rattraper le retard.
Résultat : la stratégie d’ensemble du plan France 2030 a été questionnée, comme en ce qui concerne les projets de mini-lanceurs. Un bilan critique de la promotion et du financement public des secteurs se revendiquant du « New Space », dont les résultats et retombées relèvent pour l’essentiel de l’économie de la promesse et de la spéculation semble nécessaire à mener. Il faudrait par ailleurs planifier le secteur spatial en mettant l’accent sur la bifurcation écologique et industrielle.
La France, tous gouvernements confondus, n’a cessé d’approfondir cette déconvenue. La création de la coentreprise Airbus Safran Launchers en 2015 s’est accompagnée d’une revente des 34 % de parts de l’État et d’une relégation du CNES au rang de client et de prêteur complaisant. Les gouvernements PS ont souhaité faire la part belle au privé, tout comme Emmanuel Macron avec le volet spatial du plan France 2030. Ce plan a saupoudré l’argent public dans les entreprises et les start-ups, sans planification, en espérant que l’innovation et la libre concurrence remplissent leur rôle promis par les grandes théories néolibérales. L’industrie « privée » n’a finalement pas honoré la mission qui lui a été confiée par ses créanciers institutionnels.
Au tournant des années 2000, les projets de micro-lanceurs se sont multipliés en Europe. L’Allemagne, notamment, mise sur des entreprises privées (Isar Aerospace, RFA) pour stimuler la compétition sur ce créneau et monter en puissance à moyen terme avec le concours de l’Agence spatiale européenne (European Space Agency, ESA). La France se trouve soudainement menacée. La réponse d’Emmanuel Macron sera alors de suivre la stratégie allemande. L’emphase mise sur les micro-lanceurs français, aidés dans le cadre de France 2030, se veut une réponse et une promesse d’un sursaut pour la filière spatiale française. L’Europe se retrouve ainsi avec une kyrielle de projets de lanceurs quand deux suffiraient (un lourd, un léger, tous deux visant la réutilisation).
Le segment du lancement est l’arbre qui cache la forêt. Le spatial, en France comme en Europe, est menacé de déclassement partout : conception et fabrication des satellites, industrie des services en aval.
Le spatial français est lui ballotté par les vents contraires. Le pilotage stratégique national manque. Le « COSPACE », qui avait pour mission de susciter un dialogue entre tous les acteurs de la filière et l’État, reste une coquille creuse. Les tutelles changeantes du CNES, de même que les flottements dans les orientations de l’agence, contribuent à l’impression d’une perte de sens politique. Les salariés du CNES ont débrayé en avril 2022 à l’occasion d’une grève historique et très suivie à Toulouse contre la politique de son ancien PDG, devenu depuis ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, politique uniquement orientée vers le business et les start-ups, qui transformait le CNES en une simple agence de moyens. Alors qu’un nouveau contrat d’objectifs et de performances doit être mis en place rapidement, le risque du déclin s’amplifie à mesure que le gouvernement abandonne l’agence.
1.2. Refaire de l’espace un patrimoine commun de l’humanité
Contre la fuite en avant dans la marchandisation et l’inflation militaire dans les usages de l’espace, une alternative serait de renouer avec l’esprit fondateur d’un âge spatial guidé par l’idéal de paix entre les peuples et de mise en partage de l’espace, dont la consécration est la signature du Traité des Nations unies sur l’espace en 1967. En plus des autres textes onusiens qui lui sont associés, les États signataires se sont entendus pour soustraire l’espace du champ de la rivalité et de la conflictualité belliqueuse, et ont ainsi posé comme principes essentiels que l’exploration et l’utilisation de l’espace doivent être mises au service de tous les États, qu’il ne peut y avoir d’appropriation de l’espace par quelque moyen. Enfin, les États signataires sont responsables des activités spatiales qu’ils mènent autant que celles de leurs ressortissants.
Ce traité fondateur, négocié au pic de tension entre les deux blocs de la guerre froide, reste d’une grande actualité. Cependant, il est aujourd’hui en défaut sur la réglementation des activités en orbite terrestre basse, sur lesquelles apparaît l’essentiel des conséquences négatives du spatial : encombrement physique et radioélectrique, risque de collisions en chaîne sous l’effet du syndrome de Kessler[1], impact environnemental majeur du fait de la rentrée destructive des satellites en fin de vie (à terme, ce sont par exemple 8 000 tonnes de satellites Starlink qui seront brûlées chaque année).
En 1979, à l’effet de confirmer ces principes essentiels, un traité spécifique à la Lune est établi mais n’a été signé que par une seule puissance spatiale, la France, qui ne l’a ensuite pas ratifié. C’est une lacune dommageable, car ce traité contient une doctrine qui consacre le concept de « patrimoine mondial de l’humanité », la nécessité de sa préservation et de son partage équitable, et proscrit de fait toute forme d’accaparement unilatéral.

Recommandation :
- Organiser la ratification rapide du traité de la Lune. Il s’agirait d’envoyer un signal fort, à l’international, pour faire face aux tentatives d’accaparement de l’espace et amorcer une discussion multilatérale et démocratique sur ce sujet.
En 2015, cédant au lobbying d’entreprises privées et d’influenceurs de la « tech » qui prétendaient entreprendre l’exploitation minière des corps célestes, les États-Unis d’Amérique ont adopté un SPACE Act (Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act of 2015) qui autorise les entreprises états-uniennes à explorer, exploiter et, surtout, approprier les ressources spatiales. Le Luxembourg leur a emboîté le pas en 2016, et il est à craindre que l’Europe emprunte le même chemin avec l’UE Space Act. Cette proclamation de légitimité de l’exploitation des ressources des corps célestes, et la production d’un droit national pour garantir les intérêts des ressortissants engagés dans cette exploitation, est absolument contraire au principe de non-appropriation du Traité de 1967.
Plus tard, dans le but d’encourager des investissements dans la nouvelle course à la Lune, les États-Unis ont approfondi cette orientation par les « accords Artemis », texte juridiquement non contraignant mais excessivement engageant et lourd de conséquences. En plus d’autoriser l’appropriation privée des ressources spatiales, il instille la nécessité technique de sécuriser des « zones de sûreté » (safety zones), afin de protéger l’activité du premier déclarant, notion contraire au traité de 1967. Ces « accords » ont surtout pour objectif d’installer un ordre juridique spatial distinct du multilatéralisme onusien originel, avec les États-Unis au centre d’accords bilatéraux. Autrement dit, ils ratifient une vision de l’exploitation de l’espace qui porte les germes d’une transgression des principes du Traité de 1967, avec lequel les entrepreneurs et les capitalistes états-uniens rêvent d’en finir.
La France, d’abord attentiste, a finalement signé les accords en juin 2022. Cette signature a été décidée de façon unilatérale par le président de la République, sans faire l’objet d’un examen du Parlement. Cet engagement n’est cependant pas irréversible. La remise en cause unilatérale par la France du programme éponyme Artemis pourrait par exemple constituer une opportunité pour œuvrer dans le sens d’une politique d’exploration spatiale internationaliste et pacifique, fixant des objectifs universalisables.
Recommandations :
- Consulter le Parlement au sujet des accords spatiaux.
- Se retirer des accords Artemis et inviter d’autres signataires à en faire de même.
- Promouvoir et adopter au sein des Nations unies une extension du traité de 1967 pour régir l’occupation des orbites basses terrestres.
- Décliner ces positions à l’échelle nationale et au sein de l’Union européenne.
La stratégie spatiale nationale peut insister sur la volonté de la France d’agir pour un espace démilitarisé, qui prend en compte les nouvelles menaces. La France peut devenir la nation référente d’une pacification des usages de l’espace dans les arènes internationales de la diplomatie spatiale. Il n’est pas de paradoxe dans le fait qu’une telle ambition passe par la maîtrise de technologies et activités qui participent de la militarisation de l’espace : il faut s’armer pour désarmer.
Recommandations :
- Œuvrer au renforcement et à la création de mécanismes de transparence permettant de lutter contre la militarisation et favorisant la désescalade, conformément aux préconisations de la résolution 75/36 de l’Assemblée générale des Nations unies. Le code de conduite de La Haye (contre la prolifération des missiles balistiques) et l’exemple de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans le domaine nucléaire donnent des exemples crédibles de ces mécanismes.
- Proposer une résolution au Conseil de sécurité des Nations unies pour réaffirmer l’usage pacifique de l’orbite et l’interdiction des armes de destruction massive, voire de toutes armes.
- Réinvestir le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS), et placer le traité des Nations unies au cœur de l’élaboration de notre politique spatiale, et sortir des activités qui lui sont contraires.
2. Refonder la stratégie spatiale française : partir des besoins
2.1. Les besoins essentiels à notre souveraineté
Porteurs d’intérêts privés, start-ups ou fonds d’investissements, ne peuvent être au point de départ d’une stratégie basée sur les besoins. Ils ne peuvent dire ce qui serait stratégique. Seule la puissance publique est à même de recenser ces activités essentielles. De fait, gouverner par les besoins impose donc une nouvelle méthode. Elle doit être articulée entre des utilisateurs ou bénéficiaires de services spatiaux et le champ de la décision politique, dans sa dualité exécutif/législatif.
Ainsi, l’État doit d’abord s’atteler à un recensement des besoins essentiels, sur lesquels investir en priorité, et cesser les politiques publiques qui ne répondent pas à un besoin identifié.
Le premier besoin est celui de la durabilité. Celui-ci passe par la sobriété des usages. L’espace est un espace public qui consomme des ressources publiques et engage des responsabilités publiques. C’est pourquoi il ne peut être qu’au service de l’intérêt général. Et il incombe à la puissance publique d’encourager et d’autoriser des usages utiles de l’espace ou, à l’inverse, de contenir ou interdire ceux qui ne produisent pas de bienfait public comme le tourisme spatial, ou ceux dont les externalités négatives sont inacceptables, comme les « mégaconstellations ».
Recommandation :
- Plaider pour la mise en place d’un moratoire international sur le déploiement des mégaconstellations.
À l’embranchement du besoin de connaissance et de sobriété, se trouve le besoin et le droit fondamental de la nuit. L’accès au ciel nocturne est contrarié par les dégâts engendrés par la pollution lumineuse. Les zones sombres se sont raréfiées en France, empêchant l’observation des étoiles, y compris dans un but purement contemplatif, ou le travail des astronomes, professionnels comme amateurs. Il faudrait réduire l’intensité lumineuse des éclairages publics et privés nocturnes, travailler à recréer des zones sombres et à délimiter des trames noires. Et pour cela il faudrait associer pleinement les collectivités locales et les citoyens à la protection de ce bien commun qu’est l’environnement nocturne. Ce chantier en recoupe un autre, encore peu visible, et qui concerne la pollution lumineuse provoquée par les flottes de satellites en orbite terrestre basse. D’après une étude scientifique récente parue dans Nature, la réflexion de la lumière par les milliers de satellites en orbite basse circumterrestre pourrait augmenter la luminosité diffuse du ciel nocturne de 7,5 % d’ici à 2030.

Recommandations :
- Lancer un programme national de lutte contre la pollution lumineuse. Pour cela il convient de réactualiser l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Diminuer l’intensité, la périodicité d’allumage et la densité des éclairages nocturnes. Créer des trames noires sur le territoire, et interdire l’éclairage orienté vers le ciel.
- Encourager l’émergence d’une éducation populaire à l’exploration spatiale, notamment par la médiation scientifique et des productions culturelles et/ou éducatives (via l’audiovisuel public notamment) ayant pour thème les techniques spatiales et leurs missions scientifiques.
La maîtrise de la production de toutes les briques de base et systèmes est une garantie de l’autonomie. Il faut savoir tout faire pour répondre aux besoins de l’espace utile. Or pour ce faire, il faut d’abord disposer d’un accès souverain à l’espace pour satisfaire tous les besoins de sa politique spatiale. Il est ainsi nécessaire de pouvoir compter sur des systèmes de transport spatial souverains pour assurer le déploiement de ses capacités orbitales. La combinaison d’un lanceur lourd (Ariane 6) et d’un lanceur plus léger (Maia, bientôt opérationnel) est la plus optimale. La pérennisation du Centre Spatial Guyanais est une autre condition de l’autonomie nationale. La France maîtrise les technologies satellites de bout en bout : de la conception des plateformes aux charges utiles des instruments installés à bord, jusqu’aux services au sol qui exploitent les satellites. C’est une base industrielle et technologique à restructurer sous la forme d’un pôle public du satellite, qui agrègerait les branches nationalisées d’Airbus Defence and Space et de Thales Alenia Space.
Recommandations :
- Revoir l’architecture de financement du secteur spatial afin d’optimiser l’utilisation des deniers publics ; s’appuyer en premier lieu sur les ressources propres de l’État (CNES renouvelé, ONERA, etc.). L’appel au secteur privé ne doit intervenir qu’en seconde intention, en conservant toujours la maîtrise d’œuvre.
- Concentrer les financements publics sur un seul projet de mini-lanceur : MaiaSpace, filiale d’ArianeGroup (à nationaliser).
- Planifier un programme ambitieux d’exploration de l’Univers qui impliquera la mise en place d’un vaste programme de modélisations, d’instrumentation et de traitements des données. Il irriguera l’industrie et les PME/TPE. Et il permettra de combler les lacunes de la France dans les domaines où elle a pris du retard voire perdu en souveraineté : détecteurs (infrarouge notamment), calculateurs, etc.
- Intensifier la recherche dans le domaine de la météorologie de l’espace (prévision des tempêtes solaires). Maintenir un accès libre et ouvert aux données météorologiques et d’observation de la Terre fournies par les services satellitaires européens.
Face aux menaces hybrides, et au rôle toujours plus grand du spatial dans les stratégies de défense, le besoin de souveraineté ne peut ignorer les besoins identifiés dans le spatial de défense, visant à protéger nos infrastructures, et préparer la dissuasion de demain.
La précédente stratégie spatiale de défense a consacré le concept de « défense active », et a permis la création du Commandement de l’Espace, censé assurer la bonne mise en œuvre de ladite stratégie. La géopolitique de l’espace est bouleversée par l’accélération des technologies spatiales, par les récents conflits mondiaux (notamment par les leçons tirées de la guerre en Ukraine), par la course aux armements spatiaux toujours plus intense (qui s’accompagne de menaces de déploiement d’armes de destruction massive en orbite, notamment nucléaires, en violation du Traité sur l’espace), et par le positionnement agressif et conquérant des États-Unis d’Amérique sur la scène internationale.
La stratégie spatiale de défense mérite d’être actualisée pour répondre aux nouvelles menaces. Mais cela ne signifie pas nécessairement participer à la politique de surmilitarisation de l’espace menée par les États-Unis d’Amérique et par d’autres pays. Il s’impose d’être lucides et de développer les outils garantissant d’abord la souveraineté face aux menaces venant de l’espace militarisé. La France doit refuser la course à l’armement de l’espace dans laquelle les États-Unis et d’autres nations comme la Russie, la Chine et l’Inde sont engagées. Pour approfondir cette stratégie de non-alignement, la France doit se dégager des dépendances spatiales contractées dans le cadre de l’OTAN.

Recommandations :
- Annoncer la fermeture du centre spatial de l’OTAN à Toulouse.
- Faire de la France le fer de lance de la démilitarisation méthodique et coordonnée de l’espace en négociant un nouveau traité de démilitarisation sous les auspices de la commission désarmement et sécurité internationale de l’Organisation des Nations unies.
- Doter la France des capacités et infrastructuresrendant crédible sa volonté de (re)pacifier les usages de l’espace. Le faire en accompagnant la montée en puissance opérationnelle du Commandement de l’Espace, en interaction avec les autres acteurs du spatial français de défense (Direction générale de l’armement (DGA), Centre national d’études spatiales (CNES), armées, Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA), etc.).
Le besoin de protection des satellites militaires français est tout aussi vital pour les armées françaises. Cela passe par un renforcement des centres des opérations au sol. Mais aussi par la mise au point de capacités en orbite, capables de parer aux agressions de manière opérationnelle. Dans ce domaine, en rester aux simples exercices de démonstration, comme c’est le cas des programmes YODA et Toutatis n’est pas suffisant. Télécommunications (Syracuse IV), renseignement (CERES), observation militaire (constellation CSO) : les systèmes orbitaux de défense sont d’un usage critique. Le déploiement réussi du satellite CSO-3 le 6 mars 2025 par Ariane 6 est de bon augure pour les utilisateurs des armées, au vu des capacités de surveillance de très haute résolution. Ainsi, non seulement ces satellites sont indispensables, mais il faut en plus en assurer et sécuriser le bon fonctionnement le temps de la mission. Il convient également d’élargir la gamme des capacités disponibles. Pour cela, la France pourrait par exemple investir dans des capacités d’observation radar autonomes et dans des systèmes antibrouillage.
Recommandations :
- Sécuriser les financements prévus dans la loi de programmation militaire dans le spatial de défense. Elle doit assurer en priorité la mise en œuvre des projets prévus (IRIS², EGIDE, CELESTE, SYRACUSE 4C). Veiller à ce que les satellites d’IRIS² soient équipés de systèmes antibrouillage les plus poussés possible, et étudier la possibilité d’installer des capteurs optiques sur ces plateformes.
- Équiper les armées françaises d’une capacité d’observation radar autonome.
Face à la prolifération des constellations de satellites en orbite terrestre basse, la question de la sécurisation du milieu exo-atmosphérique et les systèmes qui y évoluent se pose avec acuité. Entre autres exemples, le programme Copernicus est aujourd’hui indispensable dans l’observation de la planète, la surveillance des dérèglements climatiques et la gestion de crise. Ce système d’observation doit bénéficier d’une protection contre les débris et les attaques extérieures éventuelles. Il en va de même du système de positionnement européen Galileo.
Cet enjeu est également discuté dans le cadre du développement du projet européen de constellation satellite de communication sécurisée IRIS². Une stratégie de planification dans la protection de nos infrastructures stratégiques devra être négociée, la France devra être motrice de cette stratégie.
Recommandations :
- Doter la France de moyens supplémentaires de neutralisation des actions hostiles menées contre elle depuis l’espace. Cela notamment par l’utilisation de faisceaux lasers. On doit aussi penser aux intercepteurs si nous pouvons nous assurer qu’ils ne génèrent pas de débris. La récente annonce d’un nouveau programme de coopération franco-allemande pour le développement d’une capacité d’alerte avancée est très loin d’être satisfaisante. Si en effet aujourd’hui la dépendance aux États-Unis en la matière est encore pire, les industriels français sont relégués au second plan au profit de leurs homologues allemands dans cette coopération. C’est l’entreprise OHB qui se voit confier la coordination, alors même que la France possède une expérience reconnue dans ce domaine avec le programme SPIRALE, lancé dès 2009, et notre savoir-faire avec les radars transhorizon, illustré par le démonstrateur NOSTRADAMUS, dont le développement a récemment été relancé par le ministère des Armées. Confier la maîtrise d’œuvre à un industriel allemand revient à déclasser notre base industrielle et technologique de défense spatiale, et à affaiblir notre souveraineté en renonçant à une filière française. Cette expérience ne peut continuer sans dommage pour la France et elle doit donc être entièrement reconsidérée.
- Se donner les moyens de développer une capacité d’alerte avancée en autonomie ou dans le cadre d’une coopération réellement équilibrée.
L’enlisement du SCAF (système de combat aérien du futur) impose d’anticiper le développement d’une nouvelle génération d’avions de combat. Il faut donc déterminer s’il est pertinent de poursuivre vers une véritable 6ᵉ génération, comme le prévoyait initialement le SCAF.
Recommandation :
- Étudier l’opportunité de passer directement à une technologie de 6e génération, ou d’engager sans attendre la voie d’un avion évoluant en très haute altitude (THA), voire d’un avion spatial.
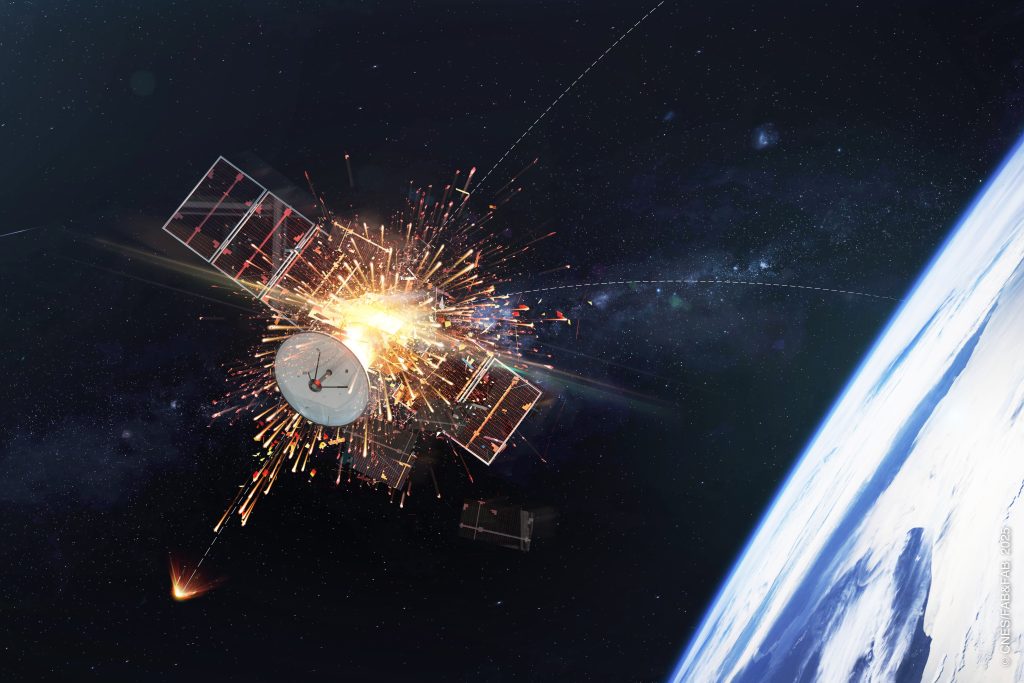
FOCUS. LA DISSUASION SPATIALE
La dissuasion nucléaire est actuellement la clef de voûte de notre défense. Car il n’existe à l’heure actuelle aucune alternative présentant un niveau de risque équivalent à pour qui voudrait attenter aux intérêts de la nation. Mais il faut également en relever ses limites, car la dissuasion est une arme posthume. D’où l’opportunité de l’objectif de désarmement global et multilatéral. Mais, dans l’attente d’une entente mondiale et démocratique sur le sujet, il faut penser d’autres formes de dissuasion. Elles viendraient pallier les limites de la dissuasion nucléaire actuelle. C’est ici qu’intervient l’idée d’une « la dissuasion spatiale ».
Il s’agit de développer des stratégies de dissuasion depuis l’espace capables de désorganiser un pays adverse, ses communications et ses infrastructures, en étant beaucoup moins létales et plus écologiques. Il faut ainsi préparer la dissuasion spatiale pour se prémunir d’attaques d’autres pays. Il est alors essentiel de dissuader d’une éventuelle attaque dirigée. Ici sont concernées les capacités de remplacement, les capacités de détection des missiles et toutes les mesures d’amélioration de la résilience…). Sinon en effet, le développement d’armements spatiaux permettant d’infliger des dommages insoutenables ou impossibles à attribuer à une puissance ennemie pourrait mettre la France face au fait accompli d’une attaque sans être en mesure d’y riposter.
Recommandation :
- Se doter des moyens de préparer la dissuasion de demain, en investissant dans la dissuasion spatiale, et en protégeant ses infrastructures stratégiques.
L’augmentation du trafic en orbite terrestre basse, les risques associés aux manœuvres inamicales et la pollution engendrée par des décennies d’activité sont autant de facteurs de perturbation. L’idée d’une « gestion » des flottes de satellites demeure très importante. La France peut progresser dans ce domaine. La surveillance et la sécurité des objets spatiaux (Space Situational Awareness, ou SSA) sont des activités critiques. Elles dépendent encore beaucoup des données fournies par l’armée états-unienne. La solution qui a consisté, ces dernières années en France, à encourager l’essor de start-ups et services à visée commerciale sur ce créneau, montre ses limites dès lors qu’il faut passer stade opérationnel. Les moyens de détection – radar, optiques, émissions électromagnétiques, éventuellement satellites en orbite mériteraient d’être renforcés.
Recommandations :
- Investir dans des capacités autonomes, sans dépendre d’acteurs privés et des images satellitaires états-uniennes.
- Proposer et soutenir une coopération approfondie entre le centre satellitaire des Nations unies (UNOSAT) et l’Organisation mondiale de la santé afin de développer des capacités partagées de planification sanitaire pour lutter contre les épidémies et les pandémies.
- Garantir le caractère public et accessible des données essentielles à la population, notamment celles nécessaires à la compréhension des phénomènes climatiques. Et il lui faut aussi veiller à les soustraire aux logiques de prédation marchande et commerciale. S’attacher à assurer un stockage de ces données pleinement souverain, le plus propre et sobre possible.
Le radar GRAVES (Grand Réseau Adapté à la VEille Spatiale), d’abord expérimental puis utilisé de manière routinière, s’est avéré extrêmement utile pour surveiller les satellites transitant au-dessus de la France métropolitaine. La récente annonce de son remplacement par le nouveau radar Aurore que proposera Thales va dans le bon sens. Mais il faut à présent déployer ce programme à l’échelle de la planète, avec une variété de capteurs. Cela représente un investissement conséquent, mais nécessaire pour peser dans le champ du SSA. Un plan de nationalisation des capacités déjà déployées peut être étudié.
Recommandation :
- Investir dans le SSA, par des capacités de détection multi-sources et les internaliser au sein du Commandement de l’Espace.
2.2. Construire des coopérations internationales harmonieuses
Pour consolider sa stratégie spatiale, la France doit identifier les secteurs où la coopération est possible et productive. Elle devra construire des coopérations pacifistes et altermondialistes avec les nouveaux acteurs du spatial. Telle est la méthode pour porter sans ambiguïté une politique indépendante et non alignée.
L’accession de Donald Trump au pouvoir pour un second mandat à partir de 2025 est lourde de menaces et de remises en question. Cette accélération erratique enjoint à réviser globalement les positionnements de la France en matière de coopération. Ces errements, malgré nos alertes dès 2017, sont coûteux à bien des égards.
Quelle est la situation ? Par l’intermédiaire du CNES, la France s’est engagée dans de nombreuses missions – passées, présentes et futures – avec la NASA ou la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) qu’il serait embarrassant d’interrompre. Mais en plus, en cas d’interruption unilatérale côté états-unien (ce qui ne serait hélas pas une première), cela engendrerait des pertes financières considérables. C’est pourquoi il faut diversifier les coopérations avec d’autres pays plutôt que de s’obstiner dans une relation de dépendance toxique avec un Empire qui ne manquera jamais une occasion de rappeler sa suprématie.
L’Allemagne n’est pas un partenaire fiable. Nous l’avons évoqué précédemment à propos du programme d’alerte avancée. Mais l’exemple le plus révélateur reste celui des accords de Schwerin, signés en 2002. Cette coopération prévoyait que la France fournisse à l’Allemagne des images issues de sa composante spatiale optique, en échange de données collectées par la constellation allemande de satellites radar à synthèse d’ouverture. En contrepartie, la France laissait à l’Allemagne la direction du projet de drone MALE, afin d’éviter la duplication des moyens et de permettre à chacun de se spécialiser. Or, en 2017, Berlin a rompu cet équilibre en commandant deux satellites d’observation optique à OHB, trahissant une fois de plus la coopération.
Recommandations :
- Privilégier les coopérations bilatérales ou multilatérales dans les domaines scientifiques.
- Examiner l’opportunité de renforcer nos coopérations satellitaires avec l’Italie, notamment à travers les collaborations existantes. Il sera temps aussi d’articuler les projets avec les pays émergents qui veulent participer au spatial au Maghreb et en Afrique subsaharienne.
Depuis une dizaine d’années, la Chine s’est imposée comme une puissance spatiale de premier plan. La course à l’occupation durable de la Lune pourrait se solder par une première chinoise d’ici à 2029 : des taïkonautes foulant la surface de notre satellite naturel – avant les Nord-Américains. Selon les critères classiques d’affirmation de la puissance spatiale, la Chine tient la corde : vols habités (2003), station spatiale Tiangong (2021), exploration lunaire, au moyen de rovers performants ou du projet en cours de base sur le pôle sud (International Lunar Research Station), et aussi missions robotiques sur Mars et aux confins du système solaire. Mais loin de se cantonner à reproduire un parcours prestigieux tracé par d’autres, la Chine s’impose d’ores et déjà comme une puissance pionnière. Elle l’a prouvé avec l’alunissage de la sonde Chang’e-4 sur la face cachée de la lune en 2019. Il s’agit là d’une grande première et d’une prouesse technologique. La Chine a inauguré fin 2024, deux centres spatiaux dédiés aux lancements commerciaux. L’un à Hainan dévolu aux lanceurs Longue Marche 12, et l’autre à Dongfeng où exercera la fusée Zhuque-2. Ces deux sites sont l’aboutissement de dix ans de développement proactif du secteur spatial commercial.
La collaboration de la France avec la Chine est déjà enclenchée. L’installation de l’instrument DORN à bord de la sonde lunaire Chang’E 6 en est un exemple. Parce que les positions sont rebattues au niveau international, il est aujourd’hui essentiel de préserver ces collaborations encadrées, au niveau français ou européen. La Chine est désormais un acteur spatial de premier plan, avec lequel il faut impérativement travailler.
Recommandation :
- Renforcer et protéger les collaborations avec la Chine, acteur spatial de premier plan. Les partenariats à nouer doivent être aiguillés par la nécessité d’un partage équitable des ressources offertes par le milieu spatial.
- Investir de nouvelles coopérations avec les puissances spatiales de premier plan comme l’Inde et le Japon, notamment dans les domaines de l’observation de la Terre, de la préservation de l’orbite basse, de l’écologie spatiale et de la surveillance. Elle peut impulser des programmes communs entre l’AfSA et le CNES.
Mais une autre partie du monde émerge et la France doit absolument s’investir : l’Agence spatiale africaine (AfSA) a été officiellement inaugurée le 20 avril 2025 au Caire. De nombreux pays du continent africain se dotent d’agences spatiales nationales et cherchent à fédérer leurs efforts en vue de construire des programmes définis en fonction d’objectifs établis de façon autonome. En opposition aux tentatives d’influence aux relents coloniaux absurdes ou aux gesticulations des capitalistes cherchant de nouvelles parts de marché, la France peut engager une politique de coopération. La création d’une université francophone de l’espace pourrait constituer un formidable levier.
Recommandations :
- Mobiliser les centres spatiaux universitaires existants afin de créer une université internationale francophone des métiers de l’espace à Kourou avec l’université de Guyane.
- Renforcer le Centre spatial guyanais, à 100 % entretenu et financé par la France, et en faire un avant-poste souverain vers la nouvelle frontière de l’espace.
- Impulser par le CNES des programmes scientifiques communs avec l’AfSA.
FOCUS. L’EUROPE SPATIALE, OU LA NÉCESSITÉ DE TRANCHER APRÈS DES ANNÉES DE TERGIVERSATIONS
L’organisation du spatial européen est d’une excessive complexité. La concurrence entre l’ESA et la Commission européenne, via l’EUSPA (EU Agency for the Space Programme) créée en 2021, y est pour beaucoup. Elle s’ajoute à la concurrence entre les nations sur le continent. La tentation de l’exécutif de l’ESA d’autonomiser une compétence proprement politique n’est pas admissible. Et pas davantage, son intention d’augmenter très substantiellement son budget pour la période 2025-2028 (22 milliards contre 16,9 milliards pour 2022-2025), en mêlant civil et militaire, en rupture avec l’usage pacifique de l’espace.
La position de la France au sein de l’ESA est désormais reléguée au second plan. Le conseil ministériel de l’agence l’a confirmé. L’Allemagne est la première contributrice, et de loin (5 milliards d’euros engagés), devant l’Italie (4 milliards), puis la France (3,5 milliards). Ce décrochage budgétaire d’un membre fondateur n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. En effet, c’est l’occasion de clarifier et de repenser l’implication française dans l’agence née il y a 50 ans, et qui a son siège à Paris.
Au même moment, la Commission européenne consolide sa compétence spatiale. La création récente d’une Direction générale « Industrie de défense et Espace », investissant dans le spatial de défense, est désastreuse et illégitime. Jusqu’alors cantonnée à la mutualisation des programmes phares communautaires (Copernicus, Galileo, bientôt IRIS²), la Commission déborde ses prérogatives de façon inacceptable. Elle veut porter la politique spatiale européenne. Sous Emmanuel Macron, qui encourage cette orientation, le spatial français est ainsi enjoint de céder sous couvert de « souveraineté européenne ». Résultat : la politique spatiale française entrée dans la phase habituelle de perte de vitesse avant passage sous contrôle extérieur.
Les conséquences sont désastreuses. Les grandes coopérations industrielles européennes ne fonctionnent pas. Les Allemands ne sont pas des partenaires fiables et profitent de la naïveté de nos gouvernants, qui semblent être les seuls à croire encore à l’existence d’un « couple » franco-allemand ayant des intérêts réellement partagés. À chaque fois, les schémas se répètent, et dans tous les secteurs : l’Allemagne a besoin de développer un programme, fait appel à la France, capte nos brevets, notre savoir-faire, puis poursuit seule.
L’européanisation de nos politiques spatiales en est l’illustration parfaite. La France s’est dépouillée pour renforcer l’Allemagne. Nous disposions pourtant d’un accès souverain à l’espace et d’une filière satellitaire de très haut niveau ; nous avons tout partagé, pour un résultat médiocre, puisque nous sommes désormais largement distancés par la Chine et les États-Unis. Notre lanceur Ariane 6 est aujourd’hui européanisé, tout comme nos satellites.
La France a joué le jeu sans réserve, mais les Allemands ont en parallèle développé leur propre filière nationale : portée par des budgets en forte augmentation, elle pourrait être en mesure de bientôt concurrencer les programmes européens. Isar Aerospace développe son propre lanceur, tandis qu’OHB construit une filière satellitaire complète.
La France se retrouve ainsi en position de dépendance dans un domaine où elle était pourtant largement autonome et à la pointe technologique. La nationalisation d’Ariane doit permettre de sortir le secteur des lanceurs de l’emprise de l’ESA. Il en va de même pour le redéploiement de notre filière satellitaire nationale. La France cessera de financer massivement ces deux secteurs via l’ESA et donc sa contribution diminuera mécaniquement. Notre contribution à l’ESA se recentrera sur ces programmes scientifiques, qu’il conviendra de financer à hauteur des besoins.
2.3 Recherche scientifique, utilisation raisonnée, et exploration
Alors que s’ouvre une nouvelle séquence de l’histoire spatiale, il faut être audacieux. Au-dessus de nous gisent les résidus en perdition et la pollution engendrée par des décennies d’opérations en orbite circumterrestre. Il est temps non seulement de réguler l’accès et le trafic sur les orbites les plus menacés. Il n’est plus possible de déployer du matériel dans l’indifférence des conséquences. Il faut donc changer radicalement la planification du spatial avant qu’il ne nous tombe sur la tête.
Recommandation :
- Promouvoir un programme international de dépollution de l’orbite basse, porté par les Nations unies.
S’il apparaît évident que l’industrie spatiale a un impact climatique certain au regard du nombre d’objets qu’elle produit, la quantification précise de ce dernier reste inconnue. Au-delà de ces zones d’émissions particulières au secteur, la nature même des rejets (particules d’alumine, oxydes d’azote, suie ou métaux divers) est encore mal connue. Pourtant, les impacts sur le climat et la couche d’ozone sont avérés.

Ces satellites et les étages supérieurs de fusées restés dans l’espace après leur fin de vie se sont accumulés. Ils entrent parfois en collision entre eux et génèrent ainsi de nouveaux et plus nombreux débris dangereux. Cette réaction en chaîne, dénommée syndrome de Kessler, pourrait être contrôlée par la sobriété bâtie sur l’utilisation raisonnée de l’espace. Malheureusement, les projets spatiaux outre-Atlantique et chinois sont bien loin d’être raisonnables : des collisions se sont produites et la rentrée des satellites n’est pas encore systématique. Ainsi, nous risquons une augmentation incontrôlable du nombre de débris qui aurait pour conséquence de rendre inutilisable certaines orbites, si ce n’est toutes, pour des décennies ou des siècles. Se réfugier dans le mythe techno-solutionniste du retrait actif des satellites n’est qu’une chimère ! Le coût de l’opération globale serait faramineux et les résultats incertains. La réutilisation de tout ou partie des lanceurs, si elle permet d’économiser des ressources et de sérialiser la production, n’est pas la solution ultime.
Recommandation :
- Augmenter les financements dédiés aux recherches sur la sobriété dans l’espace, et à la réduction de l’empreinte carbone.
La France adopte pour le moment un comportement irresponsable en priorisant une croissance non contrôlée des activités commerciales et en restant volontairement indifférente à leurs potentiels de contribution au dérèglement du fragile équilibre du système Terre.
Recommandation :
- Publier et mettre en œuvre une feuille de route ambitieuse de soutenabilité des activités spatiales, en prenant en compte tant les émissions carbones que non carbone.
Cela implique aussi de refuser le EU Space Act de la Commission européenne, véritable cheval de Troie de la privatisation de l’espace. Pour réussir, la position de la France doit être forte et constante sur la question de la sobriété des usages et de la bifurcation écologique du spatial.
Bien que toutes les activités spatiales aient des impacts environnementaux, leurs contreparties d’usages diffèrent d’une mission à l’autre. Des modèles éloignés de la prédation des capitaux et qui profitent à l’environnement et au bien commun sont possibles. C’est le cas avec les satellites de météorologie ou de mesure du climat dont les données sont souvent partagées en libre accès. On peut prendre comme exemple les missions mesurant les Variables Climatiques Essentielles (VCE). Elles contribuent de manière décisive à la caractérisation du climat de la Terre en fournissant une image du changement climatique à l’échelle mondiale. Les informations émanant de ces mesures peuvent être utilisées à terme pour orienter les mesures d’atténuation et d’adaptation et pour évaluer les risques climatiques.
Recommandation :
- Soutenir les programmes d’observation de la Terre (notamment les missions mesurant les VCE).
L’espace doit rester un champ de coopération internationale, notamment sur les grands projets scientifiques. Il y a aujourd’hui, un manque d’investissement dans l’exploitation scientifique des missions financées par la France. La Recherche et le Développement bénéficient de financements pour monter les missions, l’exploitation scientifique des résultats nécessite davantage d’investissements. C’est vrai au niveau français, avec le CNES, et européen si besoin, par l’intermédiaire de l’ESA. Ces missions, pour être techniquement possibles, supposent en amont le développement de recherches technologiques de pointe dans tous les domaines de l’ingénierie spatiale. Cela vaut pour tous les segments des systèmes techniques, des lanceurs aux plateformes satellites, des charges utiles aux infrastructures au sol. Le CNES, l’ONERA et le CNRS sont les organismes publics qui devraient coordonner et réaliser ces plans de travail.
La France peut reprendre le leadership scientifique que les États-Unis abandonnent par obscurantisme et haine de la science. Ils doivent également faire des sciences spatiales un outil diplomatique par un large programme de coopération, aussi bien avec des puissances spatiales établies, qu’avec des pays aspirant à le devenir.
Il est temps de définir comme axes prioritaires de développement les sciences de l’univers, celles de la Terre et de l’atmosphère, la météorologie opérationnelle et fondamentale, les télécommunications – notamment relevant de la souveraineté – ainsi que les systèmes de navigation et de défense. Les usages fondamentaux et appliqués se complètent en particulier pour répondre au besoin le plus critique : préserver les conditions d’habitabilité de la planète que l’humanité vit en partage.
FOCUS. LA RECHERCHE DE LA VIE DANS L’ESPACE : L’ULTIME ÉNIGME DE L’HUMANITÉ
Les recherches sur l’apparition de la vie extraterrestre font partie des priorités scientifiques. Les sondes et autres astromobiles sont envoyées pour débusquer les traces et biosignatures dans le système solaire : vers Mars, sa lune Phobos, des astéroïdes, des comètes… Le rover Perseverance de la NASA, qui embarque l’instrument français SuperCam, collecte des échantillons à la surface de Mars. Leur récupération par une nouvelle mission en coopération avec l’ESA est prévue en 2033. Ce programme Mars Sample Return est néanmoins menacé par les coupes budgétaires imposées par l’administration Trump, qui préfère envoyer des astronautes américains sur Mars. C’est la raison pour laquelle la France, en coopération avec des nations spatiales fiables, doit initier un programme stable pour accélérer la collecte de traces de vie extraterrestre. Pour faire avancer la science sur une question existentielle majeure.
Recommandation :
- Initier un programme ambitieux visant à accélérer la collecte de traces de vie extraterrestre.
Le retentissement d’une telle découverte serait immense, comme l’a été, le 12 novembre 2014, l’atterrissage de Philae sur la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko, prélude d’une moisson de données sur la composition du noyau cométaire, après des années de veille de la sonde Rosetta opérée par l’ESA.
Les équipes de prospective scientifique réunies par le CNES, les laboratoires fédérés par l’Institut national des sciences de l’univers (INSU) du CNRS, les collaborations via l’ESA, en plus des sociétés savantes (Académie des sciences, SF2A), sont les plus autorisées pour faire émerger selon les besoins les plus pertinents scientifiquement l’éventail des missions qui, à horizon 2050, devraient permettre d’engranger de nouvelles connaissances du cosmos : son origine, son évolution, sa composition, sa structure…
Cela comprend, en interaction étroite avec l’astronomie au sol, la deuxième méthode de recherche de présence de vie ailleurs dans l’univers : l’étude des exoplanètes dans la Voie lactée. 6 000 exoplanètes ont déjà été détectées depuis 1995. Il y en aurait entre 100 et 200 milliards dont une dizaine de milliards seraient « habitables ». Le James Webb Space Telescope (NASA/ESA) a commencé à analyser l’atmosphère de certaines exoplanètes. D’autres télescopes spatiaux élargiront le spectre, notamment PLATO (ESA) à lancer vers 2026 ou encore ARIEL (ESA, pas avant 2029), et des projets d’envergure, singulièrement l’éventuel Habitable Worlds Observatory. La pluralité des mondes, jadis objet de spéculations philosophiques et des entretiens d’un Fontenelle du temps des Lumières, puis évidence scientifique à étayer au 20e siècle, est le grand chantier scientifique du 21e siècle. La France doit y prendre sa part !
De même, l’observation du fond diffus cosmologique est incontournable pour valider le scénario de l’inflation aux premiers âges de l’univers primordial. Le projet LiteBIRD, initié en coopération avec le Japon, devrait être relancé pour un lancement en 2032. Il impliquerait l’acquisition d’une autonomie industrielle en Europe sur les détecteurs infrarouge ou la cryogénie. Par ailleurs, les projets pilotés par l’ESA comme LISA ou Athena sont à renforcer à brève échéance. Tous ces projets ont été fragilisés par les retraits de la NASA ; c’est l’occasion de rebondir et de les relancer, en coopération France/ESA et/ou avec d’autres partenaires internationaux comme le Japon.
Recommandation :
- Relancer un programme ambitieux d’exploration de l’Univers par des sondes robotiques (pour le système solaire) ou des télescopes spatiaux, et le faire seule ou en coopération avec des partenaires fiables et qui s’engagent jusqu’au bout : de la conception à la construction jusqu’à l’exploitation.
3. Garantir une autonomie stratégique pérenne en renforçant notre souveraineté
3.1. Retrouver un accès souverain à l’espace
Le CNES, en lien avec les industriels et les communautés d’utilisateurs scientifiques et militaires, devait faire monter la France en puissance spatiale au moment de sa création en 1961. Les modèles états-uniens et soviétiques ont été opportunément repris pour accélérer l’effort d’organisation. Les décennies suivantes, le CNES a démontré son excellence technique et scientifique, il a été à l’origine de nombreuses missions, a façonné le programme Ariane, installé l’évidence de la France comme grande nation spatiale. S’il conserve un héritage bon pour les livres d’histoire spatiale, il doit se projeter dans l’avenir. Or ces dernières années, il a été exposé aux renoncements et aller-retour du pouvoir. En guise de stratégie, Emmanuel Macron a enjoint de copier SpaceX.
Pourtant, d’autres formules existent dans le monde. Toutes celles qui mettent l’accent sur la maîtrise complète des systèmes, technologies et services, de manière intégrée et dans le souci de l’autonomie stratégique, peuvent inspirer une stratégie française de planification spatiale. L’Inde est souvent citée, et à raison : son modèle d’innovation « frugale » ainsi que sa démarche volontariste de planification des capacités en fonction des besoins fléchés par les autorités publiques partent d’une bonne intention. Elle convainc moins du fait de sa définition ultra-nationaliste du déploiement spatial. On le voit notamment pour ce qui concerne le programme de vol spatial habité, calé sur les standards qui prévalent aux USA, en Russie ou en Chine. Un autre modèle est bon à penser par exemple, celui du spatial japonais. Il vise à toujours plus d’indépendance technologique et programmatique. Cela après des décennies d’essor contrarié sous l’autorité de son premier partenaire états-unien.
En France, l’autonomie stratégique reste à (re)construire. Il faudrait pour cela nationaliser ArianeGroup, en rupture avec le crédo de la privatisation qui prévaut sans discontinuer depuis au moins les années 2000. L’indépendance dans l’accès à l’espace exige de disposer à tout moment de capacités autonomes. Il faut ainsi anticiper d’ores et déjà l’après Ariane 6, par la mise au point d’un lanceur polyvalent, réutilisable et sobre. Le CNES devrait être mis à contribution pour favoriser le développement d’une filière publique de satellites et de lanceurs.
Recommandation :
- Nationaliser ArianeGroup et réintégrer la maîtrise d’ouvrage des programmes de transport spatial au sein du CNES, par l’intermédiaire d’une direction du transport spatial renforcée dans ses prérogatives.
FOCUS. LE CENTRE SPATIAL GUYANAIS, PORTE SOUVERAIN VERS L’ESPACE

Le Centre Spatial Guyanais est un atout précieux. La relocalisation des tirs en Guyane durant les années 1960 a permis à la France de bénéficier d’une fenêtre optimale vers l’espace depuis l’équateur. L’enjeu essentiel est d’occuper cette base et ses aires de lancement. Or, les cadences ont décru ces dernières années. Arianespace lance beaucoup moins. Trois tirs seulement en 2024. L’occupation du site est défaillante et c’est pourquoi il faut changer de méthode.
Il faut d’abord assumer d’en reprendre le contrôle à 100 %. Puis en assurer la vocation de base spatiale française ouverte aux coopérations altermondialistes, et non plus seulement « port spatial de l’Europe » suite aux accords de 2008 avec l’ESA. Ce serait une clarification bienvenue, car la France supporte l’essentiel des dépenses de fonctionnement ainsi que les investissements d’infrastructure.
Ce recentrage s’accompagnerait également d’une priorisation des objectifs et des choix de coopérations, en les diversifiant et en intensifiant celles avec les nations spatiales émergentes du Sud. En outre, le Centre spatial guyanais doit être refondé. Le passé néocolonial d’un site continue de façonner les représentations des Guyanais. L’implantation de la base a supposé de nombreuses expropriations et de réduire au silence des voix locales. L’effet en est délétère.
C’est pourquoi, au-delà du seul mécénat et des subventions (modestes) apportées par le CNES ou les partenariats entre la Collectivité Territoriale de Guyane et l’État, l’objectif est d’inclure bien davantage le CSG dans l’environnement guyanais, d’en faire une pointe avancée du développement du territoire, par et pour les Guyanais. Cela vaut en particulier pour la formation et accompagnement des recherches et développements dans les applications mobiles à partir de l’espace.
Avec la nationalisation d’ArianeGroup, le Centre spatial guyanais et son pas de tir deviendraient exclusivement à usage français, le préservant ainsi des prédations internationales. Le pas de tir pourrait être loué à des pays partenaires, sous des conditions définies avec la population territoriale et les gouvernements respectifs. Ainsi, la France retrouverait pleinement son accès souverain à l’espace, par la nationalisation de ses lanceurs, et la souveraineté sur son pas de tir.
3.2. Créer un pôle public du satellite et préserver nos entreprises stratégiques
L’économie du spatial est enfermée dans la conception marchande. Ses instigateurs, inspirés par les comportements dominateurs états-uniens, tentent de lui imposer un modèle inefficace de développement.
Les récentes annonces de suppressions d’emplois chez Airbus et Thales Alenia Space en sont aujourd’hui l’exemple le plus criant. 980 suppressions de postes chez TAS, 2500 chez ADS, le secteur du spatial. Ces suppressions de postes sont la conséquence de l’absence de planification de la commande publique. Le secteur est victime du manque d’anticipation, de l’obsession de la rente actionnariale et de l’austérité budgétaire, alors même que les carnets de commande sont pleins, et que l’activité est en passe de s’accélérer. Les employés qui partent se retrouvent généralement dans des start-ups, parfois détenues par des capitaux étrangers. En laissant faire ces suppressions d’emplois massives, les gouvernements de Macron organisent la fuite des compétences et des savoirs faire. Cela alors même que les salariés sont en capacité d’organiser et de gérer toute la chaîne de production.
Recommandation :
- Interdire les licenciements et les suppressions d’emplois dans nos secteurs stratégiques du spatial, et renforcer les recrutements, la fidélisation et la montée en compétence.
Le projet « Bromo », piloté notamment par Goldman Sachs et Bank of America, risque d’amplifier la dynamique des suppressions de postes. Il fusionne certaines chaînes de production et les sections de Recherche et Développement en mettant en danger des milliers d’emplois. Ceux-ci sont pourtant essentiels dans la mise en œuvre et la planification des activités spatiales. Dans ce domaine comme dans les autres l’objectif « réduire les coûts » veut dire enrichir des industriels nouvellement fusionnés, qui tiennent toujours secrets leurs bénéfices. Par ailleurs, le rapport Saint-Martin Vignon sur les satellites de défense (mai 2025) alerte sur le fait que l’industriel allemand OHB est pour l’instant exclu du projet. Il existe donc un risque que la fusion contraigne ADS, TAS et Leonardo à vendre des actifs à OHB, qui verrait ses capacités augmentées. Le projet pourrait renforcer OHB. Il bénéficie déjà des mannes de la commande publique allemande. Il serait alors un concurrent sérieux en Europe. Cette fusion pourrait être néfaste tant pour l’emploi que pour la sauvegarde de la base industrielle en France. Elle accélérerait son déclassement.
Le privé reste à la manœuvre : la fusion de cette usine à gaz n’assure pas plus de souveraineté pour la France, d’autant que Leonardo, le géant italien, dispose d’un carnet de commande dirigé pour moitié vers les États-Unis. Se pose ainsi la question de la dépendance états-unienne. Il n’est pas solutionné par une fusion de ce genre, davantage tirée par les promesses de rentabilité financière que par l’objectif d’industrie souveraine. Les trois entreprises disent travailler sur un scénario de fusion à horizon 2027. Mais rien n’est fait. Le projet, quoique soutenu et encouragé par le gouvernement macroniste, doit encore être étudié par les services de la Commission européenne. Les salariés, eux, se mobilisent pour défendre l’emploi et l’excellence technique de leurs sites.
La crise spatiale française résulte d’une multiplicité de facteurs. Les errements industriels et les défauts d’anticipation des directions ont pesé dans les mauvais résultats. Déboussolés, les défenseurs de la fusion cherchent à copier des modèles (SpaceX et son intégration verticale, MBDA et son organisation compartimentée), avec retard, sans imagination. Il faut changer de méthode, par un retour aux sources de la puissance spatiale française. Nous proposons de nationaliser stratégiquement ces filiales des grands groupes Airbus et Thales dans l’objectif de créer un pôle public du satellite. L’objectif, expliqué dès le début de notre stratégie, est de maîtriser tous les segments et de les intégrer en un tout cohérent, dans un système d’entreprises publiques sous contrôle et gouverné en fonction de besoins avérés, et non pas pour la course aux profits.

Recommandation :
- Créer un pôle public du satellite, dans le but de garantir une maîtrise complète sur le segment de la conception et de construction des satellites.
Les suppressions massives d’emplois et le besoin de renforcement des grands industriels de défense, proviennent du retard pris depuis de nombreuses années. Cela dans l’innovation comme dans la défense des intérêts souverains de la France. Tout est lié à un manque de planification et d’anticipation des besoins réels.
Le suivi des évolutions de l’industrie nous conforte dans une stratégie : la consolidation de la maîtrise technique et industrielle sur tous les segments doit s’accompagner d’une rationalisation de la commande publique et de la stratégie de subventionnement. Plutôt que de saupoudrer l’argent public dans des jeunes pousses qui, pour certains, développent des compétences essentielles à la filière, l’État doit sans plus attendre, prendre le contrôle des entreprises et start-ups les plus stratégiques, après avoir mené un audit faisant état des besoins de la filière.

Recommandation :
- Nationaliser les start-ups et PME essentielles à la bonne conduite de la stratégie spatiale.
Pour préserver nos entreprises stratégiques de la prédation des fonds d’investissement en capital-risque étrangers, des mesures peuvent être prises. Les investissements étrangers doivent être scrupuleusement soumis à la procédure d’autorisation préalable de l’État prévue par le décret Montebourg de 2014. Il pourrait le cas échéant être étendu. Des conventions de protection des actifs stratégiques devront être systématiquement conclues avec les entreprises du domaine spatial bénéficiaire d’aides de l’État quelle qu’en soit la forme (contrats, subventions nationales ou régionales, apports en fonds propres, prêts remboursables, mise à disposition de moyens). Il s’agit de conditionner toute cession, aliénation, transfert à l’étranger de tout actif matériel ou immatériel à l’autorisation de l’État.
Recommandations :
- Protéger ses actifs stratégiques par des conventions de protection avec les entreprises du domaine spatial bénéficiaires des aides de l’État, et refuser toute cession aliénation et transfert à l’étranger de ses actifs.
- Nationaliser les entreprises stratégiques du spatial français et organiser le secteur par la planification et la commande publique.
3.3. Redéfinir le rôle du CNES et coordonner la politique spatiale française
Le CNES peut redevenir le planificateur central de la stratégie spatiale française et prendre en charge le processus d’organisation et de mise en cohérence des besoins en une politique d’ensemble et la préparation des nouvelles briques techniques ou technologiques.
Pour en préciser le mandat, il faudrait transformer le CNES, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), en établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST). De sorte que la contribution à la recherche scientifique et technologique soit assumée. C’est ainsi que l’ambition spatiale de l’agence, à l’avant-poste de l’exploration, pourra se renouveler sur des bases nouvelles, et ainsi conjurer la perte de sens et de capital d’autorité technique qui l’a fait décliner.
Les compétences du CNES pourraient être renforcées pour développer l’initiative française. En son sein peuvent se réaliser les études de missions et de phase 0, pré-phase A et phase A, préalables aux instructions des décisions de programme. Il s’agit ainsi de rompre avec l’externalisation et la délégation de service. Elles altèrent le savoir-faire et l’utilité de l’agence spatiale. Cela exige de la doter de capacités de coproduction industrielle, en lien avec les entreprises, pour confirmer son statut et son autorité technique.
Recommandations :
- Transformer le CNES en établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST).
- Faire du CNES une usine à études de missions et de phase A pour développer l’initiative français en matière d’espace.
La conduite de cet organisme et sa mission pourrait être de coordonner et d’animer, sous une direction politique, la construction d’une politique spatiale harmonisée à partir de besoins et solutions issus des bénéficiaires légitimes, en étroite collaboration avec le CNES.
Le CNES est chargé de la représentation de la France à l’Agence spatiale européenne. Sa participation aux programmes de l’ESA ou l’implication dans ceux de l’UE ne doit pas se faire au détriment du programme national.
La mise en œuvre opérationnelle de la Loi sur les Opérations Spatiales est essentielle pour assurer tous les engagements internationaux de l’État français lorsqu’il est État de lancement, notamment lors des lancements depuis la Guyane.
Recommandation :
- Réinstituer le CNES comme l’agence opérationnelle de mise en œuvre de la Loi sur les Opérations Spatiales, garante des intérêts de l’État dans toute opération spatiale mettant en jeu ses responsabilités pécuniaires et internationales.
Conclusion
Le 26 novembre 1965, la France est entrée dans l’histoire spatiale en plaçant sur orbite le satellite Astérix après un tir de la fusée Diamant-A, depuis la base d’Hammaguir. Le 6 mars 2025, le premier tir « commercial » d’Ariane 6 confirme que la France garde un accès autonome à l’espace. Cet accès garanti et souverain à l’espace est vital. Il l’est parce qu’il permet d’opérer les missions et programmes que nous jugeons utiles.
Il est indispensable aujourd’hui de penser autrement la politique spatiale. Un autre espace est possible : celui éloigné des prédations capitalistes et marchandes, un espace qui répond aux besoins, de manière durable, démilitarisé et dépollué. Un autre espace dont l’occupation est assurée de telle sorte que cette ressource est préservée dans l’intérêt général humain, à un moment particulièrement critique de l’histoire spatiale où la menace d’effondrement technique n’est plus théorique.
Il est nécessaire de radicalement faire bifurquer la politique spatiale française et internationale. La stratégie spatiale macroniste intervient après de nombreuses alertes dressées par la France insoumise depuis plusieurs années. La nouvelle stratégie spatiale française, la ministérielle de l’ESA, le lancement d’Ariane 6, les RETEX des différents conflits amènent à une prise de conscience généralisée sur l’importance du sujet. La France devra porter une proposition non alignée et planificatrice sur la scène internationale. Nous disons notre certitude que pour le reste du monde, la conscience s’imposera de sa dépendance à un accès soutenable à un espace maîtrisé en commun.
24.10.2025 à 18:17
Pour un nouveau communalisme : le nouveau livre de l’Institut La Boétie
Texte intégral (706 mots)
L’Institut La Boétie publie son nouvel ouvrage, Pour un nouveau communalisme : les communes au cœur de la révolution citoyenne, dans la collection « Les livres de l’Institut La Boétie » aux éditions Amsterdam.
À quelques mois des élections municipales, Pour un nouveau communalisme se propose de répondre à une question essentielle : pourquoi les communes peuvent être, pour la gauche de rupture, un maillon essentiel de son projet de révolution citoyenne.
L’histoire de notre pays a montré que les communes ont été un haut lieu de mobilisation populaire. Elles ont préfiguré les changements révolutionnaires de la société toute entière : gouvernement représentatif, souveraineté populaire, logement social, services publics, sécurité sociale… Autant de ruptures nettes avec l’ordre établi. Le livre propose de renouer avec la longue tradition du communalisme pour répondre aux grands défis de notre siècle.
Il s’ouvre par une préface de Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie. Ses auteurs y analysent comment les politiques municipales ont été mises sous tutelle par un néolibéralisme urbain en pleine expansion et décryptent les mécanismes de l’emprise du capital sur la ville : grands projets inutiles, spéculation immobilière et politiques d’exclusion des pauvres.
Mais surtout, il propose un chemin pour faire des communes des préfiguratrices de la révolution citoyenne et formule des pistes réellement transformatrices pour en faire le creuset d’un changement global de politique, au service de l’émancipation de la société entière.
Pour un nouveau communalisme propose donc une analyse critique du capitalisme urbain mais pose aussi les bases d’un mouvement communaliste contemporain, au service de la nouvelle France et de ses besoins. Un livre essentiel pour celles et ceux engagé·es dans la bataille pour gouverner les communes.
Procurez-vous Pour un nouveau communalisme.
Plusieurs rencontres autour du livre sont en cours d’organisation. Retrouvez prochainement les lieux et dates de la tournée de promotion !
- Jeudi 29 janvier à Orléans : Manuel Menal à la librairie Les temps modernes
- Jeudi 29 janvier à Bordeaux : Antoine Salles-Papou
- Jeudi 29 janvier à Marseille : Allan Popelard, Sébastien Delogu, Charlotte Deweerdt, Rabyata Boinaheri et Sergio Coronado
- Vendredi 30 janvier à Caen : Manuel Menal, Emma Fourreau et Aurélien Guidi
- Mardi 3 février à 19h15 à Sciences Po Paris : Antoine Salles-Papou
- Mercredi 4 février à 18h30 Sète : Manuel Menal
- Jeudi 5 février dans le 13e arrondissement de Paris : Cécile Gintrac
- Mardi 10 février à Belfort : Allan Popelard
- Jeudi 12 février au Pré-Saint-Gervais : Manuel Menal et Dylan Quenon
- Jeudi 12 février à Arles : Allan Popelard, Jécila Rega et Patrick Gianfaldoni
- Vendredi 13 février à Tours : Cécile Gintrac
- Jeudi 19 février à Amiens : Antoine Salles-Papou, Zahia Hamdane et Samy Olivier
- Jeudi 19 février à Mende : Allan Popelard et Sandrine Nosbé
- Vendredi 20 février à Clermont-Ferrand : Allan Popelard et Marianne Maximi
- Vendredi 20 février à Castres : Manuel Menal
- Samedi 21 février à Montluçon : Allan Popelard
- Mardi 24 février à Strasbourg : Antoine Salles-Papou et Florian Kobryn
- Mercredi 25 février à Grenoble : Antoine Salles-Papou et Allan Brunon
- Jeudi 26 février à Limoges : Allan Popelard et Damien Maudet
- Vendredi 27 février à Soyaux : Allan Popelard à la salle Matisse
- Samedi 28 février à Rochefort : Allan Popelard
- Samedi 7 mars à Foix : Allan Popelard
23.10.2025 à 20:25
Comment le capitalisme contemporain a étendu le domaine de l’exploitation
Texte intégral (6734 mots)
| Note de lecture du livre d’Ulysse Lojkine, « Le fil invisible du capital : déchiffrer les mécanismes de l’exploitation », Éditions La Découverte, 2025 |
Ulysse Lojkine est normalien, agrégé de philosophie, doctorant en philosophie et en économie à l’Université de Paris-Nanterre et à l’École d’Économie de Paris, chercheur post-doctorant à Sciences Po Paris. Il a travaillé sur les concepts de pouvoir et d’exploitation dans le monde du travail autour des pensées marxiste et postkeynésienne.
Qui travaille pour qui ? Et qui exploite qui ? C’est à partir de ces deux grandes questions qu’Ulysse Lojkine démarre son important travail d’élaboration théorique sur le capitalisme contemporain. Son point de départ est le suivant : il est désormais bien plus difficile que par le passé de déchiffrer les relations d’exploitation et de domination dans notre économie. Les évolutions du capitalisme – financiarisation, mondialisation et fragmentation des réseaux de production, émergence de nouvelles formes d’emplois… – ont conduit à un brouillage de ces rapports, auparavant cristallisés dans l’affrontement direct entre le travailleur et son employeur.
Partant de ce constat, Lojkine propose de renouveler la théorie de l’exploitation marxiste traditionnelle en se penchant sur l’émergence d’autres dimensions de l’exploitation, en dehors de la sphère salariale. Pour lui, cette multiplication des échelles et des formes d’exploitation capitaliste induit aussi une réévaluation de la nature du capitalisme : l’auteur nous invite alors à le concevoir non pas uniquement sous l’angle de l’exploitation, mais aussi comme un système de coordination économique particulièrement efficace, bien qu’injuste. Dès lors, si l’on souhaite substituer au système capitaliste un mode de production égalitaire, il s’agit non seulement de penser l’abolition de l’exploitation, mais aussi la construction de formes alternatives de coordination des échanges.
Ce livre est une pièce majeure aux débats sur la nature du capitalisme actuel, et, ce faisant, sur la construction d’une stratégie anticapitaliste adaptée à notre temps. L’Institut La Boétie en propose un aperçu à travers cette note de lecture.
I) (Re)définir l’exploitation capitaliste : appropriation du travail et relations de pouvoir
| « Le capitalisme est structurellement un système d’exploitation de certains groupes sociaux par d’autres, au sens d’une appropriation du travail d’autrui combinée à une relation de pouvoir asymétrique. » |
Comptabiliser le surtravail
L’ambition d’Ulysse Lojkine est de mettre en lumière les mécanismes contemporains de l’exploitation capitaliste. Pour cela, il prend comme point de départ la théorie de l’exploitation de Marx, qu’il propose d’amender et de prolonger pour l’adapter à la structure actuelle du capitalisme.
Il reprend à son compte la définition traditionnelle de la théorie marxiste : l’exploitation, c’est l’accaparement du surtravail, c’est-à-dire l’appropriation par les uns du travail fourni par les autres. Or, dans le système capitaliste, ce surtravail est rendu invisible aux yeux des travailleurs : il leur est impossible de savoir quelle partie de leur journée de travail travaillent-ils pour eux-mêmes, et quelle partie consacrent-ils aux profits du patron. Par ailleurs, dans une société marchande de division du travail, le travailleur ne récupère pas directement le fruit de son travail : celui-ci lui est rendu indirectement, par l’intermédiaire de la monnaie – son salaire – par laquelle il pourra acheter des marchandises produites par d’autres pour reproduire son existence. Ainsi, « on ne peut donc mesurer le travail propre qu’en mesurant le travail incorporé aux produits que son revenu permet au travailleur d’acheter ». Chez Marx, cette analyse sert à expliquer le processus de formation de la valeur des marchandises. Lojkine réfute cette explication et propose de garder une approche purement comptable du surtravail. Il formule ainsi son idée centrale : on peut tout à fait construire une mesure de l’exploitation à partir de la théorie de l’exploitation marxiste, tout en laissant de côté la question épineuse de la valeur[1].
Il propose alors de construire ce qu’il appelle une comptabilité en travail, c’est-à-dire une comptabilité des flux de travail au sein de notre économie, qui puisse s’appliquer à l’échelle nationale et internationale. Ce projet ambitieux fait face à plusieurs défis : comment comparer entre elles des réalités de travail très différentes ? Comment mesurer précisément qui s’approprie le travail de qui, dans une économie où les flux de travail sont de plus de plus en plus indirects et complexes ?
Ces questions sont essentielles, puisque la ligne de démarcation entre exploiteurs et exploités dépend précisément de la mesure que l’on retient. Ulysse Lojkine se concentre particulièrement sur deux enjeux décisifs : la place ambivalente des cadres (les salariés à hauts revenus) et les différences de rémunération du travail entre le Nord et le Sud (l’échange international inégal). Pour résoudre cette question de l’hétérogénéité du travail, plusieurs approches ont émergé au sein du marxisme. Parmi elles, deux principales, mais qui amènent des conclusions divergentes : la « réduction par le salaire », qui considère que le salaire reflète le degré de complexité du travail effectué ; et l’approche homogène, qui considère au contraire que toutes les heures de travail doivent être comptées de la même manière.
Si l’on comptabilise le travail selon la première approche, aucune inégalité de salaire n’est due à un rapport d’exploitation : les salariés qui gagnent davantage que la moyenne ne peuvent en aucun cas être catégorisés comme exploiteurs, puisque tous leurs revenus proviennent de leur travail, et non de revenus de la propriété. À l’inverse, si l’on adopte l’approche homogène, tout écart de salaire signale au contraire un transfert net de travail, et donc un rapport d’exploitation. Les cadres peuvent donc être considérés comme des exploiteurs, puisqu’ils s’approprient une part du travail global fourni supérieure à la moyenne.
Dans la figure ci-dessous, la droite en pointillé représente la démarcation de l’exploitation selon l’approche homogène (cas 1), tandis que la droite continue représente la réduction par le salaire (cas 2). Certains groupes conservent la même position dans les deux cas : les capitalistes et le prolétariat. Mais d’autres changent de position selon l’approche : la petite bourgeoisie est considérée comme exploitée dans le cas 1, contre exploiteuse dans le cas 2. Inversement, les cadres sont considérés exploiteurs dans le cas 1, contre exploités dans le cas 2.
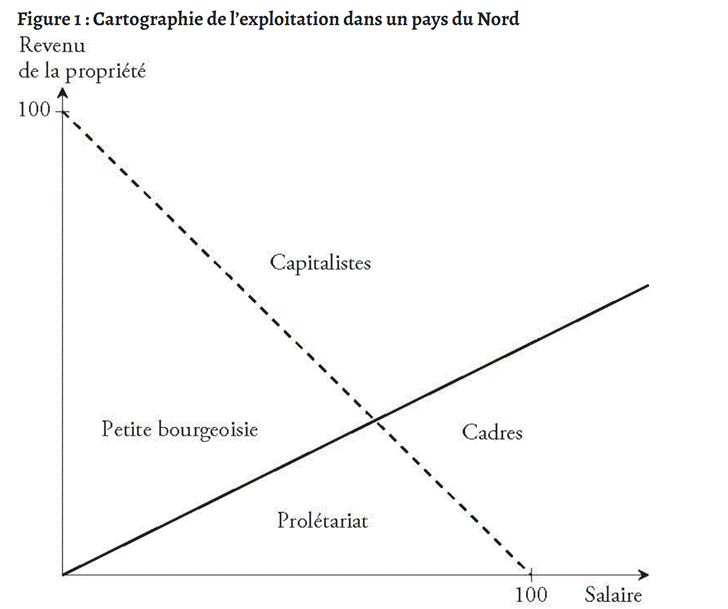
Cette même logique s’applique au cas de l’échange inégal entre le Nord et le Sud. Selon l’approche « au salaire », la ligne d’exploitation ne change pas. Mais si on opte pour l’approche homogène, une grande partie des salariés du Nord passent du côté des exploiteurs, dans la mesure où ils s’approprient une partie du travail des travailleurs du Sud – ils deviennent une sorte d’équivalent des « cadres » à l’échelle mondiale. Seuls les travailleurs pauvres du Nord demeurent dans le prolétariat mondial exploité. « En somme, résume Lojkine, les écarts de revenu entre pays sont tels que, si on considère vraiment qu’une heure de travail du Sud vaut une heure de travail du Nord, on est forcé de conclure que la majorité de la population du Nord s’approprie par le commerce un flux net de travail issu du Sud ».
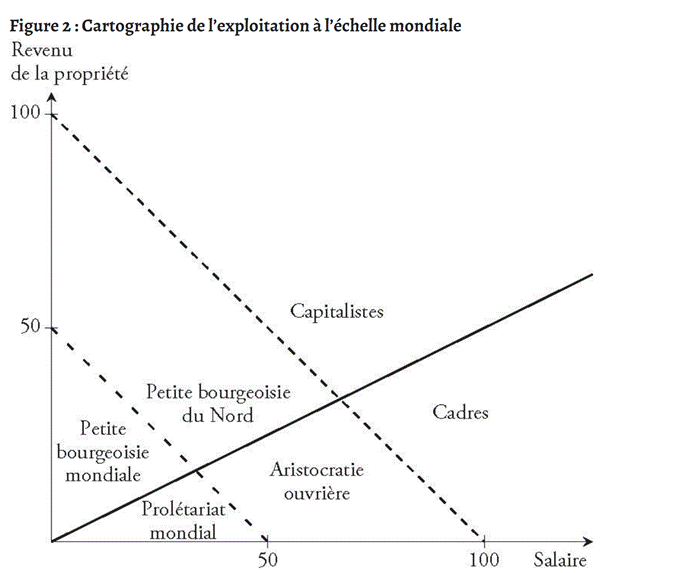
Aux termes de cet exposé, Lojkine n’impose pas de conclusion ferme quant à la meilleure manière de comptabiliser le travail, et donc de définir qui est exploité et qui est exploiteur. Mais son travail montre la capacité de l’approche homogène à rendre compte de certains mécanismes plus discrets de l’exploitation contemporaine, ainsi que ll’ambivalence de certaines positions de classe. Il appelle par ailleurs à réfléchir à la manière d’intégrer dans cette comptabilité des formes de travail non-marchand, en particulier le travail domestique des femmes que l’on ne compte quasiment jamais.
Les relations asymétriques de pouvoir dans le capitalisme
Décrire l’appropriation du travail des uns par les autres ne suffit pas à saisir les ressorts profonds de l’exploitation : on doit aussi comprendre comment cette appropriation est rendue possible, c’est-à-dire pourquoi certains se retrouvent du côté des exploités et d’autres des exploiteurs. Il faut alors se pencher sur les relations de pouvoir qui structurent le mode de production capitaliste et qui, elles aussi, sont invisibilisées par ce dernier. Pour les démasquer, Lojkine propose notamment de faire dialoguer entre elles les conceptions néoclassique et marxiste du pouvoir afin de construire une conception plus étendue de la notion de pouvoir dans l’économie capitaliste.
Pour la plupart des pensées économiques non-marxistes, le capitalisme peut exister sans exploitation. Il ne porte pas fondamentalement en lui des rapports de domination. La théorie libertarienne considère ainsi que les capitalistes n’exercent pas de domination sur les travailleurs car ils n’exercent pas de coercition. L’employeur peut simplement licencier le travailleur, mais il ne peut pas le sanctionner en usant de la violence, en confisquant ses biens ou en l’envoyant en prison, par exemple, contrairement à l’État.
Les théories néoclassiques, dominantes aujourd’hui en économie, expliquent, elles, qu’il n’y a pas de relations de pouvoir dans une économie de marché si celle-ci est suffisamment concurrentielle. Elles considèrent qu’il n’y a qu’une seule forme de pouvoir dans l’économie : celui du monopole – ou, dans le cas du marché de l’emploi, du monopsone –, que la concurrence neutralise totalement. Puisqu’une diversité d’employeurs existe, le travailleur est formellement libre de travailler là où cela lui plaît. Plus il y a d’emplois disponibles, plus il se sentira libre de refuser un travail aux conditions insatisfaisantes. La concurrence permettrait ainsi d’éviter l’arbitraire des employeurs sur les prix et les salaires.
Pour Lojkine, cette conception passe à côté du point central exposé par la théorie marxiste : la propriété privée des moyens de production permet aux capitalistes d’exploiter les travailleurs à leur gré. Ce n’est que parce que les capitalistes détiennent les moyens de production que les travailleurs sont obligés de vendre leur force de travail. Autrement dit, « la subsistance du travailleur est détenue par les possédants comme un otage, et c’est sa force de travail qu’il doit fournir comme rançon ». Marx parle en ce sens de « contrainte silencieuse » au marché : la propriété des moyens de production force les travailleurs à vendre leur force de travail sur le marché de l’emploi. Et c’est cette asymétrie de pouvoir qui fait du rapport salarial « un rapport unilatéral d’autorité et d’obéissance, de pouvoir et subordination ». La propriété privée offre un pouvoir sur le marché, indépendamment de la question de la concurrence.
Toutefois, on peut s’appuyer sur l’intuition néoclassique au sujet du rôle de la concurrence pour enrichir notre compréhension du pouvoir capitaliste, explique Lojkine. Là où les néoclassiques le définissent comme une domination individuelle, et les marxistes comme une domination impersonnelle, il propose de redéfinir le pouvoir comme une variation. Le pouvoir devient alors la capacité d’un agent à faire varier une réalité sociale, en prenant en compte la réaction des autres agents. Autrement dit, la capacité à imposer ses préférences. On y intègre donc le pouvoir formel, bien sûr, mais aussi les formes plus implicites et indirectes de pouvoir qui existent dans le capitalisme. Cette définition permet à la fois de confirmer le pouvoir issu d’une situation de monopole, mais aussi et surtout de montrer l’inégale répartition de ce pouvoir entre les groupes. En prenant l’exemple d’un marché locatif parfaitement concurrentiel, Lojkine démontre facilement comment les groupes les plus riches ont la liberté de choisir les biens qu’ils souhaitent, laissant les moins riches sur le carreau.
Ainsi le pouvoir de marché n’est pas tant déterminé par le degré de concurrence entre les agents, mais bien par la distribution de la richesse. Le capitalisme permet bien la domination structurelle des dominants sur les dominés. En suivant cette conception renouvelée du pouvoir capitaliste, on voit d’ailleurs qu’il ne se limite pas au pouvoir de l’employeur sur le marché de l’emploi, mais qu’il se déploie également ailleurs que dans le rapport salarial et la sphère de la production.
II) L’exploitation au-delà de la relation salariale : sous-traitance, crédit et rente
| « L’appropriation prend une variété de formes imbriquées, dispersées et réticulaires, souvent indirectes et en cascade. » |
Aujourd’hui, l’exploitation capitaliste ne passe pas uniquement par le rapport salarial, mais se déploie aussi dans de nouvelles sphères de l’économie : la sous-traitance, le crédit, et la rente. Selon Lojkine, ces formes d’exploitation ne sont pas dérivées de l’exploitation salariale, comme l’avançait Marx : elles existent de manière autonome, indépendamment de celle-ci. L’exploitation capitaliste n’est plus cantonnée à la seule sphère de la production, mais s’étend aussi à la sphère de la circulation des échanges. Si l’auteur rappelle toutefois la place particulière que continue de jouer le salariat, il permet de poser en de nouveaux termes le rôle de l’endettement, de la finance, ou encore de l’exploitation locative ; ainsi que leurs conséquences politiques.
L’exploitation commerciale par la sous-traitance
L’exploitation par la sous-traitance prend bien sûr une place croissante dans l’économie. Pour autant, cela ne doit pas nous faire oublier qu’elle a toujours existé dans l’Histoire. Déjà au XVIIIe siècle, les « manufactures » organisaient le travail sous une forme ternaire, c’est-à-dire avec trois parties prenantes. Le marchand ou négociant fournissait la matière première à un chef d’atelier, qui s’occupait de faire effectuer le travail par d’autres ouvriers que lui. Ce travail par intermédiaire a été perçu par Marx comme un modèle hybride, en transition vers le salariat traditionnel. Théoriquement, il l’analyse comme un rapport de salariat déguisé. Or, si le salariat s’est imposé comme la relation de travail dominante au XIXe et XXe siècle, la sous-traitance n’a jamais vraiment disparu. Surtout, Lojkine avance qu’elle a fait son grand retour à l’ère du capitalisme néolibéral, ce qui justifie de l’analyser comme une forme autonome d’exploitation.
Ces dernières décennies, la production s’est fragmentée à l’échelle mondiale, et le modèle d’entreprise en réseaux s’est largement développé. Aujourd’hui, « deux entreprises participant au même réseau sont désormais en moyenne séparées de dix chaînons intermédiaires par lesquels transitent les pièces ou les produits semi-finis ». Dans ce contexte, les entreprises elles-mêmes sont prises dans des rapports commerciaux inégaux. À l’échelle internationale, les grandes entreprises donneuses d’ordre du Nord externalisent leur production en faisant appel à des entreprises du Sud, qui embauchent elles-mêmes les travailleurs nécessaires. Cette relation implique des rapports de pouvoir ambivalents.
Pour illustrer ces rapports, Lojkine prend l’exemple d’un atelier de textile au Maroc, sous-traitant de Zara, qui fait travailler ses ouvriers dans un sous-sol. En 2021, 28 d’entre eux y trouvent la mort, suite à des inondations qui engloutirent l’atelier sans laisser aucune possibilité d’évacuation. En remontant la chaîne des responsabilités de cet accident, on met en lumière la position ambivalente de l’employeur intermédiaire : le chef de l’atelier de textile marocain est bien sûr responsable, dans la mesure où il exploite ses ouvriers (il extorque une partie de leur travail) et les fait travailler dans les conditions déplorables qui ont conduit à leur mort. Mais il y a bien un autre responsable : Zara, l’entreprise donneuse d’ordre, qui pousse ses sous-traitants à abaisser au maximum le coût du travail – jusqu’à entasser les ouvriers dans un sous-sol – pour augmenter ses propres profits.
Ces rapports d’exploitations inter-entreprises se jouent aussi à l’intérieur même des pays du Nord. C’est le cas avec les franchises. McDonald’s, Carrefour, Franprix… Toutes ces entreprises fonctionnent par système de franchise, dans lequel l’entreprise au sommet impose à ses franchisés leur fonctionnement, leurs prix, etc. Elles s’approprient ainsi de fait une partie de leur profit.
L’intérim, qui s’est largement développé ces dernières années, renvoie également à ce mode d’exploitation en cascade. Pour Lojkine, ces éléments témoignent de l’existence d’une forme d’exploitation commerciale entre des employeurs dominants et des employeurs intermédiaires : le dominant exerce sur le dominé un contrôle partiel de ses moyens de production et de son procès de travail, entraînant une appropriation partielle de son profit.
Ce phénomène s’observe par exemple à l’échelle de l’économie française. Entre 1990 et 2006, la part du profit (donc le taux d’exploitation) dans la valeur ajoutée totale est restée stable. Mais cette apparente stabilité cache deux dynamiques plus précises : si la part des profits dans chaque entreprise a bien diminué en moyenne à l’échelle nationale, les entreprises dans lesquelles le taux de profit a augmenté ont, elles, vu leur poids accru dans l’économie globale. Il y a eu une réallocation des profits entre les entreprises : autrement dit, un transfert de la valeur, et donc du surtravail de nombreuses petites et moyennes entreprises vers quelques très grandes. Donc un rapport d’exploitation.
L’exploitation financière par le crédit
Les employeurs comme les travailleurs peuvent être pris dans un autre rapport d’exploitation : celui du crédit, qui a gagné en importance à mesure de la financiarisation de notre économie. Lojkine distingue plusieurs strates de cette exploitation financière. La première est bien sûr l’actionnariat. Elle constitue une forme d’exploitation évidente, puisque l’actionnaire reçoit de l’argent (des dividendes) sans avoir fourni aucun travail, mais uniquement parce qu’il détient, via ses actions, les moyens de production.
L’exploitation par le crédit – via le versement d’intérêts – est quant à elle plus indirecte, mais toute aussi centrale. Le créancier ne détient certes pas les moyens de production, mais des fonds. En échange de ce prêt de fonds, il reçoit une somme d’argent. Ce rapport d’exploitation touche les entreprises (les capitalistes) comme les ménages. En effet, le capitalisme contemporain a connu une hausse considérable de l’endettement des entreprises. Non seulement le flux des intérêts est de plus en plus important, mais surtout, l’importance prise par ce rapport de crédit a un impact sur le rapport salarial au sein des entreprises. La pression financière exercée par les banques et les marchés financiers poussent notamment les entreprises à comprimer la masse salariale ou à réduire les salaires pour répondre aux attentes du marché. Le crédit est donc indirectement un instrument de discipline du travail qui permet d’intensifier l’exploitation.
Surtout, on ne contracte pas que pour investir, mais aussi pour assurer sa propre subsistance. Aujourd’hui, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers ou encore les crédits étudiants sont structurants dans la vie des classes populaires : « l’exploitation financière a autant de prise sur les travailleurs que l’exploitation salariale », résume Lojkine.
La relation de pouvoir (deuxième pan de l’exploitation) induite par le crédit se cristallise dès la phase de sélection, qui implique, pour celui qui souhaite contracter un crédit, de discipliner sa conduite ; puis la violence peut intervenir tout au long du crédit, à travers, en cas de défaut de paiement, une saisie sur le revenu ou une exclusion du marché.
Ainsi, « si Sisyphe, qui doit jour après jour pousser son rocher […] peut être comparé au salarié contraint jour après jour de suivre d’épuisantes prescriptions pour gagner ses moyens de subsistance, alors le crédit doit plutôt être comparé à l’épée de Damoclès qui ne fait peser aucune contrainte directe mais menace à tout instant de s’abattre sur l’imprudent ».
L’exploitation rentière
Le troisième rapport d’exploitation qu’analyse Lojkine est celui de la rente. Là aussi, il se déploie aussi bien entre les capitalistes qu’en direction des travailleurs. Il s’agit de s’approprier de la valeur, non pas grâce à la détention des moyens de production et donc à l’appropriation du surtravail, mais du simple fait du contrôle opéré sur une ressource ou un actif.
Pour ce qui est des rapports inter-capitalistes, l’exploitation rentière s’articule souvent avec l’exploitation commerciale. Elle s’appuie notamment de plus en plus sur la propriété intellectuelle : c’est le cas pour le rapport de franchise, déjà évoqué précédemment, dans lequel le franchisé paie pour utiliser la marque du franchiseur ; et qui s’accompagne parfois d’une rente foncière de la part du franchiseur, comme par exemple pour McDonald’s. On peut aussi penser aux brevets concernant des innovations technologiques, qui ont explosé ces dernières années notamment dans le domaine du numérique et qui reproduisent la même logique.
En plus d’être un rapport de force entre fractions du capital, la rente est aussi extraite directement sur les travailleurs, et ce de multiples façons. La plus frappante d’entre elles se joue sur le marché immobilier : c’est l’exploitation locative. Ici, comme pour le crédit, le rapport de pouvoir de la rente (en l’occurrence, du propriétaire immobilier) se cristallise en deux moments. En amont, les ménages sont soumis à l’arbitraire du propriétaire pour réussir à trouver un logement à louer. Ensuite, la menace de l’expulsion joue à tout moment aussi un rôle disciplinaire sur le locataire. Cette exploitation rentière, notamment immobilière, est essentielle aujourd’hui : dans tous les pays européens, pour le tiers des ménages les plus modestes, le loyer représente désormais plus d’un tiers du revenu, en nette augmentation par rapport aux années 1990.
Pour Marx, ces formes d’exploitation existent bel et bien, mais elles sont subordonnées à l’exploitation salariale, qui est perçue comme le rapport d’exploitation primordiale. Lojkine reconnaît lui aussi sa centralité (il concerne une immense majorité des travailleurs), mais il insiste sur sa spécificité : contrairement aux autres rapports d’exploitation, le rapport salarial déploie une forme de contrôle direct sur le travailleur ; et permet l’accumulation du capital industriel, donc le développement des forces productives, élément central du capitalisme. Mais il affirme que les autres formes d’exploitation ne lui sont pas subordonnées : elles peuvent exister sans lui, et ont pris une importance considérable dans le capitalisme contemporain.
III) Dépasser le capitalisme : le défi de la coordination
Le capitalisme, un rapport de coordination
| « [Le capitalisme est] un épais réseau de transactions commerciales, salariales et financières reliant à plusieurs échelles, de manière souvent indirecte, des agents individuels ou collectifs dispersés à la surface de la planète et dont les besoins se déterminent mutuellement. » |
Comment le capitalisme, comme système de production et d’exploitation, tient-il ensemble malgré sa dispersion en une multiplicité d’échelles ? Lojkine propose de concevoir le capitalisme non seulement comme un mode d’exploitation, mais aussi comme un système de coordination des activités entre elles. « En même temps qu’elle organise l’exploitation, la structure du capitalisme tient ensemble ceux qui y participent d’une manière relativement cohérente malgré leur dispersion », explique-t-il. Les mêmes institutions capitalistes qui organisent l’exploitation organisent cette coordination : le capitalisme fonctionne grâce à ces deux jambes.
Lojkine examine ainsi le rôle des trois institutions centrales du capitalisme : la propriété privée, le marché, et l’organisation hiérarchique de l’entreprise. Sans laisser de côté les failles et les limites de cette coordination, dont témoignent les nombreuses crises et la persistance du chômage, il souligne le rôle clé que jouent ces institutions dans le fonctionnement de l’économie à l’échelle globale.
La propriété privée, d’abord, permet d’abord une simple coordination négative, au sens où elle empêche le gaspillage des ressources et les conflits d’appropriation. À cette première forme primaire de coordination s’ajoute une coordination positive, celle du marché. Le marché permet en effet de coordonner les échanges entre des individus dispersés au quatre coins du monde, notamment grâce au « système impersonnel de prix ». Plus précisément, le marché des capitaux coordonne en sélectionnant les meilleurs investisseurs potentiels ; tandis que le marché de l’emploi coordonne en jouant un rôle d’appariement entre des travailleurs et des entreprises. Enfin, le capitalisme ne pourrait fonctionner sans une troisième institution coordinatrice : la structure hiérarchique au sein de l’entreprise. Elle prend la forme d’un commandement vertical et d’une distribution des tâches de chacun pour permettre de remplir l’objectif de production de l’entreprise. Lojkine souligne par ailleurs l’existence d’autres institutions de coordination, comme les formes de coordination particulières des entreprises en réseaux, évoquées précédemment. En somme, les formes de coordination du capitalisme sont elles aussi variées, tantôt marchandes et tantôt hiérarchiques, en fonction des spécificités de chaque activité.
Si Marx avait analysé le rôle structurant de la coordination dans le capitalisme, il la considérait toutefois comme secondaire face au rapport de production. C’est ce dernier qui, in fine, (re)conduit l’exploitation. Or, ce rapport de production peut être défini de deux manières dans la théorie marxiste. Au sens restreint, il désigne le rapport de production au sein de l’entreprise, et donc le seul rapport employeur/salarié. Ici, la sphère de production immédiate (le salariat) domine la sphère de la circulation (des échanges). Mais au sens large, il désigne les rappports dans la structure économique général du capitalisme. C’est dans cette deuxième conception du rapport de production que s’insère la thèse de Lojkine. En ce sens, il n’y a pas de séparation entre la sphère de la circulation et la sphère de la production dans l’économie : les deux sont transversales, et l’exploitation se déploie dans l’une comme dans l’autre.
Pour une coordination socialiste : planification, droits sociaux ou algorithmes d’appariement ?
| « Si les rapports d’exploitation actuels sont ancrés dans les institutions de coordination du capitalisme, alors ce sont d’autres institutions de coordination aux propriétés différentes qu’il faudrait mettre en place pour abolir l’exploitation. » |
Dès lors, pour remplacer le système capitaliste qui permet l’exploitation, l’enjeu est d’imaginer des formes alternatives – et au moins aussi efficaces – de coordination pour assurer la tenue de ce nouveau mode de production. L’auteur nous propose de se pencher sur deux institutions alternatives au capitalisme qui se sont développées à grande échelle historiquement : la planification étatique et les droits sociaux. Il en montre l’intérêt pour abolir (ou a minima contenir) l’exploitation, mais aussi les limites en termes de coordination, et propose donc de s’appuyer sur une troisième institution : les algorithmes d’appariement.
La logique de la planification étatique se définit par deux éléments : l’État fixe des objectifs en nature à atteindre en un temps défini ; et il utilise les différents leviers à sa disposition (y compris la coercition si nécessaire) pour les atteindre. L’expérience planificatrice historique la plus intéressante pour nous – sans en faire, loin s’en faut, un modèle – est celle de l’économie soviétique, puisqu’elle a, dans une certaine mesure, aboli la propriété lucrative, transformé radicalement les rapports de production et ainsi amoindri l’exploitation salariale. Sans compter la question fondamentale de l’inégale distribution du pouvoir dans le système soviétique, qui remet en cause l’idée d’une abolition de la domination, c’est aussi le caractère bureaucratique et vertical de la coordination qui pose problème. Lojkine avance ainsi que la planification étatique, dans son modèle traditionnel, ne permet pas de tenir suffisamment compte de la diversité des besoins et des désirs individuels dispersés. Elle est adéquate et même particulièrement efficace pour remplir un objectif collectif précis et situé, tel que la bifurcation écologique, mais insuffisante à l’échelle d’une économie entière.
Les droits sociaux, quant à eux, se sont développés au sein même des économies capitalistes suite aux luttes des travailleurs. On peut les définir comme « un droit qu’un individu ou un collectif peut faire valoir sur la société ou sur d’autres agents privés, et qui prime sur le droit de la propriété privé et des contrats ». Leurs trois piliers – la protection sociale, le droit du travail et les services publics – permettent indéniablement de contenir l’exploitation. Par exemple, au sein de la relation d’emploi, le droit du travail limite directement le droit patronal, tandis que la sécurité sociale et les services publics sortent partiellement du marché l’accès à des besoins essentiels (santé, éducation…). Mais les droits sociaux font face à une limite essentielle : leur logique n’est pas souveraine dans le capitalisme. Ces derniers agissent aujourd’hui comme un correctif, un complément au capitalisme, mais jamais comme un substitut.
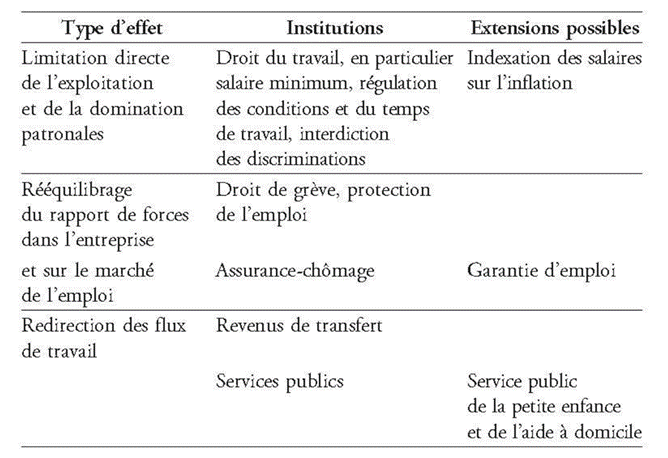
Lojkine résume alors l’enjeu comme suit : « Existe-t-il un système moderne de coordination socialiste à grande échelle qui ne soit ni, comme l’État social, un simple complément au mécanismes capitalistes, ni, comme le socialisme bureaucratique, soumis aux objectifs fixés au niveau de l’État ? ».
Il propose pour cela une piste innovante : s’appuyer sur les algorithmes d’appariement pour coordonner les échanges, qui opèrent des calculs d’optimisation économiques à la place du marché. L’intérêt est d’organiser une coordination par le bas, comme le marché, et non par le haut, comme la planification bureaucratique, mais en s’appuyant sur une décision politique démocratique, et non sur la « main invisible du marché ». Ce type d’algorithmes – algorithmes d’acceptation différée ou algorithmes des cycles d’échange – est déjà utilisé dans de nombreux pays pour diverses activités économiques nécessitant une coordination à très grande échelle : par exemple, pour allouer les greffes de reins entre donneurs et malades.
L’originalité de la proposition est de distinguer le moment de la décision politique – quelles règles souhaitons-nous pour faire fonctionner ces algorithmes ? – et le moment de l‘exécution, du fonctionnement économique. Il ne s’agit pas de s’en remettre aveuglément à des solutions technologiques au détriment de la décision collective, mais de s’appuyer sur des institutions déjà existantes pour mettre en œuvre un projet politique clairement défini, en l’occurrence anticapitaliste. En ce sens, Lojkine avance qu’une forme d’utilisation démocratique de ces algorithmes d’appariement pourrait résoudre le problème de coordination à grande échelle, tout en s’inscrivant dans un mode de production et d’échange socialiste qui abolirait l’exploitation.
Reste bien sûr à la décision démocratique la tâche de penser l’articulation de ces différentes institutions alternatives au capitalisme (planification, droits sociaux et algorithmes d’appariements), et la manière de les mettre en œuvre dans les conditions actuelles.
Conclusion
Que retirer de ce vaste travail d’élaboration théorique exposé dans Le fil invisible du capital ? D’abord, une compréhension plus fine du capitalisme contemporain. La financiarisation, la fragmentation de la production, la multiplicité des formes d’emplois, l’émergence d’un capitalisme rentier ou tributaire… : toutes ces tendances ont largement transformé les mécanismes par lesquels le capitalisme se déploie et se reproduit. Lojkine nous propose non seulement une description précise et essentielle de ces transformations, mais il analyse aussi la manière dont elles redéfinissent le cœur même de capitalisme. L’exploitation devient alors multiple, complexe, toujours plus insaisissable : elle ne se limite pas à la sphère de la production au sens de l’entreprise, mais se déploie également dans toutes les sphères de circulation de la valeur. L’extension du capitalisme à l’ensemble des sphères sociales nécessite pour l’appréhender une extension de la théorie de l’exploitation. De ce fait, la distinction entre les exploiteurs et les exploités se brouille elle aussi, et n’est peut-être plus aussi univoque qu’avant. La structure d’exploitation contemporaine définit une nouvelle multiplicité de positions de classes. Dans le même temps, ce que Lojkine ne dit pas, c’est que la généralisation de l’exploitation capitaliste à d’autres conditions que le salariat produit aussi une homogénéisation de tous ceux qui sont pris d’une manière ou d’une autre dans les rets surplombants des rapports de coordination capitalistes. De ce point de vue, on peut voir des correspondances entre la mise à jour de la théorie de l’exploitation par Lojkine et la théorie de l’ère du peuple .
Cette grille de lecture marxiste actualisée doit aussi nous permettre de poser à nouveaux frais la question de la construction d’un front de lutte anticapitaliste. Autour de quel sujet politique collectif doit-il se former ? Alors que l’ouvrier (ou même le salarié) représentait sans conteste l’acteur révolutionnaire aux siècles passées, la multiplication des rapports d’exploitation et de domination présentée dans l’ouvrage dessine un sujet exploité à construire dans un agrégat social pluriel dans des luttes sûrement plus intersectionnelles qu’avant et prenant en compte la manière dont le capitalisme saisi les individus en dehors du seul rapport salarial.
Enfin, en décrivant le capitalisme comme le couplage d’un système d’exploitation et d’un système de coordination efficace, l’ouvrage met en lumière un enjeu trop souvent éludé : pour renverser le capitalisme, il nous faudra non seulement abolir l’exploitation (ce qui est déjà une lourde tâche), mais aussi inventer des modes de coordination socialiste des échanges suffisamment structurés et efficaces pour garantir la tenue de nouvel ordre.
Le fil invisible du capital ne donne de réponse définitive à la question du dépassement du capitalisme, bien sûr. Mais la description de ses mécanismes, de ses forces et de ses faiblesses permet d’avancer considérablement dans la réflexion et la construction d’une stratégie anticapitaliste pour le 21e siècle.
| Pour aller plus loin : – Simon Verdun, La critique de l’exploitation peut-elle se passer de la théorie marxiste de la valeur ? Sur le livre d’Ulysse Lojkine, Contretemps, Septembre 2025. URL : https://www.contretemps.eu/critique-exploitation-capitaliste-theorie-marxiste-valeur/ – Jacques Bidet, Une ambitieuse alternative au « Capital ». Sur le livre d’Ulysse Lojkine, Contretemps, Octobre 2025. URL : https://www.contretemps.eu/une-ambitieuse-alternative-au-capital-sur-le-livre-dulysse-lojkine/ – Conférence d’Ulysse Lojkine, Hannah Bensussan, Marlène Benquet et Hadrien Clouet aux Amfis, Le capitalisme aujourd’hui : déchiffrer l’exploitation invisible, Août 2025. URL : https://www.youtube.com/watch?v=WjFWJfwmuF0 |
21.10.2025 à 11:49
Quand Philippe Aghion abîme le débat économique
Texte intégral (1088 mots)
Cette tribune, initiée par des économistes de tout le pays contributeur·ices des travaux de l’Institut La Boétie, est parue dans Alternatives Économiques le lundi 20 octobre 2025.
Fraichement auréolé de son « prix Nobel d’économie », Philippe Aghion était l’invité de BFMTV vendredi 17 octobre. Interrogé sur des questions économiques et politiques, il a affirmé mettre le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI) « sur le même plan ». Pour les signataires de cette tribune, qui ont contribué aux travaux de l’institut La Boétie sans pour autant être tous des soutiens inconditionnels de LFI, c’est une formule rapide, un effet de manche, qui est un double contresens.
D’abord parce qu’elle entretient un confusionnisme dangereux : quelle que soit l’hostilité que l’on peut nourrir à l’égard de tel ou tel programme, les valeurs, les pratiques et les propositions portées par ces deux forces politiques ne sont ni équivalentes ni interchangeables. Indépendamment de l’opposition fondamentale entre un mouvement défendant des valeurs humanistes (LFI) et un autre dont l’ADN est le rejet de « l’autre » (RN), leurs programmes économiques sont radicalement opposés.
Quand LFI propose une rupture avec le néolibéralisme, le RN le conforte. Quand LFI propose d’abroger la réforme portant l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, le RN oscille entre retour à 62 ans ou au contraire allongement à 65 ans. Quand LFI propose un système fiscal plus progressif et une meilleure redistribution des richesses, le RN promeut des mesures limitant les ressources de l’État et fragilisant notre système de protection sociale. Quand LFI propose de conditionner les aides aux entreprises, le RN s’aligne sur les positions du Medef. Quand LFI propose de s’engager résolument dans la planification écologique, le RN défend les politiques responsables de la crise climatique. Quand LFI promeut la hausse du SMIC, et plus généralement celle de l’ensemble des salaires, afin d’offrir des débouchés à la production des entreprises, le RN s’y oppose au nom d’une politique de l’offre qui a pourtant montré son inefficacité.
La formule de Philippe Aghion est également un contresens scientifique. En effet, lorsqu’un économiste est érigé en autorité scientifique, il lui revient plus que jamais de poser des critères, des faits et des arguments, plutôt que des sentences qui ferment la discussion. À l’heure où le débat public est miné par les « vérités alternatives » et les attaques contre la science, dévaluer la parole savante par des jugements à l’emporte-pièce, c’est affaiblir l’exigence de rationalité dont nous avons collectivement besoin.
Cette mise à distance du travail d’argumentation est d’autant plus regrettable qu’elle vient d’un chercheur reconnu qui, depuis son piédestal académique, n’hésite pas à intervenir dans le débat public afin de promouvoir le rôle de l’innovation. Or, trop souvent, la défense généreuse de l’innovation a servi de paravent à la préservation de rentes privées. De fait, les politiques de l’offre mises en place depuis 2014 par Emmanuel Macron, d’abord comme ministre de l’économie puis en tant que président de la République — CICE, baisse de la fiscalité sur les plus riches, flat tax, etc. — ont eu un coût budgétaire massif sans parvenir à transformer notre structure productive ni renforcer notre économie.
Si l’on veut parler sérieusement d’efficacité, jouons cartes sur table : l’attractivité de la France, mesurée par la hausse des investissements directs étrangers, se traduit aussi par des rachats d’entreprises françaises, donc par une perte de souveraineté économique. Philippe Aghion revendique sa participation à l’élaboration de ces politiques de « compétitivité » sans aucun recul critique ni esquisse d’un bilan de ces mesures.
Autre paradoxe : on ne peut pas marteler le rôle central de l’éducation dans le processus d’innovation tout en adoubant des politiques qui détruisent les bases de notre système éducatif. L’innovation n’advient pas par incantation. Elle réclame des enseignants considérés, des filières de formation continue sérieusement dotées, une recherche publique stable et exigeante, et un État stratège qui oriente, évalue et corrige. Si nous voulons une économie créative et robuste, la condition première est là : investir dans les capacités collectives plutôt que multiplier les cadeaux fiscaux sans conditionnalité.
Revenons alors à la méthode. Mettre RN et LFI « sur le même plan » n’est pas une analyse, c’est un argument d’autorité manipulateur et sans fondement. La science, elle, commence par spécifier un cadre, explicite des hypothèses, discute des preuves empiriques et accepte le débat contradictoire. Elle n’est ni un propos d’estrade, ni une morale commode qui distribue bons et mauvais points. Le rôle public des chercheurs n’est pas d’arbitrer la démocratie à la place des citoyens, mais d’éclairer les alternatives, d’en chiffrer les effets, d’en nommer les coûts et les bénéfices — y compris lorsque ces résultats contredisent leurs préférences. C’est cette éthique de la discussion que nous défendons.
Nous n’esquivons pas le débat, bien au contraire. Plutôt que d’en rester aux passes d’armes télévisuelles, nous proposons à Philippe Aghion un débat public, contradictoire et sourcé sur ses hypothèses théoriques et l’impact des politiques économiques menées par Emmanuel Macron, qu’il a largement soutenues, ainsi que sur les alternatives possibles.
Il y a, au fond, deux conceptions du débat démocratique. La première, verticale et paresseuse, aligne des étiquettes et met tout « sur le même plan » pour s’éviter toute contradiction. La seconde accepte la complexité : elle distingue, mesure, compare, et reconnaît le droit au désaccord — à condition qu’il soit informé. Nous plaidons pour cette seconde voie, non par courtoisie académique, mais parce qu’elle est la seule à la hauteur des défis économiques que nous devons relever. C’est ainsi que nous ferons progresser la science et la démocratie.
03.10.2025 à 17:31
Les jours fériés, une lutte de classes
Texte intégral (3330 mots)
| Note de lecture de l’ouvrage d’Hadrien Clouet, « De quoi les jours fériés sont-ils le nom ? », Éditions Le Bord de l’eau, octobre 2025 |
Hadrien Clouet est sociologue et député de la France insoumise depuis 2022. Il est chercheur associé au CERTOP (Université Toulouse-Jean Jaurès), au Centre de Sociologie des Organisations (Sciences Po) ainsi qu’au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (CNAM). Il est spécialisé dans la sociologie du travail et l’étude de l’action publique. Il est co-responsable du département de sociologie de l’Institut La Boétie. Il a notamment publié Emplois non pourvus : une offensive contre le salariat (2022) et coécrit Chômeurs, vos papiers ! (2023).
De quoi les jours fériés sont-ils le nom ? À l’été 2025, le gouvernement Bayrou a annoncé vouloir supprimer 2 jours fériés pour économiser 4,2 milliards d’euros et redresser les comptes publics. Dans ce court ouvrage, Hadrien Clouet explique que cette proposition n’est pas simplement une provocation isolée et anecdotique du macronisme. Elle s’inscrit dans la lutte de longue date que mène le capitalisme contre le temps libre des travailleurs et des travailleuses. Symbole du « travailler plus pour gagner moins » de la droite néolibérale, elle est aujourd’hui au cœur de l’offensive conservatrice contre les conquis sociaux.
Pour mieux comprendre cette opération, Hadrien Clouet remonte le fil de la longue histoire des jours fériés en France et des luttes sociales qui ont mené à leur instauration malgré l’hostilité du patronat. Il démontre ensuite comment la suppression de 2 jours fériés proposée par les macronistes vise en réalité à diminuer le salaire réel des travailleurs au profit du capital, un objectif central pour les néolibéraux. Il revient enfin sur les vertus sociales du temps libéré pour la société, en décrivant les formes d’activité et de sociabilité que permettent les jours fériés.
Ce livre déconstruit minutieusement les nombreux poncifs néolibéraux sur la question du temps de travail et propose au contraire une lecture politique de la mise en place des jours fériés. Ce faisant, il la donne à voir cette pour ce qu’elle est : une lutte de classes.
| « Les luttes du capitalisme sont des luttes de temps. » |
I) Les jours fériés : du temps libre gagné par les travailleurs contre les élites patronales et politiques
Les premiers jours fériés apparaissent dans notre histoire avec l’instauration de la République. Il s’agit alors de souder le peuple autour de moments importants de la construction nationale, comme la proclamation de la IIe République le 24 février, après l’abdication du roi Louis-Philippe Ier. C’est ensuite sous la IIIe République que naissent la plupart des jours fériés que l’on connaît aujourd’hui : le 14 juillet, bien sûr, mais aussi les lundis de Pâques et de Pentecôte rendus fériés par la loi du 8 mars 1886. Surprenamment, la demande n’émanait pas des instances religieuses mais des banques et des chambres de commerces, pour des raisons purement commerciales et financières[1]. Malgré cela, la résistance patronale se met rapidement en place, notamment dans le secteur de l’industrie. Beaucoup d’employeurs refusent d’octroyer ces jours fériés à leurs employés. Les procès verbaux pour « violation de jours fériés légaux » se multiplient partout sur le territoire. C’est seulement grâce à la mobilisation des syndicats, associations et autres organismes publics que les salariés pourront bénéficier effectivement de ces droits.

Cet affrontement de classe est encore plus marqué dans le cas du Premier Mai, journée internationale des travailleurs, rendu férié par la mobilisation consciente de la classe ouvrière. Dès 1889, le congrès socialiste de Paris exige de proclamer ce jour férié. Les mairies socialistes puis communistes vont ensuite progressivement le mettre en place pour leurs propres services municipaux et défendre sa généralisation à l’ensemble du pays, en demandant un vote de la chambre des députés. Après son instrumentalisation par le régime de Vichy – qui le transforme en « Jour du Travail » – le Premier Mai est inscrit dans le marbre à la Libération par les forces de la résistance. Le 1er mai 1946 est le premier chômé à salaire constant. En 1947, le gouvernement pérennise la disposition pour tous les premiers mai à venir, et la loi du 29 avril 1948 précise les modalités de cette généralisation.

L’instauration du 8 Mai férié a elle aussi été le fruit d’un long combat. Au lendemain de la guerre, l’État ne souhaite pas reconnaître la spécificité de la victoire du 8 mai 1945 contre le nazisme, trop marquée politiquement par la résistance antifasciste et communiste. Alors que le 11 Novembre est rendu férié dès 1922 en hommage aux morts de la Première Guerre mondiale, le jour de la capitulation allemande devra attendre 1953 – et des années de mobilisations communistes et gaullistes – avant de devenir un jour férié.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans les années qui suivent, le 8 Mai férié sera régulièrement supprimé puis rétabli – pour des raisons à la fois politiques et économiques. En 1959, De Gaulle décale la commémoration nationale au deuxième dimanche de mai, avec les mêmes justifications que celle d’un François Bayrou aujourd’hui : de trop nombreux ponts tueraient la productivité nationale… S’ensuivent plusieurs années de va-et-vient. En 1975, le président Valéry Giscard d’Estaing abroge tout simplement la commémoration officielle de la victoire sur le nazisme, au nom de l’amitié franco-allemande. En 1979, le Sénat vote son rétablissement comme jour férié, avant qu’il ne redevienne définitivement un jour férié et chômé sous la présidence de François Mitterrand.
Avec six évolutions en un demi-siècle, le 8 Mai symbolise à lui seul le caractère profondément politique et polarisant des jours fériés.
| Trop de jours fériés : les Français travaillent-ils vraiment moins que leurs voisins ? L’idée selon laquelle les Français travaillent moins que leurs voisins européens est un mythe, y compris du point de vue du nombre de jours fériés, rappelle Hadrien Clouet. • Les pays de l’Union européenne comptent en moyenne 12 jours fériés par an. Avec ses 11 jours fériés, la France se situe en dessous, à l’inverse de Chypre (15), de l’Espagne, Malte et la Slovaquie (13) ou encore de la Finlande, l’Autriche et le Portugal (13). • Même si on additionne jours fériés et congés payés, la France comptabilise 36 jours, contre 44 pour l’Espagne et Malte, 38 pour l’Autriche et 37 pour le Luxembourg. • Le temps de travail des Français n’est pas plus faible qu’en Europe. Un salarié français travaille 1491 heures par an en moyenne : c’est plus que les Allemands, les Danois, les Norvégiens, les Suédois, les Autrichiens, les Islandais, les Hollandais ou encore les Luxembourgeois. • Le temps de travail hebdomadaire moyen en France est de 37 heures. Mais il cache de fortes disparités. 1 salarié sur 5 travaille plus de 48 heures par semaine. Pour ces travailleurs, supprimer un jour férié équivaut à supprimer l’une de leurs dernières bouées de sauvetage. |
II) L’offensive macroniste contre les jours fériés : une extorsion du salaire pour les poches du capital
Derrière la justification budgétaire du Gouvernement – « Il faut sauver les finances publiques » – la suppression des jours fériés cache en réalité un autre objectif : diminuer les salaires réels et accroître les profits privés. En supprimant des jours fériés, l’État entend se faire de l’argent sur le dos du travail gratuit des salariés, tout en taxant une une partie du revenu de l’entreprise en contrepartie de ce surcroît d’activité. Or, cette contribution patronale n’est pas fléchée. On ne sait donc même pas où ira le fruit de notre travail gratuit : « Va-t-on travailler gratuitement pour financer les engagements présidentiels en matière de Défense nationale à 5 % du produit intérieur brut, dans une logique farfelue voulant que l’on indexe nos crédits militaires sur le niveau de richesse du pays ? Va-t-on abdiquer le droit au repos pour passer commande auprès du complexe militaro-industriel nord-américain ? » (p. 33).

C’est un retournement de la logique de la Sécurité sociale, explique Hadrien Clouet. Depuis 1946, le développement de la protection sociale reposait sur une hausse continue des cotisations qui augmentait ses recettes. La Sécurité sociale ne s’est jamais appuyée sur la réduction de la rémunération du travail : au contraire, son fonctionnement repose sur la hausse des salaires. Or, aujourd’hui, les macronistes veulent renverser cette logique et lier le destin de la Sécurité sociale au développement du travail gratuit, en imposant l’idée que les comptes de la Sécurité sociale seraient minés par une trop forte rémunération du travail. Ils créent ainsi une opposition factice entre salariés et assurés, alors que le principe de la protection sociale est justement de lier leur sort.
Mais combien vaut cette manœuvre idéologique ? Pas beaucoup, visiblement. L’ancien Premier ministre François Bayrou estime à 4,2 milliards d’euros le gain de la suppression de deux jours fériés. Et encore, « le chiffre a été inventé sur un coin de table », avance Hadrien Clouet, et se fonde sur un calcul très incertain. En réalité, les recettes supplémentaires de la suppression d’un jour férié gravitent plutôt autour d’1,5 milliard d’euros, selon l’OFCE. Donc environ 3 milliards pour deux jours.
À titre de comparaison, la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a coûté 4,5 milliards d’euros, soit 3 jours fériés. La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 5 milliards, soit plus de 3 jours fériés. La mise en place de la flat tax : 4 milliards, soit 2,5 jours fériés. Autrement dit, rétablir l’ISF, la CVAE et l’imposition mobilière nous rapporterait 9 jours fériés ! Par ailleurs, les gains économiques attendus liés au regain d’activité productif sont illusoires : dans un contexte d’austérité sans précédent, la consommation populaire est largement en berne.

Ceux qui vont s’enrichir de cette mesure, ce sont donc les capitalistes. En faisant appel aux fondamentaux marxistes, Hadrien Clouet nous rappelle le principe du salaire : c’est la rémunération versée en échange de la location d’une force de travail pour un temps donné. Ainsi, « lorsque l’on loue sa force de travail plus longtemps, mais à salaire constant, il est évident que le prix de cette force de travail a baissé. ». Or c’est précisément l’objectif de la suppression des jours fériés. Travailler 2 jours de plus sans hausse de salaire, cela revient à perdre environ 1 % de rémunération annuelle, voire davantage pour les salariés disposant d’un accord de branche et qui bénéficiaient d’une majoration pour leur travail en jour férié.
Le gouvernement cherche donc à augmenter le temps de travail par tous les moyens. Sa dernière invention en date : la monétisation de la cinquième semaine de congés payés. Autrement dit, il s’agit d’offrir aux salariés la possibilité d’abandonner leur semaine de congé contre une rémunération supplémentaire. Jours fériés, congés payés, retraite… : l’offensive néolibérale pour rogner sur le temps libre restant est générale.
III) Le temps libéré, ferment d’une société de l’intérêt général
| « Sauver, garantir et augmenter les jours fériés demeure donc un outil fondamental pour donner un sens irréductiblement collectif et autonome à nos existences. » |
La suppression des jours fériés est non seulement antisociale et inutile économiquement, elle est aussi nuisible aux activités solidaires et collectives de notre société. L’extension continue de la sphère marchande étouffe les vertus sociales et politiques du temps libre, explique Hadrien Clouet.
Aujourd’hui, le jour férié n’est plus nécessairement un grand rassemblement national commémoratif. L’usage du temps libre et du divertissement est plus fragmenté, plus divers que dans le passé. Mais les jours fériés continuent de jouer un rôle de « synchronisation collective des temps non lucratifs ». Certes, une fraction non négligeable de salariés continuent de travailler les jours fériés, et il est difficile de savoir exactement combien d’entre eux chôment ces jours fériés. Mais l’enquête Emploi de l’INSEE montrent tout de même qu’en présence d’un jour férié, le temps de travail hebdomadaire général baisse de 31 %. Les jours fériés demeurent une expérience de masse.

Mais que font réellement les travailleurs et travailleuses lors des jours fériés ? Comment profitent-ils de ce temps extraordinairement extirpé du quotidien marchandisé et à quelles fins ? C’est d’abord un temps où le repos devient possible, lui qui est continuellement réduit car il représente un obstacle à l’accumulation capitaliste à court terme. Le repos du jour férié est un acte informel de résistance explique Hadrien Clouet : un temps qui échappe à la tutelle patronale et aux cadences toujours plus effrénées du travail. Le temps libéré par le jour férié est aussi une occasion de travailler autrement, d’effectuer ce que l’anthropologue Florence Weber appelle le « travail d’à-côté » : bricolage, réparation, entretien…
Mais le temps libre des jours fériés permet plus que cela : il est aussi le temps du collectif, des loisirs partagées et des sociabilités. Pendant les jours fériés, le temps passé entre amis augmente de 20 minutes par rapport au reste du temps ! Ils renforcent les liens sociaux et les relations informelles au sein de la communauté, et notamment l’aide et la solidarité envers les plus vulnérables (rendre visite aux personnes âgées, donner du temps à une association…). Bref, les jours fériés sont souvent le temps de l’organisation collective, sociale, culturelle, politique, en dehors du rythme quotidien si empêchant. Ils sont donc le ferment d’une société de l’intérêt général. Les supprimer au nom de l’équilibre budgétaire, c’est avoir une basse idée de nos existences collectives, affirme Hadrien Clouet.
Il conclut en proposant non seulement de défendre nos onze jours fériés pour toutes les raisons évoquées, mais aussi d’en instaurer de nouveaux. Le propre du puissant est de dicter le temps du dominé, écrit Clouet. Renverser l’ordre des choses, c’est donc reconquérir ce temps à ceux qui le volent tout au long de nos existences. C’est la tâche de gauche de rupture si elle prend le pouvoir, qui pourrait alors instaurer de nouveaux jours fériés d’utilité publique qui symbolisent les conquêtes sociales du peuple et les grands moments de son histoire. Par exemple, le 24 février pour la mémoire de l’abolition de l’esclavage par le République, et le 18 mars, en mémoire de la Commune de Paris.
| « Être révolutionnaire, c’est assumer que la joie et le bonheur sont des objectifs en tant que tels. » |
22.09.2025 à 18:24
Quand l’histoire se répète ou comment l’extrême centre a porté Hitler au pouvoir
Texte intégral (4230 mots)
| Note de lecture de l’ouvrage de Johann Chapoutot, Les irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ?, Éditions Gallimard, 2025. |
Une idée répandue voudrait que Hitler soit arrivé au pouvoir par les urnes et qu’une irrésistible marée brune ait emporté l’Allemagne des années 1930 dans le nazisme. Il n’en est rien : les nazis n’ont jamais pris le pouvoir, on le leur a donné.
Dans son dernier livre, Johann Chapoutot montre que l’arrivée au pouvoir des nazis est en réalité le résultat d’une série de manœuvres, de paris et de calculs qui ont conduit à ce que les libéraux autoritaires de l’époque, désireux que leurs politiques, notamment économiques, continuent à être mises en œuvre, nomment eux-mêmes Hitler à la Chancellerie du Reich.
En plongeant dans ce livre sur les années 1920-1930, les similarités avec notre époque sautent aux yeux. Au-delà du spectacle abject de l’actualité – des saluts nazis d’Elon Musk et Steve Bannon aux candidats du RN en 2024 affublés d’une casquette nazie, en passant par les milices criant « Paris est nazi » et qui poignardent des militant·es de gauche – c’est l’analogie entre le contexte politique général des années 1920-30 et celui d’aujourd’hui qui frappe. Les mécanismes qui ont concouru à l’ascension des nazis et à la nomination de Hitler à la Chancellerie du Reich le 30 janvier 1933 semblent en effet d’une troublante actualité :
- Une Constitution permettant l’autoritarisme de l’extrême centre, qui refuse de respecter le résultat des élections et dont les courtisans et conseillers méprisent les idées démocratiques ;
- L’industrie médiatique, qui panique devant le « bolchévisme culturel » – une chimère, inventée pour désigner tout ce qui se rapporte de près ou de loin au progrès social – tout en répandant une idéologie raciste et antisémite propre à l’extrême droite ;
- Des personnalités politiques et médiatiques qui condamnent « les extrêmes » et diabolisent une supposée « extrême gauche », alors même que l’extrême droite terrorise réellement les rues et les esprits ;
- Un « cercle de la raison » autoproclamé qui poursuit une politique d’austérité résolument probusiness, aggravant les inégalités et minant l’économie nationale ;
- Une gauche social-démocrate déboussolée qui soutient cette politique, afin dit-elle, « d’éviter le pire » ;
- Une propagande va-t-en-guerre et une politique de puissance, mêlant expansionnisme et impérialisme territorial…
La liste des forfaitures et des compromissions qui ont mené à l’arrivée du nazime au pouvoir est longue. Mais loin de nous conduire à la fatalité et à la résignation, le livre de Johann Chapoutot nous enseigne une chose : les situations politiques ne sont jamais écrites à l’avance. À travers une galerie de portraits des hommes qui, par calcul ou par aveuglement, ont contribué à porter Hitler au pouvoir, l’historien montre que si les dynamiques structurelles de la montée de l’extrême droite (chômage, sentiment de déclassement, racisme…) jouent un rôle, elles ne suffisent pas à elles seules à expliquer son accession au pouvoir. Derrière la nomination de Hitler à la Chancellerie, il y a des visages et surtout des intérêts : ceux de la caste au pouvoir, dont la responsabilité est accablante.
Du comportement de l’extrême centre partisan au rôle des élites économiques, l’Institut La Boétie revient sur quelques-uns des éléments structurants du récit que fait le grand historien de l’accession au pouvoir du nazisme, malheureusement riche d’enseignement pour le présent.

I) Les libéraux autoritaires au pouvoir : en marche vers le fascisme
La crise politique de 1930 et le viol de la Constitution
C’est en décembre 1929 que le président de la République de Weimar, Paul von Hindenburg et Heinrich Brüning, futur Chancelier du Reich (équivalent au poste de Premier ministre), arrêtent, quelques mois avant la nomination de Brüning, un plan pour contourner la démocratie et conserver le pouvoir dans un contexte de crise politique.
Brüning est un technicien des finances publiques, docteur en économie et une figure importante de l’extrême centre allemand (Zentrum). C’est lui que le président Hindenburg décide d’appeler à la Chancellerie le 28 mars 1930 pour remplacer Heinrich Müller, le Chancelier social-démocrate, qu’il exècre au plus au point et auquel il reproche d’avoir échoué sur les questions sociales et budgétaires, alors que la crise économique frappe de plus belle l’Allemagne depuis l’automne 1929.
Leur objectif est clair : gouverner en faisant fi du Reichstag (le Parlement allemand), sur le fondement de l’article 48 de la Constitution. Cet article confère des pouvoirs exceptionnels à l’exécutif, destinés à être utilisés en cas de crise majeure. Cependant, les libéraux autoritaires en détournent l’usage : au lieu de répondre à un danger grave et imminent, l’article leur sert à promulguer des ordonnances en matière de législation financière (article 48-2), comme celles introduisant de nouvelles taxes sur le tabac et la bière.
Outre l’usage extensif et abusif de l’ordonnance législative, la nouvelle pratique institutionnelle du pouvoir fait basculer la République de Weimar dans un régime présidentiel autoritaire. La séquence du vote du budget est particulièrement saisissante à cet égard (toute ressemblance avec des faits contemporains existants serait fortuite). L’opposition social-démocrate rejette la politique austéritaire du gouvernement Brüning. En réponse, ce dernier utilise l’article 48-2 pour faire passer le budget en force. Pour le contrer, l’opposition a recours à l’article 48-3, dans le but de faire tomber le texte. L’article 48-3 dispose en effet que « les mesures ainsi prises [par le gouvernement] sont annulées à la demande du Reichstag ».
C’est alors que le Président Hindenburg décide, à la surprise générale, de dissoudre le Parlement (article 25). Profitant du vide parlementaire – l’Assemblée étant sans session, il fait adopter le texte budgétaire par l’article 48-2. Coup de théâtre : cette situation n’avait pas été prévue par les constituants de 1919 et contrevient gravement à l’esprit de la Constitution de 1919, en fragilisant l’équilibre entre les pouvoirs législatifs et exécutifs.
L’échec de la dissolution et la formation de gouvernements régionaux coalisant l’extrême centre et l’extrême droite
En pleine dérive autoritaire, le gouvernement est sanctionné dans les urnes suite à la dissolution. Lors des nouvelles élections qui interviennent le 14 septembre 1930, les sociaux-démocrates (SPD) perdent des voix (-5 points), mais restent le premier parti (24,5 %). Les communistes (KPD) gagnent 2,5 points et envoient 77 députés au Reichstag, tandis que le Zentrum (le parti de Brüning) dégringole avec un score de 14,8 % pour 68 sièges. Le grand gagnant est le NSDAP (le parti d’Hitler), qui progresse de manière spectaculaire, passant de 2,8 % à 18,3 %, envoyant 107 députés au Reichstag.
« Le gouvernement Brüning sera donc minoritaire au Reichstag : la « coalition nationale » de la droite libérale et conservatrice sur laquelle souhaitait s’appuyer le chancelier ne représente plus, au mieux, que 35 % des voix (…) contre plus de 50 % dans la législature précédente ». (p.45)
Battu dans les urnes, le gouvernement parvient néanmoins à mettre en œuvre sa politique de réduction des salaires et de baisse des dépenses sociales, pendant deux ans. Une longévité extraordinaire, qui tient à un fait majeur : le soutien de la gauche sociale-démocrate. Elle défend face aux nazis une politique du « moindre mal » – ce qui semble paradoxal, puisque cette même politique nourrit le vote nazi. Dans une résolution votée le 3 octobre 1930, le SPD fustige à droite le « mouvement fasciste des nazis » et à gauche « le parti communiste », accusé de diviser la classe ouvrière.
Cherchant des alliances, Brüning songe à faire entrer trois ministres nazis au gouvernement. Mais l’obsession de Hitler pour « l’extermination des communistes, des socialistes et des forces réactionnaires » le refroidit quelque peu. L’alliance avec les nazis au Reich attendra, mais pourquoi ne pas former un tel gouvernement au niveau des États fédérés (Länder) ? Ainsi, le Chancelier écrit dans ses mémoires :
« Pour ne pas trancher les fils déjà tissés (…), je me déclarais disposé à faire en sorte que le NSDAP et le Zentrum puissent former des gouvernements dans les Parlements des Länder, partout où cela serait arithmétiquement possible, et ce, dès cette première phase de rapprochement entre nous. » (p.49)
Cette ligne politique est décisive : en décembre 1932, les nazis gouvernent dans cinq Länder, dont trois dirigés par la droite et le centre. Ces coalitions régionales servent à la fois de vitrine et de laboratoire à l’extrême droite – en matière de politique intérieure notamment. Elles participent aussi, selon Chapoutot, à une « habituation réciproque entre droite et extrême droite » qui rend crédible l’hypothèse nazie.
Finalement, celui qui précipite la chute de Brüning est le même que celui qui l’a porté au pouvoir : Hindenburg. Et l’une des raisons est révélatrice des préoccupations de l’ancien maréchal prussien devenu président du Reich : les intérêts agrariens, un enjeu social majeur de l’époque.
Brüning propose une réforme agraire, visant à redistribuer les terres inexploitées de l’Est, pour les lotir et permettre aux habitants des villes de s’installer à la campagne, réduisant ainsi le chômage. Cette proposition touche un point sensible : la propriété terrienne des Junker, ces seigneurs de l’Est, dont fait partie Hindenburg et dont toute la sociabilité du Président est imprégnée : c’est ce projet de réforme qui scelle le sort de Brüning et marque le début de l’ère Papen – qui promet, lui, de mener une politique largement favorable aux intérêts privés mais aussi peu répressive à l’égard des nazis.

II) Les élites politiques et économiques au service de l’extrême droite
Hitler n’est pas arrivé seul au pouvoir. Il y a été amené, par la capitulation des partis de droite et du centre enlisés dans une crise politique et s’accrochant au pouvoir à tout prix. Mais ils ne sont pas les seuls : l’entremise de grands patrons séduits par le nazisme pour protéger leurs intérêts est elle aussi décisive.
Hugenberg, le magnat des médias qui rêve d’une « union des droites »
Surnommé le « Führer oublié » par son biographe, Alfred Hugenberg est un haut-fonctionnaire, spécialiste des questions agricoles, banquier et pionnier dans l’entrepreneuriat idéologique. Ayant fait fortune dans l’industrie lourde, il fantasme une Allemagne puissante, redoutée et triomphante – celle de Bismarck et de Guillaume II. Précurseur du magnat de la presse anglophone Rupert Murdoch et du français Vincent Bolloré, il est persuadé que ses projets financiers nécessitent une influence sur l’opinion publique.
Cette conviction le conduit à constituer un empire médiatico-financier inédit (Konzern), lui permettant d’imposer les thèmes de l’extrême droite dans le débat public. Dans la holding qu’il préside, il regroupe pas moins de 26 quotidiens et hebdomadaires nationaux et provinciaux – dont le troisième plus grand groupe de presse d’Allemagne, acquis dès 1916 avec l’aide du gouvernement allemand. À cette collection, s’ajoute une usine à textes (la WiPro) qui diffuse et produit du prêt-à-penser en continu. La ligne de cet empire médiatique est ouvertement antisémite, raciste, nationaliste et réactionnaire. Elle trouve un écho inédit dans l’espace médiatique : pas moins de 1600 journaux relaient les « informations » propagées par le Konzern. C’est une véritable industrie du fait divers qui est mise sur pied, afin de diriger l’attention de la population toute entière sur des faits montés en épingle[1]. Johann Chapoutot résume les conséquences de cette entreprise :
« En travaillant l’écume de l’actualité, on laboure en réalité les profondeurs océaniques de la psyché nationale, dans un sens conservateur, voire réactionnaire : quelques « unes » bien calibrées sur tel scandale impliquant des Juifs vont permettre de réactiver 1500 ans d’antisémitisme européen ». (p.91)
Outre son goût pour la presse, Hugenberg s’illustre aussi en politique. Il rejoint le Parti national du peuple allemand en 1918 – un groupement national-conservateur et en prend la tête en 1928. Hugenberg travaille à l’union des droites, mais Hitler veut le pouvoir pour lui seul. À l’automne 1930, Hugenberg propose alors à Hitler de créer un « front national » (sic). Il pense ainsi drainer le mouvement nazi tout en l’utilisant à son avantage, persuadé de pouvoir dominer cette alliance.
Ironie du sort : ceux qui pensaient avoir fait une affaire en or en misant sur les nazis à la baisse se retrouvent morts ou sous tutelle. Hugenberg en est l’exemple parfait. Il soutient Papen en 1932 et devient ministre de l’Economie, de l’Agriculture et de l’Alimentation d’Hitler en 1933. En six mois de gouvernement Hitler, il est dépouillé et contraint de brader son empire aux nazis en leur cédant ses entreprises médiatiques. Ainsi, comme une grande partie des élites politiques de l’époque, celui qui croyait s’allier au NSDAP n’était pour Hitler qu’un simple marchepied vers le pouvoir.

« Plutôt Hitler que le Front populaire »
Le gouvernement Papen (1ᵉʳ juin 1932 – 3 décembre 1932) est généralement évacué en deux lignes dans les livres d’histoire. Johann Chapoutot s’attache au contraire à montrer que les libéraux autoritaires qui entourent le Chancelier Papen – banquiers, propriétaires terriens, industriels, militaires, journalistes, universitaires – avaient bel et bien une vision de long terme et un programme pour l’Allemagne (dérégulation du droit du travail, subventions massives aux entreprises…).
Une fois au pouvoir, Papen décide de dissoudre le Reichstag, clamant que le pays a besoin d’une « clarification politique intérieure »[2]. Une décision irresponsable – résultant d’un accord discret avec le parti nazi – le NSDAP étant dans une dynamique électorale favorable. Les résultats marquent une défaite cuisante pour le gouvernement : les nazis obtiennent 37,3 % des voix, très loin devant le SPD qui obtient 21,6 % des voix. En août 1932, l’analyse de Wilhelm von Gayl (1879-1945), ministre de l’Intérieur de Papen, est stupéfiante. Il affirme que l’Allemagne est divisée en trois blocs : les marxistes (le SPD et le KPD), les nationalistes (le NSDAP et le DNVP), qui refusent de rejoindre le Zentrum, car ils veulent la Chancellerie, et le bloc central, titulaire de la meilleure politique et qui doit conserver le pouvoir par tous les moyens. Gouvernant avec moins de 10 % des voix, Papen cherche des alliances. Tout rapprochement avec la gauche – même la plus modérée – étant exclu, Papen engage alors des négociations avec les nazis.
III) Une décision irresponsable : nommer Hitler à la Chancellerie
L’effritement du NSDAP après la défaite : le parti au bord de la scission
Hitler rejetant tout scénario de victoire partielle, Papen doit lui aussi (comme Brüning) renoncer au soutien des nazis au niveau du Reich. Incapable de se maintenir au pouvoir, Papen décide de dissoudre le Reichstag une nouvelle fois en septembre 1932. Le mythe de la prise du pouvoir par les nazis s’évanouit à la lecture des résultats de ces élections législatives. Le bilan est manifeste : loin d’une ascension fulgurante, le parti nazi est en net déclin. Il perd deux millions d’électeurs, 4 points (33 %) soit 34 sièges de député.
L’échec de la stratégie légaliste et maximaliste du NSDAP est tel que Hitler envisage de se suicider en décembre 1932. Outre le recul dans les urnes, le parti est au bord de la scission. Le n°2 du parti, Georg Strasser, nazi de la première heure, plaide pour l’entrée au gouvernement (ligne minimaliste). Une ligne que Hitler refuse puisqu’il souhaite être nommé Chancelier (ligne maximaliste).
Le général Kurt von Schleicher, l’un des personnages les plus influents du Reich, pousse pour que la ligne minimaliste du NSDAP entre au gouvernement, afin de disloquer le parti. Ayant pris conscience de la dangerosité de Hitler, pas question pour Schleicher de lui confier la Chancellerie.
Alors que Papen est seul, dépourvu d’un socle électoral solide sur lequel s’appuyer pour gouverner, ce dernier envisage de faire un coup d’État. Pour l’en empêcher, Schleicher convainc Hindenburg de le nommer Chancelier à sa place le 2 décembre 1932.
L’échec de la manœuvre de Schleicher et la nomination de Hitler à la Chancellerie
Schleicher est resté à la postérité pour sa stratégie du Querfront (« le front oblique »). Elle vise à traverser les organisations politiques et syndicales, afin d’en extraire une base transpartisane et dépasser les appareils. En dialoguant avec la droite de la gauche (SPD et syndicalistes conservateurs) et la « gauche » des nazis (aile « sociale » de Strasser), il cherche à fracturer les blocs électoraux pour bâtir une majorité nationale-sociale.
Finalement, l’effondrement psychique de Strasser le 8 décembre 1932, qui démissionne de toutes ses fonctions au sein du NSDAP, scelle le sort de l’expérience Schleicher. Il ne parviendra pas à faire une coalition entre l’aile de Strasser du NSDAP, le Zentrum et la droite conservatrice. En outre, le projet de réforme agraire, qui touche aux intérêts de la famille Hindenburg, le fait tomber en disgrâce auprès du Président. Enfin, Papen, rongé par la rancœur, intrigue en secret avec Hitler pour convaincre Hindenburg de franchir le pas qui changera l’histoire du monde à jamais : nommer Hitler à la Chancellerie du Reich.
Mais ce sont en dernière instance les intérêts fonciers des Hindenburg qui ont pesé dans la décision de nommer Hitler. Menacé par Hitler de révéler un scandale sur les aides publiques aux propriétés foncières de l’Est dont la famille Hindenburg a gracieusement bénéficié, Oskar von Hindenburg, fils de Paul von Hindenburg, pousse son père à soutenir Hitler. Le 10 janvier 1933, Hitler est nommé Chancelier.

C’est ainsi qu’une droite autoritaire, incapable d’obtenir plus de 10 % des suffrages, décide, après de sordides calculs patrimoniaux, de donner la Chancellerie aux nazis, alors en déclin. Les « centristes » Hindenburg et Papen pensent pouvoir manipuler les nazis par cette manœuvre et tourner la situation à leur avantage. En réalité, cette décision irresponsable scelle le destin de la caste au pouvoir, ainsi que celui de millions de vies qui périront du nazisme.
Conclusion : 1932 / 2025, une identité de rapport
L’auteur conclut son livre par une réflexion sur le statut de la comparaison en histoire, dont nous devons tirer toutes les conséquences pour agir avec lucidité dans la conjoncture actuelle :
« En l’espèce, en dépit de similitudes étonnantes, Hugenberg n’est pas Bolloré et Papen n’est pas Macron, mais leurs positions dans les configurations politiques, économiques et sociales de la France de 2025 et de l’Allemagne de 1932 sont analogues. Pas d’égalité ou d’identité terme à terme (A n’est pas C), mais une identité de rapport (A/B=C/D). » Ainsi, « […] ce n’est n’est pas parce que l’histoire ne se répète pas que les êtres qui la font – qui la sont – ne sont pas mus par des forces étonnamment semblables ». (p.278)
Alors que le bloc bourgeois démontre jour après jour sa capacité à se compromettre avec l’extrême droite et ses idées, le livre de Johann Chapoutot résonne donc comme un appel à la lucidité et au courage politique face aux irresponsables d’aujourd’hui.
13.08.2025 à 11:42
Nouveau peuple, nouvelle gauche : le nouveau livre collectif de l’Institut La Boétie
Texte intégral (538 mots)
L’Institut La Boétie publie son deuxième ouvrage collectif, Nouveau peuple, nouvelle gauche, dans la collection « Les livres de l’Institut La Boétie » aux éditions Amsterdam.
Cet ouvrage collectif est dirigé par le sociologue Julien Talpin. Il s’ouvre par un entretien croisé de Nancy Fraser, philosophe féministe états-unienne et Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie, et se clôt par une postface stratégique de Clémence Guetté, co-présidente de l’Institut et vice-présidente de l’Assemblée nationale.
Il rassemble les contributions de 21 auteur·ices, sociologues, philosophes, économistes ou politistes, qui, ensemble, mettent à l’épreuve l’idée d’un « divorce » consommé entre la gauche et le peuple. Loin de la vision fantasmée d’une classe ouvrière uniforme, figée dans le marbre, il propose de décrire les classes populaires d’aujourd’hui, dans leur diversité et leurs transformations.
Il répond à des questions telles que « le peuple est-il devenu de droite ? », et revient sur des épisodes clés de l’évolution de la relation entre la gauche et les milieux populaires : évolution de la social-démocratie ; Gilets jaunes ; mobilisations des quartiers populaires, etc. Enfin, il propose des pistes pour quelques-uns des grands défis qui se posent pour construire une « nouvelle gauche » capable d’assurer la victoire de ce « nouveau peuple ».
Ce livre est donc une pièce majeure aux débats stratégiques qui animent actuellement la gauche française et internationale. En s’appuyant sur des analyses rigoureuses en sciences sociales, il trace un chemin clair pour l’action : s’appuyer sur la nouvelle réalité sociologique du peuple – plutôt que la nier – pour construire une nouvelle réalité politique.
Liste des contributeur·ices : Sarah Abdelnour, Bruno Amable, Sophie Bernard, Sophie Béroud, Jean-Baptiste Comby, Magali Della Sudda, Clara Deville, Nancy Fraser, Pierre Gilbert, Élisabeth Godefroy, Raúl Gómez, Clémence Guetté, Tristan Haute, Samuel Hayat, José Lopes, Hadrien Malier, Jean-Luc Mélenchon, Julian Mischi, Rachel Silvera, Julien Talpin, Vincent Tiberj.
Commandez dès maintenant Nouveau peuple, nouvelle gauche.
Découvrez la présentation du livre et le sommaire sur le site des éditions Amsterdam
Parution en librairie le vendredi 5 septembre. Plusieurs rencontres autour du livre partout dans le pays avec des contributeur·ices sont programmées ou en cours d’organisation, retrouvez la liste ci-dessous :
- Samedi 10 janvier à Grenoble : Sophie Béroud et Élisa Martin à la salle Moyrand
- Samedi 17 janvier à Perpignan : Élisabeth Godefroy à la librairie Torcatis
- Mercredi 11 février à l’ENSAE à Paris : Clémence Guetté
- Mercredi 18 février à l’université Paris Dauphine : Clémence Guetté
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
