13.01.2026 à 11:45
Détruire tout: Ce que dit le lauréat Bernard Bourrit

Texte intégral (1211 mots)
Lundi 10 novembre 2025, l'écrivain Bernard Bourrit recevait le prix Wepler-Fondation La poste pour son livre Détruire tout (éditions Inculte). A cette occasion, comme il est de coutume, il a prononcé un bref discours lors de la remise du prix. Le voici dans sa (presque) intégralité.

Bonsoir à toutes et à tous, Je ne serai pas long. C’est une expérience vraiment étrange et déconcertante pour moi de me tenir ici devant vous afin de recevoir ce prix. J’étais loin de me figurer en commençant à écrire Détruire tout que mon livre susciterait un quelconque intérêt au-delà du cercle confidentiel de lecteurs auquel j’étais habitué. Alors, tout d’abord, je tiens à exprimer ma joie. L’immense joie que j’éprouve à voir mon ouvrage mis en lumière. Il y a derrière cet honneur que vous me faites ce soir un long chemin d’écriture tracé le plus souvent dans l’ombre et l’indifférence. Et cette joie, je voudrais la partager avec celles et ceux qui l’ont rendue possible. Je remercie donc chaleureusement l’ensemble des membres du jury qui a eu le courage de choisir un livre iconoclaste. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux éditions Actes Sud et à mon éditeur, ici présent, Claro […].
Si j’ai commencé en vous disant que c’était une expérience déconcertante de m’exprimer devant vous, c’est que, de toute ma vie, jamais je n’ai attendu un quelconque avantage pour mon travail d’écrivain. Pas plus que je n’ai cherché à me mettre en évidence, ou encore à parler à la place de mes textes. Pour moi, un texte s’exprime toujours mieux que son auteur ; et c’est l’inverse qui me paraît problématique. C’est donc l’occasion de rappeler que Détruire tout est entièrement fait de la voix des autres. En m’immergeant longuement dans les archives pour reconstituer le féminicide qui constitue le cœur et le nœud de mon livre, je voulais surtout, et d’abord, faire résonner au présent les voix du passé. Des voix qui précisément n’étaient pas celles de l’auteur. C’est à force de me demander comment m’y prendre pour ouvrir le récit à sens unique qu’avait produit la presse de l’époque que la réponse s’est imposée d’elle-même : en multipliant les échos et les points de vue, quitte pour cela à faire sauter le cadre de la représentation. C’est l’histoire du joujou cher à Baudelaire, comme un enfant, j’ai entrouvert la mécanique de ce fait divers, et je l’ai secouée à la recherche de son âme. Évidemment, je ne l’ai pas trouvée.
Je voudrais conclure en partageant avec vous une dernière pensée qui m’est venue récemment en songeant à mon livre. Détruire tout a été écrit dans une perspective féministe, c’est indéniable. Toutefois, il ne s’attaque pas frontalement aux structures patriarcales. Il s’attaque à la société des « pères » : c’est une distinction subtile peut-être, mais importante à mes yeux, et qui légitime mon geste d’écriture, car, si je ne suis pas une femme, je suis au moins un fils. Ce glissement (du patriarcat au père, de la structure à la figure) ne fonctionne que si l’on accepte de désaxer le centre de gravité du mot « père ». Si l’on accepte l’idée que quiconque revendique un territoire où exercer sa force mérite ce titre. Si l’on accepte l’idée que le propre d’un territoire, parce qu’il institue un « tout », c’est d’exclure. Cela posé, nous cherchons tous, et toujours, mes personnages, vous et moi, à occuper une place et à jouer un rôle dans le maillage de ces territoires qui s’enchevêtrent. C’est-à-dire trouver à exister dans l’exclusion que ces territoires fabriquent. Que ce soit dans la résignation, la révolte, la liberté ou la violence. Sous cet angle, on le voit, c’est une autre histoire qui commence de se raconter. Mais assez parlé. Merci à tout le jury ! Merci à la Fondation La Poste ! Merci pour ce précieux encouragement ! Merci à la brasserie Wepler !
Claro, le 13/01/2026
Bernard Bourrit, Discours de réception pour le prix attribué à Détruire Tout, éditions Inculte
13.01.2026 à 11:20
“Mon envie d’histoire se passe dans l’image.” Interview de Fanny Michaëlis pour “Et c’est ainsi que je suis née”

Texte intégral (7956 mots)
Cela faisait presque 10 ans que Fanny Michaëlis n’avait pas publié de nouveau livre, mais restait très active avec de grands projets d’illustrations (affiches pour le Festival de la BD d’Angoulême, le Centre Pompidou), des affiches, des concerts et en 2025 elle revient avec Et c’est ainsi que je suis née, un album qui débute avec les aspects du conte pour pour proposer un regard et ouvrir des pistes de réflexion sur la violence de notre époque.

Comme dans ses albums précédents Fanny Michaëlis ouvre son nouveau livre avec une image forte, énigmatique et symbolique pour accompagner l’évolution de ce personnage retroussé et sa découverte du monde. Ce portrait atypique va nous entraîner dans une lecture qui semble avoir tout de la fable et qui se révèle bien ancré dans notre réalité. Traitant de la violence, de l’exclusion, du racisme, de la démagogie ; cet album propose des pistes de réflexion à travers cette héroïne inversée qui incarne aussi bien les individus qui se questionnent, qui cherchent une place que le corps social qui s’organise, qui résiste et qui lutte.
Une lecture poétique et politique servie par un dessin méticuleux et vif, qui alterne entre un trait porté par les lignes droites qui découpent les planches, influencent le découpage et des pages plus charbonneuses, chargées qui occupent tout l’espace. Le découpage est intimement lié au dessin ici et certaines symboliques se dessinent à la fois dans le dessin et les cadrages dans un noir & blanc tout aux crayons.
Rencontre avec l’autrice pour en savoir plus sur ce travail graphique, sur son rapport aux images, mais aussi pour évoquer les thématiques de l’album.

Photo de l’autrice / Creative Commons Éditions-cornélius
Ce livre commence sur une image très forte, avec cette glotte qui forme la tête, le buste du personnage, avec une symbolique de la bouche omniprésente, l’idée du livre est venue de cette image ?
Fanny Michaëlis : Oui, tout à fait. La première idée est venue de cette image du personnage retroussé, avec cette tête à l’envers. Et c’est souvent que ça se passe comme ça, pour moi : j’ai une image en tête, souvent avec une phrase, « le mot et l’image » précisément ce qui structure la bande dessinée en tant que médium.
En l’occurrence, cette phrase, c’était le titre. Je ne me disais pas forcément que ce serait le titre au départ, mais cette phrase est venue, associée à cette image de personnage la tête à l’envers ; et les séquences d’avant puis d’après, se sont construites autour de cette image pivot.
Je voulais la positionner avec cet archétype du « papa / maman / enfant » et ce père dont la bouche est invisible — entravée d’une grande barbe— et cette mère toute gueule ouverte puis ce zoom qui conduit à cette à cette figure retroussée.
C’est le même processus pour tous tes livres ?
F.M. : Pas pour tous mes livres, mais c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour Avant mon père aussi était un enfant mon tout premier livre qui est paru en 2011 chez Cornelius.
À l’époque, je travaillais dans une fondation où je surveillais une expo et j’avais pas mal de temps « vide » où je travaillais dans un carnet. J’avais noté cette phrase : « Avant mon père aussi était un enfant » et j’avais fait un dessin qui est la première case de la BD. Ce n’est pas systématique, mais c’est vrai que c’est souvent une association d’idées qui lance le récit.
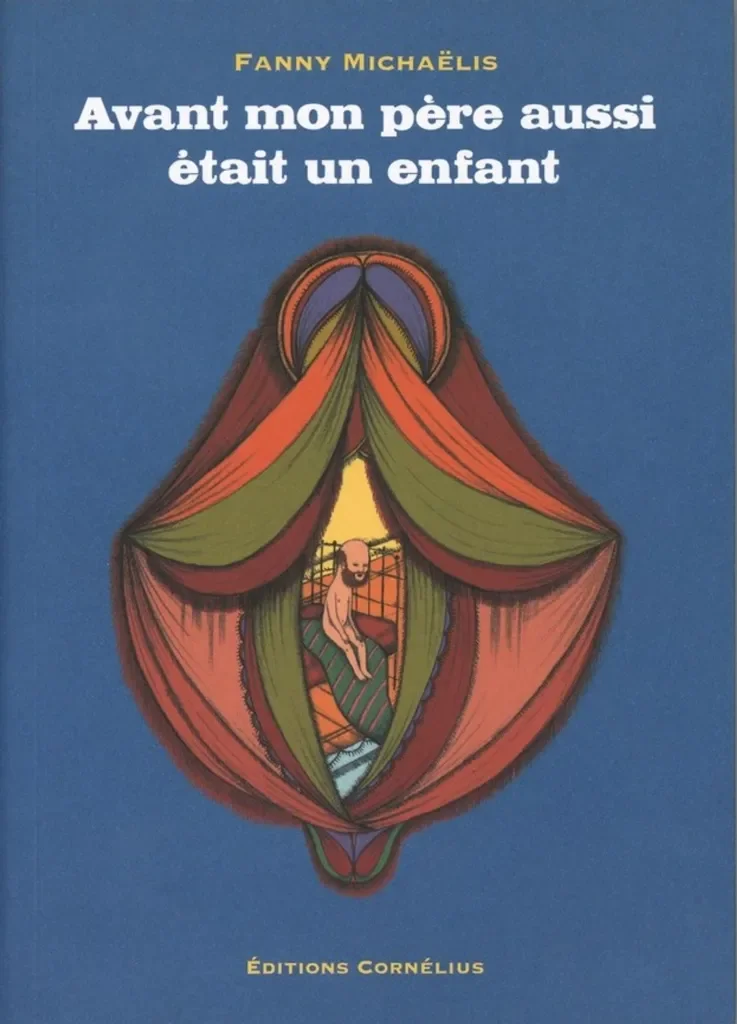
Il y a l’aspect conte qui est très fort au début, et puis ça glisse vers quelque chose de plus tangible, on va dire, pour nous…
F.M. : C’est aussi parce qu’il y a une part d’improvisation, je n’écris pas de scénario en amont.
Ce « papa / maman » qui sont aussi un peu le bûcheron et la bûcheronne d’Hansel et Gretel pourrait être, effectivement, des figures très proches du conte. Mais elles peuvent également être référencées dans un schéma de récit initiatique qui se révèle introspectif avec une voix off— presque comme dans Alice au pays des merveilles.
C’était aussi l’idée que ça conduise à un récit plus collectif, je n’avais pas envie de m’arrêter à raconter seulement l’histoire de cette jeune femme. L’idée de départ était comment sa tête va se soulever ?
Même moi, je suis spectatrice de la machine narrative : comment elle va se soulever ? Je ne sais pas forcément, je n’ai pas d’idée préconçue. C’est vraiment en dessinant et en écrivant que l’histoire se structure.
Avec cette écriture qui part de l’improvisation, est-ce que parfois tu dois reprendre des pages pour mieux coller à la suite du récit qui a évolué ?
F.M. : Ça m’est arrivé, dans mes précédents livres, d’avoir une écriture en aller-retour, mais pas sur celui-là.
J’ai mis du temps à trouver la forme et j’avais beaucoup d’interruptions —parce que je faisais des illustrations— et j’y suis allée pas à pas, et ça s’est construit dans la chronologie. Je ne suis pas vraiment revenue en arrière, seulement à la fin, lors du travail avec mon éditrice, Angèle Pacary, où on a réglé des détails sur quelques planches.
L’histoire s’est vraiment écrite dans une chronologie malgré le fait de l’avoir dessinée et écrite dans un temps assez long, sur plusieurs années, ce qui a fait qu’à chaque fois que j’ai repris le travail je n’étais pas dans la même disposition —pas forcément la tête à l’envers— mais à chaque fois avec de nouvelles questions.
Je savais qu’il y avait des choses que j’avais envie de raconter, mais comment ? Et à chaque fois que je reprenais, ça se précisait. Ce n’était pas évident de s’interrompre, ce n’était pas idéal comme manière de fonctionner, mais ce n’était pas une mauvaise chose.
J’espère que je ne ferai pas mon prochain livre comme ça, mais, en même temps, il y a des livres qui ont une temporalité différente, qu’on doit associer au moment présent. Ça a du sens.
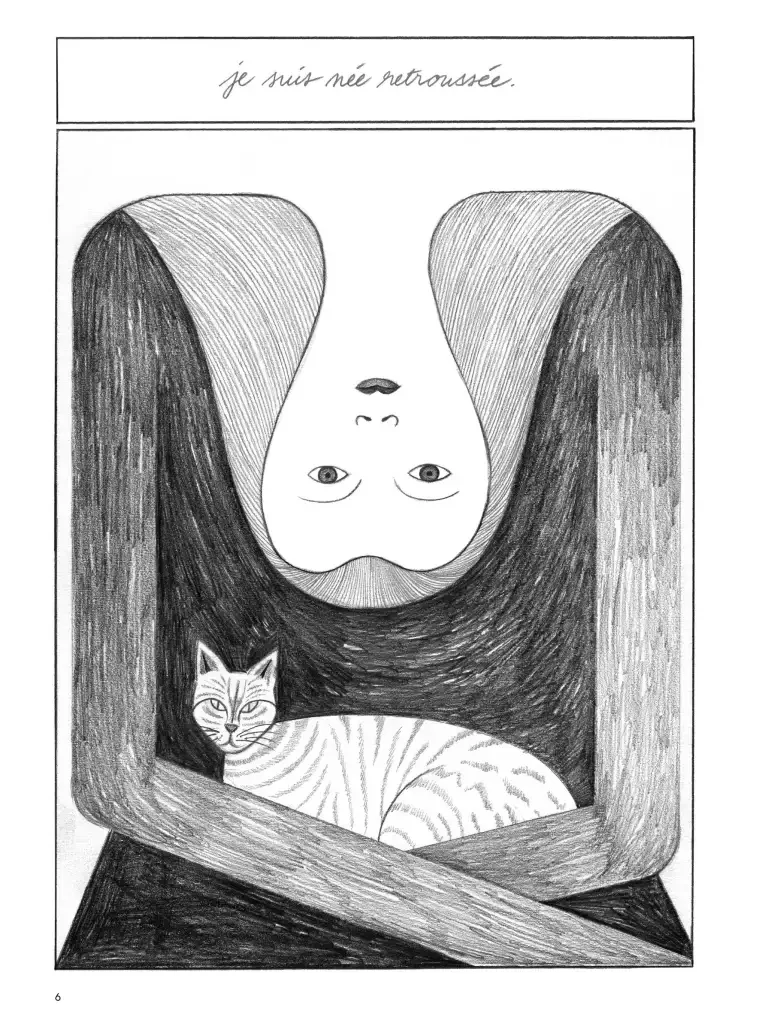
Par rapport à ta méthode de travail où l’improvisation à une bonne place, à quel moment tu fixes à la fin ?
F.M.: Plus j’avance, plus je sais ce que je veux dire [rires] les choses se précisent un peu. On est un peu sur un fil quand on travaille comme ça, c’est aussi par chance qu’on y arrive parce qu’on peut se perdre en chemin.
Mais je crois aussi au fait de composer des scènes qu’on a en tête et qu’on veut très fort raconter ; à l’intuition qui fait que d’une phrase on commence un récit.
Quelque part, « Et c’est ainsi que je suis née », c’est une phrase de conclusion, ça pourrait être la dernière page d’une histoire. Pourtant, c’était le début pour moi. Et de voir comment cette tête va sortir et comment cette question est résolue en 10 pages, je me rends compte qu’il ne s’agissait pas que de raconter cette naissance-là. Pas que celle-là.
J’ai emmagasiné des observations —sur l’aéroport parce que j’y ai un peu travaillé ou sur les situations de personnes étrangères via une association dont je suis proche, où je me suis retrouvée au contact de personnes dans des situations d’une grande violence — mais aussi des réflexions sur la politique actuelle, française ou internationale, sur la précarisation qui me révoltent. C’est aussi ces paliers-là que je voulais partager dans ce livre.
De la même manière que je me questionne personnellement sur comment on peut vivre dans un monde aussi insupportable de violence, où on assiste en ce moment à une radicalisation des idées d’extrême droite combinée à un capitalisme qui ne semble pas montrer de signe de faiblesse, ou qui s’adosse à des démocraties qui n’en sont plus… ces questions je me les pose tout au long du récit.
Et ce récit-là, qui est circonscrit —qui ne m’informe pas sur la manière dont ça peut se passer dans notre monde— me permet de sublimer cette question ou en tout cas, de lui donner du corps.
Il y avait des choses très importantes dans cette espèce de théâtre qu’est l’aéroport. De montrer à la fois le rapport au travail, les inégalités d’existence et d’inviter aussi les lectrices et les lecteurs à se poser la question de cet imaginaire collectif autour de ce lieu. Un lieu qui est à la fois perçu comme un lieu de liberté, de progrès, de modernité, de rêve et en même temps, qui est comme un symbole ou s’incarnent les problématiques systémiques, sociales, écologiques qui traversent l’ensemble de nos sociétés…
Il y a une scène d’expulsion avec une femme et son enfant qui sont obligés de quitter le territoire, et cette question rebondit sur le corps du personnage principal.
Ce personnage, qui n’a pas un corps adapté va tenter de s’émanciper, c’est un livre qui a les aspects du conte, mais qui est très ancré dans le présent…
F.M. : J’ai envie de parler de choses très concrètes. C’était déjà le cas dans certains de mes autres livres, mais le rapport à la fiction permet une souplesse et un jeu vis-à-vis d’un réel que je ne pourrais pas aborder d’une manière purement documentaire. Mais ce n’est pas tellement volontaire, c’est juste comme ça que je le vois.
Il s’agit d’inviter ce réel, quelque part, dans une machine qui le rend archétypal avec ce léger décalage qui fait que ça n’est pas contextualisé. Il n’y a pas tellement besoin d’associer l’aéroport à Roissy par exemple, ça reste des archétypes qui interpellent l’imaginaire collectif des lectrices et des lecteurs sur lesquels on peut projeter ce qu’on veut, d’une certaine manière.
Avec une écriture poétique qui n’est pas là pour adoucir les choses, mais invite plutôt à cet imaginaire très concret, qui parle du monde du travail et de questions sociales, très crues.
Dans tes livres, il est question de transmission, héritage, atavisme, ce sont des thématiques qui s’imposent, peu importe le sujet, ou tu y réfléchis en amont ?
F.M. : C’est en moi. Ce n’est pas forcément des choses dont j’ai envie de parler. Par exemple dans Le Lait noir qui parle d’exil, c’est mon livre le plus personnel dans le sens où ça implique une histoire familiale même s’il y a de la fiction et un décalage.
C’est important que ce soit décollé du passé pour pouvoir résonner dans le présent. Quand on voit ce qui se passe actuellement, à Gaza par exemple, on voit que ça réactive ces questions, et on voit que ce n’est pas en les figeant dans le temps qu’on peut mieux les penser. L’histoire est très importante, mais je ne suis pas historienne, ce n’est pas mon enjeu. Et je n’avais pas non plus envie d’en faire une histoire psychanalytique même si ça m’intéresse beaucoup et qu’à titre personnel ça m’enrichit.
Dans Le Lait noir, il y a des personnages qui n’ont pas d’histoire ou dont l’histoire est absolument méprisée, ils n’ont pas de consistance pour le monde dans lequel ils sont reçus : eh bien cette grand-mère, c’est un peu l’incarnation de cette mémoire-là. De cette nostalgie, peut-être, et de cet attachement affectif à un ailleurs qui est en nous mais qui nous échappe, qui est peut-être perdu, mais qui est certainement un bien commun parce qu’on a tous cette idée-là qu’on vient de quelque part —et c’est toujours une quête.
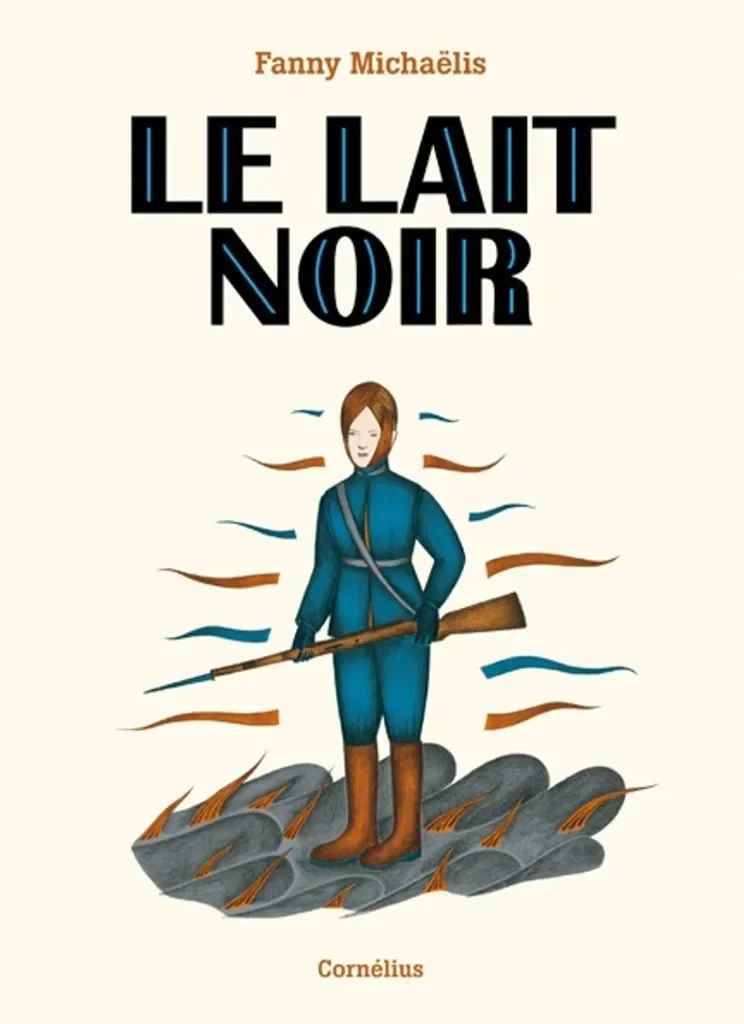
Sur la couverture d’Et c’est ainsi que je suis née, où on peut voir à la fois la position d’un accouchement, à la fois une attitude guerrière, avec d’autres couches de lecture, le côté Gulliver, la foule des sans têtes… comment tu l’as trouvée, est-ce qu’il y a eu beaucoup d’itérations ?
F.M.: Je pense que pour toutes les autrices et les auteurs, la couverture, c’est vraiment un moment pénible. Parce qu’à la fois, il faut inviter à la lecture, laisser les choses ouvertes et en même temps, ne pas tout dévoiler.
Je l’ai faite vraiment à la fin, une fois que j’avais terminé le bouquin, mais c’est venu assez vite. J’avais l’idée qu’il fallait que quelque chose de cet « à l’envers » soit présent —la couverture est à l’envers, mais c’est le cadrage qui veut ça— et en même temps que ça fasse référence au début du livre et à la fin du livre, sans trop en dévoiler.
Comme tu dis, elle est dans une attitude guerrière —ou en tout cas de lutte— et en même temps, traversée par une faille qu’on pourrait imaginer comme une blessure, mais qui dévoile l’idée qu’il ne s’agit pas que d’un corps individuel : ce corps est habité, et cette blessure laisse la possibilité de quelque chose de collectif. Elle n’est pas seule à avoir cette arme en main, ils sont des centaines.
C’est à la fois très frontal —avec le regard vers le lecteur, la lectrice— et en même temps il y a cette idée de profondeur de champ sur l’idée d’un corps qui est à la fois, un corps féminin, un corps individuel, mais aussi un corps collectif.
Par le jeu de la typo, le Je se retrouve souligné par l’accent de née, et justement l’héroïne n’a pas de nom, elle est Je, il y a des variations de visages pour cette jeune femme, comme pour justement incarner tous ces destins. C’est aussi une histoire qui parle de la force du collectif face à cette pression du capitalisme, il y avait une volonté de pouvoir se projeter ?
F.M. : Le personnage principal, qui n’a pas de nom, est un peu comme une chambre d’écho effectivement. Elle est à la fois cette espèce de regard qui se pose sur le monde et sur lequel, le réel rebondit —c’est sa vision des choses.
C’est porté par une voix off —sa voix intérieure— et en même temps, il y a des allers-retours avec des scènes hyper concrètes, très dialoguées. Sans dévoiler la dramaturgie, son corps, son regard sont impliqués de telle manière qu’effectivement ils sont l’écho de toutes ces problématiques de domination, ces questions d’inégalité d’existence, de machine à détruire et invisibiliser…
Il y a une interrogation sur une forme de système et il s’agit à la fois d’un personnage qui a une structure individuelle, mais, en même temps, qui est là pour porter ou interroger la question d’une voix collective, d’un soulèvement collectif. D’incarner ces accumulations de violence et de questionner quel est le déclencheur qui fait que ça explose à un moment donné.
Une langue commune doit se former pour pouvoir inventer autre chose —autre chose, que je ne propose pas dans le livre, c’est vraiment un hors-champ— comment cette langue va se construire ?
C’est une vraie question qui reste en suspens, même si j’avais des exemples concrets. Il y a des organisations communes, de lutte et de solidarité qui existent et qui peuvent être des propositions, mais dans le livre, ça reste une question ouverte.
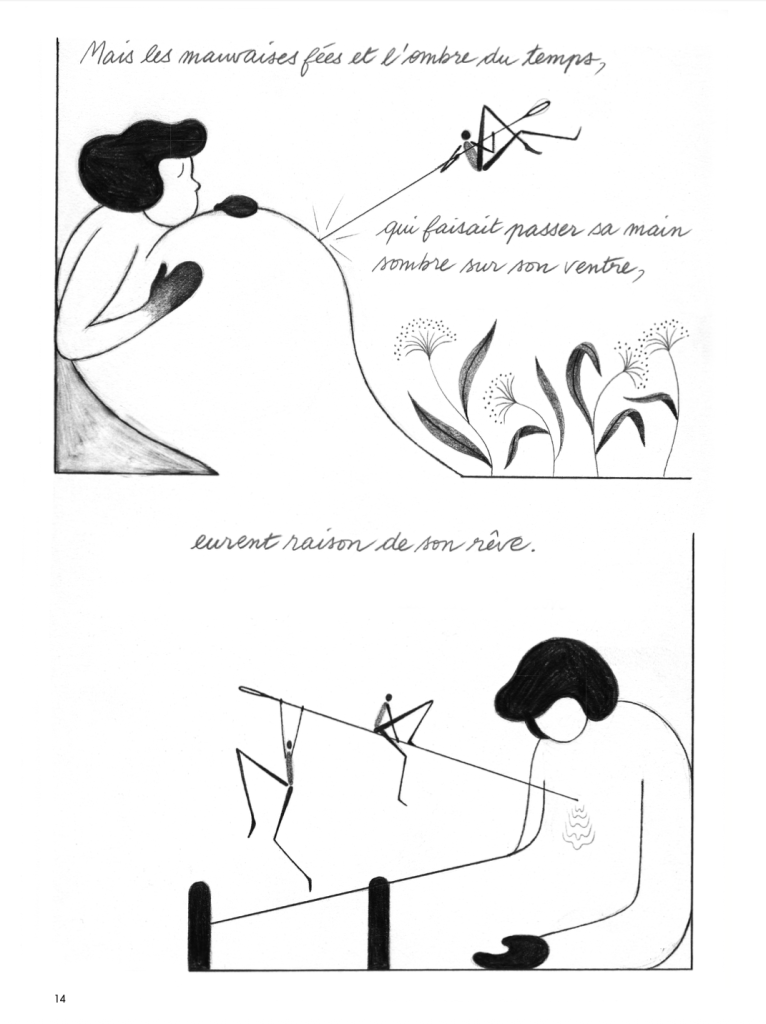
Il y a cette idée de renversement, « l’endroit était pour moi l’envers » dit la jeune fille, ça résonne beaucoup avec ce renversement du sens, de l’appauvrissement du langage par les politiques depuis la première ère Trump…
F.M. : La question politique par rapport au langage, à la vérité, au sens (ou au non-sens) elle se pose effectivement et elle se fait l’écho de ces premières planches.
Par la suite, cette confrontation s’incarne dans la ville et parce qu’elle décide de s’arracher à quelque chose, elle se jette dans le monde avec une telle violence que quelque chose se produit —qui n’est pas toujours heureux, mais qui n’est pas non plus dramatique— et qui peut faire écho à des choses qu’on a toutes et tous, vécues, qui font partie de la vie.
Mais à ce moment précis du récit, on est encore dans quelque chose qui pose un personnage en marge de sa propre parole, de son propre langage. Et qui, par un jeu graphique, se formule de telle manière que l’on comprend qu’elle est à côté. À côté d’une possibilité relationnelle avec le réel, avec les gens, avec les autres.
Parce que sa propre parole ne peut pas se produire dans le monde —avec ce jeu par rapport au père,à la mère, à ce petit théâtre familial— et que quelque part elle-même en souffre. Elle souffre de ce regard inversé, ou de sa disposition corporelle qui ne lui permet pas d’être dans une forme de norme.
C’est une question d’adaptation. Là, clairement, le personnage se pose d’emblée comme inadapté. Elle est inadaptée, mais cette disposition qui pourrait apparaître comme une forme de handicap ou d’absence de compétence pour vivre, lui donne finalement une compétence : celle d’un regard porté sur le monde et de pouvoir participer d’un soulèvement nécessaire, face à cet ordre systémique est insupportable.
Il y a une planche où elle dit qu’elle n’est pas malheureuse et que le fait d’être en creux, quelque part, lui permet d’être habitée par toute chose. On pourrait parler d’empathie ou d’hypersensibilité, qui peut être vécue comme un handicap, une forme d’inadaptation et cette non-compétence se renverse.
Dans ton travail en général, il y a ces jeux avec les expressions ou métaphores parfois prises au pied de la lettre qui donnent un côté poétique ou décalé, le dessin met en lumière l’importance de la langue ?
F.M. : Pour ce livre-là, la question de l’écriture a été moins complexe à aborder que dans les précédents, qui sont quasiment sans texte. Il n’y en a pas énormément dans celui-là non plus, mais il a de l’importance. Je le travaille en tant que tel, à part.
Mais par rapport à ce que tu dis, c’est vrai qu’il y a un langage dans le dessin et le dessin me permet vraiment de parler. Et inversement le texte peut permettre de créer des images et ce jeu-là m’intéresse.
C’est pour ça que je me sens à ma place dans la bande dessinée, parce que le récit et la séquence permettent de parler et l’écriture vient rebondir, enrichir quelque chose. Mais mon envie d’histoire se passe dans l’image.

Et ce texte te permet de décaler un peu l’interprétation ? De créer une dualité ?
F.M. : J’ai essayé d’enlever les choses redondantes pour faire respirer au maximum la partie dessin. Et le fait que je me pose pas de contrainte en termes de représentation me permet d’être libre de faire une pleine page ou quelque chose qui peut-être se rapproche plus de l’illustration, voir de quelque chose de plus pictural ou de plus abstrait… qu’il y ait quelque chose de sensible qui passe par le dessin, la matière, et qui ne soit pas forcément nommé.
C’est très sujet à l’interprétation des lectrices et des lecteurs. Il y a une zone qui peut perturber, avec une libre interprétation sur certaines pages, notamment les scènes sexuelles qui ne sont pas représentées, mais plutôt soulignées.
Comment travailles-tu, quels sont tes outils ?
F.M. : C’est du crayon, du crayon 3H à 10B —c’est une gamme de crayons avec des crayons très noirs et des crayons beaucoup plus clairs— et une gomme, une règle et du papier. C’est assez rudimentaire, il n’y a pas tellement d’outils, mais ce sont des outils qui me vont très bien parce que je trouve qu’on peut faire beaucoup de choses avec.
Peut-être que je me lasserai, mais le crayon permet beaucoup de choses : aller de la matière à la représentation. Être dans le plaisir de chercher des formes et des matières qui ne sont pas uniquement de la figuration, mais qui donnent du corps au dessin.
Et aussi, je voulais parler de couleur, parce que tu parles du noir & blanc là, mais dans Une Île, tu as une palette très colorée avec des jeux de superposition, des motifs ; tu as fait aussi les couleurs d’Epiphania deLudovic Debeurme avec un côté très pictural, il y a du modelé, des couleurs peu courantes…
F.M. : J’adore les couleurs et l’illustration de commande pour la presse ou l’édition m’a vraiment permis de découvrir ou de redécouvrir —parce que j’ai fait de la peinture avant de faire de la bande dessinée— que j’aimais vraiment la couleur. Et que je pouvais l’utiliser avec tout le plaisir que ça comporte.
Pour Epiphania, la trilogie de Ludovic Debeurme, on a réfléchi ensemble puis j’ai travaillé de mon côté et Ludovic est ré-intervenu sur des choses et c’était passionnant de pouvoir travailler en se posant la question des références, en cherchant des atmosphères aussi longtemps.
Mais pour un projet de narration personnelle, ça ne s’impose pas du tout. C’est-à-dire que ça serait vraiment aller du côté d’une surcharge illustrative que je ne désire pas. Pour un projet comme Et c’est ainsi que je suis née, la couleur serait vraiment superflue parce que je n’ai pas pensé les dessins comme ça.
Je ne me suis autorisée la couleur que sur la couverture parce que le livre est un objet, il faut lui donner une peau, un corps et une carnation au sens propre. Ça ne me semblait pas un non-sens, même si on pourrait se questionner : c’est un livre en noir & blanc, du coup, c’est un peu bizarre de mettre la couverture en couleur, mais j’aime bien cette friction quelque part.
Mais peut-être que le jour viendra où j’aurai envie de faire de la bande dessinée en couleur, et ça aura du sens. J’ai essayé, j’ai eu des débuts de projets, mais qui n’étaient pas du tout convaincants.
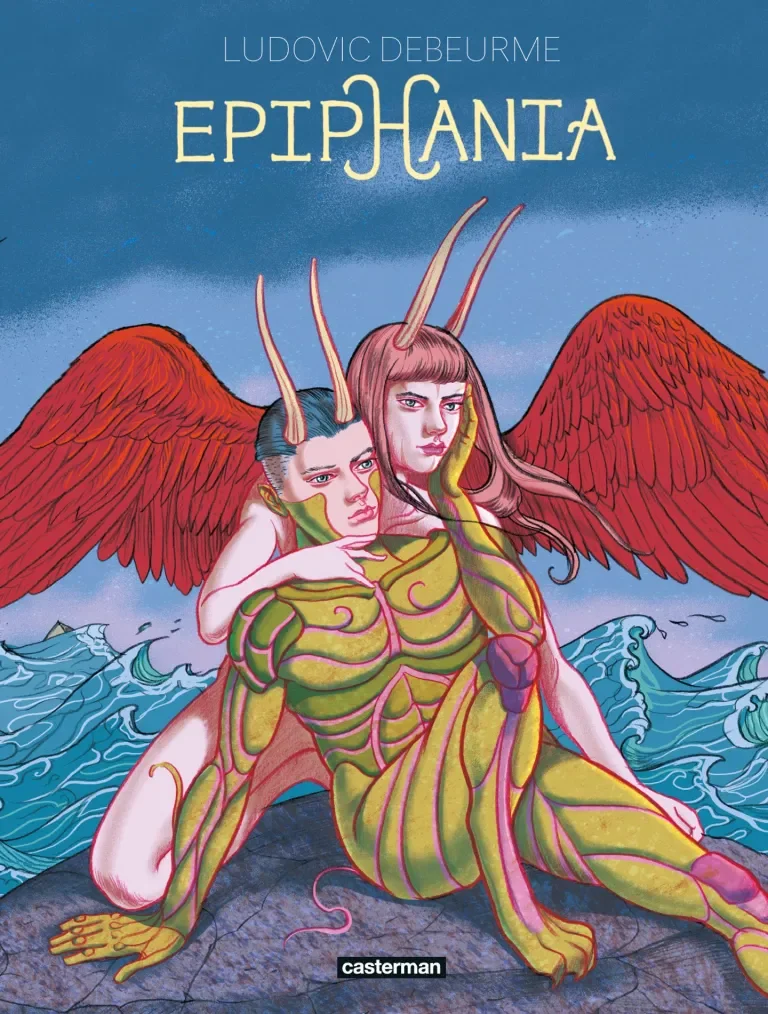
Tu fais de la bande dessinée, de l’illustration, et tu parlais de peinture tout à l’heure, je voulais savoir est-ce que tu pratiques aussi le carnet de croquis ?
F.M.: Pas trop. J’ai fait une école de BD à Saint-Luc à Bruxelles, et à l’époque, on dessinait beaucoup sur le motif, tout le monde avait des carnets de croquis, moi aussi. Mais je ne croque pas les gens, je dessine rarement dans le métro, mais ça ne m’empêche pas de collectionner des impressions, des images —peut-être que je me fais trop confiance— mais l’idée de les imprimer dans ma tête et de m’en servir après, au moment, le moment venu, c’est plus ma manière de faire.
Dans mes carnets je note des idées, du texte ou des images qui s’associent ou qui viennent, mais je n’ai pas cette pratique, presque musculaire, du dessin. J’aimerais bien, mais ce n’est pas très intéressant quand je le fais [rires] donc je ne suis pas convaincue.
Je te demandais ça aussi, parce que dans ce livre il y a des traits très géométriques pour dessiner les personnages, à la règle, c’était une envie graphique ?
F.M.: Dans mes illustrations pour la presse ou pour les livres, ce sont des outils que j’utilise souvent. Mais le fait d’avoir beaucoup d’illustrations ces dernières années et d’avoir moins fait de bandes dessinées —je n’avais pas sorti de bande dessinée depuis Le Lait noir, donc ça fait presque 10 ans— ça a invité dans ma pratique d’autres outils. Des outils qui ne sont pas des outils de ouf, mais qui donnent au dessin cette tension entre des recherches de matière —avec un côté pictural— et en même temps, quelque chose de très dessiné —presque constructiviste.
Il faut laisser parler ses affections pour certaines choses —je pense à Fernand Léger— mais aussi ne pas se brimer donc, il y a des coups à la règle —la ville est comme une machine, qui correspond presque plus à celle du 19e siècle qu’aux villes actuelles. C’est aussi un plaisir de dessinatrice.
On a vu ça sur ton affiche pour la BD à tous les étages au Centre Pompidou, c’était très à la règle et on se dit qu’il a une suite.
F.M.: Oui, c’est exactement ça, le fait de m’être tellement concentré sur certaines images très longtemps —typiquement cette affiche— et de pousser crayonné, réintervenir… Il n’a pas eu tellement de modifications, mais il fallait penser les choses longtemps pour que le trait soit bien. C’était un peu stressant. Et puis le Centre Pompidou il fallait le représenter quelque part donc, c’était difficile de contourner la question de la règle [rires].
Le fait de s’attarder longtemps sur une image m’a aussi fait revenir différemment à la bande dessinée, avec une envie de composer les planches dans leur entièreté et de vraiment m’y attarder. Et du coup, j’ai été assez lente parce que j’ai passé du temps sur certaines planches que j’ai vraiment pensé comme des petits tableaux —il y a des planches qui m’ont pris moins de temps que d’autres— mais j’ai traîné dessus [rires].
J’espère mettre moins de temps pour le prochain album, je travaille sur un projet sur lequel j’aimerais moins avoir à m’interrompe systématiquement pour aller jusqu’au bout, mais encore une fois je serais allée plus vite ça aurait été moins pénible, mais ça n’aurait pas laissé mûrir les choses je n’aurais peut-être pas trouvé la fin, peut-être que je me serais perdue en route, j’en sais rien.
Finalement, je ne regrette pas, mais « stratégiquement » [rires] je préférerais mettre moins de temps pour la prochaine.
En complément de cette lecture d’Et c’est ainsi que je suis née, je vous conseille d’explorer ses autres livres—Avant mon père aussi était un enfant, Géante, Le Lait noir— mais aussi de découvrir ses illustrations en couleurs récentes dans Ce que disent les rêves, où elle illustre les contes de Muriel Bloch, ou dans ses livres jeunesse : Une île et Dans mon ventre.
Thomas Mourier, le 13/01/2026
Fanny Michaëlis - Et c’est ainsi que je suis née - Casterman
-> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués.

12.01.2026 à 18:45
Apprendre à regarder autrement avec Gehrard Richter

Texte intégral (11945 mots)
La leçon de Richter est peut-être celle-ci : toute image est fragile, toute mémoire est incertaine, mais l’art, lorsqu’il accepte cette fragilité, peut encore nous apprendre à regarder autrement. D’où l’importance d’aller voir, avant sa fermeture le 2 mars 2026, la formidable rétrospective de 50 années de son travail que propose la Fondation Louis Vuitton.

© Gerhard Richter
Gerhard Richter est né en 1932 à Dresde, dans une Allemagne en plein basculement. Enfant du nazisme, adolescent dans l’Allemagne de l’Est communiste, il grandit dans un pays marqué par la propagande, la surveillance et la reconstruction d’après-guerre. Il est formé à l’Académie des Beaux-Arts de Dresde, où l’enseignement repose sur le réalisme socialiste, imposé par le régime.
En 1961, quelques mois avant la construction du mur de Berlin, Richter décide de fuir et passe à l’Ouest. Ce changement radical (passer d’un système idéologique à un autre) le marque profondément. Il découvre alors la liberté artistique de Düsseldorf : l’abstraction américaine, le Pop Art, les expériences conceptuelles… tout ce qui lui avait été interdit en RDA. Cette confrontation brutale entre deux univers visuels opposés crée chez lui une méfiance durable envers toutes les images, qu’elles soient politiques, photographiques ou même picturales.
C’est ce doute qui devient le véritable moteur de son travail. Plutôt que de peindre d’après nature, Richter choisit dès le début de peindre d’après des photographies existantes : des images de journaux, de son album de famille, des archives scientifiques ou historiques. Il les agrandit, les floute, les efface ou les recouvre. Ce geste révèle déjà que toute image est une construction, un filtre, une distance.
Tout au long de sa carrière, cette tension entre réalité et fiction, mémoire et effacement, figuration, abstraction et technologie revient sans cesse. Richter n’a jamais cessé de tester les limites de la peinture : il transforme des photographies, il peint des crimes en les rendant étrangement décoratifs, il crée des panneaux de verre qui reflètent le monde au lieu de le représenter, il explore l’abstraction systématique, puis les images numériques et scientifiques.
À chaque étape, on a l’impression qu’il reformule la même question : qu’est-ce qu’une image ? Et que peut encore la peinture à une époque saturée d’écrans et de photographies ? Ce sont les questions, dont il fut parmi les premiers artistes à réaliser toute l’importance, et qui sont devenues aujourd’hui d’une actualité brûlante avec l’essor des nouvelles technologies de fabrication et de diffusion des images, qu’aborde l’exposition rétrospective de son oeuvre organisée par la fondation Louis Vuitton.
Exceptionnelle par son ampleur : cette exposition réunit plus de 275 œuvres, couvrant plus de soixante ans de création, de 1962 à 2024. On y trouve des peintures, des dessins, des aquarelles, des sculptures, des œuvres sur verre, mais aussi des photographies peintes et des documents préparatoires. C’est l’une des rétrospectives les plus complètes jamais organisées sur Richter, et elle offre un terrain idéal pour comprendre sa manière singulière de travailler avec les images. Cette interrogation traverse l’ensemble de son œuvre, qu’il s’agisse des portraits flous des années 1960, des œuvres liées au terrorisme de la Fraction Armée Rouge, de ses grandes abstractions ou de la série sur les camps de concentration : Birkenau.
En suivant le fil de son parcours, l’exposition commence avec ce qui marque véritablement le début de la carrière de Richter en Allemagne de l’Ouest : les photo-peintures qu’il réalise à partir de 1962, juste après son arrivée à Düsseldorf. Ces premières œuvres montrent que, dès le départ, Richter choisit de travailler non pas d’après le réel direct, mais d’après des images déjà produites par la société. Copier des photographies, ce geste apparemment simple devient le point de départ d’un véritable renversement de la peinture.
De la copie photographique à l’altération du réel
Dans la première galerie, on découvre une série d’images dont les sujets semblent extrêmement ordinaires. Il commence par peindre Tisch (Table), en 1962 qu’il inscrira plus tard comme l’œuvre n°1 de son catalogue raisonné. Ce tableau résume parfaitement le programme de son art. Avant même de peindre, il altère la photographie : il l’efface partiellement au solvant, créant une zone blanche au centre de l’image. Ensuite seulement, il repeint cette photo déjà abîmée. Ce double geste d’effacer et reproduire crée une tension fondamentale : la peinture affirme quelque chose et le nie en même temps. Richter montre ainsi qu’il ne croit plus à l’idée d’une copie fidèle ou transparente : pour lui, toute image est déjà un fragment, une construction, une mémoire trouée. Cet entre-deux deviendra la matrice de toute son œuvre.

Gehrard Richter : Tisch (Table). 1962
Donc dans ce premier ensemble on peut voir que Richter commence par choisir des images banales : une table trouvée dans un magazine, des paysages quelconque, mais aussi (et c’est essentiel) des photographies de sa propre famille, qu’il n’identifie pas encore comme telles.
Dans Familie am Meer ou Onkel Rudi, ces visages lui appartiennent, mais Richter les traite comme n’importe quelle autre image trouvée : des documents visuels, anonymes, déchargés de leur poids affectif. Ce n’est que plus tard qu’il reconnaîtra leur dimension autobiographique.
Parmi ces images figure l’une des œuvres les plus bouleversantes de ses débuts : Tante Marianne (1965). Le tableau montre sa tante tenant le jeune Richter bébé. Derrière cette scène intime se cachent les fractures profondes de l’histoire familiale : Marianne, diagnostiquée schizophrène, fut assassinée par les nazis dans le cadre du programme d’euthanasie (Aktion T4). Son oncle Rudy apparaît sur d’autres images en uniforme SS. Plus tard, en 1957, Richter épousera sans le savoir la fille du médecin SS responsable de l’hôpital où sa tante avait été tuée. Quant à son père, enrôlé malgré lui dans le parti nazi, il perd son emploi après la guerre. Tout cet héritage familial, longtemps refoulé, fait écho à la Vergangenheitsbewältigung, ce travail allemand pour surmonter le passé, un enjeu central chez Richter, même si lui-même, au moment de peindre ces images, refuse encore de les considérer comme autobiographiques.

Gerhard Richter : Tante Marianne. 1965
C’est aussi à cette période, à partir de 1963, qu’apparaît son procédé le plus célèbre : le flou. Richter frotte la peinture encore humide pour brouiller les contours. Le flou n’est pas là pour créer une atmosphère nostalgique : il exprime au contraire une incertitude, presque un aveu d’échec volontaire. Il marque la distance entre la photo brute et notre regard, et met en doute la croyance selon laquelle une image, parce qu’elle ressemble au réel, serait plus vraie.
Ce travail de distanciation se radicalise dans Acht Lernschwestern (Huit élèves infirmières), peint en 1966. Richter utilise une coupure de presse montrant huit jeunes femmes assassinées dans un dortoir à Chicago. En isolant ces visages du texte qui relatait le drame, il transforme un fait divers tragique en une image sérielle qui rappelle le Pop Art d’Andy Warhol, un artiste qu’il admire. Mais contrairement à Warhol, Richter rejette toute forme de spectaculaire. Le flou efface les détails, atténue la violence directe, et révèle comment les images de presse peuvent banaliser même les événements les plus atroces. Le tableau met au jour notre fascination collective pour le crime, tout en soulignant l’éthique fragile de la représentation. À partir du milieu des années 60, Richter commence aussi à s’intéresser à d’autres types d’images, mais avant d’aborder ces paysages urbains, l’exposition montre un premier déplacement important dans son travail : l’entrée dans l’espace réel.

Gerhard Richter : Acht Lernschwestern (Huit élèves infirmières). 1966
En 1967, il réalise 4 Glasscheiben (4 panneaux de verre), une œuvre composée de quatre grandes plaques de verre transparentes montées sur une structure métallique. Ici, il ne peint plus rien : il crée un objet. Ces vitres ne montrent rien, ne protègent rien. Elles reflètent l’environnement, dédoublent les visiteurs et transforment la perception de l’espace. On reconnaît l’influence du minimalisme, mais le questionnement reste le même : qu’est-ce qu’une image, si elle ne sert plus à figurer, mais à filtrer le réel ?
L’année suivante, en 1968, ce déplacement s’accompagne d’un élargissement des sujets. Avec Stadtbild D (Paysage urbain D), il part d’une photographie de ville et adopte pour la première fois un style plus cru, presque expressionniste. La ville apparaît fragmentée, comme frappée par une violence sourde. On peut y lire l’ombre des villes détruites de la Seconde Guerre mondiale qu’il a vues enfant. Sans illustrer explicitement la guerre, Richter laisse la mémoire collective affleurer à travers une simple image de rue. Cela devient une constante chez lui : le passé surgit non pas par narration, mais par résonance.
Enfin, en 1971, Richter aborde la sculpture figurative de manière exceptionnelle dans son parcours avec Zwei Skulpturen für einen Raum von Palermo (Deux sculptures pour un espace de Palermo). À la fin des années 1960, il se lie d’une grande amitié avec l’artiste Blinky Palermo, qu’il a rencontré à l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. En 1971, Palermo expose une peinture ocre jaune qui recouvre les quatre murs d’une pièce dans une galerie à Munich. Richter, enthousiaste, lui dit qu’il faudrait « ajouter des sculptures ». Il réalise alors un moulage en plâtre du visage de Palermo, Palermo l’aide à faire le sien, puis Richter modèle le reste des têtes : cheveux, oreilles, arrière du crâne. Sur ces moulages, il applique ensuite une peinture grise grossièrement brossée.
Ce geste brouille les traits, efface les identités, et transforme ces portraits en sortes de présences spectrales. Même en trois dimensions, Richter poursuit le même questionnement : partir d’une empreinte du réel pour la recouvrir, l’altérer, et montrer que toute représentation reste une forme de distance, jamais une présence pure.
C’est précisément à ce moment du parcours que l’exposition introduit un ensemble essentiel : l’Atlas, commencé dès 1964. Ce vaste regroupement de photographies trouvées, images de presse, photos personnelles, esquisses et documents constitue le laboratoire visuel de Richter. L’Atlas accompagne toute sa carrière, révélant comment il collecte, classe et observe les images avant de les transformer. Il fait le lien direct entre les photo-peintures des années 60 et les expérimentations systématiques des années 70.

Cette première partie du parcours montre donc comment Richter part d’un geste presque naïf de copier une photographie pour en faire un véritable outil critique. En modifiant, floutant, détruisant ou recouvrant l’image, il transforme la peinture en un espace de doute. Elle ne sert plus à affirmer la réalité, mais à révéler à quel point toute image la transforme, la réduit ou la déplace. C’est ce rapport complexe entre ce que l’on voit et ce que l’on ne peut plus voir qui définit les débuts de Richter et pose les fondations de tout son futur travail.
Le passage au grand format : entre abstraction, systématisation et monumentalité
Après les premières photo-peintures des années 60, centrées sur l’image, la mémoire et le flou, l’exposition nous fait entrer dans une décennie décisive : les années 1970. À ce moment-là, Richter élargit littéralement son vocabulaire. La peinture devient un champ d’expérimentation, un laboratoire où il peut tester aussi bien les systèmes conceptuels, les grilles de couleurs que les possibilités de l’abstraction. C’est aussi une période où l’avant-garde internationale annonce la “fin de la peinture”. Richter ne s’y oppose pas frontalement, mais il absorbe ces influences pour prouver que la peinture peut encore penser, interroger, se transformer.
En 1972, Richter est invité à représenter l’Allemagne à la Biennale de Venise : c’est son véritable premier pas sur la scène internationale. Pour ce contexte exceptionnel, il choisit d’interagir avec l’architecture néoclassique du pavillon allemand, un bâtiment lourd d’histoire, construit dans les années 1930. Il y installe une frise monumentale de 48 portraits d’hommes célèbres, trouvés dans des dictionnaires et encyclopédies. Aucun choix esthétique ou idéologique précis : les images sont sélectionnées presque au hasard. Ce qui l’intéresse, c’est la manière dont la monumentalité du dispositif crée une égalité visuelle entre ces figures savantes, comme si toutes devenaient interchangeables.
Disposés d’une façon similaire par la fondation Louis Vuitton, ils sont alignés sur les murs, ces portraits forment une sorte de décoration, de citation, ou même de tombeau, qui s’accorde étroitement à l’architecture du pavillon. Pour la première fois, Richter utilise la peinture à une échelle symbolique et publique, dépassant le simple cadre de l’image.

Gerhard Richter : 48 portraits. 1972
Le changement d’échelle : de l’image intime à la peinture publique
Avec les 48 Portraits, Richter expose au spectateur une accumulation d’images, un ensemble riche, presque saturé d’informations. À l’inverse, lorsqu’il commence ses peintures grises au début des années 1970, il adopte une stratégie totalement opposée : réduire la peinture à son strict minimum. Dans ces œuvres monochromes, tout est recouvert de gris. Les tableaux ne se distinguent plus par leur motif inexistant mais par la manière dont la couleur est déposée, on y voit avec l’épaisseur des couches, des gestuelles plus ou moins perceptibles, une variation de texture. C’est alors qu’avec une seule teinte, Richter explore une multitude de nuances possibles.
Le résultat produit une impression d’effacement, d’absence d’expression individuelle. Le gris devient la couleur du neutre, de la retenue, presque de l’impersonnel. Là où 48 Portraits construisait une monumentalité fondée sur la multiplication des images, les Gris instaurent une monumentalité qui repose sur le retrait, sur une présence silencieuse et dépouillée. Cette neutralité devient une forme d’architecture : la peinture cesse d’être un récit ou une imitation, elle devient un lieu. Ce passage au monumental amplifie tout ce qu’il a exploré dans les années 60 : le doute, l’effacement, la distance deviennent littéralement spatiaux.
La peinture comme système : hasard, grilles et répétitions
En parallèle de cette exploration du format, Richter s’engage dans une autre direction, très liée aux courants conceptuels du moment : il met en place des systèmes, des règles, des protocoles. Il cherche à neutraliser la main du peintre, à réduire l’expression personnelle, et à voir ce que devient la peinture lorsque l’artiste s’efface derrière une procédure. Les nuanciers de couleurs, qu’il développe dès 1966 mais qu’il systématise au début des années 70, en sont un exemple essentiel. Dans 1024 Farben (1973), il établit une gamme de couleurs entièrement déterminée, puis les répartit dans une grille où chaque case est attribuée par tirage au sort. Il ne compose plus : il distribue.
La couleur n’est plus une intuition : elle devient un code.
Ces grilles produisent des images vibrantes, presque pré-numériques, comme si Richter anticipait les pixels avant l’ordinateur. Elles montrent comment une peinture peut exister sans composition traditionnelle, sans geste expressif, simplement à partir d’un système. Avec ces œuvres, il prouve que la peinture peut devenir une structure objective, mais rester profondément visuelle.

Gerhard Richter : 1024 Farben. 1973.
Mettre en tension photographie, peinture et histoire de l’art
Richter refuse de choisir un langage définitif. Pendant qu’il développe des systèmes abstraits ou des surfaces neutres, il continue à travailler d’après photographie et à dialoguer avec l’histoire de l’art. Cette tension entre photographie, peinture et histoire de l’art apparaît de manière exemplaire dans plusieurs œuvres de la décennie, notamment les 48 Portraits présentés à la Biennale de Venise en 1972, évoqués plus tôt et qui prennent ici toute leur signification. En uniformisant ces images encyclopédiques en noir et blanc, Richter transforme le panthéon culturel occidental en un système visuel, presque en un code, plutôt qu’en une série d’individualités.
Il en va de même avec la série Annonciation d’après Titien (1973). Richter y copie un chef-d’œuvre de la Renaissance à partir d’une simple carte postale. La copie commence fidèlement, puis l’image se brouille, se désagrège, se transforme en variations presque abstraites. Le flou devient la preuve que copier une image ne garantit jamais d’en saisir la vérité. Dans les deux cas, Richter montre que la peinture peut à la fois reprendre des images existantes, les monumentaliser, les détruire partiellement et en faire naître un nouvel espace de sens.

Gehrard Richter : Annonciation d’après Titien. 1973
Une étape décisive : la peinture devient un langage évolutif
Ce qui est frappant dans cette partie du parcours de l’exposition, c’est que Richter n’abandonne rien de ce qui a fait sa force dans les années 60. Il continue de partir d’images existantes, il garde le flou, il maintient une distance critique. Mais en même temps, il élargit tout : l’échelle, les procédures, les variations. La peinture devient un langage évolutif. C’est alors qu’elle n’est plus seulement une image fixée sur une toile, mais un ensemble de possibles, une succession de systèmes, de surfaces, de gestes, de copies et de variations. Elle passe d’un registre à l’autre sans jamais perdre sa cohérence.
Cette décennie des années 70 est donc décisive : elle montre que Richter n’est pas seulement un peintre de l’image, mais un peintre de la pensée, un artiste qui interroge la peinture dans toutes ses dimensions spatiales, historiques, conceptuelles. Et elle prépare directement les années 80, où Richter va faire exploser l’abstraction tout en revenant, paradoxalement, à des images intimes d’une grande douceur, comme les portraits de Betty ou les natures mortes silencieuses.
Les années 1980 : entre monumentalité abstraite et retours intimes
Après les expérimentations conceptuelles et les surfaces systématiques des années 1970, l’exposition nous fait entrer dans les années 1980, qui marquent un nouveau tournant dans la carrière de Richter. À ce moment-là, un nouveau contexte international apparaît : un peu partout, on assiste au “retour de la peinture”. En Allemagne, le mouvement des Nouveaux Fauves (Baselitz, Kiefer, Lüpertz) remet la figure et la matière au centre. Richter, fidèle à son doute fondateur, ne se laisse pas absorber par cette mode, mais il répond à sa manière : en inventant une abstraction d’un genre totalement nouveau, née à la fois du geste, du hasard, de la transformation d’esquisses, et d’un rapport toujours critique à l’image. Au début des années 80, Richter développe ce qui deviendra l’une de ses signatures majeures : les Abstraktes Bild, des peintures abstraites d’une ampleur spectaculaire.

Gerhard Richter : Abstraktes Bild. 1986
Contrairement à l’abstraction expressive américaine, ces œuvres ne sont jamais improvisées. Elles commencent souvent par de petites esquisses au crayon, à l’aquarelle ou à l’huile, que Richter agrandit, transforme, puis attaque littéralement à la raclette, en raclant des couches successives de couleurs.
Ce procédé, qu’il perfectionne à partir de 1984, lui permet de créer des surfaces extrêmement denses, où des strates se révèlent ou disparaissent. Le tableau devient un champ de tensions : entre hasard et contrôle, entre construction et destruction. Ces peintures sont monumentales, parfois de plusieurs mètres, et plongent le spectateur dans un paysage abstrait en perpétuel mouvement.
Richter affirme d’ailleurs : « Le hasard est pour moi un outil, car il permet à la peinture d’être plus intelligente que moi. » Ce dialogue entre maîtrise et imprévu donne naissance à des surfaces denses, vibrantes, en perpétuelle transformation, où le spectateur se trouve immergé dans un paysage abstrait mouvant. Dans l’exposition, ces grands formats occupent des salles entières. Ils affirment une puissance picturale qui naît paradoxalement du doute : plus Richter remet en question la peinture, plus il la rend spectaculaire.
Le parallèle intime : portraits, natures mortes et douceur inattendue
Mais dans ces années 80 de bouillonnement créatif, Richter ne se contente pas de développer une abstraction monumentale.
En parallèle, presque en secret, il revient à des images profondément personnelles :
– des portraits de ses enfants,
– des scènes de famille,
– des natures mortes silencieuses.
Ces œuvres sont d’une finesse incroyable, réalisées à partir de photographies, comme à ses débuts. Elles montrent, à contre-courant de ses grands formats, une fragilité, une tendresse, une intimité. Dans l’exposition, Betty (1988) est sans doute l’un des tableaux les plus saisissants.

Gehrard Richter : Betty. 1988.
Richter y représente sa fille, alors âgée d’environ dix ans, vue de dos, détournant légèrement la tête vers un fond gris. La scène semble presque anodine, mais elle produit un effet très fort : ce n’est pas seulement un portrait, c’est une image sur l’attention, sur l’éloignement, sur la mémoire.
Ce qui frappe immédiatement, c’est le paradoxe : Richter peint sa propre enfant, mais elle nous échappe. Elle ne nous regarde pas, elle regarde ailleurs. Encore une fois, il part d’une photographie familiale, mais il transforme ce cliché intime en un espace de silence, un moment suspendu. Le tableau ne cherche pas à représenter la personnalité de Betty, mais plutôt la distance qui existe dans toute image : quelque chose ou quelqu’un est là, mais ne se laisse jamais saisir complètement.
Richter lui-même a souvent évoqué la manière dont ce tableau entre en résonance avec 18. Oktober 1977, le cycle historique qui le suit immédiatement dans son catalogue raisonné. Il parle d’une coexistence du tragique et du sublime, du politique et du personnel, comme si ces deux œuvres si différentes étaient en réalité deux manières de répondre à un même questionnement sur la fragilité humaine.
Il confie d’ailleurs que « l’art et la beauté sont l’apanage de l’espoir face à une réalité souvent difficile à supporter », la beauté étant pour lui l’opposé direct de la destruction et du désespoir. À travers Betty, ce geste est palpable : derrière la douceur du portrait, il y a une méditation sur la distance, le temps qui passe, l’impossibilité de retenir une image ou un être. Autre image emblématique des années 80 : la série des Kerze (Bougies, 1982, 1983).

Gerhard Richter : Kerze (Bougie). 1982
Richter y met en scène une simple bougie, peinte d’après une photographie, et aborde à travers ce motif le passage du temps, la fragilité de la vie, et même une dimension spirituelle que l’on n’associe pas spontanément à son œuvre.
La flamme, légèrement floue, vacillante, semble presque prête à s’éteindre.
Ce flou, typique de sa technique, n’est pas un effet nostalgique : il crée une distance, comme si cette lumière fragile appartenait à un souvenir qui se dérobe. Richter décline ce motif dans une série d’environ vingt-cinq peintures, réalisées entre 1982 et 1983, qui réinterprètent profondément la tradition des vanités classiques. Il compare d’ailleurs ces tableaux à des rites funéraires : la bougie allumée symbolise à la fois l’adieu, la présence apaisée d’une vie qui s’éteint doucement, et le temps qui s’écoule inexorablement. Comme dans les vanités du 17e siècle, le motif est simple, mais la charge symbolique est immense : tout disparaît, tout passe, et la peinture est là pour en porter la trace.
Ce qui rend ces œuvres particulièrement touchantes, c’est le contraste entre la monumentalité du format, car ce sont souvent de grandes toiles, et l’extrême simplicité du sujet. On y retrouve une attention très fine à la lumière, au quotidien, à la douceur des choses ordinaires, presque à l’opposé de la violence ou de la complexité des grands formats abstraits qui occupent à la même période une grande partie de son énergie.
Cette coexistence entre l’intime et le monumental, entre la douceur et la tension, entre la vie familiale et l’histoire collective, est l’un des traits les plus marquants de l’œuvre de Richter dans les années 80. Elle montre un artiste qui peut tout aborder, du plus personnel au plus politique, sans jamais sacrifier la profondeur ou la nuance.
Quand l’histoire collective s’invite dans la peinture : 18. Oktober 1977
Après avoir évoqué l’intimité lumineuse des Kerze et la douceur silencieuse du portrait de Betty, il peut sembler surprenant de voir Richter se tourner, presque au même moment, vers l’un des sujets les plus sombres et les plus sensibles de l’histoire allemande récente.
Et pourtant, le contraste est volontaire : Richter explique souvent que ces œuvres dialoguent entre elles.
La lumière fragile d’une bougie, le visage détourné d’une enfant, et les images fantomatiques de la Fraction Armée Rouge sont trois manières d’aborder une même question : comment représenter ce que la mémoire ne parvient pas à saisir, qu’il s’agisse d’un moment intime ou d’un traumatisme collectif ?
C’est dans cet esprit qu’il réalise, en 1988, la série 18. Oktober 1977.


Gerhard Richter : 18. Oktober 1977. 1988
Composée de quinze tableaux peints d’après des photographies de presse et de police, elle reprend les images liées à la Fraction Armée Rouge, un groupe terroriste d’extrême gauche actif dans les années 1970. Les tableaux montrent les membres du groupe emprisonnés, certains lors de leur procès, d’autres morts dans leurs cellules le 18 octobre 1977 date officielle de leur suicide, un épisode encore entouré de zones d’ombre.
Cette série marque une étape importante : elle montre que la peinture peut encore affronter l’histoire, mais sans violence, sans pathos, sans spectaculaire. Elle le fait par la distance, par le retrait, par la fragilité de l’image. C’est une réponse très personnelle à la question allemande du rapport au passé.
Une décennie de contrastes : douceur, violence, monumentalité
Ce qui frappe chez Richter dans cette période des années 80, c’est la coexistence de ces registres :
– l’abstraction la plus intense,
– les images intimes les plus fragiles,
– et l’histoire la plus sombre.
Richter ne sépare rien. Il refuse le cloisonnement. Pour lui, la peinture peut tout accueillir : le geste, la copie, la mémoire, l’histoire, l’intime. Dans l’exposition, cette coexistence est très forte : même dans des salles séparées, on perçoit une tension entre les grands formats abstraits, qui débordent littéralement des murs, et ces petites images silencieuses qui retiennent le regard.
Cette tension est la clé des années 80 : c’est une décennie où Richter prouve que la peinture, loin d’être dépassée, peut encore penser, questionner et toucher profondément.
Les années 2000 : verre, couleur, mémoire et transformations du réel
Après les grands cycles abstraits et les œuvres intimes des années 80 et 90, l’exposition nous conduit vers les années 2000, un moment où Richter transforme une nouvelle fois sa pratique. Il s’éloigne progressivement de la toile traditionnelle pour explorer d’autres matériaux, notamment le verre, qui devient l’un des centres de son travail. En même temps, il continue d’interroger l’image, sa matérialité, sa transparence, sa fragmentation et sa place dans la mémoire.
Ce moment marque une nouvelle étape dans son œuvre : la peinture n’est plus seulement un lieu de représentation ou d’expérimentation gestuelle, mais un espace où le réel lui-même est mis à l’épreuve.
Le verre occupe une place essentielle dans la dernière partie du parcours. Depuis les premières expériences menées en 1967 avec les 4 Glasscheiben, Richter s’intéressait déjà à la capacité du verre à transformer la perception. Mais au début des années 2000, le verre devient un médium à part entière.

Gehrard Richter : 6 panneaux verticaux. 2002/2011
Dans des œuvres comme 6 panneaux verticaux ou dans les grands ensembles de panneaux transparents, Richter ne peint plus d’image. Il construit un dispositif perceptif qui reflète, dédouble, fragmente et laisse passer la lumière. Le verre agit aussi comme un filtre qui introduit un flou naturel, un trouble optique. L’œuvre ne représente plus le monde : elle l’absorbe, le déforme et en montre l’instabilité.
Cette démarche prolonge toute sa carrière. Le flou des photo-peintures se manifeste ici non plus par le pinceau, mais par la matière elle-même. Transparence, reflets et opacités partielles deviennent des manières de mettre en doute ce que nous voyons.
Les abstractions tardives : geste, hasard et musique
En parallèle, Richter continue de développer une abstraction très riche, qui n’a plus tout à fait le même statut que dans les années 80. Les grandes toiles à la raclette réalisées autour de 2005 et 2010, notamment la série Cage, témoignent d’une maturité nouvelle.
Le titre renvoie au compositeur américain John Cage, dont Richter admirait la manière d’intégrer le hasard, le silence et l’imprévu dans la musique. Dans ces œuvres, le hasard intervient dans la superposition des couches, dans la manière dont la raclette révèle ou efface les couleurs, dans la vitesse du geste ou encore dans la résistance de la matière. Ces peintures créent des surfaces où la couleur vibre, glisse et se superpose de manière imprévisible. Elles ne représentent rien, mais donnent l’impression d’un espace autonome, presque musical, où l’œil se perd dans des profondeurs de matière.
September (2005) : une réponse sobre au traumatisme contemporain
Au cours de cette même décennie, Richter aborde un événement historique majeur : l’attentat du 11 septembre 2001. Dans l’œuvre September, réalisée en 2005, il choisit de ne pas représenter directement la violence ou la catastrophe. Au contraire, il adopte une grande retenue.

Gerhard Richter : September. 2005.
Le tableau montre deux formes verticales gris-bleu qui se détachent sur un fond marqué par des stries horizontales et verticales. Sans le titre, l’image pourrait sembler purement abstraite ; avec le titre, les deux formes deviennent immédiatement les tours du World Trade Center. Richter part d’une photographie, mais il efface presque tout ce qui s’y trouvait. Il recouvre l’image, il la racle, il la trouble, comme si la mémoire refusait de fixer l’instant exact.
Richter explique qu’il voulait éviter toute esthétique du spectaculaire. Il ne s’agit pas de représenter l’événement, mais de représenter ce qu’il en reste dans l’esprit : une image fragmentaire, floue, incertaine, trop fragile pour être saisie frontalement.
La série Birkenau (2014) : représenter l’irreprésentable
L’exposition se termine sur l’un des ensembles les plus puissants de l’œuvre de Richter : la série Birkenau, commencée en 2014. Elle est née de quatre photographies clandestines prises en 1944 par des prisonniers d’Auschwitz-Birkenau, montrant les meurtres en cours. Richter a d’abord tenté de peindre directement ces images. Mais très vite, il a recouvert les figures, puis entièrement effacé les scènes sous des couches successives de raclette : des gris, des rouges sombres, des verts toxiques, des noirs et des stries horizontales et verticales.

Gehrard Richter : Différents états de Birkenau, jusqu’au tableau final. 2014.
Les photographies sont présentes sous la surface, mais elles ne sont plus visibles. Ce geste n’équivaut pas à une destruction, mais à un refus de livrer ces images à la consommation visuelle. Richter protège ces photographies en les recouvrant. Il souligne l’impossibilité éthique de représenter l’horreur de manière frontale.
À travers Birkenau, Richter propose une mémoire voilée, mélancolique, presque musicale, où la peinture devient un lieu de deuil et de réflexion. C’est une manière de répondre, avec dignité, à la question de la représentation de la Shoah. Richter affirme d’ailleurs qu’il peut exister une poésie après Auschwitz, mais une poésie qui passe par la retenue et non par la reproduction de l’horreur.
Après la série Birkenau, qui affronte l’une des questions éthiques les plus vertigineuses de son œuvre, comment représenter ce que l’on ne peut ni montrer ni même regarder, Richter peint encore pendant quelques années. Et ce qui frappe, dans ses toutes dernières toiles avant 2017, c’est le contraste absolu avec la gravité de Birkenau.
En regardant ces ultimes peintures abstraites, on a le sentiment qu’une joie nouvelle s’est introduite dans son travail : un abandon plus libre au geste, des couleurs vives, une énergie presque jubilatoire. Après les couches lourdes, les strates sombres, les hésitations volontaires des décennies précédentes, ces œuvres semblent respirer autrement. Elles ne portent plus la même tension, comme si Richter se permettait enfin de peindre sans devoir répondre à une question historique, éthique ou conceptuelle.
Richter a toujours travaillé par groupes : il peignait intensément pendant plusieurs mois, puis s’arrêtait, attendait, observait, et revenait lorsque le désir revenait lui aussi. En 2017, après avoir terminé ce dernier groupe de peintures, il fait une pause comme à son habitude… mais cette fois, le désir ne revient pas. Il dit simplement : « Je n’ai plus le désir de peindre. »
Ce n’est pas un geste spectaculaire.
Ce n’est pas une déclaration programmatique.
Ce n’est pas “la fin de la peinture” comme certains artistes l’ont proclamée.
C’est un constat intime, presque calme :
quelque chose a changé. Il ne se reconnaît plus dans la nécessité de retourner vers la toile.
Et pourtant, ces dernières peintures ne ressemblent en rien à une fin.
Elles ont l’allure d’un grand geste final, mais un geste qui ne clôt rien.
Elles sont ouvertes, vibrantes, pleines.
C’est paradoxal : au moment où Richter cesse de peindre, ses tableaux semblent dire exactement le contraire : que la peinture continue, qu’elle déborde, qu’elle reste vivante.
Après 2017, bien que pas montré lors de l'exposition, il ne cesse pas de créer : il dessine quotidiennement, il produit des œuvres sur papier, des encres, des expériences avec le hasard, les solvants, les strates fines qu’il superpose comme des respirations. Comme si le passage au dessin, un médium qu’il n’avait jamais considéré comme central, lui offrait une légèreté nouvelle.
Pour conclure, cette rétrospective montre que Gerhard Richter n’a jamais été un artiste d’un seul langage. Pendant plus de soixante ans, il a exploré la figuration, l’abstraction, le verre, le numérique et même le dessin, sans jamais se laisser enfermer dans un style fixe. Ce qui l’intéresse avant tout, ce n’est pas la forme, mais la manière dont une image se construit, se transforme ou se dérobe.
Depuis ses premières photo-peintures jusqu’aux œuvres sur papier des dernières années, la même question revient : que voyons-nous vraiment quand nous regardons une image ? Et peut-on encore représenter la mémoire ou l’histoire dans un monde saturé de photographies ?
La photographie est au cœur de cette interrogation. Richter s’en sert en permanence, mais il s’en méfie. Pour lui, une photo n’est pas une vérité, mais un fragment, un filtre, déjà chargé d’interprétation. En peignant d’après des images de famille, des coupures de presse, des documents historiques ou des cartes postales d’œuvres célèbres, il ne cherche pas à les copier, mais à en montrer les limites. Le flou, les effacements, les recouvrements, le verre ou encore les images numériques servent à briser l’illusion d’une image transparente et à ralentir notre regard.
Son œuvre entretient ainsi un lien profond avec l’histoire de la photographie contemporaine. Elle en révèle les zones d’ombre et rappelle que la peinture, loin d’être dépassée, reste un moyen privilégié pour affronter ce que les images ne peuvent pas dire complètement : la violence, le deuil, mais aussi la douceur, la lumière et le simple plaisir de peindre.
Au fond, la leçon de Richter est peut-être celle-ci : toute image est fragile, toute mémoire est incertaine, mais l’art, lorsqu’il accepte cette fragilité, peut encore nous apprendre à regarder autrement.
Unika Perez, le 12/01/2026
___________________________________________________________________________________
Fondation Louis Vuitton
8 Avenue du Mahatma Gandhi
75116 Paris 16
Accès
1 station Les Sablons
Tarifs
Tarif - 3 ans : Gratuit
Tarif étudiant (jeudi uniquement) : Gratuit
Tarif - 18 ans : 5€
Tarif - 26 ans : 10€
Plein tarif : 16€
Site officiel
www.fondationlouisvuitton.fr
Réservations
www.fondationlouisvuitton.fr
02.01.2026 à 11:59
On aime #121

Texte intégral (1202 mots)

Louise Glück photographed early in her career as poet and educator. (Courtesy of the Library of Congress)
L'air du temps
Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - Se Você

L'éternel proverbe
La forêt est la pelisse du pauvre.
Proverbe estonien
Le haïku sur la tête
Un drapeau rouge
Dans une ruelle de Nara
Et la lune de jour.
Nakamura Teijo
Les mots qui nous parlent
Il est vrai qu’il n’y a pas assez de beauté dans le monde.
Il est vrai aussi qu’il n’est pas de ma compétence de lui en redonner.
Il n'y a pas non plus de sincérité et ici je peux être d'une certaine utilité.
Je suis
au travail, bien que silencieuse.
La fade
misère du monde
nous serre de chaque côté, comme une allée
bordée d’arbres ; nous sommes
ensemble ici, sans parler,
chacun dans ses pensées ;
derrière les arbres le fer forgé
des portails de maisons privées,
pièces aux volets fermés,
l’air désert, abandonné,
comme si l’artiste avait
le devoir de créer
de l’espoir, mais avec quoi ? avec quoi ?
le mot lui-même,
faux, un artifice pour réfuter
la perception – À l’intersection,
les lumières ornementales de la saison.
J’étais jeune alors. Voyageant
en métro avec mon petit livre
comme pour me défendre
contre ce même monde :
tu n’es pas seule,
disait le poème,
dans le sombre tunnel.
/
It is true there is not enough beauty in the world.
It is also true that I am not competent to restore it.
Neither is there candor, and here I may be of some use.
I am
at work, though I am silent.
The bland
misery of the world
bounds us on either side, an alley
lined with trees; we are
companions here, not speaking,
each with his own thoughts;
behind the trees, iron
gates of the private houses,
the shuttered rooms
somehow deserted, abandoned,
as though it were the artist’s
duty to create
hope, but out of what? what?
the word itself
false, a device to refute
perception-At the intersection,
ornamental lights of the season.
I was young here. Riding
the subway with my small book
as though to defend myself against
this same world:
you are not alone,
the poem said,
in the dark tunnel.
Louise Glück – Il est vrai qu’il n’y a pas assez de beauté dans le monde … – October (poem) – The New Yorker (28 October 2002) . Poème cité dans le livre de James Longenbach, La résistance à la poésie (Editions de Corlevour, 2013) Traduit de l’anglais 'États-Unis' par Claire Vajou

Louise Glück
19.12.2025 à 10:27
Avec Frank Zappa, les freaks sortent aussi la nuit - Part 1

Texte intégral (2186 mots)
Le 27 juin 2026, Freak Out ! des Mothers of invention fêtera ses 60 ans. Collages sonores, improvisations inspirées, album-concept… il détonne toujours par son approche éclectique, gourmande et expérimentale de la musique, s'essayant à plusieurs genres et s'écartant des sentiers conventionnels du rock, du jazz ou du classique. L’album avait foiré aux Etats-Unis mais la Franck Zappa touch, leader du groupe, a conquis les jeunes Européens.

Une semaine après la sortie de Blonde on Blonde de Dylan, Freak Out ! des Mothers of Invention jaillit des boites à disques en juin 66, un double album fou, étrennant le premier concept-album, un an pile poil avant le « Sergent Pepper » des Beatles. Freak out !donc ou l’extravagance des grandes pendules de fête foraine, et leur loopings émotionnels. Dix années psyché suivraient. En chef de bande, Franck Zappa, avec son univers singulier et multiple, confluent toutes les recherches à venir, zigzagant entre soul, jazz, doo wop, blues, musique contemporaine et rock appuyés par un discours engagé sur la vacuité de la société de consommation américaine. Tout cela ciselé-emballé avec l’humour ultra-caustique d’un Zappa (1940-1993) synchro avec son époque. Entre avant-garde revendiquée et crétinisme de façade, Freak out ! constitue un chef d’œuvre qui a mis du temps à se faire reconnaître comme tel aux USA, mais a séduit plus vite les jeunesses européennes.
Si l’année 1966 marque le début de l’envoi massif de marines au Vietnam, après le rapatriement des derniers citoyens américains sur place et les premiers bombardements comptables en milliers de tonnes l’année précédente ; c’est parce que le Président démocrate Lyndon B. Johnson, en vieux routier des institutions a fait précédemment passer des lois sur l’abaissement des impôts pour les moins fortunés et le relèvement pour les autres, en vue de financer l’aide médicale, les programmes de développement scolaire, le droit de vote des Afro-américains, l’accès à la justice pour tous et organisé le budget de la guerre qui va aller s’amplifiant. En réponse à cela, la jeunesse des USA qui ne voit pas l’intérêt du conflit répond, à sa manière, avec la naissance des premières communautés hippies, les premières manifestations étudiantes massives contre la guerre : la conscription des classes moyennes appellent 30 000 hommes sous les drapeaux chaque mois. Des émeutes raciales, à Cleveland et Chicago, sont réprimées par la Garde Nationale, comme à Watts en 1965. Aux élections de mi-mandat, les Démocrates perdent une cinquantaine de sièges au Sénat et à la Chambre en réaction aux lois sur les droits civiques, les électeurs du Sud se tournant vers les Républicains. En octobre, naissance des Black Panthers et le 8 novembre, l’ex-acteur de série B, Ronald Reagan est élu gouverneur de Californie.
Le déclencheur de cette vague de fond se situe du côté du 2 mai 1965 lorsque l’administration Johnson, en rupture avec la politique de « bon voisinage » affirme que les « nations américaines ne peuvent, ni ne veulent, ni ne voudront autoriser l’établissement d’un autre gouvernement communiste dans l’hémisphère occidental » et engage les États-Unis dans la défense de « tous les pays libres » de la région. En 2026, Cuba est toujours sous embargo… Et la CIA, d’habitude peu apte à commenter les décisions présidentielles, critiquera très sévèrement l'opération qu'elle qualifiera de « gaspillage humain et financier sans précédent dans l'histoire des États-Unis. » Quelle ironie pour le bras armé international du complexe militaro-industriel !
« Quelle est l'agence bien connue de Dieu ?
Celle qui a pris son bâton et sa verge ?
Putain d'homme de la CIA !
L'homme de la CIA ! »
(The Fugs/ CIA Man 1965)
« Quand le rythme de la musique change, les murs de la ville tremblent », prophétisait Shakespeare. Et c’est à la fois de Californie, du Texas et de New-York que tous les signes ou plutôt les sons du grand chamboulement s’annoncent en 1965. Les Byrds en synthétisant l’approche électrique des Beatles et les textes folk de Dylan, envoient leur version en 4/4 du « Mister Tambourine Man », en lieu et place du 2/4 originel. Gros carton pour les Californiens qui vont faire virer Dylan électrique le printemps suivant à Newport – et le faire traiter de « renégat » par des barbus qui n’y entravent que pouic. À New-York, un groupe de poètes se baptise les Fugs (détournement du F.U.C.K. de Norman Mailer qui les saluera en les intégrant dans un autre roman ); c’est la naissance du premier groupe underground de l’histoire du rock avec humour acide, contestation pointue et comportement anar durable. Et, côté psychédélisme, c’est au Texas qu’on assiste à la rencontre inopinée, non loin d’une table de dissection, d’une cruche amplifiée et d’une guitare électrique au sein du 13th Floor Elevators qui conduira à la sortie en 1966 de The Psychedelic sounds, le prototype de l’album psyché qui influencera toute la scène californienne, balayant le folk et la country pour envoyer des soli de guitare dans les étoiles – et à la gueule de l’establishment. Mais le 13th Floor, après avoir écumé les scènes de San Francisco et infusé la philosophie orientale (mélangé au LSD), impressionnant tous les groupes locaux avec leur garage psyché, retournera tout piteux à Austin, avant de s’auto dissoudre par lassitude, après trois albums indispensables, poursuivi par la police locale, le chanteur Rocky Erickson se voyant même infliger des électrochocs. C’est sûrement ça la magie du Texas.
« Réverbération, réverbération
Vous voyez la réverbération
Dans votre dernière incarnation
Vous pensez que c'est une sensation
Mais ce n'est qu'une réverbération »
(13th Floor Elevators/ Reverberation)
Freak Out! ou comment combattre une Amérique au seul goût de Vache qui rit (Suzy Creamcheese what’s got into you ? )
Deux derniers détours, s’il vous plaît, car d’importance, avec le compositeur américain d’origine française Edgard Varèse (1883-1965) et le Velvet Underground.
Ainsi Zappa dans Stereo Review, (volume 26, n°6), juin 1971, qui célèbre le sixième anniversaire de la mort de Varèse, raconte sur une dizaine de pages, son « Edgard Varese : Idol of my youth », avec « reminiscence and appreciation » et dévotion.
« Le jour de mon quinzième anniversaire, ma mère m'a dit qu'elle m'offrirait 5 dollars, mais je lui ai répondu que je préférais passer un appel téléphonique longue distance. J'ai pensé que M. Varese vivait à New York parce que le disque avait été enregistré à New York (et parce qu'il était tellement bizarre qu'il vivrait à Greenwich Village). J'ai obtenu le numéro de New York Information, et bien sûr, il était dans l'annuaire.
C'est sa femme qui a répondu. Elle était très gentille et m'a dit qu'il était en Europe et qu'il fallait rappeler dans quelques semaines. C'est ce que j'ai fait. Je ne me souviens pas exactement de ce que je lui ai dit, mais c'était quelque chose comme : « J'aime beaucoup votre musique ». Il m'a dit qu'il travaillait sur une nouvelle pièce intitulée Déserts. Cela m'a beaucoup plu, car je vivais alors à Lancaster, en Californie. Lorsque vous avez quinze ans, que vous vivez dans le désert de Mojave et que vous apprenez que le plus grand compositeur du monde, quelque part dans un laboratoire secret de Greenwich Village, travaille à une chanson sur votre « ville natale », vous pouvez être très enthousiaste. Le fait que personne à Palmdale ou à Rosamond ne se soucie de l'entendre un jour m'a semblé être une grande tragédie. Je pense toujours que Déserts parle de Lancaster, même si les notes de pochette du disque Columbia disent qu'il s'agit de quelque chose de plus philosophique. »
Et le petit Franky conservera comme un fragment divin ionisé, le menu billet d’une conversation qui ne s’est jamais faite entre humains, mais par musiques interposées :
VII 12th/57
Dear Mr. ZappaI am sorry not to be able to grant your request. I am leavingfor Europe next week and will be gone until next spring. I amhoping however to see you on my return. With best wishes.Sincerely Edgard Varese
Ceci justifie les notes de pochette de Freak Out! qui paraphrasent le « Manifeste de 1921 » de Varese et son « Present Days Composers refuse to die /Les compositeurs contemporains refusent de disparaître. »
Second détour avant le feu d’artifice.
Hello la musique contemporaine, bonjour le Velvet Underground, fort de deux musiciens contemporains dans la première version du groupe : le percussionniste Angus McLise et le pianiste/violoniste John Cale. Tous deux sont issus du groupe de La Monte Young, le Theatre of Eternal Music; premier ensemble à développer l’usage du drone qui fera le bonheur de titres comme Heroïn ou du contenu du second album White light/ White Heat. Défini par Zappa comme « le meilleur groupe de folk urbain » de New-York, Frank s’arrangera quand même chez MGM pour avoir la primeur de la sortie d’album, évitant de se retrouver à lutter avec le seul autre groupe de rock vraiment barré du moment. Lou Reed, à son habitude, vociférera sur les magouilles de Zappa visant à éliminer la concurrence…
Des deux groupes, on dira qu’ils auront partagé le même producteur atypique Bob Wilson, l’un des rares afro-américain renommé de l’époque qui a travaillé juste avant à électrifier Dylan, ou produire aussi bien Simon & Garfunkel, Cecil Taylor que Sun Ra.
“Allez, Wall Street, faut pas traîner/
Cette guerre, c'est du gâteau/
Y a plein de fric à se faire
Pour équiper l'armée /
Faut juste espérer et prier que quand ils larguent les bombes/
Elles tombent bien sur le Vietcong”
Country Joe & the Fish / I Feel Like I’m Fixin to die rag
La suite - Avec Frank Zappa, les freaks sortent aussi la nuit - Part 2 - au prochain numéro
16.12.2025 à 11:43
L'art et le dilemme de la photographie de rue selon Jeff Schewe : la vérité dans la rue

Texte intégral (1848 mots)
Chaque portrait, demandé ou pris au passage, est un témoignage de la présence humaine, un instantané d'une histoire qui, sans cela, pourrait être oubliée.

En tant que photographe de rue, je suis attiré par l'énergie brute et spontanée des gens réels qui se déplacent dans des espaces réels. Les portraits de rue sont ma façon de documenter la vie telle qu'elle se déroule, et au fil des ans, j'ai appris que photographier avec ou sans permission entraînait des conséquences différentes. Lorsque je demande la permission, la dynamique change. Le sujet prend conscience de l'appareil photo et ajuste souvent sa posture, son expression ou son attitude. Dans ces moments-là, l'image devient une collaboration. Le portrait gagne en intimité et le sujet peut se sentir valorisé en participant au processus. Cet effort de coopération conduit souvent à des portraits riches en émotions et consciemment expressifs, même si cela se fait parfois au détriment de la spontanéité.
D'un autre côté, photographier sans permission préserve l'authenticité de la scène. La personne est simplement elle-même, inconsciente de l'objectif. Cette approche candide apporte une vérité documentaire à l'image : honnête, sans filtre et pleine de vie. Ces moments sont souvent les plus puissants, car ils ne sont pas mis en scène.

Je marche constamment sur la ligne entre le respect et l'impulsion artistique. En fin de compte, le portrait de rue est un exercice d'équilibre entre la connexion et l'observation. Que je m'engage avec mon sujet ou que je capture tranquillement le moment à distance, mon objectif reste le même : refléter l'esprit de la rue et la beauté du quotidien. Chaque portrait, demandé ou pris au passage, est un témoignage de la présence humaine, un instantané d'une histoire qui, sans cela, pourrait être oubliée.


Jeff Schewe est un photographe renommé et primé basé à Chicago, dans l'Illinois, qui compte près de 50 ans d'expérience dans la photographie commerciale et artistique. Après avoir suivi une formation de peintre, Schewe s'est tourné vers la photographie, apportant une sensibilité picturale à ses images et apportant une contribution significative à l'imagerie numérique et à l'impression artistique.
John Agfa le 16/12/2025
Jeff Schewe : la vérité dans la rue

16.12.2025 à 11:30
Taiaida Silvania : des fourmis dans le fromage brésilien

Texte intégral (1049 mots)
Après les fromages qui coulent, ceux qui sentent trop fort et même ceux qui coûtent une petite fortune, voici une nouveauté croustillante tout droit venue du Brésil : le fromage aux fourmis. Oui, oui, des fourmis. Dans le fromage. Et contre toute attente, ce produit audacieux ne fait pas fuir les consommateurs… il les séduit. Bienvenue dans l’univers gustatif du Taiada Silvania, le fromage aux fourmis qui bouscule les papilles et les idées reçues.

Une tradition indigène transformée en succès gastronomique
Tout commence dans la ferme Estância Silvânia, au cœur de l’État de São Paulo. Camila Almeida, la propriétaire, voulait créer un produit unique qui raconte une histoire locale. Elle s’est alors inspirée d’une tradition culinaire indigène ancienne : la dégustation des fourmis içá (Atta laevigata), de grandes fourmis coupe-feuille récoltées une fois par an et très appréciées pour leur goût délicat rappelant l’amande et la châtaigne. Ces insectes sont parfois surnommés « le caviar brésilien » tant ils sont recherchés.
Plutôt que de les servir seules comme en-cas, Camila a décidé de les intégrer à un fromage fermier au lait cru A2, fabriqué à partir de vaches Gir nourries à l’herbe. Le résultat est à la fois surprenant et raffiné : une pâte douce et souple ponctuée de petites fourmis grillées, qui apportent une touche croquante et un parfum unique, entre noisette et fenouil sauvage.
Le fromage aux fourmis : une innovation médaillée
Présenté en 2021 au prestigieux Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, à Tours, le Taiada Silvania – c’est le nom de ce fameux fromage aux fourmis – a décroché une médaille de bronze. Pas mal pour un fromage parsemé d’insectes !
Le jury a salué l’équilibre entre originalité et qualité gustative. Ce succès a ouvert à Camila les portes du Salon du Fromage à Paris, où son produit a continué à étonner les visiteurs, aussi bien les gastronomes que les simples curieux.
Cette réussite rappelle que l’univers culinaire adore les mélanges inattendus. Après tout, qui aurait parié sur le succès du café aux excréments de jacú, une autre spécialité brésilienne née d’une idée improbable ? Ou sur la notoriété planétaire du pule, le fromage le plus cher du monde ?
Un goût unique qui bouscule les habitudes
Le secret de ce fromage aux fourmis ne réside pas dans une recette complexe, mais dans le moment précis où les fourmis grillées sont incorporées au caillé. En les ajoutant au moulage, elles conservent leur texture croustillante et libèrent des arômes délicats lorsqu’on croque dedans. Le contraste entre la douceur lactée et le petit “pop” croquant sous la dent est assez déroutant au début, mais la subtilité des saveurs finit souvent par convaincre.
Ce mélange entre tradition et innovation n’est pas sans rappeler d’autres curiosités culinaires qui jouent avec les frontières du goût. Les amateurs de fromages étonnants connaissent peut-être déjà le Milbenkäse, ce fromage allemand aux acariens, oui, aux acariens vivants.
Un fromage qui interpelle autant qu’il intrigue
Si le fromage aux fourmis séduit autant, c’est parce qu’il coche plusieurs cases à la fois. Il raconte une histoire profondément ancrée dans la culture locale tout en proposant une expérience sensorielle inédite. Ce n’est pas seulement un produit “bizarre” pour réseaux sociaux en quête de buzz : c’est un vrai fromage, artisanal et travaillé avec soin, qui a su convaincre un jury international.
Bien sûr, ce type de produit bouscule nos repères culinaires. Certains hésiteront sans doute à croquer dans une fourmi – même bien grillée. D’autres seront freinés par le prix, plus élevé qu’un fromage ordinaire, en raison de la récolte saisonnière des fourmis et de la production limitée. Mais pour les curieux, l’expérience est mémorable. En savoir plus : ici et là
Tom de Savoie, le 16/12/2025
Taiaida Silvania : c
16.12.2025 à 11:07
Fred Again envoie "USB002", à la fois clé de dj et coupe dans le son de 2025

Texte intégral (760 mots)
À la base, USB002 n’est pas un “album” classique : c’est une série de morceaux pensés pour la clé USB que Fred trimballe de club en festival. L’idée est simple et géniale : 10 titres, 10 raves, 10 semaines, avec des tracks qui naissent sur la route, évoluent au fil des concerts, puis se figent sur disque. Ce double vinyle vient capter ce moment où les IDs mythiques deviennent enfin des morceaux à part entière.

Dans la lignée d’USB001 et de la Compilation USB Vol. 1, USB002 mélange edits maison, collabs et remixes, mais en poussant encore plus loin le curseur club : kicks plus durs, basses plus sales, moments de tension pensés pour les tunnels de 5 heures de set. Sur platine, tu as littéralement l’impression de poser l’aiguille au milieu d’un warehouse à 3 h du matin. Et si tu as un ampli costaud et des enceints qui assurent, tu peux te faire une rave maison…
Là où la série Actual Life et l’album ten days racontent surtout la vie intime de Fred Again.. (voix de proches, notes vocales, fragments de vie), le projet USB a toujours été tourné vers la scène. USB002 pousse la logique au maximum : c’est le Fred Again du dancefloor, sans filtre, celui qu’on voit sauter derrière ses machines en faisant hurler la foule.
Musicalement, on navigue entre house émotionnelle, UK garage, techno, hard drum, voire touches de hardstyle sur certains drops. Les premiers retours de la presse électronique et des fans sont clairs : USB002 est en train de devenir le versant le plus radical de sa discographie, celui dont on parlera comme de la bande-son d’une génération de raves post-pandémie.
Sur vinyle, cette énergie se ressent encore plus : la dynamique des kicks, les basses qui poussent vraiment les enceintes, le grain des voix pitchées… USB002 gagne une dimension physique qui complète parfaitement les versions streaming et les lives captés sur radio ou plateformes. Mais surtout, on y entend un monde pris des turbulences qui fluctue et se renouvelle sansz cesse. La bande-son de Noyel - et même après. L’album qui pousse, et pouse encore, de quoi oublier les cuves à pisse qui interdisent les raves autorisées. La fête cheza vous, pour vous De quoi clôturer une annéen forte en désillusions, patronée par un crétin orange en pleine crise de sénilité; quand ici on a un vide au sourire de veau qui a déjà gagné les élections pour la galaxie bol à raie… Enjoy !
Jean-Pierre Simard, le 16/12/2026
Fred Again - USB002 - Atlantic / East West Records UK.
16.12.2025 à 10:50
En route avec des abeilles, des choses et des fleurs pour Maude Maris

Texte intégral (1249 mots)
Quand bien même on aurait pris le temps de détailler chacune des fleurs, il manquerait encore quelque chose, l’impression d’ensemble, les nécessaires intrications du vivant. Peindre un pré n’est pas chose facile. Francis Ponge pensait que la tâche n’était envisageable que du seul point de vue du langage. Maude Maris l’a envisagé dans la continuité d’un travail de la toile qui propose de regarder entre les choses.

Maude Maris, Still, 2024 — Huile sur toile, 24 x 33 cm
“Prendre un tube de vert, l’étaler sur la page, Ce n’est pas faire un pré.”
Le Pré, Francis Ponge
Entre la forme et la contreforme, la pierre et la sculpture, l’artiste a longtemps abordé la question du sujet de biais ; il s’agissait de traiter de la représentation elle-même, de la façon dont différents systèmes de classification, de catégorisation reposent sur l’œil et l’observation.
Progressivement, des formes animales sont arrivées, présences fossiles, totems évocateurs, jusqu’à la silhouette d’un cheval, la toison d’un mouton, la tête d’une vache. Un ensemble de plus en plus mouvant, un cadre de représentation qui devient celui d’une rencontre. Pour l’artiste, l’animal est une figure de l’altérité la plus absolue. Sa présence s’impose en même temps qu’une manière d’être au monde fondamentalement différente. Une seconde ne passe pas de la même manière pour un humain ou une libellule ; un mouvement lent peut être perçu dans un autre champ de vision comme un geste brusque.
En prenant pour centre de son travail depuis 2022, une maison normande, Maude Maris avance la peinture par la marche. Il faut aller contre l’habitude de la domesticité, regarder les animaux au pré. Le travail à l’huile avec sa multitude de couches permet à l’artiste d’atteindre la bonne heure, le bon moment.
Une toile représentant une cavalcade à l’horizon, prend d’abord les teintes de l’aube avant de s’assombrir et d’atteindre à la tombée de la nuit. D’une couche à l’autre, c’est un travail des contraires qui amène l’artiste à sans cesse préciser son attention. La touche haptique rend palpable d’une toile à l’autre la neige, la paille, un certain climat.
L’artiste s’attache comme au travers de la statuaire à rendre le poids des choses, à leur donner une place. Autant que les ombres, chères à l’artiste Susan Rothenberg qui retrouvent une énergie pariétale dans ses toiles, c’est le souffle qui donne au cheval sa forme. Les contrastes sont présents : la légèreté d’une fleur qui ploie au vent, la pesanteur d’un corps capable de s’émouvoir.
Il s’agit pour l’artiste, comme l’y invitait le philosophe Jean Grenier dans Les îles, de redevenir proche par la répétition quotidienne des arbres, du ciel, des animaux, par les constantes physiques et naturelles. La part de terre et de ciel est toujours dans les tableaux en perpétuelle négociation. Le point de vue est mouvant. Deux chiens ancrés dans le sol semblent les gardiens d’un repos qui n’appartient qu’à eux. Leur façon d’occuper l’espace, leur permet pour ainsi dire d’entrer en discussion avec l’herbe, avec le soleil, les formes se répondent, les mouvements du pinceau y invitent.
Tout bruisse dans le pré, même ce que l’on n’y discerne pas.
Henri Guette, le 16/12/2025
Maude Maris — Just bees, and things, and flowers ->4:2:2026
Les Jardiniers de Montrouge 9/11, rue Paul Bert 92120 Montrouge

16.12.2025 à 10:24
« J’aime beaucoup quand les récits personnels font écho avec la grande histoire » Interview de Jérémie Dres pour “Les fantômes de la rue Freta”

Texte intégral (11910 mots)
Depuis 15 ans et son premier livre, “Nous n’irons pas voir Auschwitz”, Jérémie Dres questionne son histoire familiale — ou met en image les souvenirs des autres — pour creuser notre histoire commune à travers les fils rouges des individus. Avec “Les fantômes de la rue Freta”, c’est une enquête sur plusieurs continents, interrogeant plusieurs époques que le dessinateur déroule sous nos yeux, et c’est un morceau d’histoire qui se dévoile à partir d’une simple carte postale.

Sur 380 pages, Jérémie Dres dévoile sous forme de reportage dessiné, insérant documents, photos et objets dans les planches même. Un travail documenté, ponctué de rencontres clefs et d’échanges familiaux pour comprendre les mystères d’une carte postale envoyée depuis le ghetto de Varsovie par une de ses grandes tantes.
Sa quête prend forme au fil des chapitres alternant entre questionnements, fausses pistes et révélations, l’auteur restitue 4 ans de travail, de recherches historiques, de généalogie et d’archives avec une lisibilité qui nous fait dévorer le livre d’une traite malgré la densité.
Et pour mieux en comprendre les coulisses, ses méthodes de travail et ce pont entre Nous n’irons pas voir Auschwitz & Les fantômes de la rue Freta je vous propose un entretien copieux avec Jérémie Dres pour passer tous ces sujets en revue.
Tu repars pour une enquête, un documentaire autobiographique qui prend la suite de Nous n’irons pas voir Auschwitz, après avoir réalisé d’autres projets, c’est une recherche que tu menais en parallèle de tes autres albums ?
Jérémie Dres : L’origine de ce livre c’est la découverte de cette carte postale du ghetto de Varsovie dans les affaires de ma grand-mère, et cette découverte je la fais à peu près en 2019. J’étais en train d’écrire Le Jour où j’ai rencontré Ben Laden —le T1 je crois— et ça a mis un peu de temps à infuser. Entre le moment où j’ai fait cette découverte —qui est un truc assez incroyable— et le moment où je me dis il faut que j’en fasse quelque chose, il s’est passé 2 ans. C’est beaucoup.
Et comme je le raconte dans le livre, quand j’ai fait Nous n’irons pas voir Auschwitz je n’avais pas été jusqu’au bout. C’était un livre qui avait été nécessaire à l’époque où je le faisais, suite au décès de ma grand-mère en 2009. C’est la première fois qu’on va en Pologne avec mon frère en 2010 —le livre sort en 2011— et avec toutes nos appréhensions, il y avait vraiment une volonté à cette époque-là de se reconnecter avec nos racines. De retrouver un peu de ma grand-mère dans ce pays.
Comme le titre l’indiquait, il y avait l’idée d’évacuer très clairement toute la question des 5 années d’anéantissement, la Shoah. Mais après coup, ce livre qui me paraissait très bien était imparfait dans le sens où je ne traitais pas du tout cette question-là dans ma propre famille. Et je le raconte dans ce nouveau livre, parfois, quand je faisais des rencontres avec le public : les gens se disaient « super, au final, vous avez eu de la chance ». Et je me rends compte que je n’avais pas été juste.
Et la découverte de cette carte postale à la fois révèle cette culpabilité de ne pas avoir du tout honoré la mémoire des disparus de ma famille ; et en même temps elle me dit que c’est peut-être le moment que j’attendais pour avoir un traitement plus juste de ce sujet. Ce livre était vraiment nécessaire, après avoir fait le premier.

Photo de Jérémie Dres en dédicace à Saint Malo, 2025 ©DR
Tu parles de planification dans l’album, comment tu te prépares pour une enquête comme ça ? Pour ces voyages ?
J.D. : Ça s’est fait au fur et à mesure. On pourrait dire que c’est comme une pelote de laine avec un fil que j’ai déroulé petit à petit.
La première chose, c’est que j’ai cette carte postale écrite par la sœur de ma grand-mère, cette grande tante dont je n’avais quasiment jamais entendu parler. D’un coup, je me rends compte qu’il y avait de la famille à Varsovie, alors que je pensais que tout le monde était parti. Mon premier réflexe a été d’aller sur place pour essayer de voir si on pouvait trouver des choses sur elle et sa famille —son mari et ses deux enfants. Donc, on va dans le lieu consacré, qui est le Jewish Historical Institute de Varsovie où, a priori, c’est là qu’ils ont rassemblé toutes les archives sur la communauté juive de la ville.
Quand je vois la généalogiste au début, je tombe un peu de haut parce que je pensais lui avoir envoyé suffisamment d’éléments : il y avait cette carte postale, des photos, des noms… et elle me dit « je n’ai rien ». Ah bon ! En fait, ce sera quand même elle qui a, d’une certaine manière, déroulé tout mon livre.
Elle m’a dit — parce qu’elle a l’habitude du rien— que les archives de la ville ont été quasiment toutes détruites, surtout pour ce qui est de la communauté juive. Donc, il faut trouver des manières, il faut trouver des voies parallèles pour réussir à reconnecter les morceaux.
Elle connaît ces voies parallèles et ce sont les voies que je vais entreprendre par la suite. Comme par exemple Ellis Island où je me rends compte que quand je parlais de la famille qui avait quitté la Pologne, les premiers partent aux États-Unis et ensuite les autres vont aller à Paris. Et ma grand-mère, c’est limite, la dernière à partir.
Mais du coup mes premiers ancêtres qui partent à New York ont laissé des traces, parce qu’ils étaient obligés quand ils remplissaient les listes de passagers des bateaux. C’est toute cette histoire qui est fascinante et qu’on connaît assez bien, finalement, cette arrivée à Ellis Island.
Comme les formulaires étaient assez précis —personne à contacter dans le pays d’origine, personne à contacter sur place— d’un coup ça fait des liens entre les uns et les autres et ça permet de reconnecter, de rassembler des morceaux. Ça, c’était une voie.
Il y avait une autre voix, qui était le mémorial Yad Vashem de Jérusalem où on demande aux survivants —je crois depuis la création du mémorial— de remplir des feuilles de témoignage sur les disparus : quel est le lien avec cette personne-là, son métier, sa dernière adresse, son adresse pendant la guerre…
Ma grand-mère en avait rempli justement une pour sa sœur. En fait, si je n’avais pas rencontré cette généalogiste, l’enquête n’aurait pas eu l’ampleur qu’elle a eue. Cette dame m’a ouvert les portes et j’ai continué à dérouler la pelote de laine.

Tu vas voyager dans plusieurs pays entre 2021 et aujourd’hui, combien de temps tu as mis pour accumuler, trier la documentation avant de dessiner les planches ?
J.D. : C’est intéressant parce que c’est vrai qu’il y a un moment où on se dit ok, c’est bon. Et quand c‘est bon, c’est quand on sait qu’on a suffisamment de matière pour le livre. Je l’ai quand même su assez vite.
On n’a pas encore tout à fait parlé de cette carte postale du ghetto de Varsovie, mais pour la plupart des gens —comme pour moi— le ghetto de Varsovie c’est un lieu clos. Et le fait d’y avoir une correspondance me paraissait invraisemblable, mais ça existait ! Et dans cette carte elle raconte dans les premières phrases : « Je te remercie de m’avoir envoyé des colis. » Et d’un coup on se dit qu’il y avait quand même des échanges. Il y a un côté assez fascinant. Quand on imagine que la ville a été complètement détruite, que toute cette population a été anéantie, d’avoir pu conserver cette archive-là, c’est presque un trésor. En tout cas du point de vue d’un petit archiviste amateur.
Après, il y a ce premier voyage, cette rencontre avec la généalogiste qui m’ouvre toutes les portes. Ensuite je suis allé à New York, à Ellis Island, mais aussi pour rencontrer un grand historien, Samuel D. Kassow, qui a travaillé sur les archives secrètes du ghetto de Varsovie.
J’ai quand même fait aussi un voyage en Israël, à Yad Vashem pour retrouver ces feuilles de témoignage. J’ai fait ces choses-là par sûreté, on va dire, pour être certain que ça le faisait en sachant que j’avais le point de départ, mais je n’avais pas forcément le point d’arrivée. C’est-à-dire, est-ce que je vais trouver des choses ?
Les deux grosses questions posées étaient : pourquoi était-elle restée ? Et, est-ce que cette carte postale était la dernière trace d’elle, son dernier signe de vie ? Même quand j’ai fait ces deux voyages, je ne savais pas encore mais j’avais accumulé suffisamment de matière pour me dire que c’était bon, que je pouvais démarrer l’écriture du livre. J’étais peut-être à 100-200 pages crayonnées que je n’avais toujours pas ma fin. J’espérais toujours trouver des choses.
Alors j’ai trouvé des choses : j’ai trouvé la raison pour laquelle elle était restée là-bas, j’ai trouvé pas mal de choses sur sa vie à cette époque. Ce que j’ai tenté de faire dans le livre, c’était regarder avec les yeux du passé, j’ai vraiment essayé de comprendre ce qu’elle vivait : ça faisait un an que le mur venait d’être scellé dans le quartier dit juif de la ville. Un an que le ghetto juif été scellé et qu’elle vivait dans cet enfer avec ces deux filles qui étaient malades d’après ce qu’elle raconte dans la lettre. J’ai vraiment essayé de comprendre ce qu’avait pu être sa vie.
Mais il y avait plusieurs inconnues, elle parle de ses enfants, mais pas de son mari, qu’est-ce qu’il est devenu ? Et bien sûr qu’est-ce qu’ils sont devenus après la lettre ? C’était vraiment un mystère que j’ai essayé de creuser, creuser, creuser.
J’y apporte des réponses parce qu’on bascule à chaque fois entre mémoire familiale et mémoire collective : par exemple septembre 1941, qu’est ce que ça représente ? Je me rends compte que deux ans plus tard, elle a dû déménager d’immeuble parce que sa rue donnait carrément sur le mur du ghetto et les Allemands modifiaient les frontières du ghetto de façon assez arbitraire. Et là où elle n’avait pas eu à déménager, ce qui avait été une grande chance pour elle, elle doit déménager 2 mois après la lettre et on se dit qu’à priori son destin est scellé, mais je n’en ai pas la preuve. Et moi, je travaille comme un journaliste, dans le sens où il me faut les preuves.
Il y a eu des actes de décès. En octobre 1940, le ghetto de Varsovie est créé sur un quartier où il n’y avait pas que des juifs, pas du tout, et les juifs étaient dans tous les alentours, mais les Allemands décident de les regrouper. Les juifs qui habitaient hors de ce quartier sont forcés de déménager du jour au lendemain et les Polonais non juifs qui habitaient là sont forcés de partir, il y a un échange de population. Et déménager avait des effets très dommageables pour leur survie.
Et au début, je crois qu’elle aussi a été obligée de déménager parce que j’ai un petit doute sur l’adresse, mais je me rends compte que non, elle a heureusement pu rester sur ce temps-là. Et tout ça, c’est vraiment dans l’enquête, au fur et à mesure que je rassemble des pièces.
Entre 1940 et 1942, il y a, je crois, bien 20% de la population qui meurt de famine ou de typhus. Et ça m’a beaucoup surpris, mais pendant toute cette période il y avait un historien qui vivait dans le ghetto : Emanuel Ringelblum. Il était à la tête d’une organisation Oyneg Shabbos et a commencé à rassembler au maximum tout ce qu’il y avait : les affiches nazies, les tracts, des témoignages de personnes à différents postes : la personne qui faisait la soupe populaire, le facteur…
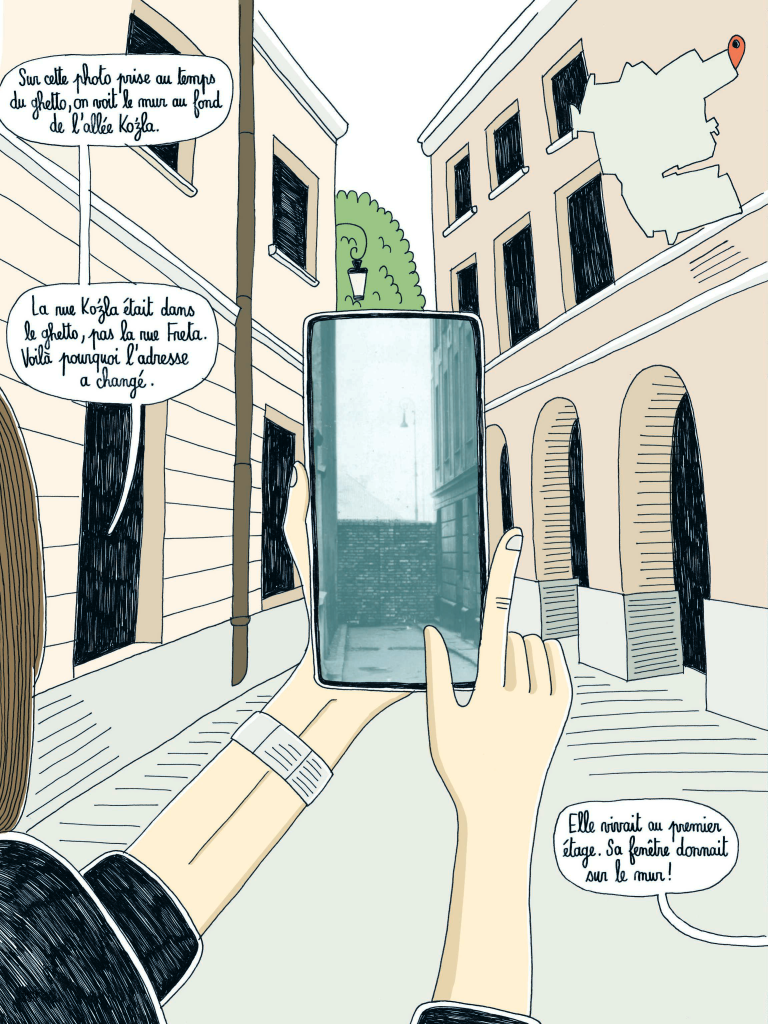
Et j’ai repris les chroniques du facteur, parce que tu te rends compte vraiment de la vie qui continue à exister dans le ghetto. C’est fascinant, c’est vraiment très différent de ce qu’on pouvait imaginer jusqu’à ce qu’on redécouvre ces archives —qu’on a appelé les archives secrètes— jusque là on pensait que le ghettos ce n’était que l’image qu’en avaient donné les nazis avec des visages émaciés par la famine, l’absence de solidarité, la misère… Ils avaient leur vision, c’était de la propagande pure. Emanuel Ringelblum a contribué à donner un autre regard, un autre angle sur le ghetto en y apportant un peu cette vie.
Et parmi ce qu’il a récolté, il a récolté des actes de décès. Un nombre restreint par rapport au nombre de gens qui sont morts. On a retrouvé des fosses communes, plus tard, dans le cimetière de Varsovie —et ça a été même filmé par les nazis, il existe un film. Je me suis intéressé à ces actes de décès, je me suis dit que j’allais peut-être retrouver son nom dans les actes de décès, j’ai retrouvé sa voisine de palier avec l’adresse, mais pas elle. Jusqu’au bout, j’ai cherché la preuve.
Finalement je n’ai pas trouvé, mais j’ai fait ce que je raconte à la fin du livre, qui m’a beaucoup marqué : les pavés de mémoire. C’est une démarche d’un artiste allemand Gunter Demnig, qui s’appelle les Stolpersteine, et ce sont des pavés en mémoire des disparus qui sont posés à leur dernière adresse. Je vivais à Hambourg à cette époque-là, la deuxième ville d’Allemagne où il y a le plus de Stolpersteine après Berlin. J’ai vécu un an là-bas et quand je marchais dans la rue je voyais ces Stolpersteine partout et à un moment donné je me suis dit, c’est ça ma fin !
Sur internet, sur Twitter, je vois que la première Stolpersteine a été posée à Varsovie. Il faut imaginer, Varsovie c’est la ville qui comptait le plus de juifs d’Europe avant la Deuxième Guerre mondiale et la première Stolpersteine posée : 2023. Pour la pose des Stolpersteine, ça dépend des municipalités, à Paris par exemple ou à Munich, ils ne veulent pas en mettre.
Mais Varsovie, ils veulent bien et j’ai entamé les démarches. Ça a été très, très long. Parce qu’ ils veulent bien, mais tu dois passer par quelqu’un qui parle la langue, pour communiquer avec la municipalité, parce que ce sont des fonctionnaires polonais qui ne vont pas s’embêter à parler anglais avec toi. Tout se fait en langue polonaise, heureusement, j’ai été beaucoup aidé.
En plus, il s’avère que cette adresse, 27 rue Freta, est en plein dans le vieux quartier piéton —qui s’appelle le vieux quartier, mais c’est un quartier qui a été reconstruit ensuite— donc les règles sont plus strictes. Et ça a pris plus de temps, mais au final j’y suis arrivé et ça a été une grande fierté pour moi de poser ces pavés.

Le livre a un impact sur le monde…
Oui, c’était le but de la démarche. Ça permettait d’avoir quelque chose de physique, en plus du livre, je me suis complètement retrouvé dans la démarche de cet artiste. Je me suis dit « c’est exactement ça ». Et quand j’ai découvert les Stolpersteine, mes interlocuteurs étaient une personne de la fondation des Stolpersteine, allemande, et la personne qui gérait toute l’administration pour la municipalité de Varsovie, donc polonaise. Et petit à petit, j’ai découvert les choses, mais à la base, je ne connaissais pas du tout cet univers-là et j’ai compris ensuite qu’il y avait effectivement ces cérémonies-là avec des discours.
Bon du coup, c’est à moi de faire le discours [rires], il n’y a rien de formel, mais c’est l’usage. La chance que j’ai eue pour le livre, mais aussi personnellement c’est d’avoir eu des représentants de l’ambassade d’Allemagne qui sont venus à la cérémonie et ça faisait sens : j’avais baigné pendant toutes ces années d’enquête sur les mauvais traitements qui étaient infligés par les nazis allemands à la population. C’était juste horrible. Et là deux représentants de l’ambassade d’Allemagne, en costumes, qui déposent une gerbe, ça a été hyper fort.
La ville a beau avoir été reconstruite, elle est quand même marquée, d’un coup, tu ressens vraiment la puissance du passé. Surtout que l’endroit précis, c’était l’endroit où se tenait un mur. C’est un moment tellement magique, tellement puissant que c’était un vrai enjeu de le raconter.
Dans ces deux albums, il y a ton frère puis ton père, ta sœur et ta fille qui t’accompagnent, est-ce qu’au moment de la réalisation tu leur fais relire ? Est-ce qu’ils ont apporté des changements suite à ce qu’ils ont pu lire de leur mise en scène ?
J.D. : C’est une bonne question, mais je la joue très journaliste dans le sens où j’essaye le moins possible de me brider. Et du coup, je vis avec la peur, je vis avec l’angoisse de me dire : ils ne vont pas aimer.
Tu as des vraies personnes et tu en fais des personnages de BD, ce ne sont pas des caricatures, mais pas loin : tu vas pousser certains traits de leur personnalité parce qu’il faut en faire des personnages. S’ils sont trop insipides, trop neutres, c’est chiant pour le lecteur donc, il faut pousser les traits.
Ma fille elle donne le change en termes d’enfance et de naïveté. Quand elle me pose la question « c’est quoi un ghetto, papa ? » —et elle me l’a vraiment posée— tu te demandes comment un jour, les humains se sont dits on va créer ça ; et tu dois le raconter à ta fille. C’est quelque chose d’incroyable.
Mon père, j’en fais un peu un complotiste entre guillemets [rires] ; pour ma sœur j’avais un peu peur parce que, effectivement, à la fois, elle peut poser des questions hyper pertinentes, mais parfois elle est à la cool, très contente d’être là. Et moi je suis dans le rythme du journaliste reporter qui a besoin de récolter les choses et forcément ça crée un peu des petites tensions avec quelqu’un à la cool. Mais j’avais envie qu’on puisse sentir un peu ça.
Donc je ne le fais pas lire, mais après coup, j’ai un peu les chocottes en me disant « comment ils vont le prendre ». Mais jusqu’à présent tout le monde le prend bien. Typiquement, au lancement, il y avait pas mal de gens de ma famille présents —notamment ma sœur, mon frère, mon père— et ils voient ça d’un bon œil. Ils me font confiance. Mais ça reste toujours bienveillant, je pousse les traits, mais au final, ils connaissent bien l’intention, et en vrai ça ne va pas ternir leur réputation [rires].
Généralement, j’ai de la chance pour ça, quand tu prends Le Jour où j’ai rencontré Ben Laden, qui n’a rien à voir, j’ai interrogé Mourad et Nizar, mais je ne leur ai pas fait lire avant. Mourad et Nizar ont découvert l’album avant que je l’envoie en impression et Mourad n’était pas du tout d’accord avec le titre, en rejet total. Et puis, quand il a commencé à lire, il a dit « OK, ce n’était pas un piège». J’ai raconté leur version.
Moi ce qui m’intéressait, c’était de donner un contexte historique à l’expérience qu’ils avaient vécue et ils ont apprécié la démarche et m’ont suivi dans la promo après. Donc ça va jusqu’à maintenant, je touche du bois, je n’ai pas eu de personnes qui se fâchent après coup.

Dans tes documentaires, tu vas à la rencontre d’historiens, écrivains ou spécialistes, comment tu sélectionnes ce que tu gardes dans le livre, on imagine que tu as à chaque rencontre une quantité d’infos, de dialogues.
J.D. : Quand tu regardes Nous n’irons pas voir Auschwitz où il y a beaucoup de blocs de texte. C’était mon premier livre et j’avais rencontré deux personnages que je trouvais incroyables, ils étaient à la tête d’une association juive communiste —qui datait de l’époque où la Pologne était sous giron soviétique et cette association avait perduré— et ces deux personnages étaient complètement intemporels et drôles. Pur humour juif ! Ils m’avaient fait rire pendant 4-5h et je me suis dit que j’allais tout raconter : et le chapitre faisait 50 pages [rires].
J’ai beaucoup changé, mes livres sont beaucoup plus concis et je vais beaucoup plus à l’essentiel. Il y a pas mal de personnages dans mon nouveau livre —et j’ai essayé d’en mettre le moins possible, malgré tout— mais il y a des experts, historiens, archivistes, généalogistes. Il y en a que je n’ai même pas mis parce que ce n’était plus pertinent après 4 ans d’enquête.
Par exemple, je vais à Arolsen qui est le plus grand fonds de documentation des archives nazies, je me déplace et je rencontre l’archiviste. Il y a une discussion qui dure de 2-3h sur une ville chargée d’histoire : Arolsen est devenue une sorte de QG des alliés franco-britannique-US, la ville a une histoire particulière pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je n’en fais qu’une page.
Mais j’apprécie de plus en plus ça. J’avais lu Retour à Lemberg, une bande dessinée adaptée du livre de Philippe Sands et lui fait ça aussi. Il rencontre une personne importante : une case, une bulle. Pour moi c’est vers ça qu’il faut tendre dans une enquête, il ne faut pas trop dériver, il faut aller à l’essentiel.
Pour tout ce qui touche au ghetto de Varsovie, j’ai lu énormément sur ce sujet. J’étais fasciné par l’insurrection du ghetto, et il faut voir qu’après la grande liquidation de l’été 1942 il reste encore 5-10% de la population juive dans le ghetto et ils commencent à créer des bunkers sous terre ou dans les appartements pour préparer l’insurrection. Cette période, je l’ai trouvé fascinante, mais je n’ai pas trop pu en parler.
Au fil des livres, je crois qu’il faut aller là où on a besoin. Tout à l’heure, j’ai parlé du facteur qui s’appelle Peretz Opoczynski, c’était pour moi très pertinent de raconter ça. Parce qu’il avait fait à la fois une chronique sur son métier de facteur qui s’est retrouvée dans les archives secrètes : il raconte d’où venaient les colis. Les colis, c’était une chance de survie, ça permettait à certaines familles de se maintenir 2-3 semaines de plus.
Mais il raconte aussi la contrebande là où vivait ma tante —c’était fascinant pour moi— et sa chronique date d’un mois après la lettre de ma tante. L’enquête, c’est pour moi l’idée d’être le plus précis et le plus proche. Et ces chroniques étaient parfaitement pertinentes par rapport à l’enquête que je menais. J’ai lu beaucoup de témoignages en travaillant sur cette période-là, mais si je voulais apporter du fond sur le parcours de ma tante, il fallait recentrer un maximum autour d’elle, de son quartier, dans la période où je savais qu’elle était encore en vie. C’est un vrai travail de tri et de sélection, mais ça rend les choses plus fortes.

Tu proposes aussi ton processus de réflexion, des fausses-pistes, des moments de doutes en regard de l’enquête qui avance, comment tu scénarises ces parties-là ? Comment tu rythmes ton récit ?
J.D. : Je ne sais pas si tu fais référence à ça, mais son mari, c’est un mystère. Parce que dans la lettre, elle parle de l’état de ses enfants — qui sont dans un état vraiment très difficile— elle dit qu’elle a dû vendre son manteau, alors que l’hiver approche, pour acheter du pain. On sent qu’elle est vraiment dans une position délicate, mais elle ne parle pas de son mari, elle signe avec son nom de jeune fille, alors qu’elle est mariée depuis presque 10 ans. C’est interpellant, même s’il était mort, elle pourrait continuer à signer de son nom de femme mariée.
Du coup, j’ai essayé de m’intéresser au parcours du mari pour essayer de voir si je trouvais des choses sur lui. Malheureusement, le nom de famille du mari, Berliner, est un nom très commun : Berliner c’est comme Dupont. Berliner ça désigne un habitant de Berlin. Tu démarres avec ça, gros handicap. Et son prénom écrit à la polonaise “Heniek”, en hébreu “Hersz”, en yiddish, “Herschel”, un prénom juif de l’époque assez classique.
J’avais plus ou moins son année de naissance grâce à la fiche de témoignage que ma grand-mère avait rempli à Yad Vashem. Et je me suis rendu compte le nombre de Hersz & Herschel Berliner qui étaient nés entre 1902 et 1910, dans ces cas-là tu te permets d’être flou, parce que tu veux essayer de trouver le maximum de profils correspondants. Je me suis retrouvé devant 5-7 profils qui correspondaient et j’ai trouvé que c’était intéressant de le montrer.
C’est pour ça que j’ai choisi d’intégrer les archives au récit, c’est de montrer l’état de mes recherches avec l’idée d’inviter aussi les lecteurs à m’accompagner là-dedans —ce qui est déjà une grande chose en soi— mais aussi de peut-être les poursuivre. De voir les pistes que j’ai essayé d’explorer, mais pourquoi pas pour des gens un peu plus érudits, qui lisent le yiddish, qui lisent l’hébreu, qui lisent le polonais, de se dire est-ce que je ne pourrais pas essayer de trouver des choses ? Ces fausses pistes sont aussi un petit clin d’œil au lecteur pour lui dire : voilà ce que j’ai trouvé.

Plutôt que de mettre un cahier documentaire à la fin, tu intègres directement les documents dans tes planches, encapsulées dans des dessins, dans la mise en page, l’idée est arrivée à quel moment ?
J.D. : Petit à petit, parce qu’habituellement dans mes livres, je démarre avec des vrais principes graphiques et là je me suis cassé les dents. Ça ne fonctionnait pas parce qu’ il y avait une vraie ambition.
La carte postale avec la calligraphie de ma grand-tante —cette écriture qui a pris la pluie, qui a pris le temps, qui est jaunie, qui est très marquée— elle voulait dire beaucoup de choses. La reproduire seule n’avait aucun sens, donc très tôt, je me suis dit que l’inclure au récit était plus pertinent.
Et quand j’ai retrouvé le visage de ma grand-tante et sa famille, de ma grand-mère quand elle arrive en France dans les années 30, à 20 ans. Et toutes ces images, toutes ces archives sont tellement précieuses, tellement belles. J’adore les archives anciennes comme ça. Et petit à petit ça faisait complètement sens qu’elles soient incluses dans le récit.
Ça se fait peu en bande dessinée, j’ai essayé de trouver d’autres BD comme ça : je pourrais citer Heimat : Loin de mon pays de Nora Krug qui est pas mal là-dedans, mais j’ai eu du mal à en trouver d’autres. Ce n’est pas du tout courant et pourtant c’est un enjeu : il faut que tu t’y retrouves graphiquement, que ça ne fasse pas un patchwork indigeste. C’est un défi que j’ai relevé et je crois que ça fonctionne : j’ai travaillé là-dessus pour faire en sorte que ça puisse être le plus harmonieux possible.
Et ça rejoint ce que je disais sur le côté où le lecteur m’accompagne dans l’enquête, c’est pour ça que j’avais envie qu’on puisse lire l’écriture des ancêtres, de pouvoir consulter à la fois des photos de l’histoire collective, des photos d’histoire familiale —même s’il y a plus de photos d’histoire familiale— mais pour cette richesse graphique que ça pouvait apporter.
C’est vrai qu’ il y a eu beaucoup de défis dans le livre : il y a également l’idée de mélanger le présent au passé. Comment tu traites le passé, comment tu traites le présent ? Il y a eu aussi un défi assez particulier qui a été de comment représenter les habitants du ghetto de Varsovie, parce que la plupart des sources photographiques qu’on a, ce sont celles des nazis : soit des photos de propagande avec des mises en scène, soit celles des soldats nazis qui faisaient plus ou moins du tourisme sur place et qu’on a retrouvé plus tard comme celles de Willy Georg, un des photographes qui a pris des photos dans le ghetto un peu clandestinement, dont je parle dans le livre. D’ailleurs, il s’est fait confisquer certaines de ses bobines, mais son fils en a ressorti dans les années 90.
Il faut prendre en compte cette dimension-là : dans le ghetto dès qu’un Allemand passait les Juifs devaient courber la tête, limite enlever leur chapeau. Il y avait une volonté très claire de soumission et quand tu regardes tous ces visages, ce n’est pas naturel : il faut prendre ça en compte.
On a fait croire que c’était naturel parce que c’est ces photos, on les connaît —tu tapes ghetto de Varsovie et on les trouve— mais il manque ce contexte. Et je n’avais absolument pas envie de faire comme si ce contexte n’avait pas eu lieu : ce sont des sujets qui sont pris à leur insu. Il y a pas de consentement, on a des visages fuyants pour la plupart et qui se font prendre en photo sans l’avoir choisi.
Et ça, pour moi, c’était important : c’est ce qui fait que je n’ai pas voulu leur donner de visage. Ce sont des fantômes, voilà d’où vient le titre Les fantômes de la rue Freta. J’aurais pu les dessiner comme je travaille beaucoup avec des archives photographiques anciennes, mais j’ai vraiment souhaité ne pas le faire, c’était impossible de les traiter comme n’importe quelle archive photographique.

Et côté graphique justement, comment tu travailles, quels sont tes outils ?
J.D. : Jusqu’à maintenant j’ai toujours tout fait à la main sauf les couleurs que je bosse sur ordi.
Pour ce livre, je voulais me mettre à l’iPad et j’ai commencé à faire tous mes crayonnés sur la tablette : 380 pages, c’est colossal. Et entre temps, un magazine m’avait demandé un petit reportage de 10 pages et j’essayais de me familiariser à l’outil, de choisir des brushs mais en imprimant je trouve que c’est trop gros. Et le plaisir n’était pas au rendez-vous —j’ai déjà fait 7 bouquins, avec le même outil— alors j’ai rebasculé en traditionnel.
J’ai repris mes crayonnés quand même, je n’ai pas bossé pour rien, mais l’encrage a été fait avec mon stylo habituel. Même si le côté relou là dedans, c’est le scan. Scanner 300 et quelques pages, ça prend un temps inouï. Mais ce n’est pas grave par rapport au plaisir du dessin. Je suis peut-être un peu à l’ancienne, mais le plaisir de la page, du stylo, de l’encre qui sèche c’est des trucs que tu n’as pas sur un iPad. Et sur un iPad tu peux tellement revenir sur un dessin qu’il perd presque de son sens.
Je n’ai pas encore trouvé la solution, et pour les prochains projets je vais rester en traditionnel. Après j’ai beau tout faire à la main, j’utilise aussi l’ordi, par exemple dans les planches qui sont dans le passé, je passe mon trait noir avec une teinte et ça donne un graphisme intéressant. J’aime bien jouer quand même avec tout ça en partant d’une base à la main.
Et tu parlais des enjeux graphiques, au tout début tu intègres une séquence de légende familiale sans avertissement, est-ce que c’est une manière de dire attention la transmission, ce sont aussi des histoires qu’on ne peut pas vérifier dans un bouquin où tout est axé sur la recherche de la vérité ?
J.D. : Quand j’ai commencé à explorer tout ce sujet-là, je suis revenu loin en arrière. Je suis revenu aux parents de Sonia, donc aux parents de ma grand-mère, mes arrière-grands-parents — qui sont d’ailleurs dans le cimetière de Varsovie, c’est leur tombe que je retrouve dans mon premier livre de Nous n’irons pas voir Auschwitz.
C’est une histoire ancienne, et comme toute histoire elle a un peu sa mythologie avant de pouvoir se retrouver dans des archives. Pour certaines familles aristocrates, on trouve des archives qui remontent à 1400, ce n’est pas mon cas. Mais, par exemple, pour cet arrière-grand-père, Moszek, on a quand même retrouvé des choses dans l’histoire de la ville de Varsovie. Très peu, la plupart des archives ont été détruites et lui est mort avant la guerre, en 1915, je crois.
Il y a une mythologie autour de lui —une mythologie parce que ce sont des on-dit— j’ai le souvenir que ma grand-mère m’a dit ça, mon père aussi, mais on n’est plus très sûr de l’exactitude des faits. On sait qu’il est mort en 1915 à Varsovie, et qu’il venait d’un petit village.
C’est probablement dans son village qu’il a été poursuivi par cet ours, mais est-ce que c’est vrai ? Pour ce projet il y a une ambition de saga, d’aller au plus loin, d’inscrire le récit dans tout le XXème siècle. Ça commence forcément par une anecdote un peu floue, de l’ordre de la légende.

Est-ce que tu peux nous parler de la conception de la couverture ? J’ai remarqué que sur les couvertures de tes BD documentaires, il a toujours ton alter ego au 1er plan avec un document à la main et un décor en fond.
J.D. : Oui, tu n’as pas tort. L’idée, c’est toujours de mettre le personnage principal dans le feu de l’action —je reprends les codes de la BD, je n’invente pas— et là il s’avère que c’est moi.
Après, il y a parfois eu des constructions : dans Dispersés dans Babylone, j’ai voulu construire un décor fait de plusieurs de mes voyages, avec plusieurs plans et arrière-plans.
Pour Les fantômes de la rue Freta, ici ça faisait complètement sens qu’on se retrouve dans la rue Freta parce que c’était là que ça s’est passé, c’est là qu’elle a écrit la lettre. En fouillant, je me suis rendu compte que sa fenêtre donnait sur le mur, sa dernière demeure connue —c’est des informations tellement incroyables— et la couverture rassemble un peu tout ça.
Mon personnage est entre le touriste et le reporter, avec la carte du ghetto : il fallait souligner qu’on parlait de l’histoire du ghetto parce qu’effectivement, le titre était moins évocateur que Nous n’irons pas voir Auschwitz qui tout de suite te renvoie à la Deuxième Guerre mondiale. Là, Les fantômes de la rue Freta, ça peut être tout et rien —même un titre de livre pour enfants, presque— donc il fallait bien placer l’histoire du ghetto de Varsovie.
C’est un travail avec l’éditeur. Souvent, c’est moi qui insuffle l’idée, qui dessine un peu et on discute. À la base, je n’avais pas spécialement envie qu’on mette l’étoile de David sur ces silhouettes qui s’apparentent à ma tante et ses enfants, même s’il y a un doute. Je me suis d’ailleurs inspiré des photos du photographe nazi, Willy Georg pour ces personnes-là. Mais je n’avais pas envie d’insérer l’étoile de David, j’aime bien quand la couverture suggère sans tomber dans les gros symboles comme la croix gammée et autres mais je comprends qu’il faut également une identification immédiate au sujet. D’où les mots « ghetto de Varsovie » pour attirer l’œil.
J’essaie de trouver le bon moment de l’action —Varsovie, clairement— et de rassembler les moments les plus forts de l’intrigue. Même si ça reste obscur ou à découvrir pour la personne qui ne l’a pas lue j’ai envie qu’elle puisse avoir une deuxième lecture. Typiquement la fenêtre au fond à droite, elle est éclairée : j’imagine que c’est ma grand-tante qui est en train d’écrire sa lettre. J’aime bien l’idée que le lecteur puisse reprendre la couverture et la réinterpréter.
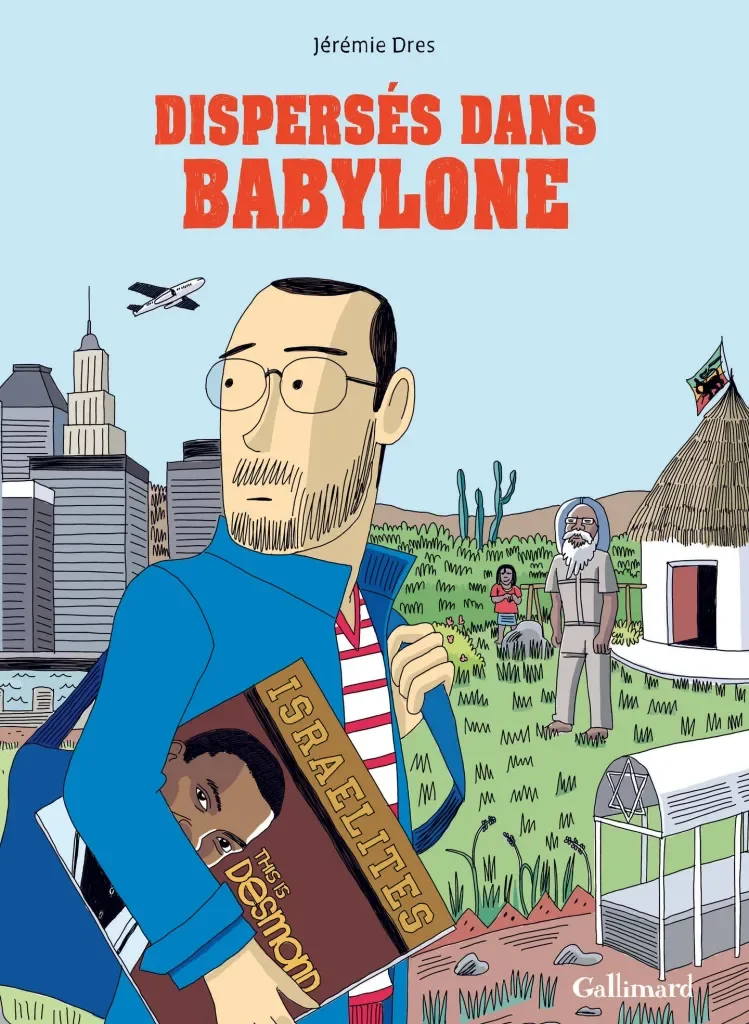
Dernière question, à la fin, il y a une sorte de point final, est-ce que tu as terminé un cycle ?
J.D. : C’est une bonne question, je me la suis posée en écrivant. Cette période-là m’a beaucoup inspiré. Je ne sais pas encore. Peut-être que j’y reviendrai dans quelques années.
C’est vrai que c’est un cycle et qu’il m’a fallu du temps entre Nous n’irons pas voir Auschwitz et ce dernier livre —presque 15 ans— et entre ces deux-là, j’ai exploré d’autres thématiques. J’aime beaucoup quand les récits personnels font écho avec la grande histoire, c’est vraiment mon truc. J’ai exploré d’autres thématiques dans d’autres livres et dans dans des reportages plus courts pour des magazines. Je n’en ai pas terminé, mais ce ne sera pas le prochain.
Ce sont des livres qui demandent de la maturation, et ça me va, de me donner le temps pour ce type de livre, qui sont quand même assez chargés, avec une grosse bibliographie… Il faut savoir les aborder avec originalité, justesse, apporter des choses nouvelles aussi. Il ne faut pas se précipiter sur ces sujets donc pourquoi pas y revenir un jour ou l’autre, mais pas tout de suite.
Je vous invite à aller lire Les fantômes de la rue Freta & Nous n’irons pas voir Auschwitz à la suite pour apprécier ce diptyque informel même si vous pouvez les lire de manière indépendante. Puis de jeter un oeil sur Le jour où j’ai rencontré Ben Laden (notre coup de coeur) qui nous surprend sur un tout autre sujet.
x Jérémie Dres, - Est-ce que tu peux nous parler de la conception de la couverture ? J’ai remarqué que sur les couvertures de tes BD documentaires, il a toujours ton alter ego au 1er plan avec un document à la main et un décor en fond.
J.D. : Oui, tu n’as pas tort. L’idée, c’est toujours de mettre le personnage principal dans le feu de l’action —je reprends les codes de la BD, je n’invente pas— et là il s’avère que c’est moi.
Après, il y a parfois eu des constructions : dans Dispersés dans Babylone, j’ai voulu construire un décor fait de plusieurs de mes voyages, avec plusieurs plans et arrière-plans.
Pour Les fantômes de la rue Freta, ici ça faisait complètement sens qu’on se retrouve dans la rue Freta parce que c’était là que ça s’est passé, c’est là qu’elle a écrit la lettre. En fouillant, je me suis rendu compte que sa fenêtre donnait sur le mur, sa dernière demeure connue —c’est des informations tellement incroyables— et la couverture rassemble un peu tout ça.
Mon personnage est entre le touriste et le reporter, avec la carte du ghetto : il fallait souligner qu’on parlait de l’histoire du ghetto parce qu’effectivement, le titre était moins évocateur que Nous n’irons pas voir Auschwitz qui tout de suite te renvoie à la Deuxième Guerre mondiale. Là, Les fantômes de la rue Freta, ça peut être tout et rien —même un titre de livre pour enfants, presque— donc il fallait bien placer l’histoire du ghetto de Varsovie.
C’est un travail avec l’éditeur. Souvent, c’est moi qui insuffle l’idée, qui dessine un peu et on discute. À la base, je n’avais pas spécialement envie qu’on mette l’étoile de David sur ces silhouettes qui s’apparentent à ma tante et ses enfants, même s’il y a un doute. Je me suis d’ailleurs inspiré des photos du photographe nazi, Willy Georg pour ces personnes-là. Mais je n’avais pas envie d’insérer l’étoile de David, j’aime bien quand la couverture suggère sans tomber dans les gros symboles comme la croix gammée et autres mais je comprends qu’il faut également une identification immédiate au sujet. D’où les mots « ghetto de Varsovie » pour attirer l’œil.
J’essaie de trouver le bon moment de l’action —Varsovie, clairement— et de rassembler les moments les plus forts de l’intrigue. Même si ça reste obscur ou à découvrir pour la personne qui ne l’a pas lue j’ai envie qu’elle puisse avoir une deuxième lecture. Typiquement la fenêtre au fond à droite, elle est éclairée : j’imagine que c’est ma grand-tante qui est en train d’écrire sa lettre. J’aime bien l’idée que le lecteur puisse reprendre la couverture et la réinterpréter.
Dernière question, à la fin, il y a une sorte de point final, est-ce que tu as terminé un cycle ?
J.D. : C’est une bonne question, je me la suis posée en écrivant. Cette période-là m’a beaucoup inspiré. Je ne sais pas encore. Peut-être que j’y reviendrai dans quelques années.
C’est vrai que c’est un cycle et qu’il m’a fallu du temps entre Nous n’irons pas voir Auschwitz et ce dernier livre —presque 15 ans— et entre ces deux-là, j’ai exploré d’autres thématiques. J’aime beaucoup quand les récits personnels font écho avec la grande histoire, c’est vraiment mon truc. J’ai exploré d’autres thématiques dans d’autres livres et dans dans des reportages plus courts pour des magazines. Je n’en ai pas terminé, mais ce ne sera pas le prochain.
Ce sont des livres qui demandent de la maturation, et ça me va, de me donner le temps pour ce type de livre, qui sont quand même assez chargés, avec une grosse bibliographie… Il faut savoir les aborder avec originalité, justesse, apporter des choses nouvelles aussi. Il ne faut pas se précipiter sur ces sujets donc pourquoi pas y revenir un jour ou l’autre, mais pas tout de suite.
Je vous invite à aller lire Les fantômes de la rue Freta & Nous n’irons pas voir Auschwitz à la suite pour apprécier ce diptyque informel même si vous pouvez les lire de manière indépendante. Puis de jeter un oeil sur Le jour où j’ai rencontré Ben Laden (notre coup de coeur) qui nous surprend sur un tout autre sujet.
Thomas Mourier, le 16/12/2025
Jérémie Dres - Les fantômes de la rue Freta - Bayard graphic
Tous les visuels sont © Jérémie Dres / Bayard graphic
-> les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les œuvres évoquées

16.12.2025 à 10:11
Quelque chose de la poussière de Lune Vuillemin (balaye la famille)

Texte intégral (4018 mots)
Nature sauvage et hantée, cercle familial rapporté et bizarre, quête imprécise et fabuleuse : un extraordinaire roman court de l’intime transfiguré en drame aussi séculaire que spécifique.
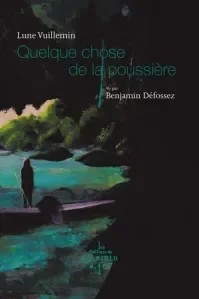
On marche toute la nuit, la vieille ne veut pas parler. Lorsqu’elle sent que je vais briser son silence, elle siffle. Comme les serpents. La nuit, moi, ça m’angoisse. Dans le bois, surtout. Les arbres se changent en ourses aux ongles longs qui marchent sur nos pas. Ce sont des masses noires aux museaux humides et fumants. Je me tords la cheville sur quelques branches et quand j’ai trop peur je caresse ma boîte d’allumettes. Si une de nous meurt un jour en forêt, ce sera moi. La vieille a ses esprits qui la protègent. Dans le bois, surtout, elle leur parle tout bas. Mais je l’entends, j’ai compris, c’est bien pour ça qu’elle veut mon silence. Qu’elle veut le silence de tout. Elle pleure aussi, elle renifle et s’essuie les joues avec le poing. Je ne sais pas comment elle fait pour pleurer la nuit dans le bois, on dit que les larmes attirent les couguars orphelins. Ceux qui cherchent leurs mères, qui savent le goût de l’abandon.
Pas étonnant qu’on lui ait donné le nom d’un arbre qui pleure.
Lorsqu’on entend l’océan, c’est un grand soulagement. Au-dessus de l’eau : la lumière de la lune, fatiguée et fade, derrière les immenses pins. Encore un jour prêt à se lever. Les vagues se jettent désespérément sur la plage, elles sont belles quand elles se retirent. Il n’y a rien que le calme et nos peurs. J’inspire profondément l’iode et l’air qui goûte le large. La vieille ramasse du bois flotté, je la regarde se pencher. J’ai envie de grimper sur son dos, faire craquer ses vertèbres capricieuses. Elle devient toute petite tellement elle se penche sur les choses, sur les gens, sur la plage. Elle étreint les troncs d’arbres morts comme si ça ressentait la tendresse un tronc d’arbre mort, comme si ça avait du sens. Je n’ai plus le goût de dormir, d’ailleurs la lune déchante. Quelques mouettes cassent l’horizon et viennent brailler au-dessus de nous. J’ai froid et mon dos frissonne. Il faut faire du feu et préparer le café, il faut qu’il soit fort, qu’il soit noir. L’eau est froide, pourtant la vieille se déshabille et marche lentement vers elle. Le ciel est violet, bleu aussi. Les corbeaux se réveillent au-dessus de la vieille. J’imagine le sel qui dégouline dans les ravins de ses rides qui contournent ses gros seins en forme de goutte de pluie. J’imagine qu’elle sourit, maintenant que personne ne la voit. Elle se donne entière à l’océan, ses cuisses molles claquent comme des portes. On doit se sentir jeune dans les vagues du matin, et la vie doit perdre son sens. J’aimerais peut-être qu’elle ne revienne pas, qu’elle reste dans l’eau, qu’elle se change en phoque à la peau lisse, même si j’ai peur de retourner dans le bois toute seule. La marée ramène à terre toutes sortes de trésors venus du continent. Une chaussure, des bouteilles et des canettes de bière où sont mortes des balanes. Il n’en reste que leur volcan poreux que j’aime caresser du bout des doigts. Des filets de pêche abandonnés et des contenants en plastique. Les ratons laveurs s’aventurent sur la plage à coups de griffes, leurs queues hésitantes balayent le sable et le café est prêt. Un pygargue survole notre déjeuner, j’enfonce mes orteils profondément dans le sable. La vieille bâille doucement et ses yeux bleus semblent fragiles comme des fossiles. Une légère brume s’installe sur la cime des arbres quand enfin elle ferme les paupières. J’aime quand elle dort, mais ça ne dure jamais longtemps. Je regarde le duvet gris au-dessus de sa lèvre, celle qui disparaît. Je regarde ses rêves agités dans le froncement de ses sourcils. Je regarde ses doigts qui tremblent sous une joue écrasée. Je regarde un grain de sable sur son menton. Je regarde la vieille qui dort. Elle ressemble à un monstre marin, qui somnole dans des eaux sombres. Il fait encore froid et je sais qu’il nous faudra nous émanciper de l’océan. Je sais qu’il nous faudra affronter la terre. Nous sommes venues dire au revoir au jour qui pointe sur notre plage.

C’est une nouvelle terre pour nous, quelque chose de la poussière et de l’absence de sel. Pourtant, vite retrouver les étendues de pins majestueux, les trembles fins et gracieux et le passage des cervidés sur la route. La neige nous attendra bientôt, et notre silence est accablant de douleur. Nous perdrons la tête, c’est sûr. Nous ne sommes pas prêtes pour le monde. La vieille s’arrête sur le bord pour uriner et j’aimerais me glisser à sa place, empoigner le volant et démarrer en trombes. Partir sans elle, la laisser penaude dans le fossé. Mais je sais qu’elle gardera son calme et qu’elle me retrouvera.
Il n’y a plus d’océan, c’est la terre des grands lacs qui sont pour nous comme de misérables flaques d’eau. Des buses se retournent sur notre passage, et bientôt : les hommes forts qui coupent les arbres dans leurs bottes à cap d’acier. La vieille me tire par la manche. Abandonné le pick-up dans la boue du chemin, seuls les grumiers ont le droit de passage. On est bien plus libre à pied. L’un des bûcherons nous insulte, nous apostrophe, nous traite de chair fraîche. La vieille fait semblant de rire et je lui fais voir mon plus beau doigt d’honneur. Je ne suis pas de la pâtée pour chat sauvage, monsieur. Je suis en colère parce que j’ai peur. Parce que la vieille m’entraîne toujours dans les bois à la tombée du jour, et qu’elle ne peut plus me défendre. J’aurais voulu qu’on reste dans nos bois sauvages, ceux dans la maison qui n’existe plus ou ceux autour que nous connaissons si bien.
Je sens comme une respiration chaude qui nous enveloppe, des esprits sans doute appelés par la vieille pour nous guider. La voilà qui s’immobilise devant moi. La vieille fait volte face. La vieille a peur. Je comprends, derrière nous.
Peut-être l’animal nous suit depuis les roues du pick-up embourbées dans la gadoue. C’est un couguar, il est beau et je ne peux regarder que sa gueule brune massive. Il a le regard sévère. On dit qu’il ne faut jamais tourner le dos à un couguar, qu’il vous écrase les omoplates à l’instant même où vous pensez vous retourner pour courir. Que les os tremblent, et qu’on ne sent rien. La vieille déjà se calme. Elle cherche à s’asseoir à terre et je sais que la fuite n’est pas envisageable. Plier les genoux devant l’animal ? Se soumettre ? Je ne sais pas quoi faire devant le ventre chaud et les pattes extraordinaires qui se dressent devant moi. C’est une femelle, une mère qui arpente la montagne, les mamelons gorgés de lait.
Je ne sais plus qui regarder, la vieille ou le sol, la mâchoire ou la queue. Sent-on comment on meurt si l’on s’endort avant ? Je comprends derrière mes oreilles et un peu au-dessus comme des dents peuvent serrer très fort. Pourtant sa gueule est bien fermée, droite. La vieille porte son menton haut comme une tour, et je décide de lever la tête. Me tenir droite, moi aussi, comme les deux autres qui m’entourent. Je déroule ma colonne, elles le voient tout de suite, tous les yeux sont sur moi. J’ai le dos droit mais pas de mur pour m’y adosser, et ça ne dure pas. Je n’ai pas l’étoffe d’un prédateur, mes vertèbres ne tiennent pas dans leur verticalité.
Comment fait-elle, avec son squelette qui a vécu des centaines d’années, pour ignorer la fourmilière dans ses mollets ? Je prends appui sur mes coudes, ils sont fragiles. Je vais chercher de l’air dans les recoins de mon corps, c’est hésitant. Au moment très précis où l’angoisse est née, le couguar tourne un peu son museau vers moi. Et la vieille de relâcher la pression. Son dos se courbe un peu, je sais qu’elle va bientôt pouvoir dormir. Ma peur va nourrir la bête, elle s’en léchera les babines. La vieille m’abandonne dans l’éveil. Il n’y a plus que l’animal et moi. Je voudrais pleurer, j’ai chaud sous les bras et dans le bas du dos. J’aimerais qu’un chasseur perdu apparaisse derrière moi et m’enlace. Mais personne ne vient, la vieille s’endort et je pleure. Peut-être cette nuit, je mourrai dans les bras du couguar.

Publié en 2019, le premier roman (court, 87 pages) de Lune Vuillemin est magnifiquement rehaussé par les illustrations de Benjamin Défossez, dans le cadre de ce dialogue permanent entre littérature et arts plastiques que pratiquent les éditions du Chemin de Fer (on garde par exemple encore un souvenir puissant, intact et ému, du « Tryggve Kottar » de Benjamin Haegel illustré par Marie Boralevi).
Si son décor évoque d’abord les confins sauvages familiers aux lectrices et aux lecteurs de David Vann ou de Pete Fromm, mais aussi à celles et ceux de Bérengère Cournut, pour cette capacité à y saisir une intimité évoluant sous contraintes rituelles et (quasiment) cosmogoniques, « Quelque chose de la poussière » dévoile rapidement, puis plus sourdement et secrètement, ses propres miracles. Lune Vuillemin, s’appuyant sur les méandres secrets évoluant à l’intérieur des crânes humains comme sur les sentiers cachés au cœur des forêts et des taillis, invente sa propre langue et sa propre tonalité. Joliment retorse face aux attentes créées par les premiers jalons qu’elle dissémine avec précision dans sa narration croisée, elle manie avec un sauvage entrain les silex à frapper pour donner naissance à d’éventuels feux ravageurs, comme à des braises et à des cendres subtilement inattendues. Et c’est ainsi que naît chez nous l’impression de plus en plus tenace d’assister ici à la naissance d’une grande écriture.
En arrivant au bord du lac, les filles se tressent les cheveux. La blonde saute dans la benne et fait glisser le canot vers la bleue qui transpire déjà. Ses joues se gonflent et luisent mais elle est aussi athlétique que l’autre. Je roule une cigarette, l’air est humide et trempe le tabac, le transformant en algue noire. Le canot en frêne était celui de ton père. Ce grand-père que je n’ai jamais connu. Tu me parlais de ses mains formidables et des veines sur son front qui saillaient lorsqu’il jouait de l’harmonica. L’odeur de tabac à pipe, de ses bottes crottées, du café de chaga et du canot. Lorsque tu as eu treize ans, il t’a choisie toi, l’aînée de ses deux filles pour être celle qui chasserait le castor.
Tu ne m’as jamais raconté ce premier jour au lac, mais je me souviens du mien. Mon initiation au piège à ressort, il pleuvait aussi, tu avais disparu sous ta capuche et m’apprenais des nœuds. Nous savions où étaient les huttes, passions des journées entières à faire le tour du lac à la recherche de coulées. Il suffisait de poser les pièges devant une entrée de hutte, et revenir quelques jours plus tard. On retrouvait les bouées plus loin, où personne n’a pied. Les castors mouraient sur le coup, entraînés par la bouée. Je regardais tes doigts et la corde qui relierait le piège à la bouée jaune. En voyant la grosse bague de métal couler dans l’eau noire, j’ai pensé à mon propre corps et mes os en miettes dans la mâchoire du piège. Pour la première fois, j’ai pensé à ma mort.
“Maintenant, rejoins l’autre rive, nous allons voir si un castor a mordu”, m’avais-tu dit.
Je pagayais timidement et lentement, faisant des zigzags pour retarder notre arrivée au niveau de l’autre bouée. Et j’ai su, quand tu as tenté de la soulever, qu’un castor avait mordu.
C’est ta petite-fille qui s’occupe du lac désormais. À bord du canot de grand-père, elle pagaie le dos bien droit, avec agilité et vitesse. Je reste à terre, je n’ai plus l’âme à initier qui que ce soit. Dans mes jumelles, je vois les joues rondes de la bleue, si belle sur le lac, entourée des Douglas majestueux et sombres. J’aurais aimé qu’elle soit ma fille, pour ses épaules musclées et son silence. Pour qu’elle me porte sur son dos et se taise, pour que jamais je ne cesse de partir en forêt. Sa présence ne me gêne pas, avec elle je suis seule. Elle n’a aucune énergie, aucun charisme. Ma fille, elle, scintille et cogne. Son corps s’impose dans l’espace et prend toute la place. Marcher en forêt avec elle c’est épuiser les prédateurs, faire fuir les insectes et assécher les ruisseaux.
Là voilà déjà qui tire sur la corde. L’animal doit être lourd, mort noyé. La blonde hisse la carcasse trempée à bord. Le cœur de la bleue bat dans ses joues. Je regarde la blonde et j’imagine qu’elle lui explique ce qu’on en fera. Soudain, la bleue lui saute à la gueule. Le canot manque de se retourner, la bleue serre ses mains autour du cou de la blonde. Ma fille ne panique pas, je la vois tenter d’inspirer le plus d’air dont elle est capable. Elle sait survivre. La bleue lâche prise, la gifle et hurle comme une louve. Une joue rouge et une joue blanche, ma blonde déboussolée sous la poigne de la géante. Les deux se lèvent et à leurs pieds gît le mammifère trempé de vase. La bleue mord la blonde à l’épaule. La blonde en croche-pied et l’autre qui tombe dans le canot qui tangue de plus en plus. Un coup de poing fend l’air, j’entends un cri. La bleue soudain, le nez écarlate, plonge dans le lac et disparaît.
Un plongeon huard pousse sa longue plainte. La blonde paraît si petite sur le lac, insignifiante. Elle sursaute dans la brume en entendant la bleue reprendre son souffle derrière elle. Elle attrape une pagaie et menace de la frapper au crâne. Sans attendre, la bleue se hisse sur le canot de tout son poids et, lentement, fait pencher l’embarcation. Elle s’arrêtera à temps, je le sais. Ce n’est qu’un jeu. Ce ne sont que des enfants. Une dispute entre sœurs. Mais elle ne s’arrête pas, la blonde hurle. La barque se referme sur les deux filles comme une bouche. Je pousse un cri, moi aussi, mais aucun son ne sort de ma gorge sèche. Ma voix semble s’être évanouie elle aussi dans les eaux troubles du lac. Mon cri dans les profondeurs, et l’image de leurs corps lourds qui luttent. La blonde, la bleue et le castor.
Elle ne sait pas nager.
Hugues Charybde, le 16/12/2025
Lune Vuillemin et Benjamoin de Fossez - Quelque chose de la poussière - éditions Chemin de Fer
l’acheter chez Charybde, ici

lune-vuillemin-2023-credits-seb-germain
09.12.2025 à 12:34
La sand castle university de Janel Hawkins a comme un grain

Texte intégral (1855 mots)
Sur une plage, on s’attend à croiser des parasols, des mouettes kleptomanes et, parfois, un château de sable vaguement cubiste fait par un enfant très confiant. Et puis il y a l’autre scénario : vous tombez sur une façade détaillée, avec arches, corniches, escaliers et proportions d’architecte. Pas un décor de cinéma. Juste du sable. Bienvenue dans l’univers de Janel Hawkins, sculptrice professionnelle et fondatrice de Sand Castle University.

Hawkins a transformé ce qui ressemblait à un job improbable en véritable entreprise : Sand Castle University fonctionne comme une structure mobile, entre sculptures sur commande, animations d’événements et cours pour apprendre à bâtir “proprement” sur le sable. L’autre carburant, ce sont les réseaux : filmer la construction, montrer les détails, et donner l’impression qu’un mini-palais pousse tout seul au rythme des marées.
Et parfois, elle joue carrément la carte “pop-culture”, parce que le sable adore les symboles reconnaissables : si vous aimez quand l’imaginaire devient une architecture grandeur nature, vous allez forcément sourire devant Poudlard en château de sable (vidéo). Même magie, aucune autorisation de lancer des sorts sur la marée.

Son secret technique est … capillaire
Pourquoi le sable humide tient-il debout alors que le sable sec s’écroule comme un soufflé vexé ? Parce que l’eau crée de minuscules ponts capillaires entre les grains : ces micro-ménisques génèrent des forces qui augmentent la cohésion du matériau. Et c’est là qu’arrive la règle d’or des châteaux solides : ni trop sec, ni trop mouillé. Trop peu d’eau : pas assez de ponts. Trop d’eau : l’effet “cohésion” s’effondre et tout devient pâteux.
Dans la pratique, les pros recherchent un sable à granulométrie “coopérative”, compactent par couches (pour éviter les poches d’air), puis sculptent par retraits successifs : on enlève de la matière au lieu d’empiler des détails fragiles. Si vous voulez rester dans l’univers “sculpture hyper réaliste qui fait oublier le matériau”, vous pouvez d’ailleurs enchaîner avec les fantastiques sculptures de sable de Guy-Olivier Deveau : même obsession du détail, même talent pour donner au sable un air beaucoup trop sérieux pour être honnête.

Autre détail savoureux : Hawkins n’utilise pas seulement des outils “de plage”. Elle pioche aussi dans la maçonnerie, la construction, la poterie… parfois même des petits outils de finition qui servent surtout à lisser, araser, nettoyer. Parce que oui : la haute couture du sable passe par des gestes de précision. Le château de sable, version pro, c’est moins “pelle + seau” et plus “atelier de sculpteur sous contrainte météo”.
Pourquoi ses œuvres finissent-elles détruites ?
Le retournement de scénario, c’est la fin : beaucoup de séquences populaires montrent Hawkins démolir ses propres sculptures. Ça paraît cruel, mais il y a une logique : selon les plages et les périodes, les consignes de sécurité (y compris pour la faune) imposent de laisser le sable “plat” et d’éviter les obstacles. En clair : ce qui est superbe à 18h peut devenir un problème à 2h du matin, quand la plage appartient à d’autres habitants. Sur la côte du Golfe, la saison de nidification/éclosion des tortues marines en Alabama est généralement donnée du 1er mai au 31 octobre, et il faut limiter les risques pour les tortues et les bébés en route vers la mer.
Et au fond, c’est aussi ça qui rend ce médium fascinant : le sable n’est jamais “acquis”. Il peut être architecture, sculpture, décor… mais il reste un matériau de passage, fait pour bouger.
En savoir plus :
• Le site web de l’artiste ici
• Son compte Instagram là
• US Fish & Wildlife Service
• Scientific American
Eric Deloizeau, le 9/12/2025
La sand castle university de Janel Hawkins

09.12.2025 à 12:22
Se faire mordre par La Rat est une excellente expérience

Texte intégral (661 mots)
Avant d'entendre La Rat, vous n'aviez probablement pas réfléchi à quel point vous aviez besoin d'un rappeur néerlandais psychédélique, à la voix d'hélium et au thème des rongeurs. Né de l'imagination des musiciens amstellodamois Goya van der Heijden et Tobias Jansen, le projet éponyme du duo rappelle le pseudonyme Quasimoto de Madlib, qui rencontre le génie encyclopédique du cut-and-paste de Steinski.
Joyeusement décalé, le très immersif La Rat, composé de huit titres, est alimenté par des boucles imprégnées de funk et des percussions sombres et graves : « Crab Dish » combine une basse floue et roulante et des parasites crépitants avec une philosophie des fruits de mer qui rappelle les Beastie Boys de l'époque Paul's Boutique ; « Problems » est un mélange sonore de respirations lourdes et effrayantes, de distorsions radio et de percussions délicieusement syncopées ; et « Puppet Show » est fièrement étrange, avec un riff de violon bancale et déformé et une voix déjantée qui décrit en détail un défilé cérémoniel qui semble impliquer de la fumée de cigarette et beaucoup de chiens. La version vinyle de l'album étant déjà épuisée, La Rat semble destiné à devenir un véritable classique culte pour les collectionneurs.
La Rat s'avance vers le centre du cercle avec une collection de boucles et de mesures imprégnées de funk et de soul, bandes sonores d'une virée nocturne à travers une ville pluvieuse. L'esthétique de La Rat s'étend plus loin qu'un cycliste ivre sur un canal bondé, ripostant au statu quo à travers huit titres, avec des clins d'œil à la psychédélique, au blues, au jazz et à la musique latine. Les collages rythmiques qui en résultent ont ensuite jeté les bases d'une rafale de raps hors normes, issus de l'esprit d'un parolier adeptes du copier-coller. Le duo collaboratif s'inspire de sources aussi variées que Georgia O'Keeffe, MC Hellshit et DJ Carhouse, Pauline Oliveros et Rammellzee, et finit par se réapproprier une partie de l'univers survolté du hip-hop. Si avec cette introduction vous n’êtes pas alléchés, écoutez les sornettes de Brigitte micron !
Phil Spectro le 9/12/2025
La Rat - La Rat - South of North

09.12.2025 à 12:02
L'Europass photographique de Victor Sira méduse

Texte intégral (2808 mots)
Dans son catalogue d'exposition/nouveau livre Europass, publié par sa maison d'édition bookdummypress, Victor Sira examine un thème récurrent dans la photographie de voyage. Le livre s'appuie sur une série de voyages effectués par l'artiste vénézuélien en Europe entre 2001 et 2006, période qui a coïncidé avec le passage de l'utilisation omniprésente de la photographie analogique et des appareils photo compacts au téléphone comme appareil photographique principal.

Notes for a Ritual of Photography Gone Extinct
Il est essentiel de réfléchir au rituel de la photographie analogique et à la manière dont elle constituait un processus éditorial sélectif. Il y avait un prix à payer, et le délai entre la prise de vue et la production de l'image pouvait être de plusieurs semaines, selon la rapidité avec laquelle on déposait son film et récupérait ses tirages en pharmacie. Il était très rare que les films, en particulier les films couleur, soient développés pendant le voyage.
Le nombre d'images par rouleau était compris entre 24 et 36, ce qui est un nombre minimal de photographies pouvant être prises par rouleau ; cela obligeait donc le photographe à être sélectif, contrairement à notre utilisation des téléphones. Entre les moments et les mauvais angles, il y a une expérience, et même si les photographes amateurs pouvaient être désinvoltes avec la photographie analogique, il y avait davantage de rituel, de peur que la production d'images ne soit jetée. En fait, avec un budget limité, il fallait faire attention à la façon dont on cadrait et exposait le film pour obtenir les résultats souhaités tout en respectant le budget. Dans ce sens, les photos étaient pensées de manière plus intense, et la recherche de bonnes images était aussi vitale pour l'amateur que pour l'artiste ou le semi-professionnel. Il y avait également le temps entre la prise de vue et le développement qui permettait de réfléchir aux images, de partager l'essentiel dans des albums et de les partager avec des amis et des membres de la famille qui n'avaient peut-être pas fait le voyage. Cela donnait au photographe le temps de réfléchir et de repenser ce qu'il voulait partager lorsqu'il feuilletait les épreuves de ses négatifs.

Pour les photographes ou les artistes les plus soucieux, le délai et le rituel du développement des pellicules permettaient également de réfléchir au matériel et au contexte dans lequel il pourrait être utile. Les artistes prennent des photos partout où ils voyagent, par habitude. Pourtant, il y a souvent du matériel qui pourrait être utilisé pour un album personnel plutôt que pour une exposition ou un livre. Il y a matière à chevauchement. On peut penser à la photo de Mary et des enfants de Robert Frank dans la voiture en Amérique comme un exemple flexible où cela fonctionne le mieux. Je pense également aux relations et aux voyages de Seiichi Furya et Christine Furuya-Gössler, tels qu'on les trouve dans leurs livres plus récents publiés par Chose Commune. Leur dernier voyage à Venise est gravé dans ma mémoire à la fois comme un document familial et une expérience artistique. Le livre The Open Road, de David Campany, documente de manière exhaustive le phénomène du road trip, et plusieurs ouvrages ont été consacrés aux voyages en train à travers l'Europe, en particulier une série de titres moins connus sur le Transsibérien. Les phénomènes du road trip et du voyage en train se marient bien avec la photographie.

Quant à Europass et Victor, j'ai découvert ce travail avant de l'interviewer pour Nearest Truth et avant cela, j'avais découvert son incroyable production de maquettes, de maquettes et de livres photo et d'objets livres uniques. Je reste un fan de sa production et de son caractère excessivement généreux. Il connaît également très bien les livres photo et la communauté qui les considère comme un média à part entière. Notre conversation a porté sur son parcours, du Venezuela à New York, et sur la façon dont la photographie continue de l'intéresser après des décennies passées à produire des livres, sans hommage ni fanfare. Victor est à la fois passionné et pragmatique. Son parcours est remarquable, et j'ai sauté sur l'occasion de chroniquer ce livre, poursuivant ainsi mon admiration pour son travail. Bien qu'Europass soit techniquement un catalogue de son exposition récente au Japon, le livre fonctionne comme un livre photo à part entière, avec des images de la série présentées dans la première partie et son maquette originale imprimée à la fin, mettant en lumière les photos et son processus de création, mais aussi avec une note parfaite expliquant le fonctionnement de ses maquettes.

Les images contenues dans le livre offrent un magnifique aperçu du voyage de Victor. L'œuvre donne l'impression d'un petit documentaire filmé à la caméra. J'ai cette sensation dans certains livres de Bertien van Manen, et je la retrouve ici avec précision. Elle met en lumière le voyage de Victor, permettant de ressentir le temps qui passe à travers les différents arrêts de train et l'intérieur des wagons eux-mêmes, avec un clin d'œil aux clichés de Stephen Shore ou Guido Guidi représentant respectivement de la nourriture ou des fruits. Il y a un peu de mélancolie, mais franchement, après avoir vécu deux décennies en Europe, je commence à penser que c'est simplement la situation d'après-guerre ici, alors que les décennies succombent au changement. Les années 2001-2006 ont également été marquantes pour le monde entier, avec de multiples fronts de guerre et les séquelles du 11 septembre encore très présentes, une période difficile. Je crois que Victor était à New York lors des attentats, alors peut-être qu'il a emporté un peu de cela avec lui outre-mer. Je sais que c'était mon cas.

Je trouve que c'est un livre fantastique, et j'encourage tout le monde à découvrir les photographies et les livres de Victor. Je pense qu'il a un excellent modèle pour l'avenir de la production, alors que les économies vacillent et que les prix montent en flèche. Victor n'est pas près d'arrêter sa production.
Brad Feuerhelm le 9/12/2025
Victor Sira - Europass - Bookdummy Press

- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
