24.01.2026 à 15:00
« La ligne Maginot était autant un projet social que militaire », une conversation avec Kevin Passmore
guillaumer
La ligne Maginot a mauvaise réputation. Après l'invasion allemande, elle fut décriée comme la grande erreur stratégique française.
« Projet orgueilleux », la « ligne » avait en réalité d'autres fonctions que la seule défense du territoire : décentraliser le commandement, gérer le moral des troupes ou enrayer l’autonomisme de l’Alsace-Lorraine.
Kevin Passmore signe une somme qui renouvelle l'approche historique sur ce symbole de la « drôle de guerre ».
Nous le rencontrons.
L’article « La ligne Maginot était autant un projet social que militaire », une conversation avec Kevin Passmore est apparu en premier sur Le Grand Continent.
Texte intégral (6965 mots)
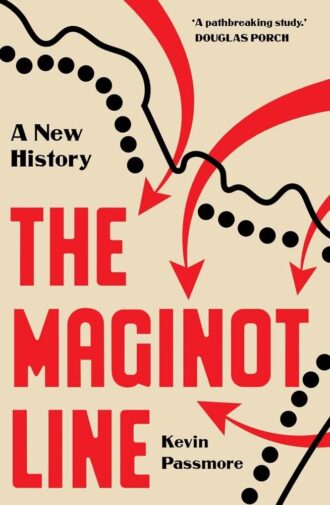
- Auteur
- Florian Louis
- Date
La ligne Maginot charrie de nombreuses idées reçues, au point que vous parlez à son propos d’un véritable mythe. Comment le résumeriez-vous ?
Le mythe de la ligne Maginot est en fait celui de la présumée décadence française des années 1930 : l’armée se serait complaisamment retranchée derrière un ensemble de fortifications situées aux frontières allemande et luxembourgeoise et censées former une ligne imperméable ; ces fortifications ont alors été contournées par une attaque éclair audacieuse plus au nord, à travers la Belgique, et plus particulièrement à travers la forêt des Ardennes, réputée imprenable, où seules des fortifications légères avaient été construites.
Selon le mythe, la ligne Maginot était bien plus qu’une simple erreur militaire : elle aurait bercé le peuple français dans un faux sentiment de sécurité, le traumatisme de la Première Guerre mondiale ayant sapé la volonté nationale et rendu la France « décadente ».
Ce concept de décadence est problématique. Il repose sur des hypothèses indéfendables issues de la fascination de la fin du XIXe siècle pour la biologie sociale, l’évolution et la race , il part du principe que les nations sont des organismes qui évoluent selon des cycles de déclin et de renaissance. Pétain et la Résistance voyaient le monde en ces termes et prétendaient, chacun à leur manière, régénérer une France décadente et vaincue.
Un autre problème du mythe de la décadence tient au fait qu’il lit l’histoire à rebours, à partir de la défaite ; il repose sur un sophisme consistant à considérer un événement comme la cause d’un autre du simple fait qu’il lui est antérieur. Quand un système complexe échoue, il est aisé, après coup, de pointer du doigt une « catastrophe annoncée » ; Julian Jackson a ainsi montré que si la France avait perdu en 1914 ou la Grande-Bretagne en 1940, comme cela a failli arriver, il aurait été facile de trouver des failles aussi graves que celles supposées être responsables de la débâcle française de 1940.
Les spécialistes ont depuis longtemps réfuté ces mythes, arguant que la ligne Maginot était une politique rationnelle compte tenu des circonstances ; ils se concentrent désormais plutôt sur les erreurs des généraux.
Cette approche ne me satisfait cependant pas totalement. En effet, l’idée d’« erreurs » conduit trop facilement à des spéculations, voire à des fantasmes sur ce que les généraux et les hommes politiques « auraient dû faire ».
La thèse de la décadence établit à juste titre un lien entre les questions militaires, la politique, la société et la culture ; le problème est que la façon dont elle le fait est grossière. Les décisions des généraux et leur contexte ont tous deux leur importance, le plus difficile étant de les mettre en relation.
C’est ce que j’ai essayé de faire dans ce livre.
Toute l’originalité de celui-ci tient effectivement à ce que votre approche de la ligne Maginot ne se limite pas à l’histoire militaire, mais fait toute sa place à l’histoire sociale, politique et culturelle.
J’ai toujours été intéressé par l’idée de Marc Bloch consistant à prendre un objet historique et à l’étudier sous l’angle de différentes disciplines. La ligne Maginot semblait suffisamment vaste pour cela.
Bloch, qui avait connu deux guerres mondiales, imaginait chaque discipline comme un projecteur éclairant un avion ennemi, leurs faisceaux se croisant pour donner une image globale.
Je souhaitais déplacer l’objet de l’enquête, de la question de savoir pourquoi les Français ont perdu la guerre en 1940 à celle de savoir pourquoi ils ont pris les décisions qui les ont conduits à ce résultat. Je voulais tenter d’expliquer ce qui était en jeu politiquement et socialement dans la décision de construire la ligne Maginot ; j’ai essayé de montrer qu’il s’agissait autant d’un projet social que militaire, et qu’il ne fit jamais l’unanimité. Cela nécessitait d’abandonner la sempiternelle opposition entre une doctrine française passive et défensive et une doctrine allemande active et agressive — une interprétation souvent présentée comme le reflet d’une distinction entre deux mentalités.
Au-delà de ces débats, la ligne Maginot mérite d’être étudiée pour elle-même. C’est une histoire humaine fascinante : au moins un million de soldats français y ont servi, avec parmi eux, des personnages célèbres comme François Mitterrand, Charles de Gaulle, Olivier Messiaen, Jean-Paul Sartre, Fernand Braudel et bien d’autres.
La ligne Maginot, en tant que projet orgueilleux visant à organiser d’en haut les hommes, les machines et le monde naturel, était intrinsèquement irréalisable.
Kevin Passmore
La ligne fut l’un des plus grands projets d’infrastructure de l’époque — peut-être plus important que le barrage Hoover construit aux États-Unis entre 1931 et 1936. Les fortifications elles-mêmes faisaient partie d’un immense complexe comprenant de nouvelles casernes pour les troupes, des cités-jardins pour les officiers, des routes militaires, des chemins de fer à voie étroite, des postes de commandement, des systèmes d’inondations planifiées, des forêts améliorées, des milliers de kilomètres de câbles électriques et téléphoniques, de barbelés et de rails antichars — ainsi que des chaînes d’approvisionnement s’étendant à travers l’empire français et le monde entier.
Au nombre des mythes entourant la ligne Maginot, figure en premier lieu le rôle d’André Maginot dans sa conception. Pourquoi ce malentendu ?
Plutôt que Maginot, c’est Paul Painlevé, un polytechnicien, ministre de la Guerre de 1925 à 1929, qui est à l’origine de la ligne. André Maginot est devenu ministre de la Guerre juste au moment de la présentation de la loi de financement ; c’est ainsi que ce projet dont il n’était pas l’initiateur s’est trouvé associé à lui.
Cette association ne fut cependant pas immédiate ; au début, seule l’Action française parlait de la « ligne Maginot ». C’est le romancier Pierre Nord, lui-même lecteur de L’Action française et auteur du best-seller Double crime sur la ligne Maginot 1, paru en 1936 et adapté au cinéma l’année suivante par Félix Gandéra, qui a popularisé l’expression.
Lors du début de la campagne de France en mai et juin 1940, pourquoi la ligne Maginot n’a-t-elle pas eu l’efficacité escomptée ?
Les Français n’ont jamais eu l’intention de rester tapis derrière leurs fortifications , au contraire, l’objectif de la ligne Maginot était de sceller les frontières allemande et italienne afin que les Allemands soient contraints de passer par la Belgique , c’est pour cette raison que la petite ville de Longuyon a été délibérément choisie comme limite occidentale des fortifications, car les contourner nécessitait alors une violation du territoire belge.
Combattre en Belgique présentait l’avantage d’éloigner la bataille du sol français et de garantir l’intervention des Britanniques, comme en 1914. La seule question était de savoir où combattre en Belgique : soit juste de l’autre côté de la frontière, sur l’Escaut ; soit plus profondément, sur la ligne dite de la Dyle, au canal Albert ; soit encore aux Pays-Bas, voire à la frontière allemande.
Maurice Gamelin, commandant en chef des forces alliées en France, a choisi l’option la plus ambitieuse. À l’annonce de l’offensive allemande, il a ordonné aux troupes blindées et motorisées de se rendre dans les plaines centrales de la Belgique et à Breda, aux Pays-Bas. Les Allemands y ont effectivement envoyé des forces, et les Français ont stoppé les Panzers lors de deux grandes batailles, à Hannut et Gembloux.
Les Français sont cependant tombés dans un piège, car les Allemands ont rapidement percé plus au sud, sur la Meuse, en Belgique et en France, notamment à Sedan ; ces derniers se sont dirigés vers la Manche en ne rencontrant presque aucune opposition et ont piégé les armées alliées en Belgique.
Les Allemands ont gagné parce qu’ils ont profité de la faiblesse intrinsèque de la défense initiale : ils ont concentré une force écrasante sur les points faibles des lignes françaises étirées ; en retour, les Alliés ont été incapables de se concentrer pour contre-attaquer.
L’erreur fatale dans cette séquence a été d’envoyer les meilleures forces mobiles aux Pays-Bas, privant ainsi les Français d’une réserve stratégique leur permettant de contre-attaquer la percée allemande.
La ligne Maginot n’a-t-elle pourtant pas une responsabilité dans la défaite de 1940 ?
Sur le fond — même si je ne suis pas en désaccord avec les récentes recherches du général Bruno Chaix et de Julian Jackson 2 — je pense que l’accent mis sur la bataille décisive en Belgique et aux Pays-Bas a conduit à négliger un peu le rôle des fortifications dans la défaite.
Dans leur enthousiasme à réfuter l’idée ancienne selon laquelle la ligne Maginot était un symbole de la décadence française, les révisionnistes ont été trop loin dans la direction opposée ; cette ligne de fortification a aussi une part de responsabilité dans la défaite. D’une part, le général Huntziger, commandant de la Deuxième armée à Sedan, s’est replié pour défendre la ligne Maginot plutôt que d’attaquer les flancs des forces allemandes qui se dirigeaient vers la Manche ; d’autre part, les fortifications étaient massivement surdotées en personnel, près de la moitié des deux millions de soldats français de première ligne étant stationnés derrière la ligne, réduisant ainsi les réserves disponibles pour contrer la percée allemande. Une grande partie de ces troupes, parmi les mieux équipées, étaient des troupes de fortification immobiles.
Comment expliquer ces erreurs stratégiques françaises ?
Sur ce sujet, les historiens s’en remettent encore trop souvent à un contraste stéréotypé entre la doctrine méthodique française, qui met l’accent sur le commandement par le haut, la défense, l’usure et les mouvements lourds, et les méthodes allemandes qui privilégient la vitesse et la manœuvre – la doctrine de l’Auftragstaktik, dans laquelle l’initiative appartient aux soldats à tous les niveaux, jusqu’au simple combattant. Cette distinction repose sur une généralisation tirée de la bataille — certes décisive — sur la Meuse, où les troupes allemandes les mieux entraînées ont affronté les divisions françaises les moins entraînées, qui étaient de surcroît moins nombreuses.
Le plan français, considéré dans son ensemble, contredit cette opposition entre la méthode française et le Blitzkrieg allemand.
Pour moi, le contraste entre les deux armées n’était pas radical ; d’un côté, l’armée allemande, à l’instar de l’armée française, présentait des niveaux de qualité variables : en raison des restrictions imposées par le traité de Versailles, de nombreux soldats allemands étaient à peine entraînés. Cela s’est vu lors de la deuxième phase de la bataille, dans l’Aisne et la Somme, où les tactiques allemandes étaient plus primitives ; les Français y ont bien combattu, malgré leur énorme infériorité.
La construction de la ligne Maginot n’a pas été le réflexe d’une nation traumatisée par la guerre.
Kevin Passmore
D’un autre côté, le plan français dans son ensemble reposait sur la ligne Maginot et sur l’avance fatale, mais audacieuse, jusqu’aux Pays-Bas. Il contraste tant avec la prudence supposée de la doctrine française que les historiens ont eu du mal à l’expliquer. Même si l’avance vers Breda visait à établir un front défensif continu — ce qui est loin d’être prouvé —, il fallait que des divisions blindées et motorisées françaises battent l’ennemi sur des objectifs situés à 200 kilomètres des lignes françaises et à seulement 100 kilomètres des bases allemandes. Il a même été suggéré que l’esprit de Gamelin était obscurci par les conséquences d’une syphilis secondaire !
Si les stratégies française et allemande n’étaient pas si radicalement opposées qu’on le dit, comment expliquer le triomphe de la seconde sur la première ?
La doctrine et les décisions françaises étaient le résultat de luttes de pouvoir politisées, non seulement entre les généraux Gamelin et Georges, mais aussi au sein de l’ensemble du corps des officiers. Le rôle des fortifications était central dans ces désaccords.
Il est désormais bien connu que le Blitzkrieg allemand est né d’un conflit au sein de la Wehrmacht ; on peut en dire autant du plan français.
Plutôt que d’expliquer la victoire allemande et la défaite française par des mentalités nationales opposées, j’utilise la méthode relationnelle et ce, dans deux sens. Premièrement, comme je l’ai dit, les Allemands ont concentré leurs meilleures forces contre les forces françaises les plus faibles sur la Meuse, tandis que les Français ont envoyé leurs meilleures forces dans un piège en Belgique ; deuxièmement, les plans ont émergé du conflit et même de la désobéissance au sein des deux armées. Guderian et Hoepner ont désobéi aux ordres de consolider les têtes de pont sur la Meuse et se sont immédiatement dirigés vers la Manche ; Huntziger a désobéi aux ordres de Georges de donner la priorité à la contre-attaque contre les Allemands et s’est replié sur la ligne Maginot.
On a souvent dit que les Français, en 1940, avaient une guerre de retard, rejouant la guerre d’avant quand les Allemands s’étaient préparés à celle d’après. En quoi les leçons tirées de la Première Guerre mondiale ont-elles eu un impact sur la conception de la ligne Maginot ?
Les leçons qu’on disait devoir tirer de la Première Guerre mondiale ont été sans cesse contestées, pendant celle-ci et après la fin du conflit — notamment sur la question de l’utilité des fortifications.
Lors de la Grande Guerre, les fortifications permanentes françaises et belges n’ont pas empêché les Allemands d’approcher de Paris ; les troupes ont aussi rapidement constaté que les tranchées offraient la meilleure protection contre les mitrailleuses et l’artillerie. Cependant, il faut aussi compter avec l’exemple de Verdun, qui a résisté. La question de savoir si cela prouvait la valeur des fortifications permanentes a fait l’objet d’un débat sans fin après la guerre.
Pétain ne croyait pas en la valeur des fortifications permanentes ; il leur préférait les défenses échelonnées. Sa méthode consistait à épuiser l’ennemi dans des lignes de tranchées successives et à passer à l’offensive lorsque l’ennemi serait suffisamment affaibli. De nombreux officiers n’acceptaient cependant pas l’idée de céder des terres qui avaient été conquises au prix de tant de sacrifices et le critiquèrent pour cette raison, en particulier pendant la Grande Guerre ; d’autres encore rejetaient complètement la défense, notamment le grand rival de Pétain, le maréchal Ferdinand Foch.
La Première Guerre mondiale avait également mis en lumière l’importance du commandement dans la conduite de la guerre.
Au début de la guerre, à l’été 1914, l’opinion courante était que les soldats ne se battraient que s’ils craignaient davantage leurs officiers que l’ennemi. Pourtant, il devint rapidement évident que la dispersion et le camouflage étaient nécessaires et que les unités devaient en conséquence être divisées en petits groupes commandés par des officiers subalternes et des sergents ; le haut commandement craignait cependant que ces tactiques décentralisées ne placent le commandement entre les mains d’officiers subalternes et de sous-officiers sans instruction 3.
Les lourdes pertes lors du conflit ont aussi conduit les officiers de réserve et les officiers promus du rang à remplacer les officiers de carrière à la tête des troupes. Cette démocratisation était permanente : la proportion d’officiers promus du rang est passée de 4 % en 1913 à 24 % en 1929. Cependant, les professionnels ont toujours douté de la capacité des officiers de réserve à commander.
Ce n’est pas tout ; le commandement a également été remis en question par les mutineries de 1917, qui ont eu lieu dans le contexte de la révolution russe et des grèves dans les industries de guerre en France.
Ces processus de décentralisation et de démocratisation se sont opposés à une autre innovation dans le domaine de la guerre : afin d’administrer, d’approvisionner et de manœuvrer de vastes armées dans une guerre longue, l’état-major s’est tourné vers des méthodes de gestion industrielle connues sous le nom de « sciences de l’organisation », notamment les systèmes d’Henri Fayol et de l’Américain Frederick Winslow Taylor. Leurs méthodes concentraient le pouvoir entre les mains des commandants tout en réduisant les travailleurs au rang de simples rouages d’une machine, effectuant des tâches simples et répétitives. Appliquées à l’armée, ces méthodes ne laissaient aucune place à l’initiative tactique.
Il est donc possible de dire que la Première Guerre mondiale a légué deux débats : l’un sur la nécessité de la fortification permanente, l’autre sur le commandement. Ni l’un ni l’autre n’était clos en 1940.
Aussi puissantes et durables qu’elles aient été, ces controverses n’ont pas empêché la prise de décisions, notamment celle de construire la Ligne Maginot ; celle-ci a pu être interprétée comme une façon de se persuader de l’impossibilité du retour de la guerre, en faisant de cette impossibilité quelque chose de tangible. Quel rôle a joué le traumatisme de la Première Guerre mondiale dans cette décision ?
La construction de la ligne Maginot n’a pas été le réflexe d’une nation traumatisée par la guerre.
Certes, le pacifisme était très répandu dans la société française, mais la politique du gouvernement consistait à maintenir une domination militaire sur l’Allemagne ; à l’issue du conflit, les Alliés ont occupé une partie de la Rhénanie, comme la Ruhr en 1923 pour contraindre l’Allemagne au paiement des réparations. En cas de guerre, le plan consistait à couper l’Allemagne en deux avec l’aide de la Tchécoslovaquie.
La Première Guerre mondiale a légué deux débats : l’un sur la nécessité de la fortification permanente, l’autre sur le commandement. En 1940, ni l’un ni l’autre n’était clos.
Kevin Passmore
Les discussions sur la manière de défendre la frontière française ont commencé immédiatement après la guerre ; elles ont suscité des débats houleux, mais elles ne portaient que sur des scénarios et des hypothèses. Lorsque, à la fin de 1925, six ans après la fin de la guerre, un comité fut enfin créé pour étudier la fortification, il déclara que « l’organisation de la défense du territoire n’est qu’une branche de l’organisation de la défense nationale et non la plus importante ». Elle était subordonnée à la restructuration de l’armée, à la mobilisation industrielle et à la protection des communications avec l’empire français en Afrique du Nord.
Le fait que les discussions sérieuses n’aient commencé qu’après le retour de Pétain du Maroc en 1926 — où il commandait les troupes françaises pour réprimer la rébellion des tribus berbères du Rif —, souligne la primauté alors accordée à l’empire.
À cette date, la politique de domination de l’Allemagne avait échoué. Dès lors, les gouvernements se tournèrent vers la réconciliation avec le pays, dans un cadre de coopération économique, d’obligations conventionnelles et de désarmement ; or, ce dernier impliquait l’interdiction des armes offensives.
Comme la Société des nations définissait les fortifications comme étant au contraire défensives, celles-ci semblaient d’autant plus nécessaires que l’occupation de la Rhénanie devait prendre fin en 1930. La Rhénanie resterait alors démilitarisée, mais son rôle de zone tampon était réduit. Les discussions sur ces fortifications se sont néanmoins prolongées pendant quatre ans, car il s’est avéré très difficile de se mettre d’accord sur ce qu’il fallait construire.
Quelles étaient les différentes options sur la table ?
Le groupe de travail établi par l’armée proposa une ligne de gros ouvrages avec une artillerie très près de la frontière. Elle était destinée à faciliter les manœuvres, car elle comprenait des brèches pour canaliser l’ennemi, tandis que la frontière belge fut laissée sans fortifications.
Pétain s’opposa à ce plan ; il préconisait simplement de stocker du matériel afin d’être prêt à construire des fortifications de campagne échelonnées sur le terrain en cas de mobilisation. Il a bénéficié du soutien d’hommes politiques de gauche influents, notamment Édouard Daladier et Pierre Cot, anciens combattants de l’infanterie, qui partageaient son aversion pour les fortifications permanentes.
Une autre proposition consistait en un réseau de petits blockhaus, assez similaires au Westwall allemand — la fameuse ligne Siegfried.
Pourquoi le plan prévoyant de grands forts d’artillerie l’emporta-t-il ?
La première raison est que la plupart des officiers supérieurs croyaient que les grands forts d’artillerie permettaient aux commandants de contrôler directement les troupes, alors que les fortifications de campagne et les petits blockhaus les dispersaient. Le commandement semblait d’autant plus important que, depuis 1929, le service militaire avait été réduit à un an.
Ces gros ouvrages étaient organisés selon les principes des sciences de l’organisation. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si leurs plans ont finalement été approuvés en janvier 1930, alors qu’André Tardieu, un « organisateur » de premier plan, était président du Conseil. Les commandants de ces gros ouvrages devaient être tout-puissants, comparables à des directeurs d’usine ou à des capitaines de navires de guerre — les officiers de marine ont d’ailleurs contribué à la conception des systèmes de commandement de ce que l’on appelait souvent les « grands cuirassés enterrés ».
Les forts, de même, devaient être occupés par une forte proportion d’officiers professionnels ayant reçu une formation technique ; les troupes ordinaires, comme dans une usine, apprenaient par cœur des opérations simples et n’étaient pas censées faire preuve d’initiative.
L’inspiration tirée des sciences de l’organisation se retrouve dans d’autres aspects de la ligne ; les grands forts devaient permettre d’améliorer les conditions de vie des troupes, pour contrer l’antimilitarisme. La conception interne des forts individuels s’inspirait des plans contemporains visant à construire des logements modernes et confortables pour les classes ouvrières, séparés des quartiers industriels insalubres, afin d’éliminer les causes profondes du communisme. Dans les forts souterrains, les casernes étaient séparées des blocs de combat par de longues galeries dans lesquelles circulaient des trains électriques.
Outre ce combat contre le développement de l’antimilitarisme au sein de l’armée, le projet de fortifications a-t-il eu, au-delà de son aspect stratégique, des objectifs politiques ?
En France, l’armée et les hommes politiques étaient horrifiés par la montée de l’autonomisme en Alsace-Lorraine, comme on l’appelait encore à l’époque.
Après la récupération du territoire en 1918, le gouvernement avait provoqué le mécontentement de la population majoritairement germanophone de la région en imposant le français dans l’éducation, l’administration et les tribunaux, et en s’attaquant aux privilèges religieux ; plus tard, en 1928, le gouvernement a fait arrêter les principaux leaders autonomistes. Si la plupart des Alsaciens et des Lorrains n’avaient aucune envie de rejoindre le Reich, certains le souhaitaient, ainsi qu’en témoignent les nombreuses sections de la Jungmannschaft pro-nazie, nombreuses à l’arrière des zones fortifiées 4.
La volonté de contrer l’autonomisme a influencé le positionnement des fortifications. Pétain plaidait pour une défense en profondeur ; il envisageait uniquement des postes d’alerte à la frontière, des secondes lignes sur les fortifications allemandes d’avant 1914 et une troisième ligne sur les anciennes fortifications françaises, y compris Verdun.
Au Conseil supérieur de la Guerre, le général Boichut, alors commandant en Alsace, remarqua que la proposition de Pétain entraînerait la perte de l’Alsace. Il était très au fait de l’état d’esprit de la province, car il rapportait des incidents quotidiens entre les patrouilles et les habitants. Les grands forts permanents à la frontière qui ont finalement été adoptés présentaient l’avantage de défendre toute la province, sans que puissent être abandonnées des portions de territoire national lors de la défense, comme pouvait le préconiser Pétain ; bien mieux que le stockage de matériel de construction que celui-ci pouvait préconiser, ils symbolisaient la puissance de l’armée et de l’État français.
Il est désormais bien connu que le Blitzkrieg allemand est né d’un conflit au sein de la Wehrmacht ; on peut en dire autant du plan français.
Kevin Passmore
Pour résumer, le choix de construire des gros ouvrages a été à la fois militaire, politique et social : « neutraliser » la frontière allemande et libérer des troupes pour manœuvrer, contrer la décentralisation tactique, rétablir le commandement, améliorer les conditions des troupes afin de les rendre plus efficaces et moins susceptibles de céder à l’attraction du communisme — et, enfin, enrayer l’autonomisme alsacien-lorrain.
Le projet était donc très ambitieux ; quels ont été les obstacles d’ordre matériel lors de la construction des fortifications ?
La ligne Maginot, en tant que projet orgueilleux visant à organiser d’en haut les hommes, les machines et le monde naturel, était intrinsèquement irréalisable. Les principes sur lesquels elle reposait ont toujours été contestés, au point qu’en 1939, les opinions sur la doctrine française étaient très polarisées.
À cette date, le Génie estimait que les fortifications pouvaient « perfectionner la nature là où elle était déficiente », comme l’a dit un général ; pourtant, les tentatives de l’armée d’intégrer des rivières et des forêts dans le système défensif aboutirent à des résultats très mitigés.
Un problème majeur a été celui du contrôle de la circulation de l’air et de l’eau à l’intérieur des forts. Pendant les chaudes journées d’été, l’air extérieur se condensait dans les blocs de combat plus frais ; tout au long de l’année, la vapeur provenant des cuisines et les odeurs des latrines envahissaient les galeries et remontaient dans les blocs de combat.
Bien que les forts n’aient pas été construits dans la nappe phréatique, des sources souterraines s’infiltraient aussi dans les galeries à travers les murs de maçonnerie — il n’y avait pas assez d’argent pour les bétonner ou même les enduire. En poste au fort du Hochwald en 1939, l’écrivain Roland Dorgelès a raconté comment une sorte de brouillard envahissait les galeries, mentionnant aussi les flaques d’eau sur le sol. Il était difficile de respirer, surtout lorsque les pompes étaient éteintes ; même pendant les périodes d’occupation relativement courtes, en temps de paix, les troupes se plaignaient d’un état de dépression légère et de léthargie qu’elles appelaient « bétonite ».
Tout n’était pas noir pour autant. L’armée construisit également de nombreuses casernes modernes près des fortifications, qui constituaient une grande amélioration par rapport à ce qu’un général appelait « les trous sombres » des installations existantes. Les troupes estimaient pourtant qu’elles y passaient trop peu de temps ; en général, elles étaient occupées à faire des exercices, à construire et à garder de petits blockhaus.
Non seulement les conditions de travail étaient extrêmement inconfortables dans le climat rigoureux de l’Est, mais les commandants se plaignaient que leurs troupes étaient trop dispersées pour pouvoir les commander efficacement. Les recherches que j’ai pu faire dans les archives de la justice militaire montrent combien les officiers ont dû tolérer l’indiscipline.
Vous avez mentionné que l’implantation de la ligne en Alsace-Lorraine visait aussi à enrayer le développement de l’autonomisme dans cette région. Comment ces fortifications étaient-elles perçues dans la région ?
L’idéal d’un commandement hiérarchique était difficile à réaliser, car l’armée devait compter sur des troupes recrutées localement qui ne parlaient pas bien le français. Comme les fortifications devaient être capables de réagir instantanément à une attaque surprise, elles comptaient sur des réservistes recrutés dans les environs, capables de rejoindre leurs unités à tout moment. Plus ils étaient âgés, plus ils étaient susceptibles de ne parler que l’allemand — voire des dialectes — et d’avoir combattu dans l’armée allemande lors de la guerre précédente. On raconte que les réservistes rappelés ne comprenaient pas un mot de ce que leur disaient leurs officiers.
Les habitants, autonomistes ou non, considéraient les fortifications comme une atteinte au rôle de pont entre la France et l’Allemagne joué par l’Alsace-Lorraine ; ils ressentaient comme une injustice l’expropriation des terres agricoles et les multiples servitudes imposées autour des fortifications. De nombreux incidents ont opposé les Français de l’intérieur et les Alsaciens-Lorrains, les soldats et les civils.
Bien que les Alsaciens-Lorrains aient rarement sympathisé avec l’Allemagne, l’armée considérait tous les germanophones comme des espions potentiels. Cette crainte de l’espionnage contribua au renforcement des lois sur le sujet et même au tournant autoritaire des années précédant la guerre. La menace n’était pas pour autant imaginaire : la grande majorité des affaires d’espionnage de 1934 à 1939 concernaient la ligne Maginot.
Une fois entamées les premières constructions de fortifications, quels ont été les nouveaux débats à leur sujet ?
Peu de gens rejetaient le principe des fortifications, mais leur place dans les plans français a toujours été controversée et évolutive.
Avant 1927, si ce n’est plus tard, les Français n’ont pas considéré les fortifications comme urgentes. Alors que celles-ci commençaient à être envisagées, des débats houleux sur leur nature ont retardé leur construction pendant des années.
Ce qui a été construit a été un compromis, qui ne pouvait satisfaire pleinement personne. Avant même que les gros ouvrages ne soient achevés, les partisans de la fortification de campagne ont pris le dessus ; la victoire de la gauche aux élections législatives de 1932 a porté au pouvoir des hommes qui avaient toujours rejeté la construction de grands forts d’artillerie au profit de fortifications de campagne. Édouard Daladier, ministre de la Guerre en 1933, veilla à ce qu’aucun autre fort d’artillerie ne soit construit et élabora un plan pour la construction de la fortification de campagne de Nice à la mer du Nord.
Ces vues divergentes sur la bonne défense ne suscitèrent pas un conflit entre hommes politiques et militaires ; en 1934, Pétain devint ministre de la Guerre et mit en œuvre les propositions de Daladier. Les officiers supérieurs chargés de commander les corps d’armée en temps de guerre, quant à eux, préféraient également les fortifications de campagne, qu’ils pouvaient construire et positionner à leur guise, avant et pendant une bataille. Ils avaient longtemps ressenti comme une injustice le fait que les fortifications permanentes soient construites par une organisation indépendante d’eux, le Comité d’organisation des régions frontières (CORF), et que les unités militaires des régions fortifiées soient également indépendantes sur le plan organisationnel.
Quant aux officiers subalternes d’infanterie, ils étaient également mécontents de ce qu’ils considéraient comme les systèmes abstraits et scientifiques des ingénieurs qui dominaient le CORF ; ils privilégiaient plutôt leur propre compréhension intuitive du terrain. Beaucoup d’entre eux se tournèrent même vers la pseudo-science de la radiesthésie, une sorte de divination qui consistait à utiliser des pendules pour détecter les mouvements de troupes.
Selon un mythe, la ligne Maginot était bien plus qu’une simple erreur militaire : elle aurait bercé le peuple français dans un faux sentiment de sécurité.
Kevin Passmore
Y avait-il même au sein de l’armée des officiers rejetant entièrement le principe des fortifications ?
Bien qu’aucun officier ne se soit opposé en principe à la fortification, le service de fortification était très impopulaire.
Les officiers préféraient les unités privilégiant la manœuvre, telles que les chasseurs à pied et l’infanterie alpine. De même, ils n’aimaient pas le service dans des zones rurales éloignées habitées par une population germanophone où il n’y avait ni vie sociale bourgeoise ni lycées pour leurs enfants. Traditionnellement, le service de fortification était réservé aux officiers âgés qui terminaient leur carrière paisiblement.
L’armée tenta de contrer cette perception en présentant les nouveaux régiments d’infanterie et d’artillerie de fortification comme une élite : ils étaient mieux payés et recevaient de nouveaux uniformes kakis. Pourtant, seuls les nouveaux lieutenants sortant de Saint-Cyr en bas du classement et qui ne pouvaient donc pas choisir leur affectation étaient envoyés dans les fortifications ; d’autres y étaient envoyés pour des crimes contre l’honneur, des dettes ou pour ivresse publique en uniforme. En fin de compte, l’armée obligeait les officiers à y servir, mais ceux-ci n’appréciaient pas cette affectation.
La préférence pour la manœuvre plutôt que pour la défense était partagée au plus haut niveau. En 1931, alors que la construction de la ligne Maginot avait à peine commencé, Maxime Weygand succéda à Pétain en tant que vice-président du Conseil supérieur de guerre et donc commandant désigné en cas de guerre ; puis, en 1935, Maurice Gamelin succéda à Weygand ; tous deux étaient attachés à la manœuvre.
Gamelin et Weygand sont à l’initiative de la motorisation de l’infanterie et, en 1933, de la formation d’une division légère blindée. Leur révision du règlement en 1936-1938 est souvent considérée comme superficielle, ne rompant pas vraiment avec l’approche méthodique de 1921. Il est vrai qu’elle restait un compromis entre des positions opposées, mais les nouveaux règlements laissaient plus de place à l’initiative et comprenaient une nouvelle section sur l’utilisation des divisions blindées, précisément celle utilisée en 1940.
De telles révisions ont été également rendues possibles par l’apparition de nouvelles armes : canons antichars, chenillettes, mortiers de 60 et 81, chars et avions plus rapides ou motos. Il est important de noter aussi qu’elles étaient le résultat de longs débats au sein de l’armée, auxquels participaient des officiers de tous grades ; la controverse s’étendait à tous les rangs du corps d’officiers.
Faut-il donc dire que les Français n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur la meilleure stratégie à adopter et sur le rôle de la ligne Maginot dans celle-ci ?
La situation à la veille de la guerre était caractérisée par une polarisation et une politisation qui se sont poursuivies pendant la « drôle de guerre ».
D’un côté, Gamelin nourrissait des plans de plus en plus ambitieux pour intervenir en Belgique, aux Pays-Bas et même en Suisse. De l’autre côté se trouvaient ceux qui, face à Hitler, prônaient l’apaisement, arguant que puisque l’expansion allemande en Europe de l’Est ne concernait pas la France, le pays devait se replier derrière la ligne Maginot et sur son empire pour ne se défendre qu’en cas d’attaque — une éventualité qu’ils persistaient à croire improbable.
À la tête des partisans de l’apaisement militaire se trouvait le maréchal Pétain : en 1939, il rédigea une préface élogieuse au livre du colonel Chauvineau, Une invasion est-elle encore possible ?, qui concluait par la négative.
Cette préface a souvent été citée comme preuve d’une « mentalité Maginot ». En réalité, elle met en garde contre le retour de la doctrine offensive ; elle ne témoigne pas tant d’une « mentalité Maginot » universelle que d’une polarisation.
Dans les mois qui précédèrent la guerre, les divergences publiques s’accentuèrent encore, car la destruction de la Tchécoslovaquie par l’Allemagne et les nouvelles revendications italiennes sur Nice, la Savoie et la Tunisie réduisirent le choix à une alternative entre la guerre et l’hégémonie allemande.
Plus que jamais, les partisans de l’apaisement, menés par Pierre Laval, ne voyaient alors dans la ligne Maginot qu’un symbole ; elle signifiait la volonté de la France de ne se battre qu’en cas de menace directe.
Sources
- Double crime sur la ligne Maginot, Paris, Le livre de Poche, 1971 [1936]
- En mai 1940, fallait-il entrer en Belgique ?, Paris, Economica, 2005, et Julian Jackson, The Fall of France. The Nazi Invasion of 1940, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
