21.01.2026 à 12:55
Manifeste poétique pour une bonne année singulière
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1930 mots)
Deux citations résonnent encore car je les entends assez fécondes dans leurs rapports au monde extérieur et intérieur, sans doute sont elles également une façon de comprendre la puissance de la création dans une lecture sensible des forces qui nous gouvernent et qui appellent un dialogue avec cette raison pratique et philosophique, avec cette instance poétique qui fait Œuvre.

« Et tant que tu n’auras pas compris ce « meurs et deviens », tu ne seras qu’un hôte obscur sur la Terre ténébreuse. » Goethe
Pourrait-on inscrire la peinture dans ce deviens, toute la peinture et situer l’acte de peindre comme l’écrit Deleuze pour Cézanne, Klee et Bacon au centre du Chaos précédant l’acte démiurgique de la création et l’avènement de la peinture dans son langage pictural… soleil donc à double titre et à double foyer, et pour soi et pour le monde, acte d’éclaircissement et de lecture, de production des ce qui rend le peintre heureux, en cette lumière, en ces soleils qu’il créé et peint (même tourmentés en van Gogh bien entendu, ce soleil noir de la mélancolie) et qui éclairent aussi comme si le chant entier de la Nature (je pense à Monet) semblait s’être rendu si complice et aimant en la nature du peintre que ses mains lui soient si prodigues, si prodigieuses, qu’elles accordent, en une valse charmante, légère le fond du regard à cette âme qui s’éprend de toute la Nature (le Cosmos d’Evi Keller) et la rend sensible à tous par la peinture, eau solaire, eaux nuptiales, lumière fécondante, universalisme, souffles ligériens de ce vent paraclet au spectacle du monde…
D’où sans doute la citation camusienne: « Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été.»
Dans cette approche constituante, la lumière se créée par l’écriture et la philosophie, mais aussi par ce qu’elle comporte d’universellement Vrai dans cette expérience du Soi et de sa fonction ontologique, quand le peintre, le philosophe, le romancier fait correspondre sa sensibilité aimante avec l’expérience de la vie et sa fonction heuristique, l’art de découvrir, de pouvoir lire en soi le mouvement même de ce que l’expérience dépose et de ce qui se construit en harmonie, en présences, en faits, en intentions aussi, en ses mystères, ce qui noue, à mon sens, le plan de l’objectivité à celui de la subjectivité dans une relation dialectique épanouissante, régalienne; l’Esprit toujours couronne la création qui vient à travers cet Inspire et la féconde alors que secrètement, au cœur de l’être se sont alignées les forces mêmes de ce miroir issu des profondeurs, devenu Camera Clara, peinture, roman, chant de l’intime, lumière irradiante, ville, paysage…inséminations profondes, méditations aurait écrit Rimbaud (son roman sans cesse médité, Les poètes de 7 ans).

Manifeste poétique, Verdon, ©PASCALTHERME2025
Ces correspondances sont la preuve que nous sommes également ce monde ployé par un secret, que nous sommes au travail en nous mêmes, à répondre à la question du Sphinx, qui sommes nous vraiment? Cette question est permanente, elle noue la création à la question de la production et au travail que cette permanence induit quant aux réponses que nous tirons de la réalité et à ce qui chemine au secret, ce facteur de conscience qui se nourrit de la question du Sujet Inavoué, alors qu’immergé en cette vie et selon nos psychologies, nos raisons et déraisons, nos passions, nos folies et cette sensibilité aux idées, à la philosophie, à la foi où à son absence, à ce qui nous fait percevants, artisans de cette sensibilité morale et intellectuelle, cette question irradie…
Nous voguons sur cette mer vineuse, attachés nu aux poteaux de couleur, (A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu ) et nous attendons dans la ferveur d’être touchés par ce chant des sirènes dans ce qu’il a de surhumain et de tragique; ce chant d’avant le monde, qu’était-il donc ce chant du monde avant l’homme et sa tragédie…et qu’est ce donc que ce bateau ivre qui vogue depuis si longtemps, si loin en nous qu’il évoque l’alchimie du verbe en son logos, couleurs, lumières, mouvements, mystiques du rêve, fragrances de l’esprit, sensualité des yeux et de la main, vertus du cœur, pâmoison d’anges, verts secrets enclos de cette rumeur ancienne qui vibre au levant et s’éteint au couchant, passe la nuit, incendie ses navires, contemple sa défaite, s’assoupit enfin au devant de la plage…renait au matin par cette aube libre du chant de sa plus haute tour (Rimbaud aussi) que ce jardin illuné, hier, vaste songe panthéistique où
» Quand venait, l’oeil brun, folle, en robes d’indiennes,
– Huit ans, – la fille des ouvriers d’à côté,
La petite brutale, et qu’elle avait sauté,
Dans un coin, sur son dos, en secouant ses tresses,
Et qu’il était sous elle, il lui mordait les fesses,
Car elle ne portait jamais de pantalons ;
– Et, par elle meurtri des poings et des talons…
Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre.. »
…. et que se faisait la rumeur du quartier, les persiennes closes, il revenait à son roman sans cesse médité… ah!, on ne dira jamais assez la fureur, l’Éros de cette poétique rimbaldienne qui a insolé toute une génération durablement jusqu’à l’incandescence, et dont, bien entendu, je fais partie… cet absolu du roman issu de la vie sensible, de cette attraction fatale pour ce romantisme élégiaque, cette convaincante mission de l’Esprit libre, des corps amoureux dans leurs échanges avec l’infini et le temps, à cette parole, issue du chant du monde et de l’amour, cueillie au creux des ces reins, ces petites amoureuses, encore rimbaldiennes, rieuses et provocantes : Nous nous aimions à cette époque, Bleu laideron !On mangeait des oeufs à la coque Et du mouron ! Un soir, tu me sacras poète Blond laideron : Descends ici, que je te fouette En mon giron; (1871)… de quels bonheurs ne sommes nous toujours pas né, et si c’était le cas, nous devrions les chanter haut et fort, à tue tête, en pleine nuit et en plein jour, histoire de clarifier par le son de ce chant ce sang mauvais qui coule à en ces jours qui rabaissent notre sang gaulois dans son cœur ancestral…. Beurres-tu encore ta chevelure?
.Au chevet de cette terre qui s’en va et qui revient, plus nuptiale encore, alors que notre temps se concentre, comme un sang sombre et clair et que la main délivre, sur la neige du papier, l’encre noire du stylo, même si nous n’écrivons plus avec, l’ayant fait, un marquage s’est établi au son de cette plume et de son grattage, offre du verbe ployé, moulé en sa graphie courbe par le tracé noir ou bleu de nos lettres voyageuses au matin, langueurs des matinaux, espoir vespéral, or du midi, fusions, état de grâce, un couteau coupe le jour et l’inverse… nous roulons sous les jupes de ces matins et de ces soirs naissants à cette autre lumière, de l’autre côté du miroir.
Pascal Therme, 13 janvier 2026
21.01.2026 à 12:36
Avec Louise Mutrel embarquez dans le Starlight Express Club
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1031 mots)
L’exposition Starlight Express Club, présentée au sein du centre d’art contemporain de la Galerie Édouard-Manet, réunit un ensemble de photographies-objets aux formats variés. Les œuvres s’inscrivent dans l’espace à travers de larges caissons rétroéclairés qui convoquent des formes issues de la tradition picturale, telles que le retable ou le diptyque.

Louise Mutrel - Nord Evasion
Depuis 2019, Louise Mutrel développe au Japon une recherche visuelle et narrative autour de l’univers des « dekotora » : camions tuning spectaculaires mêlant références de la culture populaire et esthétiques ultra-saturées. Ces véhicules tunés issus d’une contre-culture née dans les années 70 et héritée de la présence américaine dans l’archipel portent la customisation au rang d’art. Leurs styles uniques reflètent la personnalité de chaque propriétaire et mélangent les influences allant de la culture picturale ancestrale japonaise à la science-fiction, en se éférant notamment aux armures robotisées des personnages de la série d'animation manga Gundam, très populaire au Japon depuis les années 80. Paradoxal, l’ornement délirant de véhicules dont la fonction initiale est censée être purement utilitaire fait de ces camions hypertrophiés des œuvres ambulantes combinant sculptures, peintures et installations lumineuses.
Au-delà des véhicules, elle s’attache aussi à celleux qui les font exister — conducteur·rice·s, rassemblements nocturnes, gestes et échanges. Les « dekotora » deviennent ainsi les supports d’une expression artistique, artisanale et sociale.

Louise Mutrel : Only You Can Complete Me
Avec Starlight Express Club, Louise Mutrel transpose cet univers en installations. Présentées sous forme de dispositifs lumineux, les images apparaissent comme des perceptions fugaces, invitant les visiteur·euse·s à plonger dans l’atmosphère nocturne et vibrante du club des « dekotora ».
-> Rencontre-conférence avec Louise Mutrel le Samedi 31 janvier à 15 h.
Kobé Abo, le 21/01/2026
Louise Mutrel - Starlight Express Club -> 14/03/2026
Galerie Edouard-Manet de Gennevilliers 3, place Jean Grandel 92200 Gennevilliers
21.01.2026 à 12:24
À Londres, les villes nouvelles sont intra-urbaines
L'Autre Quotidien

Texte intégral (4114 mots)
Non pas le Périphérique mais la North Circular, non pas Clichy-Batignolles mais Brent Cross Town (BXT). Ce nouveau noyau urbain au sein de la métropole londonienne s’inscrit dans le modèle de morphologie urbaine polycentrique. Visite. Chronique d’Outre-Manche.

Visualisation aérienne de Brent Cross Town depuis le sud, montrant les constructions actuelles en couleur et les futurs blocs en transparence @Related Argent
Londres ne possède pas de périphérique urbain comme Paris mais un demi périphérique appelé North Circular, qui décrit un arc de cercle traversant zones industrielles, infrastructures et banlieues tentaculaires du XXe siècle. Sur un tronçon d’autoroute à huit voies entre deux échangeurs à plusieurs niveaux, il longe le centre commercial Brent Cross, le troisième plus grand de Londres. Au sud cependant, une surprise est en train d’émerger : un îlot de sérénité urbaine, neutre en carbone, baptisé Brent Cross Town (BXT).
Il faudra peut-être vingt ans pour mener à bien le projet BXT, qui prévoit 6 700 logements, 30 000 m² de bureaux pour 25 000 employés et 20 hectares d’espaces verts et de terrains de sport. Par son ampleur et son ambition, BXT s’apparente à la réponse londonienne à Clichy-Batignolles à Paris (XVIIe arrondissement) : un écoquartier aux fonctions mixtes, un développement axé sur les transports en commun (TOD) qui concrétise ce que Carlos Moreno appelait en 2016 la « ville du quart d’heure ». À ce jour, seul un huitième environ de BXT est en construction, mais les premiers résidents ont déjà emménagé dans les immeubles achevés et le premier immeuble de bureaux affiche déjà presque complet.
Les promoteurs sont Related Argent, une société née en 2015 de la fusion des sociétés new-yorkaise Related et londonienne Argent. Related est surtout connue pour Hudson Yards, un quartier varié mais étrangement propre, inséré sur Midtown West Side, à Manhattan, avec ses gratte-ciel futuristes aux façades de verre vertigineuses (dont deux de plus de 300 mètres de haut), ses espaces publics piétonniers, son immense salle de spectacle modulable et l’attraction spectaculaire, mais controversée, « Vessel », une structure de 46 mètres de haut conçue par Thomas Heatherwick. Argent est quant à elle surtout connue pour la rénovation du quartier londonien de Kings Cross Central, qui étend des infrastructures du XIXe siècle réhabilitées (dont la transformation des anciens dépôts de charbon par Heatherwick) avec de nouveaux bureaux (dont le siège européen de Google) et un quartier résidentiel. Kings Cross est reconnu comme un modèle de rénovation urbaine et d’aménagement du territoire.
Lorsque l’architecte Bill Dunster a fondé l’agence Zedfactory en 1999 et conçu BedZED, un éco-village de banlieue comprenant 100 logements achevé en 2002, il a marqué une étape importante dans la transition de Londres vers la neutralité carbone. BXT est bien plus qu’un simple « village » : son envergure et la mixité de ses bureaux, logements et commerces en font une véritable « ville écologique », où les loisirs de plein air font partie intégrante du mode de vie. Morwenna Hall, directrice générale et directrice des opérations de Related Argent, souligne leur « engagement en faveur du développement durable, de la santé et du bien-être, concrétisé par la mise en place d’un “Indice de bien-être” permettant de suivre l’évolution du bien-être de la communauté tout au long du cycle de vie du projet ».
Le projet BXT trouve son origine dans la volonté d’expansion du centre commercial, à laquelle Bob Allies, associé fondateur du cabinet d’architectes Allies and Morrison, se souvient s’être opposé en 1999, estimant que le site sud devait être aménagé en premier. « Il y avait là une zone industrielle discrète, une grande usine de recyclage (désormais) relocalisée, et de nombreuses voies de garage », explique Allies. « L’ensemble du secteur était complètement isolé et plutôt morne ». Le cabinet allait par la suite élaborer le plan directeur de ce qui est aujourd’hui BXT. Mais la création d’une véritable ville, et non d’un simple lotissement résidentiel, n’était réaliste qu’avec la construction d’une nouvelle gare à l’est du site. Bob Allies se souvient : « Lorsque nous avons commencé le projet, je me rappelle avoir dessiné la gare et les gens me disaient : “Oh, ne soyez pas ridicule” ».

Hall de la gare Brent Cross West. Photo @ H.W.
C’est de la nouvelle gare de Brent Cross West que j’ai entamé ma mission pour constater l’avancement du projet BXT. Les trains rejoignent King’s Cross, au cœur de Londres, en 12 minutes et desservent directement deux aéroports internationaux. En levant les yeux vers un échangeur autoroutier depuis la gare, on aperçoit les colonnes multicolores, hautes de 21 mètres, qui entourent le poste de transformation électrique de la nouvelle ville (conçu par IF-DO et Arup, 2025), et qui a fait l’objet d’une étude de cas dans un rapport du Forum économique mondial (World Economic Forum). Sur le site adjacent, la construction d’une centrale énergétique entièrement électrique de 30 MW, qui alimentera le réseau de chauffage urbain de BXT, débute en 2026.
La station elle-même est une conception de shedkm et Studio Egret West, avec un hall spacieux de 13 mètres de haut en bois massif. À l’extérieur, au-delà des palissades, on aperçoit divers immeubles de moyenne hauteur qui émergent au cœur de BXT. Un chemin sinueux qui les traverse mène au parc Claremont, conçu par Townshend Landscape Architects et regorgeant de plantations à la biodiversité riche, d’une aire de jeux animée par les enfants et d’une structure de jeu fantastique (réalisée par Root and Erect) qui pourrait figurer dans un conte de fées.

Claremont Park et nouveaux immeubles d’appartements @H.W
Le parc s’étend à l’est, au pied d’une falaise de nouveaux immeubles résidentiels orthogonaux de hauteur moyenne comme d’énormes boîtes aux façades de briques, aux grilles de fenêtres régulières et aux balcons en acier en porte-à-faux. Ce style urbain est courant dans les nouveaux projets londoniens – Bob Allies souligne que « nous respectons tous les directives du maire en matière de logement et les mêmes réglementations en matière de construction » – et bien qu’il rappelle l’architecture vernaculaire londonienne en briques, il pourrait tout aussi bien se trouver en Scandinavie ou aux Pays-Bas. Bob Allies affirme : « Nous savons que les bâtiments orthogonaux peuvent créer de très belles villes » et « j’ai toujours tenu à ce que les bâtiments donnant sur le nouveau parc forment un mur continu ». Deux immeubles d’appartements conçus par les architectes Maccreanor Lavington sont déjà occupés. Ces derniers expliquent que le Delamarre s’inspire des immeubles de type « mansal block » londoniens du XIXe siècle (on y retrouve les baies vitrées mais pas les ornements). Les appartements affichent des prix (exorbitants) conformes au marché londonien mais, derrière, le solide immeuble Conductor House (conçu en collaboration avec Whittham Cox) abrite 120 logements abordables et accueille des résidents des logements sociaux des années 1960 récemment démolis du Whitfield Estate.
Un centre d’accueil primé par le RIBA se trouve au fond du parc. Cette structure en bois de trois étages, conçue par Moxon Architects, présente des murs en gabions au rez-de-chaussée, un bardage en zinc à l’étage et du mélèze au sommet. À l’intérieur, se trouvent un espace d’exposition lumineux et un café. L’entrée du centre d’accueil donne sur un immeuble d’après-guerre abritant des commerces, sur Claremont Way. « AFG » fonctionne toujours comme une petite épicerie indépendante, un modèle menacé dans les villes britanniques. Autrefois indispensable au quartier de Whitfield Estate, AFG a désormais de nouveaux voisins : une pizzeria branchée et un torréfacteur. La banale rangée de boutiques a acquis une touche urbaine moderne grâce à une peinture bleue et une fresque botanique vibrante, « Cattleya », d’Annu Kilpeläinenn, sur le mur du fond. Malheureusement, ce joyau psychogéographique inattendu, qui connaît aujourd’hui une seconde vie prometteuse, risque fort de disparaître au profit d’un complexe commercial et de loisirs beaucoup plus imposant. Mais les plans changent, et comme le souligne Bob Allies, « une chose que nous avons apprise avec Argent grâce à l’expérience de King’s Cross, c’est… d’essayer de conserver les bâtiments existants autant que possible. On peut donner vie à un bâtiment existant d’une manière totalement différente ».

Claremont Way en 2008 et 2025, juste avant la démolition des logements sociaux Whitfield (gauche) et le relogement de ses résidents dans Conductor House (3ème bâtiment à droit) @Google Street View
Traversant les imposants immeubles d’appartements déjà construits, je suis arrivé à Neighbourhood Square. Il est dominé par la tour Fusion élancée de 24 étages (la plus haute de Brent Cross Town), composante du complexe en forme de L (Glenn Howells Architects), qui accueille des étudiants quelle que soit leur école ou université. La fontaine vert fluo de 4,3 m de haut, conçue par Studio Neon, évoque les fontaines des places européennes. Morwenna Hall, la directrice générale de Related Argent, souligne que « l’art continuera de jouer un rôle clé dans l’identité de Brent Cross Town à mesure que le quartier se développe ».
Plus de 50 nouveaux commerces, restaurants et cafés devraient ouvrir leurs portes, et Neighbourhood Square est appelé à devenir le cœur urbain de la communauté de Brent Cross Town. Copper Square, relié par une rue commerçante et situé à l’ouest, près de la gare, sera le centre commercial névralgique du quartier. Le premier immeuble est construit : le 3 Copper Square, un bâtiment de 14 étages presque cubique conçu par shedkm, avec une structure hybride en bois massif et béton. Six étages sont déjà occupés par l’Université Sheffield Hallam. Le prochain bâtiment livré sera le 2 Copper Square (Bennets Associates), un immeuble de neuf étages de couleur verte, entièrement construit en bois massif et agrémenté de terrasses végétalisées.
Le développement de BXT va se poursuivre de manière significative, s’étendant sur toute la longueur de la rocade nord, entre les échangeurs. Une passerelle verte enjambera cette rocade et reliera le centre commercial, actuellement accessible uniquement par d’étroits ponts débouchant sur des parkings ou par des routes sans trottoirs. Un vaste parc sportif arboré, baptisé Clitterhouse Park et conçu par Gustafon Porter Bowman, prolongera BXT vers le sud. Ce parc est essentiel à la vision de Morwenna Hall, qui souhaite faire de BXT « un quartier où le bien-être et la pratique du sport et des loisirs sont primordiaux ».

Neighbourhood Square, avec la tour Fusion (Glenn Howells Architects) et la fontaine verte (Studio NEON) @H.W
Qu’en est-il des habitants des banlieues qui découvrent soudainement une nouvelle ville devant chez eux ? Une vaste consultation a été menée et les riverains semblent avoir été conquis. Selon Bob Allies, ce succès s’explique par « l’amélioration de leur cadre de vie, la création d’une nouvelle gare, la connexion avec le centre commercial, l’amélioration des services de bus et un investissement important dans l’aménagement paysager ».
En tant que nouveau noyau urbain au sein de la métropole londonienne, BXT s’inscrit dans le modèle de morphologie urbaine polycentrique des grandes villes identifié en 1945 par les géographes Harris et Ullman de Chicago. Londres compte déjà de nombreux pôles où se concentrent des usages mixtes en périphérie, allant de Canary Wharf, apparu dans les années 1990, aux villes et anciens villages ruraux engloutis par l’expansion londonienne.

3 Copper Square (conçu par shedkm) et 2 Copper Square (par Bennets Associates)
Les villes sont généralement des îlots urbains enclavés dans la campagne, à l’instar des 32 « villes nouvelles » britanniques construites après la Seconde Guerre mondiale, certaines pour désengorger Londres. L’automne dernier, le Groupe de travail sur les villes nouvelles (NTT) a recommandé la construction de 12 nouvelles « villes nouvelles » à faible émission de carbone en Angleterre afin de fournir des logements, de stimuler la croissance économique et de faciliter l’accès aux transports. Certaines sont situées en zone urbaine, mais cinq occupent des espaces ruraux vierges. C’est regrettable, car nous devrions préserver, voire renaturaliser, nos campagnes, et non les détruire. Ce sont les banlieues dépendantes de l’automobile, et pas seulement les friches industrielles, qui doivent être ciblées et densifiées, et le Royaume-Uni doit accélérer le processus. Les plans de BXT sont antérieurs à ceux de NTT, mais ils répondent parfaitement à ses objectifs. Et cette « ville nouvelle » intra-urbaine est déjà en train de devenir réalité.
Tout ce dont BXT a besoin, c’est d’un élément modeste pour préserver la mémoire du passé. Espérons que la vieille galerie marchande de Claremont Way ne soit pas démolie.
Herbert Wright pour Chroniques d’architecture le 21/01/2026
À Londres, les villes nouvelles sont intra-urbaines
21.01.2026 à 11:24
Désespérance techno sud-américaine : les "Reminiscencias" de Binary Algorithms
L'Autre Quotidien
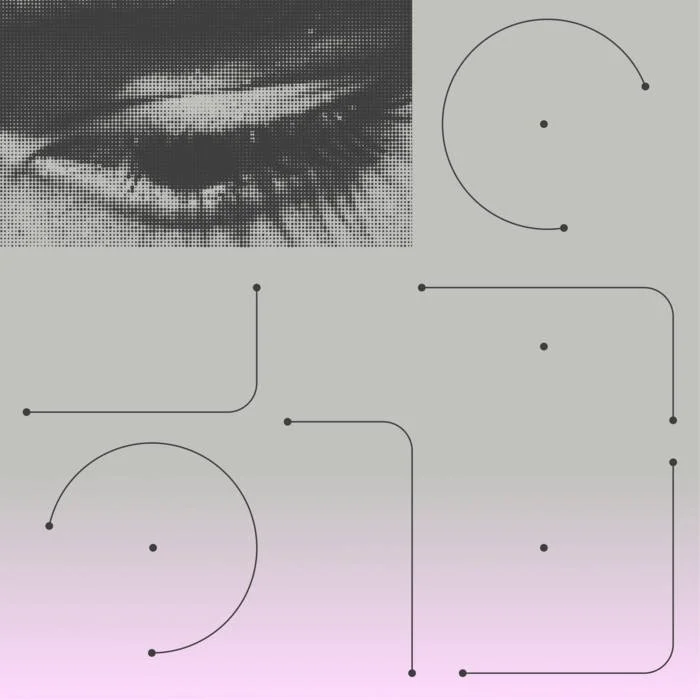
Texte intégral (893 mots)
Conçu entre 2023 et 2025, le premier album studio de Binary Algorithms dépeint une histoire de décadence et de désespoir, où se rencontrent la périphérie latino-américaine, le désespoir de l'absence d'amour et la tragédie de la résistance dans les pays du Sud. Mêlant IDM, dub-techno et électro à des influences UK bass et ambient, Binary Algorithms retrace également la dichotomie des identités « latines », si souvent réduites au « tropical ».
Néanmoins, Reminiscencias ne se limite pas à un seul fil conducteur. Il s'agit d'une cartographie intime des lieux vécus et abandonnés, où se croisent mémoire personnelle et histoire collective. Des coins de rue marqués par l'absence, des pièces à demi éclairées où des voix résonnaient autrefois, des trajets en bus à travers des banlieues tentaculaires, le bourdonnement lointain des marchés s'estompant dans un silence de béton. Les sons qui entourent Andrés – des routes rurales aux bourdonnements sourds de la circulation sur les autoroutes fissurées – se mêlent à des fragments de souvenirs : rencontres fugaces, lettres jamais envoyées, poids des mots non dits. Ces espaces sont imprégnés d'histoires de résilience et de perte, dont l'écho dépasse largement leurs limites physiques.

Chaque composition évolue entre des structures rythmiques abrasives, des passages atmosphériques expansifs et une conception sonore raffinée, évoquant la tension entre résilience et effondrement, nostalgie et futurs qui ne se sont jamais réalisés, utopies promises et vérité impitoyable. Dans cette convergence, le LP devient à la fois un document et une réflexion — un paysage sonore façonné par le temps, la perte et les espaces laissés entre eux.
Et si la comprenette vous fait encore défaut, pensez Trump, pensez Maduro et surtout la guignol de service :Maria Corina Machado, la même affidée qui a refilé son prix à l’agent orange… Plus clair comme ça ?
Jean-Pierre Simard, le 21/01/2026
Binary Algorithms - Reminiscencias - Furatena
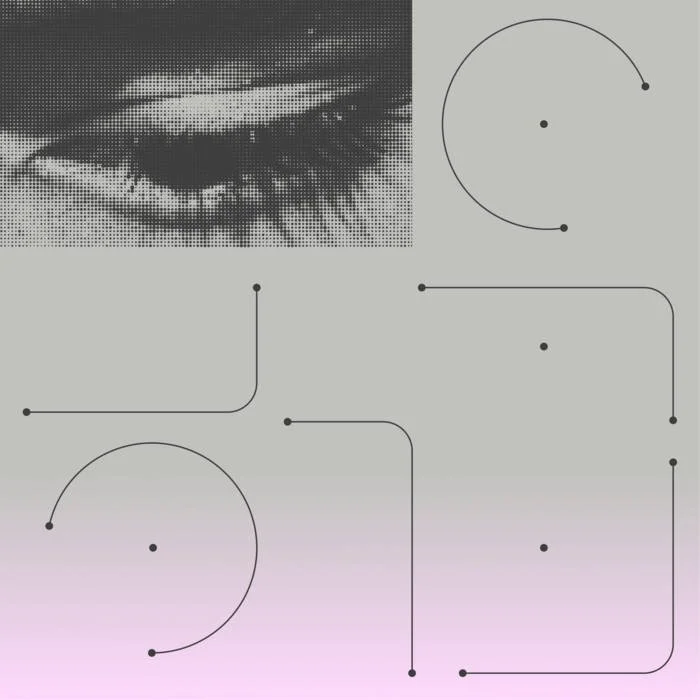
21.01.2026 à 10:55
“Décharge”, de Séverine : après la dévoration
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1027 mots)
Décharge, le nouveau texte de la poétesse Séverine, parle d'un corps perdu au pays des ogres et des ogresses, un corps asservi tantôt en poupée auscultable, tantôt en animal de laboratoire, coupé du monde par le silence, un silence devenu bourbier.

Coincée entre les larmes folles de la mère et les doigts intrusifs du père, le corps de l'enfant a devoir de confession, comme s'il fallait la purger d'une parole dont elle est par ailleurs interdite. Objet de convoitise autant que de dégradation, le corps ici marqué ne connaît du verbe soigner qu'une foule d'antonymes.
Comment, quand on appartient désormais à ce que l'auteure appelle "la horde des désaxées", se reconstruire? Le terme lui-même – reconstruction – semble ridicule alors qu'il s'agit de ruines, d'annihilation. Alors que l'enfant s'est vu spoliée d'enfance pour être sacrée terrain d'expérimentation. Alors que son entourage s'est décrété strangulatoire. Pourtant, contre ce passé piétiné, il faut se dresser, ou plutôt faire que la langue se dresse, qu'elle fore le mur blanc de silence derrière lequel s'abritent les prédateurs:
"Là encore, le présent est imprononçable, le lieu détruit insaisissable, cette part de toi, de la fumée. Tu ne te rends pas compte de ce que tu vis. Tu perds ton étanchéité, tu avales à l'aveugle des pulsions infernale, à grosses goulées. On ne donnerait pas cher de ta mémoire qui se laisse tatouer.
La force de Décharge consiste à tissser au moins trois lignes de langage, celle du souvenir à jamais déformant qui refuse le simple récit, celle du constat de dépossession du corps qui bat en brèche l'analyse et celle de l'intime comme expérience enfin révélée. En confrontant et alternant ces lignes vibratiles, l'auteure veille à ce que son texte survive à l'anéantissement qu'une telle parole pourrait générer, tant la violence de ce qui est, par tranchants fragments, dit, prend le risque de nous sidérer. Page après page, les non-dits cèdent, les monstres sont désignés, les peurs affrontées ; la douleur prend en charge les aveux et le sang de la vérité peut de nouveau couler à ciel ouvert; l'explicite surgit comme un fer rouge du magma indicible.
"Un souvenir, c'est âpre à exhumer, le retour stroboscopique du refoulé, son avancée une milliseconde par jour, son imperceptible gain en durée. La séquence enfouie peine tellement à se dérouler, mais finit par atteindre ta ligne d'arrivée […]"
Un viol n'est pas un récit, il n'obéit pas aux lois de la narration ordinaire, et quand il est répété, perpétré sous mille formes, nié dans sa réalité, adoubé par la famille, il semble qu'il lui soit impossible d'entrer dans le langage, voire interdit, tant la chasse est à jamais gardée par les "déserteurs les petits-chefs les bâtards". En détruisant le sujet et en en faisant un objet, le bourreau condamne sa proie au néant du langage. Qui ne parle que forcée ne parle pas. Qui doit se taire sous peine d'être davantage exclu n'a plus que les mots pour briser le bouclier des tabous. Pourtant, avec Décharge, Séverine brise, éclate, déplie, retourne, assèche, bouscule – se sauve – au double sens: fuite et salut s'épaulant tant bien que mal. Naître expose, écrit-elle vers la fin. Or c'est là le grand pari de ce texte: exposer plus que témoigner. Mettre à nu le déjà-décharné. Offrir aux cris une cadence. Faire de la vérité une force neuve. "Trouver une clairière", ainsi qu'il est espéré.
Claro, le 21/01/2026
Séverine, Décharge, éd. Lanskine
20.01.2026 à 11:07
On aime #122
L'Autre Quotidien

Lire + (437 mots)

Jordi Colomer
L'air du temps
Iggy Pop - Little Virus
“Dirty little virus sleepin' inside us
Gone are the pay days, gone are the play days
Dirty little virus sleepin' inside us.
Oh what a grind! I'm losin' my mind.”
Le haïku de tête
Le papillon bat des ailes
comme s'il désespérait
de ce monde.
Kobayashi Issa
L’éternel proverbe
Un aujourd'hui vaut deux demain.
Proverbe anglais
Les mots qui parlent
- Des fois j’arrive plus à savoir si c’est moi qui débloque ou si c’est le monde qu’est devenu une fosse septique.
- Les deux. Mais votre plus gros problème c’est que vous êtes un moraliste.
James Crumley - Le dernier baiser
13.01.2026 à 17:20
James Cook fait respirer le bronze de ses statues
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1431 mots)
Le sculpteur sud-africain James Cook travaille un matériau qui n’est pas franchement réputé pour sa légèreté : le bronze. Et pourtant, ses œuvres donnent l’impression de flotter, de se fragmenter dans l’air, comme si la matière avait décidé de respirer. Entre réalisme et abstraction, il crée des corps troués, fissurés, ouverts… non pas pour les “casser”, mais pour laisser au regard un rôle actif : compléter, imaginer, ressentir.

Un résultat aérien… construit avec une méthode d’orfèvre
Les œuvres de James Cook ont souvent un look “léger”, mais leur fabrication est tout sauf improvisée. Il décrit un processus typique basé sur la fonte à la cire perdue, avec des étapes très structurées. Tout commence par une armature (souvent acier + fil) qui sert de squelette. Il pose ensuite des volumes en mousse expansive, puis affine les formes avec une couche de cire/argile de modelage. Vient alors le moulage : un moule en silicone (pour capturer le détail) maintenu par une coque rigide en fibre de verre + résine.
Ensuite, on passe au cœur de la “cire perdue” : on fabrique une réplique en cire, on lui ajoute un système d’alimentation (gates) pour guider le métal, puis on l’enrobe d’une coquille céramique par trempages successifs. La cire est éliminée par chauffe, et le bronze en fusion prend sa place. Après refroidissement : casse de la coque, assemblage, soudures, et la phase de fettling (ponçage/finition) qui fait disparaître les cicatrices pour retrouver une continuité de surface.

“The Space Between Us” : l’espace qui dit l’essentiel
Une pièce emblématique, The Space Between Us, résume très bien son langage : deux figures semblent liées, presque enlacées… mais un vide persiste entre elles. Pour Cook, cet espace peut représenter la tension, l’énergie et le manque lorsque deux personnes sont séparées et pensent à se retrouver. Et c’est là que ça devient intéressant : ce vide n’est pas “un trou”, c’est un sens possible. Le spectateur comble, interprète, projette. Autrement dit : votre cerveau finit l’œuvre, et ce n’est pas facturé en supplément.
Cook explique aussi qu’une sculpture peut lui demander des mois (souvent autour d’un semestre) entre conception, fabrication, finitions et patine. On comprend mieux pourquoi ses œuvres ont cette impression de “justesse” : elles ne sont pas pressées.
Mythologie grecque, relations humaines : des thèmes anciens, une forme neuve
James Cook revendique une inspiration forte pour la mythologie grecque, autant pour ses récits de transformation et de tension que pour son héritage sculptural. Mais il y injecte une lecture très contemporaine : amour, distance, fragilité, ambiguïtés des relations. L’Antiquité lui offre des archétypes ; lui, il les rend instables, fragmentés, humains.
En savoir plus sur son site et sur Insta.
Jean-Pierre Simard avec 2tout2rien, le 13/01/2026
James Cook fait respirer le bronze

James Cook - The Space between us
13.01.2026 à 16:56
Kalabala : l'Art Ensemble avec Muhal Richard Abrams en 1974 à Montreux
L'Autre Quotidien

Texte intégral (552 mots)
Kabalaba, l'un des nombreux enregistrements publiés par le label de l'Art Ensemble et le seul à documenter le groupe dans son ensemble, est un enregistrement live réalisé en 1974 au Montreux Jazz Festival par le même groupe élargi (avec l'ajout de Muhal Richard Abrams) qui a enregistré le superbe album Fanfare for the Warriors pour Atlantic.
Bien qu'il ne soit pas aussi enivrant que cet album, Kabalaba offre un exemple typique des concerts live de l'Art Ensemble à cette époque. Plusieurs interludes de percussions et des solos de cuivres ponctuent des morceaux thématiques plus forts, tels que Theme for Sco, qui fait ici l'objet d'un traitement énergique. Roscoe Mitchell produit un morceau solo particulièrement acerbe à l'alto, Improvization A2 [sic], tout en nœuds et en amertume suivi d'une des sorties manifestement espiègles et pleines de bavures de Lester Bowie. Le concert se termine par une explosion de cuivres en libre circulation qui s'estompe sans conclusion apparente, bien que le groupe juge bon d'ajouter plusieurs minutes inutiles d'applaudissements du public pour conclure l'album.
Cet enregistrement contient plusieurs épisodes intéressants, mais l'auditeur intéressé ferait mieux d'écouter la Fanfare susmentionné pour avoir une image complète des grands pouvoirs de cette incarnation particulière de l'Art Ensemble. Et de toute façon, les aficionados possèdent déjà l’inestimable coffret ECM. Quand on aime, on réécoute …
Jean-Pierre Simard (fan) le 13/01/2026
Art Ensemble of Chicago - Kalabala, live at the Montreux Jazz Festival - AECO
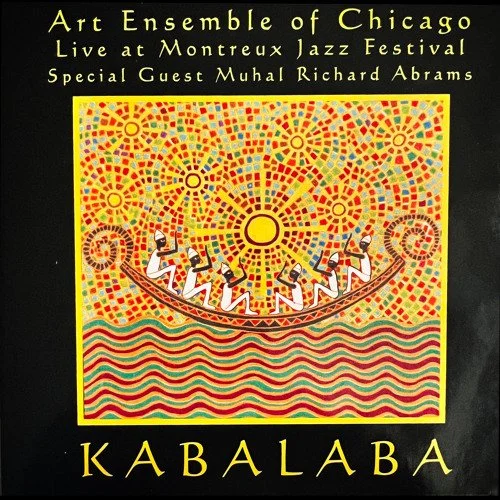
13.01.2026 à 16:31
Journal d’une jeune architecte — Entre théorie et pratique : un accès à l’enseignement sous tension
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3567 mots)
Des débats nous accompagnent tout au long de notre parcours. Ils traversent les études, les débuts professionnels, les premières expériences d’enseignement, sans jamais vraiment se résoudre. La place des praticiens dans l’enseignement de l’architecture en fait partie.

estelleofish - Cascais, Portugal
Il en est question depuis que je suis étudiante : dans les couloirs des écoles, autour des jurys, à la sortie des rendus, lors de discussions tardives entre enseignants. Alors pourquoi cette agitation soudaine autour de la règle dite du 70 % de théoriciens pour 30 % de praticiens ? Pourquoi maintenant, alors que le débat est ancien ?
Parce que, cette fois, il ne s’agit plus d’un débat d’idées. Il s’agit d’une application concrète, mécanique, comptable. Et surtout, il s’agit de trajectoires réelles. De celles et ceux qui pourront, ou non, enseigner demain.
Ce débat est souvent valeureusement porté par des enseignants déjà installés. Mais il concerne avant tout une génération encore en train de se construire : des jeunes architectes qui aspirent à transmettre, sans toujours mesurer que l’accès à l’enseignement se referme progressivement pour certains d’entre eux.
Derrière les ratios et les statuts, c’est une question plus large qui se pose : quel enseignement de l’architecture voulons-nous ? Et avec quels profils pour le porter ?
Un équilibre fragile, historiquement construit
Les écoles nationales supérieures d’architecture se sont historiquement construites sur un équilibre fragile et précieux entre enseignants praticiens et enseignants issus du monde académique. Cet équilibre n’a rien d’évident ni de naturel : il est le fruit d’une construction lente, depuis les années 1970, faite d’allers-retours constants entre le projet et la pensée, entre la recherche et la pratique professionnelle. C’est dans cette tension féconde que s’est forgée la spécificité des ENSA : un enseignement ni strictement universitaire, ni purement académique, mais profondément hybride, situé, pluridisciplinaire, et indissociable des conditions réelles de production de l’architecture.
La lettre ouverte adressée le 12 décembre 2025 à la ministre de la Culture par un collectif d’enseignants, notamment de l’ENSAPVS, le rappelle avec une grande justesse. Elle alerte sur les effets de la réforme du statut des enseignants-chercheurs engagée depuis 2018, non pas du point de vue d’un conservatisme disciplinaire, mais à partir d’une inquiétude pédagogique profonde. En imposant une lecture comptable des profils enseignants, cette réforme risque de fragiliser ce qui fait le cœur même de l’enseignement de l’architecture : la capacité à articuler savoirs théoriques, savoirs techniques et expérience du projet.
Ce texte met en lumière un point fondamental : l’architecture ne se transmet pas uniquement par des savoirs académiques autonomes. Elle se transmet aussi par une connaissance incarnée de la maîtrise d’œuvre, par une compréhension fine des territoires, des usages, des contraintes économiques, réglementaires et constructives. Autrement dit, par un rapport au réel qui ne peut être dissocié de la pratique.
Affaiblir la présence des praticiens dans les écoles, ce n’est pas seulement déplacer un curseur statutaire : c’est risquer de rompre le lien vivant entre l’école et le monde dans lequel les futurs architectes auront à agir.

estelleofish- Palerme Sicile
Une réforme qui ne menace pas tout le monde de la même manière
Ce qui frappe, dans les débats actuels, c’est que celles et ceux qui s’élèvent le plus fortement contre l’application stricte de cette réforme ne sont pas nécessairement ceux qui en subiront les conséquences les plus directes. Les enseignants déjà installés, titulaires, reconnus, ne sont pas les plus fragilisés et pourtant ce sont eux que l’on entend.
En revanche, la nouvelle génération de praticiens enseignants, celle dont je fais partie, se retrouve face à une porte qui se referme progressivement. Les consciences doivent se réveiller, et les jeunes architectes doivent plus que jamais rejoindre l’engagement collectif. Combien de jeunes praticiens, aujourd’hui encore éloignés de l’enseignement, aspirent à y entrer un jour et ne sont même pas informés de cette réduction de leurs chances d’y accéder un jour ? Les voix de notre génération doivent aussi se lever !
Soyons lucides : avec cette réforme, l’accès à l’enseignement dans les ENSA par la voie de la pratique devient presque impossible. Les dossiers de praticiens sont déjà, pour la plupart, d’un niveau exemplaire, portés par des architectes installés depuis des années, ayant construit une carrière solide. Avec la réduction mécanique du numerus clausus, comment imaginer que les jeunes praticiens, en début de parcours, puissent trouver leur place ?
Faire une thèse aujourd’hui n’est pas un simple choix intellectuel : c’est un engagement total, sur trois à quatre ans minimum. Au-delà du temps consacré, la rédaction d’une thèse implique une série de renoncements rarement nommés. Elle suppose une précarité économique prolongée, une mise entre parenthèses partielle, voire totale, de la pratique professionnelle, et une difficulté réelle à lancer ou à maintenir une agence dans un moment de vie où tout devrait, au contraire, se structurer.
À cela s’ajoute une contrainte moins visible mais tout aussi structurante : l’incertitude. Incertitude sur les débouchés réels après la thèse, sur la reconnaissance institutionnelle, sur la possibilité effective d’enseigner, sur la compatibilité future entre recherche, pédagogie et pratique. Autrement dit, un investissement massif sans garantie de retour, ni professionnel, ni économique.
Enfin, faire une thèse aujourd’hui engage aussi une forme de spécialisation précoce. Elle oriente une trajectoire, parfois de manière irréversible, à un moment où les jeunes architectes sont encore en train de construire leur identité professionnelle. Ce choix, présenté comme une ouverture, peut devenir une assignation, enfermant certains.
Le temps d’une thèse coïncide précisément avec le moment où tout se joue, où tout se forge dans une jeune agence, où une pratique peut émerger ou disparaître. Nous faudrait-il attendre nos 40-50 ans minimum pour postuler en praticien ou bien de se lancer sereinement dans un projet de recherche ?

estelleofish - Chatelet- Les Halles
Faire une thèse et monter une agence : le grand fantasme
J’ai eu cette discussion de nombreuses fois. Catherine Jacquot, présidente de l’Académie d’Architecture, a mis en place une commission dédiée à l’enseignement et Martine Weissmann m’y a convié avec plusieurs jeunes membres du collectif Le Champ des Possibles.
Autour de la table de notre côté : des doctorants, des praticiens, des enseignants, tous de moins de 35 ans. Tous animés par les mêmes questions : comment transmettre aujourd’hui ? comment trouver notre place ? comment devenir de meilleurs enseignants tout en gagnant notre vie ?
À un moment, le sujet est arrivé frontalement : faire une thèse et lancer son agence. Pour celles et ceux qui sont passés par l’exercice de la thèse et ses exigences, la réponse était nette : impossible. Le seul moyen est de s’y consacrer pleinement, puis, à 30 ou 35 ans, d’essayer de lancer une agence.
Pour les praticiens, le constat était plus nuancé, mais la frustration palpable. Beaucoup rêveraient de pouvoir s’engager dans une recherche approfondie, de prendre le temps de la pensée longue. Mais la réalité économique et celle de l’agence rattrapent vite les idéaux.
Même parmi les plus passionnés par l’enseignement, une même phrase revenait : on nous demande aujourd’hui de choisir. Comme s’il fallait accepter de se couper une jambe ou un bras. Penser ou faire. Chercher ou construire.
Une intervenante engagée dans une thèse CIFRE exprimait avec justesse cette position inconfortable de l’entre-deux. Ni tout à fait chercheuse, ni tout à fait praticienne. Moins présente sur les chantiers que ses confrères, mais pas pleinement intégrée non plus dans le monde académique. Son objectif initial était clair : enseigner et exercer. Aujourd’hui, la thèse est en poche, mais les portes de l’enseignement ne s’ouvrent pas pour autant. Et le désir de pratique, lui, revient avec force. Elle tente désormais de lancer son agence, laissant, provisoirement, l’enseignement de côté, alors même que c’était le cœur de son projet initial.
Comme si l’on ne mesurait pas l’impact réel de ces « orientations » sur les trajectoires de vie. On ne peut pas laisser les jeunes générations dans le flou, entre promesses et injonctions contradictoires.
Peut-être faut-il imaginer d’autres formats de thèse, d’autres manières de produire de la connaissance, sans abaisser le niveau d’exigence, mais en diversifiant les parcours. La recherche par le projet, la recherche située, la recherche ancrée dans le faire sont des pistes sérieuses, déjà expérimentées ailleurs.
Les médecins parviennent bien à produire des thèses sans se consacrer exclusivement à la recherche pendant trois ans. Pourquoi pas nous ?
Sortir les praticiens de l’enseignement : une aberration pédagogique
Partout, le même constat revient : les jeunes architectes sortant des écoles peinent à entrer dans le monde professionnel. Il leur est reproché un enseignement trop théorique, trop déconnecté des réalités de la maîtrise d’œuvre, des responsabilités économiques, techniques, juridiques.
C’est un autre débat passionnant : que doit-on transmettre ? De quoi a-t-on réellement le temps en cinq ans ? Ce qui est certain est que nous sommes déjà à un point de bascule. Pourtant, dans le même mouvement, il est envisagé de réduire encore la place des praticiens. Le paradoxe semble évident.
Former des architectes capables d’affronter les enjeux contemporains, écologiques, sociaux, constructifs, nécessite une connaissance fine des conditions réelles de production du projet. Cette connaissance ne se transmet pas uniquement dans les livres ou les articles scientifiques. Elle se transmet aussi par le récit de la pratique, par l’expérience, par l’erreur, par le chantier.
Il ne s’agit pas de dire que l’enseignant praticien fait tout, ni que l’enseignement doit être uniquement technique. Mais nous avons l’obligation de transmettre aux étudiants une boîte à outils qui ne peut être déconnectée du réel. Sinon, la sortie d’école devient difficile pour certain.es.
Une thèse ne fait pas un pédagogue
Je ne crois pas qu’une thèse rende mécaniquement meilleur enseignant, d’ailleurs pas plus que d’être bon praticien rende bon enseignant. Enseigner me passionne, et j’ai le sentiment de toucher du doigt combien c’est un métier à part entière. Être pédagogue demande des compétences spécifiques : une attention à l’autre, une capacité à transmettre, à adapter, à écouter. Cela suppose un rapport particulier au savoir, qui n’est pas nécessairement celui de la recherche académique.
Devenir enseignant, c’est aussi apprendre à enseigner, aux côtés d’autres enseignants, au contact des étudiants. Cela doit-il passer exclusivement par la recherche ou la pratique ? J’en doute. Alors le débat est-il vraiment au bon endroit ?
Mon rêve, depuis longtemps, serait de voir émerger une véritable formation à la pédagogie pour les enseignants en architecture. Une formation qui reconnaisse l’enseignement comme un champ de recherche et de pratique en soi. Pourquoi cela n’existe-t-il pas déjà ? D’autres disciplines l’ont fait. Le niveau et la qualité de l’enseignement n’en seraient que renforcés. Alors pourquoi pas nous ? Et si nous formions nos jeunes enseignant à devenir enseignants et non spécifiquement chercheurs ou praticiens ?
Ce débat se joue, très concrètement, dans les ateliers du vendredi après-midi, dans les corrections tardives, sur les chantiers que l’on quitte à la hâte pour attraper un train vers l’école, dans cette fatigue particulière de celles et ceux qui tentent de tenir ensemble la pensée, l’enseignement et la pratique. Le débat se joue auprès de ces jeunes passionnées qui aiment l’architecture, souhaitent la bâtir et la transmettre mais l’abandonneront si les textes de loi, les ratios ou les statuts ne changent pas.
Réduire progressivement la place des praticiens dans les écoles ne protège pas la recherche. Le projet est affaibli et l’enseignement désincarné, déconnecté de la complexité du monde que les étudiants auront à affronter dès leur sortie d’école. Les jeunes générations font face à une injonction impossible : choisir, là où l’architecture exige précisément de savoir tenir les deux.
Il ne s’agit pas d’opposer chercheurs et praticiens, ni de hiérarchiser les formes de savoir. Il s’agit de reconnaître que l’enseignement de l’architecture repose sur une pluralité de régimes de connaissance : le savoir théorique, le savoir-faire, le savoir pédagogique, le savoir situé. Aucun ne peut prétendre à l’exclusivité sans appauvrir l’ensemble.
Si l’on veut réellement préparer les architectes de demain, alors il faut cesser de demander aux jeunes enseignants d’entrer dans des cases trop étroites. Il faut inventer des parcours hybrides assumés, des statuts souples, des formes de recherche compatibles avec la pratique et, surtout, reconnaître la pédagogie comme un champ d’expertise à part entière.
Former des architectes n’est pas seulement produire des chercheurs ou des techniciens. C’est transmettre une capacité à penser le monde. Cela, aujourd’hui plus que jamais, ne peut se faire qu’à partir d’un enseignement profondément ancré dans ce monde en mouvement.
Estelle Poisson, le 13/01/2026
Architecte — EST architecture
13.01.2026 à 13:13
Blue Valentines, les blues cyanotypés d'Ida Anderson
L'Autre Quotidien

Texte intégral (2562 mots)
Blue Valentines est une série de cartes postales photographiques d’Ida Anderon, créées à l'aide du procédé cyanotype, une technique spéciale et historique connue pour ses teintes bleues profondément mélancoliques.


Ces images, empreintes à la fois de nostalgie et de sérénité, agissent comme des rappels intimes mais poignants d'un amour brisé à la fois personnel et politique, évoquant un sentiment d'exil non seulement d'un lieu, mais aussi du temps et de sa ville natale pour sa patrie. Elles reflètent un mode de vie qui semble désormais irrémédiablement perdu.
Dans cette série, des vues idylliques de Moscou sont juxtaposées à des scènes plus troublantes : barricades policières, femmes solitaires, pigeons se battant, bar fermé nommé « Furbulent Freedom » (« Liberté turbulente ») en reconstruction, panache de fumée... Elles capturent et transmettent une texture émotionnelle.


Comme dans la chanson de Tom Waits qui donne son nom au projet, Blue Valentines évoque un chagrin persistant, impossible à effacer. Les images de ceux qui se sont retrouvés dans des villes étrangères et qui partagent un sentiment de perte commun résonnent chez ceux qui s'opposent à la guerre et qui vivent à Moscou comme à Buenos Aires. Dans ce contexte de déplacement, Blue Valentines crée un espace possible pour la mémoire active et la possibilité d'une guérison des liens rompus !
En fin de compte, ce projet est une sorte de blues photographique, une élégie visuelle pour les émigrés russes qui ont quitté leur pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 en choisissant l'exil. Les cartes postales sont conçues pour être envoyées par la poste. Des fragments intimes d'expérience envoyés au-delà des frontières, reliant des amis et des proches dans une communauté dispersée mais durable; celle des exilés involontaires…


Ida Anderson est le pseudonyme créatif d'Anna Komissarova, artiste et psychothérapeute psychanalytique en exercice originaire de Russie. Elle est diplômée de l'UNIC, Institute of Culture, la DocDocDocContemporarySchoolof Photography' et a étudié dans les ateliers de Kir Esadov et Polina Muzyka. Elle est l'auteure d'un cours éducatif et de publications consacrés à la psychanalyse de l'art contemporain et de la photographie. Plus sur Insta
Jean-Pierre Simard avec PHROOM
Ida Anderson - Blue Valentines
13.01.2026 à 11:53
Les Tambourao clochoto de François Dufeil sonorisent l'espace
L'Autre Quotidien

Texte intégral (2329 mots)
Dans cette exposition personnelle, François Dufeil présentera, dès le 17/01/2026, un ensemble de sculptures instruments de musique façonnées à partir d’objets recyclés, témoins de notre ère industrielle et consumériste, ainsi qu’une série de dessins réalisés lors de sa résidence à l’Institut Sacatar au Brésil durant l’automne 2025. Ces œuvres prolongent sa recherche sur la transversalité entre le visuel et le sonore.
Bettie Nin –Tambourao clochoto nous plonge dans un univers musical expérimental matérialisé par un ensemble d'œuvres organiques et mécaniques, dignes d’une Climate Fiction1 post-énergies fossiles. Tes sculptures, faites d’objets glanés issus d’activités industrielles (vase d’expansion, bonbonne, extincteur, etc.), déploient une esthétique singulière. Peux-tu nous parler de cette esthétique où semble se jouer un futur hypo-technologique ? Comment choisis-tu tes objets ?
François Dufeil – On peut effectivement retrouver l’imaginaire solar punk2 dans mon travail, avec une inversion de l’idée de catastrophe et de dystopie pour proposer un monde plus désirable. Les objets que j’utilise portent cette symbolique d’une pétrochimie en plein essor, mais rendue obsolète par le changement de contexte. Je m’intéresse aussi à la notion de wild tech3, imaginée par l’anthropologue Yann-Philippe Tastevin, qui, entre low et high tech, renvoie à des objets issus d’une fusion entre les savoirs d’antan et les technologies d’aujourd’hui. Je glane mes objets un peu partout : dans des brocantes, des poubelles, des déchetteries, chez des ferrailleurs, sur Leboncoin... Je leur trouve un sens nouveau et les mets en espace d’une nouvelle manière. Je les découpe et les greffe à d’autres matériaux, tout en jouant avec les couleurs. Et puis, il y a toute une ingénierie qui détermine la forme des sculptures. Aujourd’hui, j’ai une palette de teintes et de matières (cuivres, bronzes, laitons, aciers bruts, objets peints, etc.) dans laquelle je peux puiser à volonté pour trouver mes compositions. Je garde les rayures, les marques, les traces d’usure qui racontent l’histoire industrielle.

BN – Ces objets font référence à la formation en génie climatique que tu as suivie chez les Compagnons du Devoir avant ton parcours en écoles d’art. De là t’est venu un intérêt pour les phénomènes de vibration, de résonance, de circulation de l’air et de l’eau, ainsi que pour les savoirs-faire artisanaux. Qu’est-ce que cette hybridation, entre technique, artisanat et création, t’offre plastiquement ?
FD – Une liberté. Toutes les techniques apprises chez les Compagnons du Devoir m’ont permis de m’affranchir de la contrainte de la technique. Ce côté fonctionnel et rationnel, que j’ai pratiqué pendant huit ans, m’a apporté une certaine vision, proche de celle du design dont je me sers dans la conception des sculptures. Ce qui m’anime aussi, c’est de chercher les moyens de production des objets que j’utilise, c’est-à-dire leurs capacités à produire de l’énergie, de la chaleur, des rayons, des vibrations, des circulations de flux, de la musique... et de mêler le côté artisanal à la proposition plastique.
BN – Tu parles souvent de « fonctionnalité » et, en effet, la plupart de tes sculptures sont activables ou possèdent une forme d’utilité propre, d’où aussi ton utilisation du terme « sculptures-outils » . Comment conceptualises-tu la notion de fonction dans tes œuvres ?
FD – Le terme « sculptures-outils » a été utilisé par la critique d’art Sarah Ihler-Meyer dès 2019 pour parler de mon travail. J’ai immédiatement trouvé la notion intéressante, parce que l’outil est une prolongation du corps sans motorisation, sans électricité, sans autres carburants que l’énergie du corps. L’intérêt d’ajouter de la fonctionnalité à une sculpture est de pouvoir la partager et de faire en sorte qu’elle puisse fonctionner aussi bien dans un atelier que dans une exposition. D’une certaine manière, cela désacralise l’œuvre, qui devient un objet que l’on peut toucher, pratiquer, éprouver et même abîmer. Cela me permet aussi de proposer à d’autres de continuer mon travail. Les rencontres que j’initie se perpétuent souvent sur plusieurs années et font évoluer les sculptures. Les sculptures-instruments de musique, par exemple, ont pris de plus en plus de place. Et puis, cela me permet de poser un regard critique sur la notion de production. Lorsque j’ai commencé à fabriquer des outils pour fabriquer mes sculptures, j’ai réalisé que ce qui m’intéressait le plus n’était peut-être pas la sculpture finale, mais tout ce que je déployais pour la fabriquer. Comme si l’outil qui fabrique la sculpture était plus fort que la sculpture elle-même.

BN – Et d’où t’est venue cette envie d’associer le visuel et le sonore ?
FD – D’un fort attrait pour la musique au départ, et d’une relation amicale avec Charles Dubois, percussionniste de musiques expérimentales, qui, un jour à l’atelier, a commencé à taper sur mes objets en remarquant leur potentiel sonore. Notre collaboration a débuté à ce moment-là et, depuis, nos échanges sont très équilibrés. Ce sont vraiment nos deux sensibilités et nos deux savoirs qui font l’objet final. J’apporte le côté plastique, la recherche des matériaux, des formes et des couleurs, et lui ses envies précises de sonorités. Le premier instrument que je lui ai créé était une batterie à eau. Puis nous avons travaillé sur une sorte de xylophone-carillon et de tambour pneumatique composés d’objets que je glanais depuis des années. Ces instruments hybrides donnent des sonorités aigües cristallines, des basses rondes quasiment électroniques. J’aime enrichir les instruments par d’autres collaborations, comme celle avec Anna Holveck, notamment à la voix. Ce mélange de musique et d’arts plastiques nous permet de réunir des publics qui se rencontrent peu et de produire d’autres façons d’appréhender l’art.
BN – Tes œuvres invitent, d’une certaine manière, à repenser les gestes. Et nous savons que tout geste est éminemment politique : c’est un mouvement du corps porteur de valeur en soi. Cette exposition amène ainsi à se demander comment agir autrement... Dirais-tu qu’il y a une dimension engagée dans ton travail ?
FD – Je ne le revendique pas forcément, mais il y a effectivement une forme d’engagement dans mon approche. Le geste est l’une des notions que j’intègre dans mes sculptures, soit frontalement par la performance des corps avec les sculptures, soit de façon plus sous-jacente comme le geste artisanal. Cela me semble intéressant aujourd’hui de défendre le rapport artisanal à la production et de réfléchir à la notion de « main qui pense » . Proposer un objet qui a visiblement été fait par une main, qui est compréhensible au premier regard, sur-mesure, adaptable, un objet que l’on peut modifier et s’approprier, est pour moi une forme d’émancipation par la production. Ce geste est aussi le témoin d’un ralentissement, et peut-être, le signe d’une société en meilleure santé.
1 Climate Fiction ou Fiction Climatique ou cli-fi : fiction d’anticipation qui traite du changement climatique et de ses conséquences possibles.
2 Solar punk (de solar : soleil et punk, mouvement de contestation) : le solar punk est un mouvement artistique et politique qui propose une anticipation optimiste d'un avenir désirable, durable, connecté avec la nature et qui se concentre sur les énergies renouvelables en particulier énergies solaires.
3 Wild tech (de wild : sauvage et punk, mouvement de contestation) : la wild tech est un domaine qui fusionne les avancées technologiques de pointe avec les aspects indomptés de la nature.
—————-
Samedi 17 janvier 2026 de 16h à 20h, VERNISSAGE
Ce jour-là le centre d’art sera ouvert à partir de 16h.
à 19h PERFORMANCE SONORE : Chansons Cloches
durée approx. 25 minutes
artistes Anna Holveck, Charles Dubois et François Dufeil
Né en 2025 autour de nouveaux modules, instruments et installations conçus par François Dufeil, Chansons Cloches est un trio et une composition-déambulation : une série de pièces sonores brèves mêlant voix, percussions et rythmiques automatiques.
De nouveaux modules d’amplification vocale se mêlent à un tambour à eau automatique, à divers idiophones joués, et à des cloches à percuteurs mécaniques dans une installation semi-autonome.
Le souffle d’Anna Holveck rencontre les timbres du son mécanique continu, tandis que les rythmiques automatiques de François Dufeil dialoguent avec les gestes percussifs de Charles Dubois, entre rigueur électronique et élasticité.
Le son des cloches et de la voix amplifiée par le porte-voix se fondent l’un dans l’autre, s’imitent en se donnant du relief et se répondent dans l’espace ; chant, sifflements et cloches tourbillonnent, accompagnés de tambours pneumatiques.
Des basses profondes aux mélodies métalliques perçantes, le spectre des timbres et des fréquences est balayé tout au long de la performance par les gestes, souffles et automates, naturellement amplifiés par les objets et matières travaillées par François Dufeil.
François Dufeil - Tambourao clochoto - > 17/01 -> 21/03/2026
CAC La Terrasse - 9, rue Traversière. 94140 Alfortville
13.01.2026 à 11:45
Détruire tout: Ce que dit le lauréat Bernard Bourrit
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1209 mots)
Lundi 10 novembre 2025, l'écrivain Bernard Bourrit recevait le prix Wepler-Fondation La poste pour son livre Détruire tout (éditions Inculte). A cette occasion, comme il est de coutume, il a prononcé un bref discours lors de la remise du prix. Le voici dans sa (presque) intégralité.

Bonsoir à toutes et à tous, Je ne serai pas long. C’est une expérience vraiment étrange et déconcertante pour moi de me tenir ici devant vous afin de recevoir ce prix. J’étais loin de me figurer en commençant à écrire Détruire tout que mon livre susciterait un quelconque intérêt au-delà du cercle confidentiel de lecteurs auquel j’étais habitué. Alors, tout d’abord, je tiens à exprimer ma joie. L’immense joie que j’éprouve à voir mon ouvrage mis en lumière. Il y a derrière cet honneur que vous me faites ce soir un long chemin d’écriture tracé le plus souvent dans l’ombre et l’indifférence. Et cette joie, je voudrais la partager avec celles et ceux qui l’ont rendue possible. Je remercie donc chaleureusement l’ensemble des membres du jury qui a eu le courage de choisir un livre iconoclaste. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux éditions Actes Sud et à mon éditeur, ici présent, Claro […].
Si j’ai commencé en vous disant que c’était une expérience déconcertante de m’exprimer devant vous, c’est que, de toute ma vie, jamais je n’ai attendu un quelconque avantage pour mon travail d’écrivain. Pas plus que je n’ai cherché à me mettre en évidence, ou encore à parler à la place de mes textes. Pour moi, un texte s’exprime toujours mieux que son auteur ; et c’est l’inverse qui me paraît problématique. C’est donc l’occasion de rappeler que Détruire tout est entièrement fait de la voix des autres. En m’immergeant longuement dans les archives pour reconstituer le féminicide qui constitue le cœur et le nœud de mon livre, je voulais surtout, et d’abord, faire résonner au présent les voix du passé. Des voix qui précisément n’étaient pas celles de l’auteur. C’est à force de me demander comment m’y prendre pour ouvrir le récit à sens unique qu’avait produit la presse de l’époque que la réponse s’est imposée d’elle-même : en multipliant les échos et les points de vue, quitte pour cela à faire sauter le cadre de la représentation. C’est l’histoire du joujou cher à Baudelaire, comme un enfant, j’ai entrouvert la mécanique de ce fait divers, et je l’ai secouée à la recherche de son âme. Évidemment, je ne l’ai pas trouvée.
Je voudrais conclure en partageant avec vous une dernière pensée qui m’est venue récemment en songeant à mon livre. Détruire tout a été écrit dans une perspective féministe, c’est indéniable. Toutefois, il ne s’attaque pas frontalement aux structures patriarcales. Il s’attaque à la société des « pères » : c’est une distinction subtile peut-être, mais importante à mes yeux, et qui légitime mon geste d’écriture, car, si je ne suis pas une femme, je suis au moins un fils. Ce glissement (du patriarcat au père, de la structure à la figure) ne fonctionne que si l’on accepte de désaxer le centre de gravité du mot « père ». Si l’on accepte l’idée que quiconque revendique un territoire où exercer sa force mérite ce titre. Si l’on accepte l’idée que le propre d’un territoire, parce qu’il institue un « tout », c’est d’exclure. Cela posé, nous cherchons tous, et toujours, mes personnages, vous et moi, à occuper une place et à jouer un rôle dans le maillage de ces territoires qui s’enchevêtrent. C’est-à-dire trouver à exister dans l’exclusion que ces territoires fabriquent. Que ce soit dans la résignation, la révolte, la liberté ou la violence. Sous cet angle, on le voit, c’est une autre histoire qui commence de se raconter. Mais assez parlé. Merci à tout le jury ! Merci à la Fondation La Poste ! Merci pour ce précieux encouragement ! Merci à la brasserie Wepler !
Claro, le 13/01/2026
Bernard Bourrit, Discours de réception pour le prix attribué à Détruire Tout, éditions Inculte
13.01.2026 à 11:20
“Mon envie d’histoire se passe dans l’image.” Interview de Fanny Michaëlis pour “Et c’est ainsi que je suis née”
L'Autre Quotidien

Texte intégral (7954 mots)
Cela faisait presque 10 ans que Fanny Michaëlis n’avait pas publié de nouveau livre, mais restait très active avec de grands projets d’illustrations (affiches pour le Festival de la BD d’Angoulême, le Centre Pompidou), des affiches, des concerts et en 2025 elle revient avec Et c’est ainsi que je suis née, un album qui débute avec les aspects du conte pour pour proposer un regard et ouvrir des pistes de réflexion sur la violence de notre époque.

Comme dans ses albums précédents Fanny Michaëlis ouvre son nouveau livre avec une image forte, énigmatique et symbolique pour accompagner l’évolution de ce personnage retroussé et sa découverte du monde. Ce portrait atypique va nous entraîner dans une lecture qui semble avoir tout de la fable et qui se révèle bien ancré dans notre réalité. Traitant de la violence, de l’exclusion, du racisme, de la démagogie ; cet album propose des pistes de réflexion à travers cette héroïne inversée qui incarne aussi bien les individus qui se questionnent, qui cherchent une place que le corps social qui s’organise, qui résiste et qui lutte.
Une lecture poétique et politique servie par un dessin méticuleux et vif, qui alterne entre un trait porté par les lignes droites qui découpent les planches, influencent le découpage et des pages plus charbonneuses, chargées qui occupent tout l’espace. Le découpage est intimement lié au dessin ici et certaines symboliques se dessinent à la fois dans le dessin et les cadrages dans un noir & blanc tout aux crayons.
Rencontre avec l’autrice pour en savoir plus sur ce travail graphique, sur son rapport aux images, mais aussi pour évoquer les thématiques de l’album.

Photo de l’autrice / Creative Commons Éditions-cornélius
Ce livre commence sur une image très forte, avec cette glotte qui forme la tête, le buste du personnage, avec une symbolique de la bouche omniprésente, l’idée du livre est venue de cette image ?
Fanny Michaëlis : Oui, tout à fait. La première idée est venue de cette image du personnage retroussé, avec cette tête à l’envers. Et c’est souvent que ça se passe comme ça, pour moi : j’ai une image en tête, souvent avec une phrase, « le mot et l’image » précisément ce qui structure la bande dessinée en tant que médium.
En l’occurrence, cette phrase, c’était le titre. Je ne me disais pas forcément que ce serait le titre au départ, mais cette phrase est venue, associée à cette image de personnage la tête à l’envers ; et les séquences d’avant puis d’après, se sont construites autour de cette image pivot.
Je voulais la positionner avec cet archétype du « papa / maman / enfant » et ce père dont la bouche est invisible — entravée d’une grande barbe— et cette mère toute gueule ouverte puis ce zoom qui conduit à cette à cette figure retroussée.
C’est le même processus pour tous tes livres ?
F.M. : Pas pour tous mes livres, mais c’est exactement comme ça que ça s’est passé pour Avant mon père aussi était un enfant mon tout premier livre qui est paru en 2011 chez Cornelius.
À l’époque, je travaillais dans une fondation où je surveillais une expo et j’avais pas mal de temps « vide » où je travaillais dans un carnet. J’avais noté cette phrase : « Avant mon père aussi était un enfant » et j’avais fait un dessin qui est la première case de la BD. Ce n’est pas systématique, mais c’est vrai que c’est souvent une association d’idées qui lance le récit.
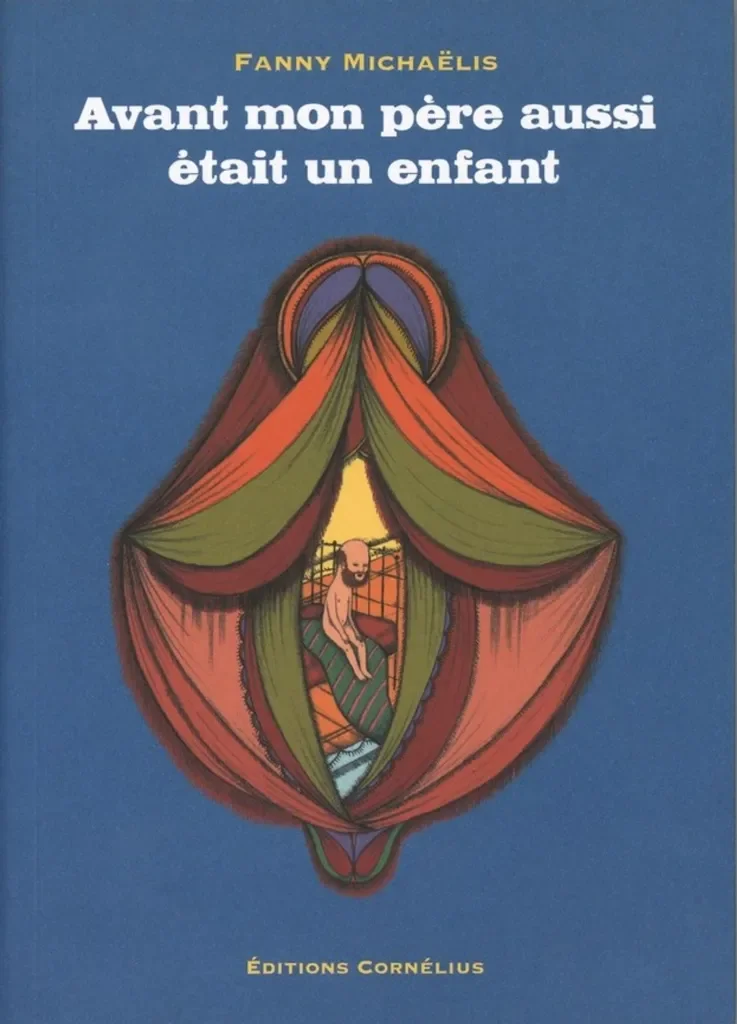
Il y a l’aspect conte qui est très fort au début, et puis ça glisse vers quelque chose de plus tangible, on va dire, pour nous…
F.M. : C’est aussi parce qu’il y a une part d’improvisation, je n’écris pas de scénario en amont.
Ce « papa / maman » qui sont aussi un peu le bûcheron et la bûcheronne d’Hansel et Gretel pourrait être, effectivement, des figures très proches du conte. Mais elles peuvent également être référencées dans un schéma de récit initiatique qui se révèle introspectif avec une voix off— presque comme dans Alice au pays des merveilles.
C’était aussi l’idée que ça conduise à un récit plus collectif, je n’avais pas envie de m’arrêter à raconter seulement l’histoire de cette jeune femme. L’idée de départ était comment sa tête va se soulever ?
Même moi, je suis spectatrice de la machine narrative : comment elle va se soulever ? Je ne sais pas forcément, je n’ai pas d’idée préconçue. C’est vraiment en dessinant et en écrivant que l’histoire se structure.
Avec cette écriture qui part de l’improvisation, est-ce que parfois tu dois reprendre des pages pour mieux coller à la suite du récit qui a évolué ?
F.M. : Ça m’est arrivé, dans mes précédents livres, d’avoir une écriture en aller-retour, mais pas sur celui-là.
J’ai mis du temps à trouver la forme et j’avais beaucoup d’interruptions —parce que je faisais des illustrations— et j’y suis allée pas à pas, et ça s’est construit dans la chronologie. Je ne suis pas vraiment revenue en arrière, seulement à la fin, lors du travail avec mon éditrice, Angèle Pacary, où on a réglé des détails sur quelques planches.
L’histoire s’est vraiment écrite dans une chronologie malgré le fait de l’avoir dessinée et écrite dans un temps assez long, sur plusieurs années, ce qui a fait qu’à chaque fois que j’ai repris le travail je n’étais pas dans la même disposition —pas forcément la tête à l’envers— mais à chaque fois avec de nouvelles questions.
Je savais qu’il y avait des choses que j’avais envie de raconter, mais comment ? Et à chaque fois que je reprenais, ça se précisait. Ce n’était pas évident de s’interrompre, ce n’était pas idéal comme manière de fonctionner, mais ce n’était pas une mauvaise chose.
J’espère que je ne ferai pas mon prochain livre comme ça, mais, en même temps, il y a des livres qui ont une temporalité différente, qu’on doit associer au moment présent. Ça a du sens.
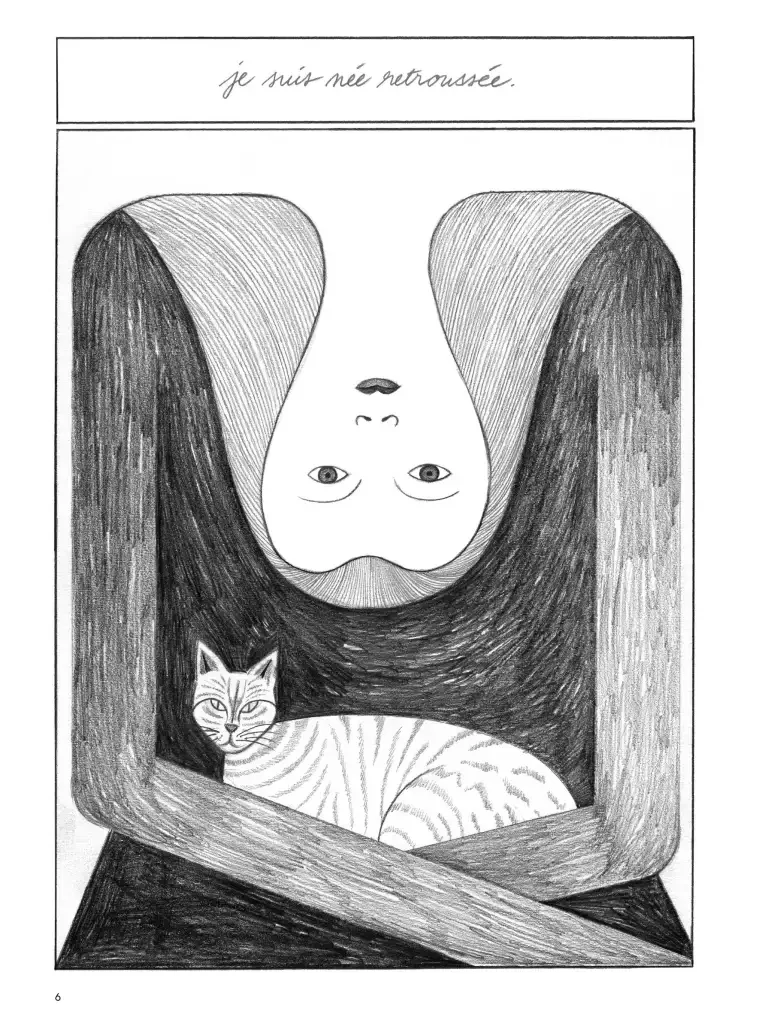
Par rapport à ta méthode de travail où l’improvisation à une bonne place, à quel moment tu fixes à la fin ?
F.M.: Plus j’avance, plus je sais ce que je veux dire [rires] les choses se précisent un peu. On est un peu sur un fil quand on travaille comme ça, c’est aussi par chance qu’on y arrive parce qu’on peut se perdre en chemin.
Mais je crois aussi au fait de composer des scènes qu’on a en tête et qu’on veut très fort raconter ; à l’intuition qui fait que d’une phrase on commence un récit.
Quelque part, « Et c’est ainsi que je suis née », c’est une phrase de conclusion, ça pourrait être la dernière page d’une histoire. Pourtant, c’était le début pour moi. Et de voir comment cette tête va sortir et comment cette question est résolue en 10 pages, je me rends compte qu’il ne s’agissait pas que de raconter cette naissance-là. Pas que celle-là.
J’ai emmagasiné des observations —sur l’aéroport parce que j’y ai un peu travaillé ou sur les situations de personnes étrangères via une association dont je suis proche, où je me suis retrouvée au contact de personnes dans des situations d’une grande violence — mais aussi des réflexions sur la politique actuelle, française ou internationale, sur la précarisation qui me révoltent. C’est aussi ces paliers-là que je voulais partager dans ce livre.
De la même manière que je me questionne personnellement sur comment on peut vivre dans un monde aussi insupportable de violence, où on assiste en ce moment à une radicalisation des idées d’extrême droite combinée à un capitalisme qui ne semble pas montrer de signe de faiblesse, ou qui s’adosse à des démocraties qui n’en sont plus… ces questions je me les pose tout au long du récit.
Et ce récit-là, qui est circonscrit —qui ne m’informe pas sur la manière dont ça peut se passer dans notre monde— me permet de sublimer cette question ou en tout cas, de lui donner du corps.
Il y avait des choses très importantes dans cette espèce de théâtre qu’est l’aéroport. De montrer à la fois le rapport au travail, les inégalités d’existence et d’inviter aussi les lectrices et les lecteurs à se poser la question de cet imaginaire collectif autour de ce lieu. Un lieu qui est à la fois perçu comme un lieu de liberté, de progrès, de modernité, de rêve et en même temps, qui est comme un symbole ou s’incarnent les problématiques systémiques, sociales, écologiques qui traversent l’ensemble de nos sociétés…
Il y a une scène d’expulsion avec une femme et son enfant qui sont obligés de quitter le territoire, et cette question rebondit sur le corps du personnage principal.
Ce personnage, qui n’a pas un corps adapté va tenter de s’émanciper, c’est un livre qui a les aspects du conte, mais qui est très ancré dans le présent…
F.M. : J’ai envie de parler de choses très concrètes. C’était déjà le cas dans certains de mes autres livres, mais le rapport à la fiction permet une souplesse et un jeu vis-à-vis d’un réel que je ne pourrais pas aborder d’une manière purement documentaire. Mais ce n’est pas tellement volontaire, c’est juste comme ça que je le vois.
Il s’agit d’inviter ce réel, quelque part, dans une machine qui le rend archétypal avec ce léger décalage qui fait que ça n’est pas contextualisé. Il n’y a pas tellement besoin d’associer l’aéroport à Roissy par exemple, ça reste des archétypes qui interpellent l’imaginaire collectif des lectrices et des lecteurs sur lesquels on peut projeter ce qu’on veut, d’une certaine manière.
Avec une écriture poétique qui n’est pas là pour adoucir les choses, mais invite plutôt à cet imaginaire très concret, qui parle du monde du travail et de questions sociales, très crues.
Dans tes livres, il est question de transmission, héritage, atavisme, ce sont des thématiques qui s’imposent, peu importe le sujet, ou tu y réfléchis en amont ?
F.M. : C’est en moi. Ce n’est pas forcément des choses dont j’ai envie de parler. Par exemple dans Le Lait noir qui parle d’exil, c’est mon livre le plus personnel dans le sens où ça implique une histoire familiale même s’il y a de la fiction et un décalage.
C’est important que ce soit décollé du passé pour pouvoir résonner dans le présent. Quand on voit ce qui se passe actuellement, à Gaza par exemple, on voit que ça réactive ces questions, et on voit que ce n’est pas en les figeant dans le temps qu’on peut mieux les penser. L’histoire est très importante, mais je ne suis pas historienne, ce n’est pas mon enjeu. Et je n’avais pas non plus envie d’en faire une histoire psychanalytique même si ça m’intéresse beaucoup et qu’à titre personnel ça m’enrichit.
Dans Le Lait noir, il y a des personnages qui n’ont pas d’histoire ou dont l’histoire est absolument méprisée, ils n’ont pas de consistance pour le monde dans lequel ils sont reçus : eh bien cette grand-mère, c’est un peu l’incarnation de cette mémoire-là. De cette nostalgie, peut-être, et de cet attachement affectif à un ailleurs qui est en nous mais qui nous échappe, qui est peut-être perdu, mais qui est certainement un bien commun parce qu’on a tous cette idée-là qu’on vient de quelque part —et c’est toujours une quête.
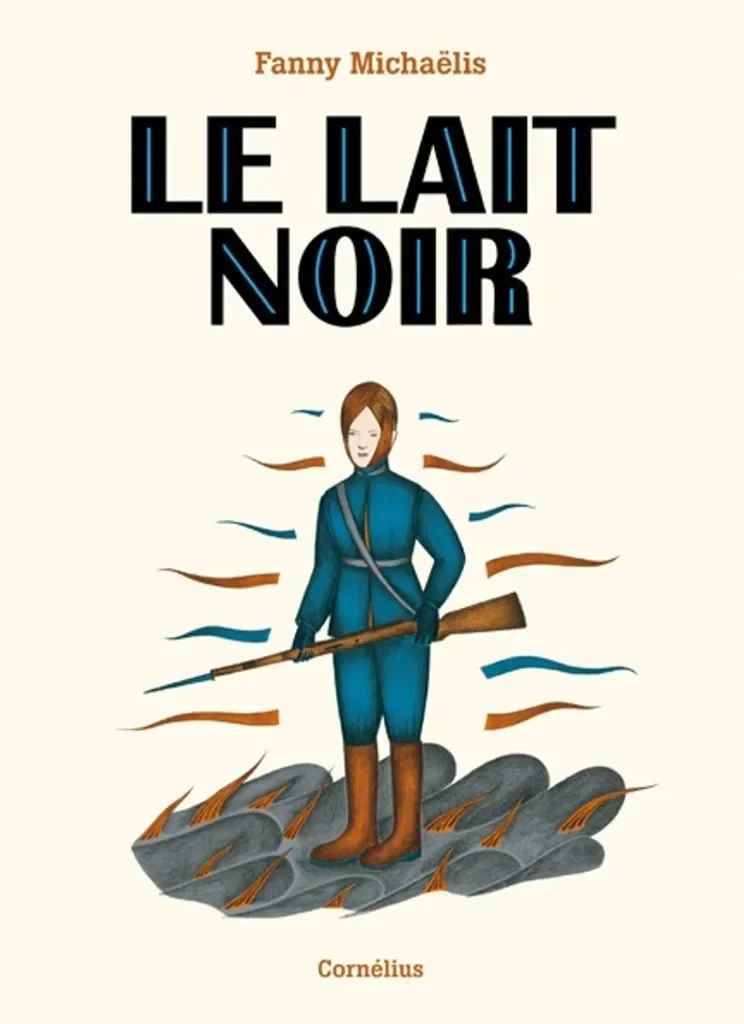
Sur la couverture d’Et c’est ainsi que je suis née, où on peut voir à la fois la position d’un accouchement, à la fois une attitude guerrière, avec d’autres couches de lecture, le côté Gulliver, la foule des sans têtes… comment tu l’as trouvée, est-ce qu’il y a eu beaucoup d’itérations ?
F.M.: Je pense que pour toutes les autrices et les auteurs, la couverture, c’est vraiment un moment pénible. Parce qu’à la fois, il faut inviter à la lecture, laisser les choses ouvertes et en même temps, ne pas tout dévoiler.
Je l’ai faite vraiment à la fin, une fois que j’avais terminé le bouquin, mais c’est venu assez vite. J’avais l’idée qu’il fallait que quelque chose de cet « à l’envers » soit présent —la couverture est à l’envers, mais c’est le cadrage qui veut ça— et en même temps que ça fasse référence au début du livre et à la fin du livre, sans trop en dévoiler.
Comme tu dis, elle est dans une attitude guerrière —ou en tout cas de lutte— et en même temps, traversée par une faille qu’on pourrait imaginer comme une blessure, mais qui dévoile l’idée qu’il ne s’agit pas que d’un corps individuel : ce corps est habité, et cette blessure laisse la possibilité de quelque chose de collectif. Elle n’est pas seule à avoir cette arme en main, ils sont des centaines.
C’est à la fois très frontal —avec le regard vers le lecteur, la lectrice— et en même temps il y a cette idée de profondeur de champ sur l’idée d’un corps qui est à la fois, un corps féminin, un corps individuel, mais aussi un corps collectif.
Par le jeu de la typo, le Je se retrouve souligné par l’accent de née, et justement l’héroïne n’a pas de nom, elle est Je, il y a des variations de visages pour cette jeune femme, comme pour justement incarner tous ces destins. C’est aussi une histoire qui parle de la force du collectif face à cette pression du capitalisme, il y avait une volonté de pouvoir se projeter ?
F.M. : Le personnage principal, qui n’a pas de nom, est un peu comme une chambre d’écho effectivement. Elle est à la fois cette espèce de regard qui se pose sur le monde et sur lequel, le réel rebondit —c’est sa vision des choses.
C’est porté par une voix off —sa voix intérieure— et en même temps, il y a des allers-retours avec des scènes hyper concrètes, très dialoguées. Sans dévoiler la dramaturgie, son corps, son regard sont impliqués de telle manière qu’effectivement ils sont l’écho de toutes ces problématiques de domination, ces questions d’inégalité d’existence, de machine à détruire et invisibiliser…
Il y a une interrogation sur une forme de système et il s’agit à la fois d’un personnage qui a une structure individuelle, mais, en même temps, qui est là pour porter ou interroger la question d’une voix collective, d’un soulèvement collectif. D’incarner ces accumulations de violence et de questionner quel est le déclencheur qui fait que ça explose à un moment donné.
Une langue commune doit se former pour pouvoir inventer autre chose —autre chose, que je ne propose pas dans le livre, c’est vraiment un hors-champ— comment cette langue va se construire ?
C’est une vraie question qui reste en suspens, même si j’avais des exemples concrets. Il y a des organisations communes, de lutte et de solidarité qui existent et qui peuvent être des propositions, mais dans le livre, ça reste une question ouverte.
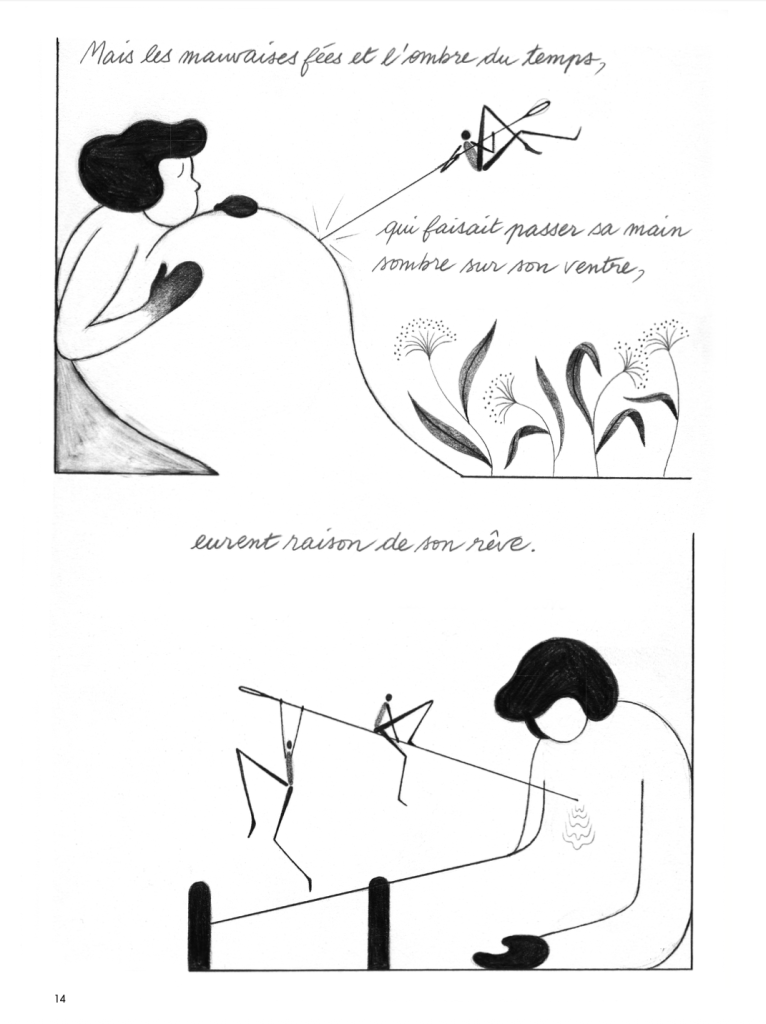
Il y a cette idée de renversement, « l’endroit était pour moi l’envers » dit la jeune fille, ça résonne beaucoup avec ce renversement du sens, de l’appauvrissement du langage par les politiques depuis la première ère Trump…
F.M. : La question politique par rapport au langage, à la vérité, au sens (ou au non-sens) elle se pose effectivement et elle se fait l’écho de ces premières planches.
Par la suite, cette confrontation s’incarne dans la ville et parce qu’elle décide de s’arracher à quelque chose, elle se jette dans le monde avec une telle violence que quelque chose se produit —qui n’est pas toujours heureux, mais qui n’est pas non plus dramatique— et qui peut faire écho à des choses qu’on a toutes et tous, vécues, qui font partie de la vie.
Mais à ce moment précis du récit, on est encore dans quelque chose qui pose un personnage en marge de sa propre parole, de son propre langage. Et qui, par un jeu graphique, se formule de telle manière que l’on comprend qu’elle est à côté. À côté d’une possibilité relationnelle avec le réel, avec les gens, avec les autres.
Parce que sa propre parole ne peut pas se produire dans le monde —avec ce jeu par rapport au père,à la mère, à ce petit théâtre familial— et que quelque part elle-même en souffre. Elle souffre de ce regard inversé, ou de sa disposition corporelle qui ne lui permet pas d’être dans une forme de norme.
C’est une question d’adaptation. Là, clairement, le personnage se pose d’emblée comme inadapté. Elle est inadaptée, mais cette disposition qui pourrait apparaître comme une forme de handicap ou d’absence de compétence pour vivre, lui donne finalement une compétence : celle d’un regard porté sur le monde et de pouvoir participer d’un soulèvement nécessaire, face à cet ordre systémique est insupportable.
Il y a une planche où elle dit qu’elle n’est pas malheureuse et que le fait d’être en creux, quelque part, lui permet d’être habitée par toute chose. On pourrait parler d’empathie ou d’hypersensibilité, qui peut être vécue comme un handicap, une forme d’inadaptation et cette non-compétence se renverse.
Dans ton travail en général, il y a ces jeux avec les expressions ou métaphores parfois prises au pied de la lettre qui donnent un côté poétique ou décalé, le dessin met en lumière l’importance de la langue ?
F.M. : Pour ce livre-là, la question de l’écriture a été moins complexe à aborder que dans les précédents, qui sont quasiment sans texte. Il n’y en a pas énormément dans celui-là non plus, mais il a de l’importance. Je le travaille en tant que tel, à part.
Mais par rapport à ce que tu dis, c’est vrai qu’il y a un langage dans le dessin et le dessin me permet vraiment de parler. Et inversement le texte peut permettre de créer des images et ce jeu-là m’intéresse.
C’est pour ça que je me sens à ma place dans la bande dessinée, parce que le récit et la séquence permettent de parler et l’écriture vient rebondir, enrichir quelque chose. Mais mon envie d’histoire se passe dans l’image.

Et ce texte te permet de décaler un peu l’interprétation ? De créer une dualité ?
F.M. : J’ai essayé d’enlever les choses redondantes pour faire respirer au maximum la partie dessin. Et le fait que je me pose pas de contrainte en termes de représentation me permet d’être libre de faire une pleine page ou quelque chose qui peut-être se rapproche plus de l’illustration, voir de quelque chose de plus pictural ou de plus abstrait… qu’il y ait quelque chose de sensible qui passe par le dessin, la matière, et qui ne soit pas forcément nommé.
C’est très sujet à l’interprétation des lectrices et des lecteurs. Il y a une zone qui peut perturber, avec une libre interprétation sur certaines pages, notamment les scènes sexuelles qui ne sont pas représentées, mais plutôt soulignées.
Comment travailles-tu, quels sont tes outils ?
F.M. : C’est du crayon, du crayon 3H à 10B —c’est une gamme de crayons avec des crayons très noirs et des crayons beaucoup plus clairs— et une gomme, une règle et du papier. C’est assez rudimentaire, il n’y a pas tellement d’outils, mais ce sont des outils qui me vont très bien parce que je trouve qu’on peut faire beaucoup de choses avec.
Peut-être que je me lasserai, mais le crayon permet beaucoup de choses : aller de la matière à la représentation. Être dans le plaisir de chercher des formes et des matières qui ne sont pas uniquement de la figuration, mais qui donnent du corps au dessin.
Et aussi, je voulais parler de couleur, parce que tu parles du noir & blanc là, mais dans Une Île, tu as une palette très colorée avec des jeux de superposition, des motifs ; tu as fait aussi les couleurs d’Epiphania deLudovic Debeurme avec un côté très pictural, il y a du modelé, des couleurs peu courantes…
F.M. : J’adore les couleurs et l’illustration de commande pour la presse ou l’édition m’a vraiment permis de découvrir ou de redécouvrir —parce que j’ai fait de la peinture avant de faire de la bande dessinée— que j’aimais vraiment la couleur. Et que je pouvais l’utiliser avec tout le plaisir que ça comporte.
Pour Epiphania, la trilogie de Ludovic Debeurme, on a réfléchi ensemble puis j’ai travaillé de mon côté et Ludovic est ré-intervenu sur des choses et c’était passionnant de pouvoir travailler en se posant la question des références, en cherchant des atmosphères aussi longtemps.
Mais pour un projet de narration personnelle, ça ne s’impose pas du tout. C’est-à-dire que ça serait vraiment aller du côté d’une surcharge illustrative que je ne désire pas. Pour un projet comme Et c’est ainsi que je suis née, la couleur serait vraiment superflue parce que je n’ai pas pensé les dessins comme ça.
Je ne me suis autorisée la couleur que sur la couverture parce que le livre est un objet, il faut lui donner une peau, un corps et une carnation au sens propre. Ça ne me semblait pas un non-sens, même si on pourrait se questionner : c’est un livre en noir & blanc, du coup, c’est un peu bizarre de mettre la couverture en couleur, mais j’aime bien cette friction quelque part.
Mais peut-être que le jour viendra où j’aurai envie de faire de la bande dessinée en couleur, et ça aura du sens. J’ai essayé, j’ai eu des débuts de projets, mais qui n’étaient pas du tout convaincants.
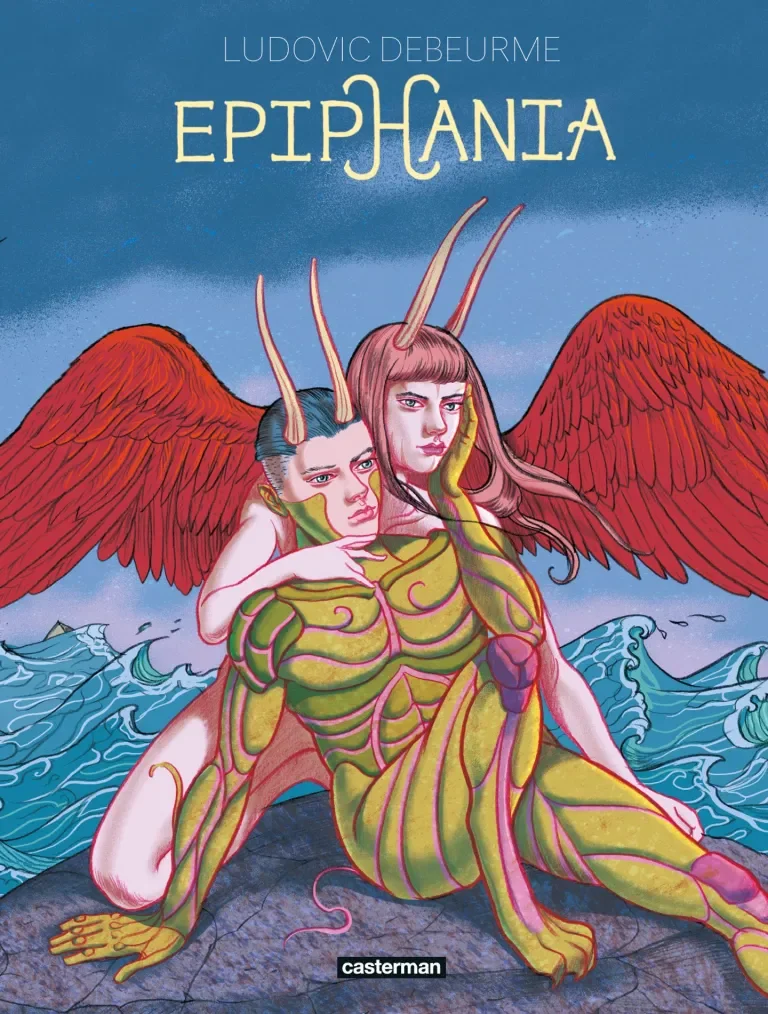
Tu fais de la bande dessinée, de l’illustration, et tu parlais de peinture tout à l’heure, je voulais savoir est-ce que tu pratiques aussi le carnet de croquis ?
F.M.: Pas trop. J’ai fait une école de BD à Saint-Luc à Bruxelles, et à l’époque, on dessinait beaucoup sur le motif, tout le monde avait des carnets de croquis, moi aussi. Mais je ne croque pas les gens, je dessine rarement dans le métro, mais ça ne m’empêche pas de collectionner des impressions, des images —peut-être que je me fais trop confiance— mais l’idée de les imprimer dans ma tête et de m’en servir après, au moment, le moment venu, c’est plus ma manière de faire.
Dans mes carnets je note des idées, du texte ou des images qui s’associent ou qui viennent, mais je n’ai pas cette pratique, presque musculaire, du dessin. J’aimerais bien, mais ce n’est pas très intéressant quand je le fais [rires] donc je ne suis pas convaincue.
Je te demandais ça aussi, parce que dans ce livre il y a des traits très géométriques pour dessiner les personnages, à la règle, c’était une envie graphique ?
F.M.: Dans mes illustrations pour la presse ou pour les livres, ce sont des outils que j’utilise souvent. Mais le fait d’avoir beaucoup d’illustrations ces dernières années et d’avoir moins fait de bandes dessinées —je n’avais pas sorti de bande dessinée depuis Le Lait noir, donc ça fait presque 10 ans— ça a invité dans ma pratique d’autres outils. Des outils qui ne sont pas des outils de ouf, mais qui donnent au dessin cette tension entre des recherches de matière —avec un côté pictural— et en même temps, quelque chose de très dessiné —presque constructiviste.
Il faut laisser parler ses affections pour certaines choses —je pense à Fernand Léger— mais aussi ne pas se brimer donc, il y a des coups à la règle —la ville est comme une machine, qui correspond presque plus à celle du 19e siècle qu’aux villes actuelles. C’est aussi un plaisir de dessinatrice.
On a vu ça sur ton affiche pour la BD à tous les étages au Centre Pompidou, c’était très à la règle et on se dit qu’il a une suite.
F.M.: Oui, c’est exactement ça, le fait de m’être tellement concentré sur certaines images très longtemps —typiquement cette affiche— et de pousser crayonné, réintervenir… Il n’a pas eu tellement de modifications, mais il fallait penser les choses longtemps pour que le trait soit bien. C’était un peu stressant. Et puis le Centre Pompidou il fallait le représenter quelque part donc, c’était difficile de contourner la question de la règle [rires].
Le fait de s’attarder longtemps sur une image m’a aussi fait revenir différemment à la bande dessinée, avec une envie de composer les planches dans leur entièreté et de vraiment m’y attarder. Et du coup, j’ai été assez lente parce que j’ai passé du temps sur certaines planches que j’ai vraiment pensé comme des petits tableaux —il y a des planches qui m’ont pris moins de temps que d’autres— mais j’ai traîné dessus [rires].
J’espère mettre moins de temps pour le prochain album, je travaille sur un projet sur lequel j’aimerais moins avoir à m’interrompe systématiquement pour aller jusqu’au bout, mais encore une fois je serais allée plus vite ça aurait été moins pénible, mais ça n’aurait pas laissé mûrir les choses je n’aurais peut-être pas trouvé la fin, peut-être que je me serais perdue en route, j’en sais rien.
Finalement, je ne regrette pas, mais « stratégiquement » [rires] je préférerais mettre moins de temps pour la prochaine.
En complément de cette lecture d’Et c’est ainsi que je suis née, je vous conseille d’explorer ses autres livres—Avant mon père aussi était un enfant, Géante, Le Lait noir— mais aussi de découvrir ses illustrations en couleurs récentes dans Ce que disent les rêves, où elle illustre les contes de Muriel Bloch, ou dans ses livres jeunesse : Une île et Dans mon ventre.
Thomas Mourier, le 13/01/2026
Fanny Michaëlis - Et c’est ainsi que je suis née - Casterman
-> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués.

12.01.2026 à 18:45
Apprendre à regarder autrement avec Gehrard Richter
L'Autre Quotidien

Texte intégral (11943 mots)
La leçon de Richter est peut-être celle-ci : toute image est fragile, toute mémoire est incertaine, mais l’art, lorsqu’il accepte cette fragilité, peut encore nous apprendre à regarder autrement. D’où l’importance d’aller voir, avant sa fermeture le 2 mars 2026, la formidable rétrospective de 50 années de son travail que propose la Fondation Louis Vuitton.

© Gerhard Richter
Gerhard Richter est né en 1932 à Dresde, dans une Allemagne en plein basculement. Enfant du nazisme, adolescent dans l’Allemagne de l’Est communiste, il grandit dans un pays marqué par la propagande, la surveillance et la reconstruction d’après-guerre. Il est formé à l’Académie des Beaux-Arts de Dresde, où l’enseignement repose sur le réalisme socialiste, imposé par le régime.
En 1961, quelques mois avant la construction du mur de Berlin, Richter décide de fuir et passe à l’Ouest. Ce changement radical (passer d’un système idéologique à un autre) le marque profondément. Il découvre alors la liberté artistique de Düsseldorf : l’abstraction américaine, le Pop Art, les expériences conceptuelles… tout ce qui lui avait été interdit en RDA. Cette confrontation brutale entre deux univers visuels opposés crée chez lui une méfiance durable envers toutes les images, qu’elles soient politiques, photographiques ou même picturales.
C’est ce doute qui devient le véritable moteur de son travail. Plutôt que de peindre d’après nature, Richter choisit dès le début de peindre d’après des photographies existantes : des images de journaux, de son album de famille, des archives scientifiques ou historiques. Il les agrandit, les floute, les efface ou les recouvre. Ce geste révèle déjà que toute image est une construction, un filtre, une distance.
Tout au long de sa carrière, cette tension entre réalité et fiction, mémoire et effacement, figuration, abstraction et technologie revient sans cesse. Richter n’a jamais cessé de tester les limites de la peinture : il transforme des photographies, il peint des crimes en les rendant étrangement décoratifs, il crée des panneaux de verre qui reflètent le monde au lieu de le représenter, il explore l’abstraction systématique, puis les images numériques et scientifiques.
À chaque étape, on a l’impression qu’il reformule la même question : qu’est-ce qu’une image ? Et que peut encore la peinture à une époque saturée d’écrans et de photographies ? Ce sont les questions, dont il fut parmi les premiers artistes à réaliser toute l’importance, et qui sont devenues aujourd’hui d’une actualité brûlante avec l’essor des nouvelles technologies de fabrication et de diffusion des images, qu’aborde l’exposition rétrospective de son oeuvre organisée par la fondation Louis Vuitton.
Exceptionnelle par son ampleur : cette exposition réunit plus de 275 œuvres, couvrant plus de soixante ans de création, de 1962 à 2024. On y trouve des peintures, des dessins, des aquarelles, des sculptures, des œuvres sur verre, mais aussi des photographies peintes et des documents préparatoires. C’est l’une des rétrospectives les plus complètes jamais organisées sur Richter, et elle offre un terrain idéal pour comprendre sa manière singulière de travailler avec les images. Cette interrogation traverse l’ensemble de son œuvre, qu’il s’agisse des portraits flous des années 1960, des œuvres liées au terrorisme de la Fraction Armée Rouge, de ses grandes abstractions ou de la série sur les camps de concentration : Birkenau.
En suivant le fil de son parcours, l’exposition commence avec ce qui marque véritablement le début de la carrière de Richter en Allemagne de l’Ouest : les photo-peintures qu’il réalise à partir de 1962, juste après son arrivée à Düsseldorf. Ces premières œuvres montrent que, dès le départ, Richter choisit de travailler non pas d’après le réel direct, mais d’après des images déjà produites par la société. Copier des photographies, ce geste apparemment simple devient le point de départ d’un véritable renversement de la peinture.
De la copie photographique à l’altération du réel
Dans la première galerie, on découvre une série d’images dont les sujets semblent extrêmement ordinaires. Il commence par peindre Tisch (Table), en 1962 qu’il inscrira plus tard comme l’œuvre n°1 de son catalogue raisonné. Ce tableau résume parfaitement le programme de son art. Avant même de peindre, il altère la photographie : il l’efface partiellement au solvant, créant une zone blanche au centre de l’image. Ensuite seulement, il repeint cette photo déjà abîmée. Ce double geste d’effacer et reproduire crée une tension fondamentale : la peinture affirme quelque chose et le nie en même temps. Richter montre ainsi qu’il ne croit plus à l’idée d’une copie fidèle ou transparente : pour lui, toute image est déjà un fragment, une construction, une mémoire trouée. Cet entre-deux deviendra la matrice de toute son œuvre.

Gehrard Richter : Tisch (Table). 1962
Donc dans ce premier ensemble on peut voir que Richter commence par choisir des images banales : une table trouvée dans un magazine, des paysages quelconque, mais aussi (et c’est essentiel) des photographies de sa propre famille, qu’il n’identifie pas encore comme telles.
Dans Familie am Meer ou Onkel Rudi, ces visages lui appartiennent, mais Richter les traite comme n’importe quelle autre image trouvée : des documents visuels, anonymes, déchargés de leur poids affectif. Ce n’est que plus tard qu’il reconnaîtra leur dimension autobiographique.
Parmi ces images figure l’une des œuvres les plus bouleversantes de ses débuts : Tante Marianne (1965). Le tableau montre sa tante tenant le jeune Richter bébé. Derrière cette scène intime se cachent les fractures profondes de l’histoire familiale : Marianne, diagnostiquée schizophrène, fut assassinée par les nazis dans le cadre du programme d’euthanasie (Aktion T4). Son oncle Rudy apparaît sur d’autres images en uniforme SS. Plus tard, en 1957, Richter épousera sans le savoir la fille du médecin SS responsable de l’hôpital où sa tante avait été tuée. Quant à son père, enrôlé malgré lui dans le parti nazi, il perd son emploi après la guerre. Tout cet héritage familial, longtemps refoulé, fait écho à la Vergangenheitsbewältigung, ce travail allemand pour surmonter le passé, un enjeu central chez Richter, même si lui-même, au moment de peindre ces images, refuse encore de les considérer comme autobiographiques.

Gerhard Richter : Tante Marianne. 1965
C’est aussi à cette période, à partir de 1963, qu’apparaît son procédé le plus célèbre : le flou. Richter frotte la peinture encore humide pour brouiller les contours. Le flou n’est pas là pour créer une atmosphère nostalgique : il exprime au contraire une incertitude, presque un aveu d’échec volontaire. Il marque la distance entre la photo brute et notre regard, et met en doute la croyance selon laquelle une image, parce qu’elle ressemble au réel, serait plus vraie.
Ce travail de distanciation se radicalise dans Acht Lernschwestern (Huit élèves infirmières), peint en 1966. Richter utilise une coupure de presse montrant huit jeunes femmes assassinées dans un dortoir à Chicago. En isolant ces visages du texte qui relatait le drame, il transforme un fait divers tragique en une image sérielle qui rappelle le Pop Art d’Andy Warhol, un artiste qu’il admire. Mais contrairement à Warhol, Richter rejette toute forme de spectaculaire. Le flou efface les détails, atténue la violence directe, et révèle comment les images de presse peuvent banaliser même les événements les plus atroces. Le tableau met au jour notre fascination collective pour le crime, tout en soulignant l’éthique fragile de la représentation. À partir du milieu des années 60, Richter commence aussi à s’intéresser à d’autres types d’images, mais avant d’aborder ces paysages urbains, l’exposition montre un premier déplacement important dans son travail : l’entrée dans l’espace réel.

Gerhard Richter : Acht Lernschwestern (Huit élèves infirmières). 1966
En 1967, il réalise 4 Glasscheiben (4 panneaux de verre), une œuvre composée de quatre grandes plaques de verre transparentes montées sur une structure métallique. Ici, il ne peint plus rien : il crée un objet. Ces vitres ne montrent rien, ne protègent rien. Elles reflètent l’environnement, dédoublent les visiteurs et transforment la perception de l’espace. On reconnaît l’influence du minimalisme, mais le questionnement reste le même : qu’est-ce qu’une image, si elle ne sert plus à figurer, mais à filtrer le réel ?
L’année suivante, en 1968, ce déplacement s’accompagne d’un élargissement des sujets. Avec Stadtbild D (Paysage urbain D), il part d’une photographie de ville et adopte pour la première fois un style plus cru, presque expressionniste. La ville apparaît fragmentée, comme frappée par une violence sourde. On peut y lire l’ombre des villes détruites de la Seconde Guerre mondiale qu’il a vues enfant. Sans illustrer explicitement la guerre, Richter laisse la mémoire collective affleurer à travers une simple image de rue. Cela devient une constante chez lui : le passé surgit non pas par narration, mais par résonance.
Enfin, en 1971, Richter aborde la sculpture figurative de manière exceptionnelle dans son parcours avec Zwei Skulpturen für einen Raum von Palermo (Deux sculptures pour un espace de Palermo). À la fin des années 1960, il se lie d’une grande amitié avec l’artiste Blinky Palermo, qu’il a rencontré à l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. En 1971, Palermo expose une peinture ocre jaune qui recouvre les quatre murs d’une pièce dans une galerie à Munich. Richter, enthousiaste, lui dit qu’il faudrait « ajouter des sculptures ». Il réalise alors un moulage en plâtre du visage de Palermo, Palermo l’aide à faire le sien, puis Richter modèle le reste des têtes : cheveux, oreilles, arrière du crâne. Sur ces moulages, il applique ensuite une peinture grise grossièrement brossée.
Ce geste brouille les traits, efface les identités, et transforme ces portraits en sortes de présences spectrales. Même en trois dimensions, Richter poursuit le même questionnement : partir d’une empreinte du réel pour la recouvrir, l’altérer, et montrer que toute représentation reste une forme de distance, jamais une présence pure.
C’est précisément à ce moment du parcours que l’exposition introduit un ensemble essentiel : l’Atlas, commencé dès 1964. Ce vaste regroupement de photographies trouvées, images de presse, photos personnelles, esquisses et documents constitue le laboratoire visuel de Richter. L’Atlas accompagne toute sa carrière, révélant comment il collecte, classe et observe les images avant de les transformer. Il fait le lien direct entre les photo-peintures des années 60 et les expérimentations systématiques des années 70.

Cette première partie du parcours montre donc comment Richter part d’un geste presque naïf de copier une photographie pour en faire un véritable outil critique. En modifiant, floutant, détruisant ou recouvrant l’image, il transforme la peinture en un espace de doute. Elle ne sert plus à affirmer la réalité, mais à révéler à quel point toute image la transforme, la réduit ou la déplace. C’est ce rapport complexe entre ce que l’on voit et ce que l’on ne peut plus voir qui définit les débuts de Richter et pose les fondations de tout son futur travail.
Le passage au grand format : entre abstraction, systématisation et monumentalité
Après les premières photo-peintures des années 60, centrées sur l’image, la mémoire et le flou, l’exposition nous fait entrer dans une décennie décisive : les années 1970. À ce moment-là, Richter élargit littéralement son vocabulaire. La peinture devient un champ d’expérimentation, un laboratoire où il peut tester aussi bien les systèmes conceptuels, les grilles de couleurs que les possibilités de l’abstraction. C’est aussi une période où l’avant-garde internationale annonce la “fin de la peinture”. Richter ne s’y oppose pas frontalement, mais il absorbe ces influences pour prouver que la peinture peut encore penser, interroger, se transformer.
En 1972, Richter est invité à représenter l’Allemagne à la Biennale de Venise : c’est son véritable premier pas sur la scène internationale. Pour ce contexte exceptionnel, il choisit d’interagir avec l’architecture néoclassique du pavillon allemand, un bâtiment lourd d’histoire, construit dans les années 1930. Il y installe une frise monumentale de 48 portraits d’hommes célèbres, trouvés dans des dictionnaires et encyclopédies. Aucun choix esthétique ou idéologique précis : les images sont sélectionnées presque au hasard. Ce qui l’intéresse, c’est la manière dont la monumentalité du dispositif crée une égalité visuelle entre ces figures savantes, comme si toutes devenaient interchangeables.
Disposés d’une façon similaire par la fondation Louis Vuitton, ils sont alignés sur les murs, ces portraits forment une sorte de décoration, de citation, ou même de tombeau, qui s’accorde étroitement à l’architecture du pavillon. Pour la première fois, Richter utilise la peinture à une échelle symbolique et publique, dépassant le simple cadre de l’image.

Gerhard Richter : 48 portraits. 1972
Le changement d’échelle : de l’image intime à la peinture publique
Avec les 48 Portraits, Richter expose au spectateur une accumulation d’images, un ensemble riche, presque saturé d’informations. À l’inverse, lorsqu’il commence ses peintures grises au début des années 1970, il adopte une stratégie totalement opposée : réduire la peinture à son strict minimum. Dans ces œuvres monochromes, tout est recouvert de gris. Les tableaux ne se distinguent plus par leur motif inexistant mais par la manière dont la couleur est déposée, on y voit avec l’épaisseur des couches, des gestuelles plus ou moins perceptibles, une variation de texture. C’est alors qu’avec une seule teinte, Richter explore une multitude de nuances possibles.
Le résultat produit une impression d’effacement, d’absence d’expression individuelle. Le gris devient la couleur du neutre, de la retenue, presque de l’impersonnel. Là où 48 Portraits construisait une monumentalité fondée sur la multiplication des images, les Gris instaurent une monumentalité qui repose sur le retrait, sur une présence silencieuse et dépouillée. Cette neutralité devient une forme d’architecture : la peinture cesse d’être un récit ou une imitation, elle devient un lieu. Ce passage au monumental amplifie tout ce qu’il a exploré dans les années 60 : le doute, l’effacement, la distance deviennent littéralement spatiaux.
La peinture comme système : hasard, grilles et répétitions
En parallèle de cette exploration du format, Richter s’engage dans une autre direction, très liée aux courants conceptuels du moment : il met en place des systèmes, des règles, des protocoles. Il cherche à neutraliser la main du peintre, à réduire l’expression personnelle, et à voir ce que devient la peinture lorsque l’artiste s’efface derrière une procédure. Les nuanciers de couleurs, qu’il développe dès 1966 mais qu’il systématise au début des années 70, en sont un exemple essentiel. Dans 1024 Farben (1973), il établit une gamme de couleurs entièrement déterminée, puis les répartit dans une grille où chaque case est attribuée par tirage au sort. Il ne compose plus : il distribue.
La couleur n’est plus une intuition : elle devient un code.
Ces grilles produisent des images vibrantes, presque pré-numériques, comme si Richter anticipait les pixels avant l’ordinateur. Elles montrent comment une peinture peut exister sans composition traditionnelle, sans geste expressif, simplement à partir d’un système. Avec ces œuvres, il prouve que la peinture peut devenir une structure objective, mais rester profondément visuelle.

Gerhard Richter : 1024 Farben. 1973.
Mettre en tension photographie, peinture et histoire de l’art
Richter refuse de choisir un langage définitif. Pendant qu’il développe des systèmes abstraits ou des surfaces neutres, il continue à travailler d’après photographie et à dialoguer avec l’histoire de l’art. Cette tension entre photographie, peinture et histoire de l’art apparaît de manière exemplaire dans plusieurs œuvres de la décennie, notamment les 48 Portraits présentés à la Biennale de Venise en 1972, évoqués plus tôt et qui prennent ici toute leur signification. En uniformisant ces images encyclopédiques en noir et blanc, Richter transforme le panthéon culturel occidental en un système visuel, presque en un code, plutôt qu’en une série d’individualités.
Il en va de même avec la série Annonciation d’après Titien (1973). Richter y copie un chef-d’œuvre de la Renaissance à partir d’une simple carte postale. La copie commence fidèlement, puis l’image se brouille, se désagrège, se transforme en variations presque abstraites. Le flou devient la preuve que copier une image ne garantit jamais d’en saisir la vérité. Dans les deux cas, Richter montre que la peinture peut à la fois reprendre des images existantes, les monumentaliser, les détruire partiellement et en faire naître un nouvel espace de sens.

Gehrard Richter : Annonciation d’après Titien. 1973
Une étape décisive : la peinture devient un langage évolutif
Ce qui est frappant dans cette partie du parcours de l’exposition, c’est que Richter n’abandonne rien de ce qui a fait sa force dans les années 60. Il continue de partir d’images existantes, il garde le flou, il maintient une distance critique. Mais en même temps, il élargit tout : l’échelle, les procédures, les variations. La peinture devient un langage évolutif. C’est alors qu’elle n’est plus seulement une image fixée sur une toile, mais un ensemble de possibles, une succession de systèmes, de surfaces, de gestes, de copies et de variations. Elle passe d’un registre à l’autre sans jamais perdre sa cohérence.
Cette décennie des années 70 est donc décisive : elle montre que Richter n’est pas seulement un peintre de l’image, mais un peintre de la pensée, un artiste qui interroge la peinture dans toutes ses dimensions spatiales, historiques, conceptuelles. Et elle prépare directement les années 80, où Richter va faire exploser l’abstraction tout en revenant, paradoxalement, à des images intimes d’une grande douceur, comme les portraits de Betty ou les natures mortes silencieuses.
Les années 1980 : entre monumentalité abstraite et retours intimes
Après les expérimentations conceptuelles et les surfaces systématiques des années 1970, l’exposition nous fait entrer dans les années 1980, qui marquent un nouveau tournant dans la carrière de Richter. À ce moment-là, un nouveau contexte international apparaît : un peu partout, on assiste au “retour de la peinture”. En Allemagne, le mouvement des Nouveaux Fauves (Baselitz, Kiefer, Lüpertz) remet la figure et la matière au centre. Richter, fidèle à son doute fondateur, ne se laisse pas absorber par cette mode, mais il répond à sa manière : en inventant une abstraction d’un genre totalement nouveau, née à la fois du geste, du hasard, de la transformation d’esquisses, et d’un rapport toujours critique à l’image. Au début des années 80, Richter développe ce qui deviendra l’une de ses signatures majeures : les Abstraktes Bild, des peintures abstraites d’une ampleur spectaculaire.

Gerhard Richter : Abstraktes Bild. 1986
Contrairement à l’abstraction expressive américaine, ces œuvres ne sont jamais improvisées. Elles commencent souvent par de petites esquisses au crayon, à l’aquarelle ou à l’huile, que Richter agrandit, transforme, puis attaque littéralement à la raclette, en raclant des couches successives de couleurs.
Ce procédé, qu’il perfectionne à partir de 1984, lui permet de créer des surfaces extrêmement denses, où des strates se révèlent ou disparaissent. Le tableau devient un champ de tensions : entre hasard et contrôle, entre construction et destruction. Ces peintures sont monumentales, parfois de plusieurs mètres, et plongent le spectateur dans un paysage abstrait en perpétuel mouvement.
Richter affirme d’ailleurs : « Le hasard est pour moi un outil, car il permet à la peinture d’être plus intelligente que moi. » Ce dialogue entre maîtrise et imprévu donne naissance à des surfaces denses, vibrantes, en perpétuelle transformation, où le spectateur se trouve immergé dans un paysage abstrait mouvant. Dans l’exposition, ces grands formats occupent des salles entières. Ils affirment une puissance picturale qui naît paradoxalement du doute : plus Richter remet en question la peinture, plus il la rend spectaculaire.
Le parallèle intime : portraits, natures mortes et douceur inattendue
Mais dans ces années 80 de bouillonnement créatif, Richter ne se contente pas de développer une abstraction monumentale.
En parallèle, presque en secret, il revient à des images profondément personnelles :
– des portraits de ses enfants,
– des scènes de famille,
– des natures mortes silencieuses.
Ces œuvres sont d’une finesse incroyable, réalisées à partir de photographies, comme à ses débuts. Elles montrent, à contre-courant de ses grands formats, une fragilité, une tendresse, une intimité. Dans l’exposition, Betty (1988) est sans doute l’un des tableaux les plus saisissants.

Gehrard Richter : Betty. 1988.
Richter y représente sa fille, alors âgée d’environ dix ans, vue de dos, détournant légèrement la tête vers un fond gris. La scène semble presque anodine, mais elle produit un effet très fort : ce n’est pas seulement un portrait, c’est une image sur l’attention, sur l’éloignement, sur la mémoire.
Ce qui frappe immédiatement, c’est le paradoxe : Richter peint sa propre enfant, mais elle nous échappe. Elle ne nous regarde pas, elle regarde ailleurs. Encore une fois, il part d’une photographie familiale, mais il transforme ce cliché intime en un espace de silence, un moment suspendu. Le tableau ne cherche pas à représenter la personnalité de Betty, mais plutôt la distance qui existe dans toute image : quelque chose ou quelqu’un est là, mais ne se laisse jamais saisir complètement.
Richter lui-même a souvent évoqué la manière dont ce tableau entre en résonance avec 18. Oktober 1977, le cycle historique qui le suit immédiatement dans son catalogue raisonné. Il parle d’une coexistence du tragique et du sublime, du politique et du personnel, comme si ces deux œuvres si différentes étaient en réalité deux manières de répondre à un même questionnement sur la fragilité humaine.
Il confie d’ailleurs que « l’art et la beauté sont l’apanage de l’espoir face à une réalité souvent difficile à supporter », la beauté étant pour lui l’opposé direct de la destruction et du désespoir. À travers Betty, ce geste est palpable : derrière la douceur du portrait, il y a une méditation sur la distance, le temps qui passe, l’impossibilité de retenir une image ou un être. Autre image emblématique des années 80 : la série des Kerze (Bougies, 1982, 1983).

Gerhard Richter : Kerze (Bougie). 1982
Richter y met en scène une simple bougie, peinte d’après une photographie, et aborde à travers ce motif le passage du temps, la fragilité de la vie, et même une dimension spirituelle que l’on n’associe pas spontanément à son œuvre.
La flamme, légèrement floue, vacillante, semble presque prête à s’éteindre.
Ce flou, typique de sa technique, n’est pas un effet nostalgique : il crée une distance, comme si cette lumière fragile appartenait à un souvenir qui se dérobe. Richter décline ce motif dans une série d’environ vingt-cinq peintures, réalisées entre 1982 et 1983, qui réinterprètent profondément la tradition des vanités classiques. Il compare d’ailleurs ces tableaux à des rites funéraires : la bougie allumée symbolise à la fois l’adieu, la présence apaisée d’une vie qui s’éteint doucement, et le temps qui s’écoule inexorablement. Comme dans les vanités du 17e siècle, le motif est simple, mais la charge symbolique est immense : tout disparaît, tout passe, et la peinture est là pour en porter la trace.
Ce qui rend ces œuvres particulièrement touchantes, c’est le contraste entre la monumentalité du format, car ce sont souvent de grandes toiles, et l’extrême simplicité du sujet. On y retrouve une attention très fine à la lumière, au quotidien, à la douceur des choses ordinaires, presque à l’opposé de la violence ou de la complexité des grands formats abstraits qui occupent à la même période une grande partie de son énergie.
Cette coexistence entre l’intime et le monumental, entre la douceur et la tension, entre la vie familiale et l’histoire collective, est l’un des traits les plus marquants de l’œuvre de Richter dans les années 80. Elle montre un artiste qui peut tout aborder, du plus personnel au plus politique, sans jamais sacrifier la profondeur ou la nuance.
Quand l’histoire collective s’invite dans la peinture : 18. Oktober 1977
Après avoir évoqué l’intimité lumineuse des Kerze et la douceur silencieuse du portrait de Betty, il peut sembler surprenant de voir Richter se tourner, presque au même moment, vers l’un des sujets les plus sombres et les plus sensibles de l’histoire allemande récente.
Et pourtant, le contraste est volontaire : Richter explique souvent que ces œuvres dialoguent entre elles.
La lumière fragile d’une bougie, le visage détourné d’une enfant, et les images fantomatiques de la Fraction Armée Rouge sont trois manières d’aborder une même question : comment représenter ce que la mémoire ne parvient pas à saisir, qu’il s’agisse d’un moment intime ou d’un traumatisme collectif ?
C’est dans cet esprit qu’il réalise, en 1988, la série 18. Oktober 1977.


Gerhard Richter : 18. Oktober 1977. 1988
Composée de quinze tableaux peints d’après des photographies de presse et de police, elle reprend les images liées à la Fraction Armée Rouge, un groupe terroriste d’extrême gauche actif dans les années 1970. Les tableaux montrent les membres du groupe emprisonnés, certains lors de leur procès, d’autres morts dans leurs cellules le 18 octobre 1977 date officielle de leur suicide, un épisode encore entouré de zones d’ombre.
Cette série marque une étape importante : elle montre que la peinture peut encore affronter l’histoire, mais sans violence, sans pathos, sans spectaculaire. Elle le fait par la distance, par le retrait, par la fragilité de l’image. C’est une réponse très personnelle à la question allemande du rapport au passé.
Une décennie de contrastes : douceur, violence, monumentalité
Ce qui frappe chez Richter dans cette période des années 80, c’est la coexistence de ces registres :
– l’abstraction la plus intense,
– les images intimes les plus fragiles,
– et l’histoire la plus sombre.
Richter ne sépare rien. Il refuse le cloisonnement. Pour lui, la peinture peut tout accueillir : le geste, la copie, la mémoire, l’histoire, l’intime. Dans l’exposition, cette coexistence est très forte : même dans des salles séparées, on perçoit une tension entre les grands formats abstraits, qui débordent littéralement des murs, et ces petites images silencieuses qui retiennent le regard.
Cette tension est la clé des années 80 : c’est une décennie où Richter prouve que la peinture, loin d’être dépassée, peut encore penser, questionner et toucher profondément.
Les années 2000 : verre, couleur, mémoire et transformations du réel
Après les grands cycles abstraits et les œuvres intimes des années 80 et 90, l’exposition nous conduit vers les années 2000, un moment où Richter transforme une nouvelle fois sa pratique. Il s’éloigne progressivement de la toile traditionnelle pour explorer d’autres matériaux, notamment le verre, qui devient l’un des centres de son travail. En même temps, il continue d’interroger l’image, sa matérialité, sa transparence, sa fragmentation et sa place dans la mémoire.
Ce moment marque une nouvelle étape dans son œuvre : la peinture n’est plus seulement un lieu de représentation ou d’expérimentation gestuelle, mais un espace où le réel lui-même est mis à l’épreuve.
Le verre occupe une place essentielle dans la dernière partie du parcours. Depuis les premières expériences menées en 1967 avec les 4 Glasscheiben, Richter s’intéressait déjà à la capacité du verre à transformer la perception. Mais au début des années 2000, le verre devient un médium à part entière.

Gehrard Richter : 6 panneaux verticaux. 2002/2011
Dans des œuvres comme 6 panneaux verticaux ou dans les grands ensembles de panneaux transparents, Richter ne peint plus d’image. Il construit un dispositif perceptif qui reflète, dédouble, fragmente et laisse passer la lumière. Le verre agit aussi comme un filtre qui introduit un flou naturel, un trouble optique. L’œuvre ne représente plus le monde : elle l’absorbe, le déforme et en montre l’instabilité.
Cette démarche prolonge toute sa carrière. Le flou des photo-peintures se manifeste ici non plus par le pinceau, mais par la matière elle-même. Transparence, reflets et opacités partielles deviennent des manières de mettre en doute ce que nous voyons.
Les abstractions tardives : geste, hasard et musique
En parallèle, Richter continue de développer une abstraction très riche, qui n’a plus tout à fait le même statut que dans les années 80. Les grandes toiles à la raclette réalisées autour de 2005 et 2010, notamment la série Cage, témoignent d’une maturité nouvelle.
Le titre renvoie au compositeur américain John Cage, dont Richter admirait la manière d’intégrer le hasard, le silence et l’imprévu dans la musique. Dans ces œuvres, le hasard intervient dans la superposition des couches, dans la manière dont la raclette révèle ou efface les couleurs, dans la vitesse du geste ou encore dans la résistance de la matière. Ces peintures créent des surfaces où la couleur vibre, glisse et se superpose de manière imprévisible. Elles ne représentent rien, mais donnent l’impression d’un espace autonome, presque musical, où l’œil se perd dans des profondeurs de matière.
September (2005) : une réponse sobre au traumatisme contemporain
Au cours de cette même décennie, Richter aborde un événement historique majeur : l’attentat du 11 septembre 2001. Dans l’œuvre September, réalisée en 2005, il choisit de ne pas représenter directement la violence ou la catastrophe. Au contraire, il adopte une grande retenue.

Gerhard Richter : September. 2005.
Le tableau montre deux formes verticales gris-bleu qui se détachent sur un fond marqué par des stries horizontales et verticales. Sans le titre, l’image pourrait sembler purement abstraite ; avec le titre, les deux formes deviennent immédiatement les tours du World Trade Center. Richter part d’une photographie, mais il efface presque tout ce qui s’y trouvait. Il recouvre l’image, il la racle, il la trouble, comme si la mémoire refusait de fixer l’instant exact.
Richter explique qu’il voulait éviter toute esthétique du spectaculaire. Il ne s’agit pas de représenter l’événement, mais de représenter ce qu’il en reste dans l’esprit : une image fragmentaire, floue, incertaine, trop fragile pour être saisie frontalement.
La série Birkenau (2014) : représenter l’irreprésentable
L’exposition se termine sur l’un des ensembles les plus puissants de l’œuvre de Richter : la série Birkenau, commencée en 2014. Elle est née de quatre photographies clandestines prises en 1944 par des prisonniers d’Auschwitz-Birkenau, montrant les meurtres en cours. Richter a d’abord tenté de peindre directement ces images. Mais très vite, il a recouvert les figures, puis entièrement effacé les scènes sous des couches successives de raclette : des gris, des rouges sombres, des verts toxiques, des noirs et des stries horizontales et verticales.

Gehrard Richter : Différents états de Birkenau, jusqu’au tableau final. 2014.
Les photographies sont présentes sous la surface, mais elles ne sont plus visibles. Ce geste n’équivaut pas à une destruction, mais à un refus de livrer ces images à la consommation visuelle. Richter protège ces photographies en les recouvrant. Il souligne l’impossibilité éthique de représenter l’horreur de manière frontale.
À travers Birkenau, Richter propose une mémoire voilée, mélancolique, presque musicale, où la peinture devient un lieu de deuil et de réflexion. C’est une manière de répondre, avec dignité, à la question de la représentation de la Shoah. Richter affirme d’ailleurs qu’il peut exister une poésie après Auschwitz, mais une poésie qui passe par la retenue et non par la reproduction de l’horreur.
Après la série Birkenau, qui affronte l’une des questions éthiques les plus vertigineuses de son œuvre, comment représenter ce que l’on ne peut ni montrer ni même regarder, Richter peint encore pendant quelques années. Et ce qui frappe, dans ses toutes dernières toiles avant 2017, c’est le contraste absolu avec la gravité de Birkenau.
En regardant ces ultimes peintures abstraites, on a le sentiment qu’une joie nouvelle s’est introduite dans son travail : un abandon plus libre au geste, des couleurs vives, une énergie presque jubilatoire. Après les couches lourdes, les strates sombres, les hésitations volontaires des décennies précédentes, ces œuvres semblent respirer autrement. Elles ne portent plus la même tension, comme si Richter se permettait enfin de peindre sans devoir répondre à une question historique, éthique ou conceptuelle.
Richter a toujours travaillé par groupes : il peignait intensément pendant plusieurs mois, puis s’arrêtait, attendait, observait, et revenait lorsque le désir revenait lui aussi. En 2017, après avoir terminé ce dernier groupe de peintures, il fait une pause comme à son habitude… mais cette fois, le désir ne revient pas. Il dit simplement : « Je n’ai plus le désir de peindre. »
Ce n’est pas un geste spectaculaire.
Ce n’est pas une déclaration programmatique.
Ce n’est pas “la fin de la peinture” comme certains artistes l’ont proclamée.
C’est un constat intime, presque calme :
quelque chose a changé. Il ne se reconnaît plus dans la nécessité de retourner vers la toile.
Et pourtant, ces dernières peintures ne ressemblent en rien à une fin.
Elles ont l’allure d’un grand geste final, mais un geste qui ne clôt rien.
Elles sont ouvertes, vibrantes, pleines.
C’est paradoxal : au moment où Richter cesse de peindre, ses tableaux semblent dire exactement le contraire : que la peinture continue, qu’elle déborde, qu’elle reste vivante.
Après 2017, bien que pas montré lors de l'exposition, il ne cesse pas de créer : il dessine quotidiennement, il produit des œuvres sur papier, des encres, des expériences avec le hasard, les solvants, les strates fines qu’il superpose comme des respirations. Comme si le passage au dessin, un médium qu’il n’avait jamais considéré comme central, lui offrait une légèreté nouvelle.
Pour conclure, cette rétrospective montre que Gerhard Richter n’a jamais été un artiste d’un seul langage. Pendant plus de soixante ans, il a exploré la figuration, l’abstraction, le verre, le numérique et même le dessin, sans jamais se laisser enfermer dans un style fixe. Ce qui l’intéresse avant tout, ce n’est pas la forme, mais la manière dont une image se construit, se transforme ou se dérobe.
Depuis ses premières photo-peintures jusqu’aux œuvres sur papier des dernières années, la même question revient : que voyons-nous vraiment quand nous regardons une image ? Et peut-on encore représenter la mémoire ou l’histoire dans un monde saturé de photographies ?
La photographie est au cœur de cette interrogation. Richter s’en sert en permanence, mais il s’en méfie. Pour lui, une photo n’est pas une vérité, mais un fragment, un filtre, déjà chargé d’interprétation. En peignant d’après des images de famille, des coupures de presse, des documents historiques ou des cartes postales d’œuvres célèbres, il ne cherche pas à les copier, mais à en montrer les limites. Le flou, les effacements, les recouvrements, le verre ou encore les images numériques servent à briser l’illusion d’une image transparente et à ralentir notre regard.
Son œuvre entretient ainsi un lien profond avec l’histoire de la photographie contemporaine. Elle en révèle les zones d’ombre et rappelle que la peinture, loin d’être dépassée, reste un moyen privilégié pour affronter ce que les images ne peuvent pas dire complètement : la violence, le deuil, mais aussi la douceur, la lumière et le simple plaisir de peindre.
Au fond, la leçon de Richter est peut-être celle-ci : toute image est fragile, toute mémoire est incertaine, mais l’art, lorsqu’il accepte cette fragilité, peut encore nous apprendre à regarder autrement.
Unika Perez, le 12/01/2026
___________________________________________________________________________________
Fondation Louis Vuitton
8 Avenue du Mahatma Gandhi
75116 Paris 16
Accès
1 station Les Sablons
Tarifs
Tarif - 3 ans : Gratuit
Tarif étudiant (jeudi uniquement) : Gratuit
Tarif - 18 ans : 5€
Tarif - 26 ans : 10€
Plein tarif : 16€
Site officiel
www.fondationlouisvuitton.fr
Réservations
www.fondationlouisvuitton.fr
02.01.2026 à 11:59
On aime #121
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1200 mots)

Louise Glück photographed early in her career as poet and educator. (Courtesy of the Library of Congress)
L'air du temps
Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - Se Você

L'éternel proverbe
La forêt est la pelisse du pauvre.
Proverbe estonien
Le haïku sur la tête
Un drapeau rouge
Dans une ruelle de Nara
Et la lune de jour.
Nakamura Teijo
Les mots qui nous parlent
Il est vrai qu’il n’y a pas assez de beauté dans le monde.
Il est vrai aussi qu’il n’est pas de ma compétence de lui en redonner.
Il n'y a pas non plus de sincérité et ici je peux être d'une certaine utilité.
Je suis
au travail, bien que silencieuse.
La fade
misère du monde
nous serre de chaque côté, comme une allée
bordée d’arbres ; nous sommes
ensemble ici, sans parler,
chacun dans ses pensées ;
derrière les arbres le fer forgé
des portails de maisons privées,
pièces aux volets fermés,
l’air désert, abandonné,
comme si l’artiste avait
le devoir de créer
de l’espoir, mais avec quoi ? avec quoi ?
le mot lui-même,
faux, un artifice pour réfuter
la perception – À l’intersection,
les lumières ornementales de la saison.
J’étais jeune alors. Voyageant
en métro avec mon petit livre
comme pour me défendre
contre ce même monde :
tu n’es pas seule,
disait le poème,
dans le sombre tunnel.
/
It is true there is not enough beauty in the world.
It is also true that I am not competent to restore it.
Neither is there candor, and here I may be of some use.
I am
at work, though I am silent.
The bland
misery of the world
bounds us on either side, an alley
lined with trees; we are
companions here, not speaking,
each with his own thoughts;
behind the trees, iron
gates of the private houses,
the shuttered rooms
somehow deserted, abandoned,
as though it were the artist’s
duty to create
hope, but out of what? what?
the word itself
false, a device to refute
perception-At the intersection,
ornamental lights of the season.
I was young here. Riding
the subway with my small book
as though to defend myself against
this same world:
you are not alone,
the poem said,
in the dark tunnel.
Louise Glück – Il est vrai qu’il n’y a pas assez de beauté dans le monde … – October (poem) – The New Yorker (28 October 2002) . Poème cité dans le livre de James Longenbach, La résistance à la poésie (Editions de Corlevour, 2013) Traduit de l’anglais 'États-Unis' par Claire Vajou

Louise Glück
19.12.2025 à 10:27
Avec Frank Zappa, les freaks sortent aussi la nuit - Part 1
L'Autre Quotidien

Texte intégral (2184 mots)
Le 27 juin 2026, Freak Out ! des Mothers of invention fêtera ses 60 ans. Collages sonores, improvisations inspirées, album-concept… il détonne toujours par son approche éclectique, gourmande et expérimentale de la musique, s'essayant à plusieurs genres et s'écartant des sentiers conventionnels du rock, du jazz ou du classique. L’album avait foiré aux Etats-Unis mais la Franck Zappa touch, leader du groupe, a conquis les jeunes Européens.

Une semaine après la sortie de Blonde on Blonde de Dylan, Freak Out ! des Mothers of Invention jaillit des boites à disques en juin 66, un double album fou, étrennant le premier concept-album, un an pile poil avant le « Sergent Pepper » des Beatles. Freak out !donc ou l’extravagance des grandes pendules de fête foraine, et leur loopings émotionnels. Dix années psyché suivraient. En chef de bande, Franck Zappa, avec son univers singulier et multiple, confluent toutes les recherches à venir, zigzagant entre soul, jazz, doo wop, blues, musique contemporaine et rock appuyés par un discours engagé sur la vacuité de la société de consommation américaine. Tout cela ciselé-emballé avec l’humour ultra-caustique d’un Zappa (1940-1993) synchro avec son époque. Entre avant-garde revendiquée et crétinisme de façade, Freak out ! constitue un chef d’œuvre qui a mis du temps à se faire reconnaître comme tel aux USA, mais a séduit plus vite les jeunesses européennes.
Si l’année 1966 marque le début de l’envoi massif de marines au Vietnam, après le rapatriement des derniers citoyens américains sur place et les premiers bombardements comptables en milliers de tonnes l’année précédente ; c’est parce que le Président démocrate Lyndon B. Johnson, en vieux routier des institutions a fait précédemment passer des lois sur l’abaissement des impôts pour les moins fortunés et le relèvement pour les autres, en vue de financer l’aide médicale, les programmes de développement scolaire, le droit de vote des Afro-américains, l’accès à la justice pour tous et organisé le budget de la guerre qui va aller s’amplifiant. En réponse à cela, la jeunesse des USA qui ne voit pas l’intérêt du conflit répond, à sa manière, avec la naissance des premières communautés hippies, les premières manifestations étudiantes massives contre la guerre : la conscription des classes moyennes appellent 30 000 hommes sous les drapeaux chaque mois. Des émeutes raciales, à Cleveland et Chicago, sont réprimées par la Garde Nationale, comme à Watts en 1965. Aux élections de mi-mandat, les Démocrates perdent une cinquantaine de sièges au Sénat et à la Chambre en réaction aux lois sur les droits civiques, les électeurs du Sud se tournant vers les Républicains. En octobre, naissance des Black Panthers et le 8 novembre, l’ex-acteur de série B, Ronald Reagan est élu gouverneur de Californie.
Le déclencheur de cette vague de fond se situe du côté du 2 mai 1965 lorsque l’administration Johnson, en rupture avec la politique de « bon voisinage » affirme que les « nations américaines ne peuvent, ni ne veulent, ni ne voudront autoriser l’établissement d’un autre gouvernement communiste dans l’hémisphère occidental » et engage les États-Unis dans la défense de « tous les pays libres » de la région. En 2026, Cuba est toujours sous embargo… Et la CIA, d’habitude peu apte à commenter les décisions présidentielles, critiquera très sévèrement l'opération qu'elle qualifiera de « gaspillage humain et financier sans précédent dans l'histoire des États-Unis. » Quelle ironie pour le bras armé international du complexe militaro-industriel !
« Quelle est l'agence bien connue de Dieu ?
Celle qui a pris son bâton et sa verge ?
Putain d'homme de la CIA !
L'homme de la CIA ! »
(The Fugs/ CIA Man 1965)
« Quand le rythme de la musique change, les murs de la ville tremblent », prophétisait Shakespeare. Et c’est à la fois de Californie, du Texas et de New-York que tous les signes ou plutôt les sons du grand chamboulement s’annoncent en 1965. Les Byrds en synthétisant l’approche électrique des Beatles et les textes folk de Dylan, envoient leur version en 4/4 du « Mister Tambourine Man », en lieu et place du 2/4 originel. Gros carton pour les Californiens qui vont faire virer Dylan électrique le printemps suivant à Newport – et le faire traiter de « renégat » par des barbus qui n’y entravent que pouic. À New-York, un groupe de poètes se baptise les Fugs (détournement du F.U.C.K. de Norman Mailer qui les saluera en les intégrant dans un autre roman ); c’est la naissance du premier groupe underground de l’histoire du rock avec humour acide, contestation pointue et comportement anar durable. Et, côté psychédélisme, c’est au Texas qu’on assiste à la rencontre inopinée, non loin d’une table de dissection, d’une cruche amplifiée et d’une guitare électrique au sein du 13th Floor Elevators qui conduira à la sortie en 1966 de The Psychedelic sounds, le prototype de l’album psyché qui influencera toute la scène californienne, balayant le folk et la country pour envoyer des soli de guitare dans les étoiles – et à la gueule de l’establishment. Mais le 13th Floor, après avoir écumé les scènes de San Francisco et infusé la philosophie orientale (mélangé au LSD), impressionnant tous les groupes locaux avec leur garage psyché, retournera tout piteux à Austin, avant de s’auto dissoudre par lassitude, après trois albums indispensables, poursuivi par la police locale, le chanteur Rocky Erickson se voyant même infliger des électrochocs. C’est sûrement ça la magie du Texas.
« Réverbération, réverbération
Vous voyez la réverbération
Dans votre dernière incarnation
Vous pensez que c'est une sensation
Mais ce n'est qu'une réverbération »
(13th Floor Elevators/ Reverberation)
Freak Out! ou comment combattre une Amérique au seul goût de Vache qui rit (Suzy Creamcheese what’s got into you ? )
Deux derniers détours, s’il vous plaît, car d’importance, avec le compositeur américain d’origine française Edgard Varèse (1883-1965) et le Velvet Underground.
Ainsi Zappa dans Stereo Review, (volume 26, n°6), juin 1971, qui célèbre le sixième anniversaire de la mort de Varèse, raconte sur une dizaine de pages, son « Edgard Varese : Idol of my youth », avec « reminiscence and appreciation » et dévotion.
« Le jour de mon quinzième anniversaire, ma mère m'a dit qu'elle m'offrirait 5 dollars, mais je lui ai répondu que je préférais passer un appel téléphonique longue distance. J'ai pensé que M. Varese vivait à New York parce que le disque avait été enregistré à New York (et parce qu'il était tellement bizarre qu'il vivrait à Greenwich Village). J'ai obtenu le numéro de New York Information, et bien sûr, il était dans l'annuaire.
C'est sa femme qui a répondu. Elle était très gentille et m'a dit qu'il était en Europe et qu'il fallait rappeler dans quelques semaines. C'est ce que j'ai fait. Je ne me souviens pas exactement de ce que je lui ai dit, mais c'était quelque chose comme : « J'aime beaucoup votre musique ». Il m'a dit qu'il travaillait sur une nouvelle pièce intitulée Déserts. Cela m'a beaucoup plu, car je vivais alors à Lancaster, en Californie. Lorsque vous avez quinze ans, que vous vivez dans le désert de Mojave et que vous apprenez que le plus grand compositeur du monde, quelque part dans un laboratoire secret de Greenwich Village, travaille à une chanson sur votre « ville natale », vous pouvez être très enthousiaste. Le fait que personne à Palmdale ou à Rosamond ne se soucie de l'entendre un jour m'a semblé être une grande tragédie. Je pense toujours que Déserts parle de Lancaster, même si les notes de pochette du disque Columbia disent qu'il s'agit de quelque chose de plus philosophique. »
Et le petit Franky conservera comme un fragment divin ionisé, le menu billet d’une conversation qui ne s’est jamais faite entre humains, mais par musiques interposées :
VII 12th/57
Dear Mr. ZappaI am sorry not to be able to grant your request. I am leavingfor Europe next week and will be gone until next spring. I amhoping however to see you on my return. With best wishes.Sincerely Edgard Varese
Ceci justifie les notes de pochette de Freak Out! qui paraphrasent le « Manifeste de 1921 » de Varese et son « Present Days Composers refuse to die /Les compositeurs contemporains refusent de disparaître. »
Second détour avant le feu d’artifice.
Hello la musique contemporaine, bonjour le Velvet Underground, fort de deux musiciens contemporains dans la première version du groupe : le percussionniste Angus McLise et le pianiste/violoniste John Cale. Tous deux sont issus du groupe de La Monte Young, le Theatre of Eternal Music; premier ensemble à développer l’usage du drone qui fera le bonheur de titres comme Heroïn ou du contenu du second album White light/ White Heat. Défini par Zappa comme « le meilleur groupe de folk urbain » de New-York, Frank s’arrangera quand même chez MGM pour avoir la primeur de la sortie d’album, évitant de se retrouver à lutter avec le seul autre groupe de rock vraiment barré du moment. Lou Reed, à son habitude, vociférera sur les magouilles de Zappa visant à éliminer la concurrence…
Des deux groupes, on dira qu’ils auront partagé le même producteur atypique Bob Wilson, l’un des rares afro-américain renommé de l’époque qui a travaillé juste avant à électrifier Dylan, ou produire aussi bien Simon & Garfunkel, Cecil Taylor que Sun Ra.
“Allez, Wall Street, faut pas traîner/
Cette guerre, c'est du gâteau/
Y a plein de fric à se faire
Pour équiper l'armée /
Faut juste espérer et prier que quand ils larguent les bombes/
Elles tombent bien sur le Vietcong”
Country Joe & the Fish / I Feel Like I’m Fixin to die rag
La suite - Avec Frank Zappa, les freaks sortent aussi la nuit - Part 2 - au prochain numéro
16.12.2025 à 11:43
L'art et le dilemme de la photographie de rue selon Jeff Schewe : la vérité dans la rue
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1846 mots)
Chaque portrait, demandé ou pris au passage, est un témoignage de la présence humaine, un instantané d'une histoire qui, sans cela, pourrait être oubliée.

En tant que photographe de rue, je suis attiré par l'énergie brute et spontanée des gens réels qui se déplacent dans des espaces réels. Les portraits de rue sont ma façon de documenter la vie telle qu'elle se déroule, et au fil des ans, j'ai appris que photographier avec ou sans permission entraînait des conséquences différentes. Lorsque je demande la permission, la dynamique change. Le sujet prend conscience de l'appareil photo et ajuste souvent sa posture, son expression ou son attitude. Dans ces moments-là, l'image devient une collaboration. Le portrait gagne en intimité et le sujet peut se sentir valorisé en participant au processus. Cet effort de coopération conduit souvent à des portraits riches en émotions et consciemment expressifs, même si cela se fait parfois au détriment de la spontanéité.
D'un autre côté, photographier sans permission préserve l'authenticité de la scène. La personne est simplement elle-même, inconsciente de l'objectif. Cette approche candide apporte une vérité documentaire à l'image : honnête, sans filtre et pleine de vie. Ces moments sont souvent les plus puissants, car ils ne sont pas mis en scène.

Je marche constamment sur la ligne entre le respect et l'impulsion artistique. En fin de compte, le portrait de rue est un exercice d'équilibre entre la connexion et l'observation. Que je m'engage avec mon sujet ou que je capture tranquillement le moment à distance, mon objectif reste le même : refléter l'esprit de la rue et la beauté du quotidien. Chaque portrait, demandé ou pris au passage, est un témoignage de la présence humaine, un instantané d'une histoire qui, sans cela, pourrait être oubliée.


Jeff Schewe est un photographe renommé et primé basé à Chicago, dans l'Illinois, qui compte près de 50 ans d'expérience dans la photographie commerciale et artistique. Après avoir suivi une formation de peintre, Schewe s'est tourné vers la photographie, apportant une sensibilité picturale à ses images et apportant une contribution significative à l'imagerie numérique et à l'impression artistique.
John Agfa le 16/12/2025
Jeff Schewe : la vérité dans la rue

- GÉNÉRALISTES
- Ballast
- Fakir
- Interstices
- Issues
- Korii
- Lava
- La revue des médias
- Time [Fr]
- Mouais
- Multitudes
- Positivr
- Regards
- Slate
- Smolny
- Socialter
- UPMagazine
- Le Zéphyr
- Idées ‧ Politique ‧ A à F
- Accattone
- À Contretemps
- Alter-éditions
- Contre-Attaque
- Contretemps
- CQFD
- Comptoir (Le)
- Déferlante (La)
- Esprit
- Frustration
- Idées ‧ Politique ‧ i à z
- L'Intimiste
- Jef Klak
- Lignes de Crêtes
- NonFiction
- Nouveaux Cahiers du Socialisme
- Période
- ARTS
- L'Autre Quotidien
- Villa Albertine
- THINK-TANKS
- Fondation Copernic
- Institut La Boétie
- Institut Rousseau
- TECH
- Dans les algorithmes
- Framablog
- Gigawatts.fr
- Goodtech.info
- Quadrature du Net
- INTERNATIONAL
- Alencontre
- Alterinfos
- AlterQuebec
- CETRI
- ESSF
- Inprecor
- Journal des Alternatives
- Guitinews
- MULTILINGUES
- Kedistan
- Quatrième Internationale
- Viewpoint Magazine
- +972 mag
- PODCASTS
- Arrêt sur Images
- Le Diplo
- LSD
- Thinkerview
